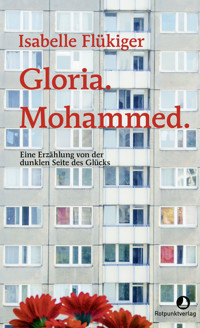Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Faim de siècle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Si vous croisez un chien qui pourrait être un ange, fuyez! Heureusement pour le lecteur, les deux amoureux au centre de cette histoire n’ont pas été prévenus et, tout occupés à construire leur carrière professionnelle, ils ne s’interrogent pas sur l’identité du chien errant qui fait irruption dans leur vie. Dans ce conte tendre et lumineux, Isabelle Flükiger décrit quelques semaines de l’existence d’un jeune couple, qu’elle dissèque d’une plume toujours aussi incisive. Ses deux héros vont découvrir que l’égalité est un leurre, la méritocratie une fiction et, surtout, que la chance est bête à manger des croquettes.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née en 1979,
Isabelle Flükiger a suivi des études en science politique à l’Université de Fribourg. En 2003, elle se fait remarquer avec son premier roman
Du Ciel au ventre, où une jeune femme fuit l’ennui de sa vie en se lançant dans une course à l’extase et aux paradis artificiels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Best-Seller
Isabelle Flükiger
Roman
Éditions Faim de Siècle
La publication de ce livre a bénéficié du soutien du
Service de la culture du canton de Fribourg
L’auteure remercie Pro Helvetia pour la bourse littéraire 2008 qui lui a permis de mener à bien ce projet.
Table des matières
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FIN
Lecture similaire
1.
J’étais en train d’écrire mon best-seller quand Simona est venue m’interrompre. Il s’agissait d’aller manger dehors. J’ai dit non. C’est facile d’aller manger dehors. On va manger dehors, et on parle et parle et parle, et finalement on n’écrit pas.
Quelques heures plus tard, j’étais en train de fumer une clope sous la pluie. Autour de moi, tous les fumeurs fumaient, et les non-fumeurs non. On avait tous un verre à la main. Je ne pensais pas à mon best-seller, parce que j’étais occupée à parler parler et parler. Simona était déjà rentrée et toutes les heures, je me disais qu’il était l’heure. Mais je restais figée là, mon verre dans la main… Mon aimé bien-aimé dormait là-bas de son sommeil précieux, des volutes de fumée montaient en nappes grises vers les cieux; le ciel d’ailleurs n’était rien. Ni noir, ni gris, ni étoilé. Il n’y avait pour le rejoindre que cette nappe grise et des paroles des paroles.
C’est bien ce soir-là, sous la pluie avec les fumeurs qui fumaient et les non-fumeurs non, que tout a commencé. Un type me bouscule. Il est saoul. Il crie: «Gabriel!» Il court; déjà il est loin. Je continue de parler avec les fumeurs et les autres, on s’enivre vaguement. Plus tard, je pose enfin mon verre sur une table; je m’en vais sous la pluie toute nue et grêle.
Je suis déjà près de chez moi lorsque je le vois accroupi contre un lampadaire. Il est tout mouillé et des perles jaunes tombent des mèches de sa frange. Il me regarde. Le silence est si mouillé, si doux et clapotant et le lampadaire lui fait tomber du jaune des cheveux… Tout cela est si gentil que je m’arrête.
Je dis: «Ça va?» On ne perd jamais rien à s’enquérir du bien-être des gens, n’est-ce pas. Il dit: «J’ai perdu Gabriel. Je sais pas, il est allé se cacher…» Il montre vaguement l’ombre au-delà de la ruelle et du lampadaire. Je dis: «Il va revenir, non?» Le type hausse les épaules. Je dis: «Vous n’avez pas froid?
–Un peu. Mais je préfère attendre. On sait jamais, si l’idée lui venait de revenir…
–Vous vous êtes disputés?» je demande à tout hasard, polie, mais déjà je commence à me les geler et je m’éloigne de lui…
«Ah non, non…» Il soupire, tout luisant de pluie, comme graissé d’humidité: «Ce qui s’est passé, c’est que ma copine m’a viré de chez moi, et je suis allé boire des verres avec Gabriel. Et quand je lui ai dit qu’on dormirait sûrement dehors, il est parti.»
Il recommence à pleuvoir serré au-dessus du lampadaire; je me dis: «Encore un paumé.» Voilà comme je le pense, parfaitement. Je propose: «Allez à l’hôtel, une ou deux nuits, ça dépanne…» Le type ne me répond pas. Il scrute l’ombre. Ça clapote vraiment ramassé maintenant, avec ce bruit dense de coups de pluie frappés sur les feuilles et les gouttières. Je n’insiste pas; je fais à reculons: «Courage, en tout cas…» Il ne me regarde toujours pas, les yeux dans l’ombre et tout plongé dans les bruits de pluie, de terre qui éponge et de branches qui craquent.
N’importe, moi j’habite juste en dessus, et une minute trente secondes plus tard, je suis chez moi.
J’enlève mes chaussures humides. Je vais à la salle de bains. Je prends une serviette de bain et je m’essuie les cheveux. Finalement, le linge de bain autour de la tête, j’entre dans la chambre à coucher où le sommeil du précieux se poursuit. Je m’approche de la fenêtre, je regarde dehors. Là-bas, contre le lampadaire, le type attend toujours. «Il doit l’aimer son Gabriel», je me dis. Je m’éloigne de la fenêtre, je me déshabille, j’enfile un t-shirt, je retourne à la salle de bains où je remets la serviette de bain à sa place; je me lave les dents, je ne pense à rien, je me rince la bouche, je sors de la salle de bains… Et je retourne à la fenêtre.
Oui, il l’attend toujours. Il pleut une pluie drue de début d’été, les bruits sont jolis et les températures fraîches. Il est là sous la pluie, dans le froid. De loin, on ne voit pas que le lampadaire lui fait des perles jaunes dans les cheveux. De loin, tout ce qu’on voit, c’est cette attente glacée sous la pluie. J’ai envie de lui dire que son Gabriel est un gros connard et qu’il devrait aller dormir. Mais ça réveillerait le précieux qui dort. Alors je m’assieds sur une chaise, et pendant très longtemps, je le regarde attendre son Gabriel sous la pluie.
«Peut-être qu’ils sont homos et la copine les a découverts? Elle les a virés, mais Gabriel, qui couchait avec lui juste pour profiter de l’appartement, s’est tiré quand il a vu qu’il n’y avait plus aucun avantage à en tirer… Y a vraiment des salauds.»
Bien plus tard, lassée des jolis bruits de pluie et de la masse immobile là-bas, je vais me coucher. Décidément, il ne bougera pas.
Matin: soleil ambré par les rideaux. Je saute du lit et je vais voir à la fenêtre. Mais il n’est plus là. Le précieux d’amour est levé lui aussi (c’est-à-dire: ainsi que le soleil mon précieux d’amour s’est levé). Je sors de la chambre à coucher. Je dis: «Salut.
–Salut.» Il est assis à la table de la cuisine, une pile de feuilles A4 devant lui. Je dis:
«Ça avance?
–Ça va…» Il me regarde: «Mais t’es jôôlie!» qu’il s’exclame en souriant. «Et tes petits pieds roses, ils vont comment?» Je lui montre les objets en question. On commente; on passe à autre chose. C’était pour dire qu’on s’aime, en somme. Il retourne à ses corrections; je retourne à mon week-end.
Il est professeur de littérature française et de latin; je suis secrétaire administrative pour une institution culturelle étatique. Ben oui, c’était la crise. On a fait des études de lettres comme tout le monde; maintenant on travaille comme tout le monde. On s’aime comme les jeunes couples à cet âge; plus tard on aura des enfants. On est tout tracés.
C’est pour ça que pendant qu’il fait ses corrections, je retourne à mon best-seller. Oui, parce qu’on serait moins tout tracés si la gloire se présentait. On graisserait moins la machine qu’elle nous graisserait, si vous voyez l’inversion. Et puis, il faut bien y croire, non? parce que secrétaire administrative, ça ne prend pas toute ma tête, et vu que je ne vais pas avancer beaucoup plus dans la vie et que, quoi qu’il advienne, je serai toujours avec lui parmi les sous-fifrelets qui chantent la chanson attendue, eh bien… J’espère en attendant, et l’espoir rend grand.
Voilà pourquoi chaque jour je rédige quelques lignes, quelques paragraphes de ma grande idée; le roman que chacun aimera lire, vous verrez. Le top du top des ventes de l’an X à venir, le top du top de la littérature mondiale… Je travaille ardemment à nous dé-menufretiniser; c’est la grande chose, de celles qui nourrissent les rêveries et font le quotidien plus ardent. De celles qui font absolument libres, bien plus hauts, à vol d’oiseau par-dessus le déterminisme tuant et les formes d’impuissance, infiniment diverses, qu’on entraîne dès le berceau.
Une fois douchée, je m’assieds donc à ma table de travail et je reprends l’idée.
Cherchant à l’intérieur de mon esprit dense et profond l’idéale phrase, je regarde par la fenêtre le rien qui se déploie. Je pense.
Et voilà que surgit dans mon champ de vision un truc blanc et noir qui frétille. Je me lève. Le truc qui frétille a disparu. J’ouvre la fenêtre, la curiosité occultant l’entier de mon esprit précédemment dense et profond. Je me penche sur le rebord de fenêtre. Là, un étage au-dessous, me regarde (et sa queue tape le gazon avec une énergie débordante) un petit chien blanc tout excité, les oreilles fixées droit dans le prolongement du crâne et l’œil droit calé dans une tache noire comme sa truffe. Il est à bouffer et il a l’air content de me voir. Je dis: «Mais salut…!»
Le chien me regarde, la langue dehors, la queue tape de gauche à droite avec un enthousiasme redoublé et sa tête se penche d’un air interrogatif. Je répète: «Maaaais sssalut…!»
Lui, à la cuisine, il dit: «Hein?» Je dis: «Y a un chien dans le jardin!» Pas de réaction. Le chien et moi on continue de se regarder; lui la tête très penchée, l’air d’attendre la suite… Je dis encore: «Salut le chien!!» Il penche la tête de l’autre côté, un début de perplexité dans l’orientation des oreilles. Il tourne la tête et regarde derrière lui. J’ai peur qu’à trop le faire attendre, il s’en aille; je dis: «Attends, le chien! J’arrive!» et je sors en courant de la pièce. J’enfile dans le couloir une paire de pompes pendant qu’il dit: «Tu fais quoi ma poupoune?
–Je vais dire salut au chien!»
Mais oui c’est un chienchien! Oh mais qu’il est câlin, mais qu’il est doux! et ça te frétille sur les genoux, et ça te léchouille les joues, et que c’est tout baveux et très heureux de te voir! Il courote d’un bout à l’autre de ma personne, les oreilles soulevées d’enthousiasme, la queue ne sait plus quoi faire de joie et tape tout ce qu’elle peut. Le bout de ses pattes est brun, comme s’il portait des chaussons, le bout de sa queue pareil, et ce n’est pas du noir mais du brun qui lui cerne l’œil et lui donne son air coquin. C’est un petit chien tout propre et qui sent bon et une fois qu’on s’est dit salut de toutes les possibles manières à ne plus savoir comment le dire encore, mon esprit dense et profond reprend le dessus. Je me dis alors: «Mais à qui est donc ce chienchien-là?» Le précieux, du rebord de la fenêtre, me crie: «Il est à qui?» Je lève la tête, je le vois qui nous regarde le chien et moi, en souriant. Je réponds: «Tu veux pas descendre?
–Je veux finir la pile; ça va trop me distraire, si je descends… Il est à qui?
–Attends, je regarde…»
Je prends donc le chien près de moi, petit léchouillage de poignet pendant que j’essaie de lire ce qui est écrit sur son collier. Il gigote, il est content, et sur son collier il est écrit: «Je m’appelle Gabriel».
Je vous le dis à vous: ça me fait un choc. A mon précieux, toujours accoudé sur son rebord de fenêtre, je crie: «C’est écrit: «Je m’appelle Gabriel».
–C’est tout?
–Ben oui.
–Mais regarde bien, y a aucun numéro de téléphone? Pas d’adresse?»
Je farfouille mieux le pourtour du collier, je tâte pour voir s’il n’y aurait pas plusieurs couches, un billet calé sous un morceau plastifié; j’observe le «Je m’appelle Gabriel», à l’arrière du collier, en profondeur, en transparence. Enfin quoi, je regarde bien partout. Le chien se laisse faire à présent; il regarde le jardin d’un air approbateur (approbateur, parfaitement) et ne bouge plus. Finalement, je crie vers le rebord de fenêtre: «Non, y a rien d’autre…
–Mmh. C’est bizarre, ça, non?
–Oui.» Je grattouille le crâne du chien en regardant là-haut mon précieux qui maintenant regarde lui aussi le rien se déployer au-delà du jardin. Je dis: «On fait quoi?
–Je sais pas.» Cependant que je grattouille le chien, les battements de mon cœur continuent de taper sourds et mats contre mes côtes. Je le revois bien, le type d’hier qui attendait son Gabriel. Monsieur Gabriel, le salaud qui n’aime pas dormir dehors… Ça doit être ce petit chienchien d’amour et son air coquin. Quand on a un collier avec «Je m’appelle Gabriel» écrit dessus, bien sûr que personne ne va penser à vous appeler autrement, même si vous êtes tout poilu et que vous ne mesurez pas plus de 50 centimètres de haut.
Je réfléchis tout haut: «On devrait mettre des billets dans la rue, pour prévenir.
–Il faudra le nourrir, en attendant…
–Oui.
–Il fait assez chaud maintenant, on peut le laisser dans le jardin…» Le chien penche sa tête et me regarde, soulevant un tantinet l’oreille, genre haussement de sourcil. Je dis: «Tu crois? Les voisins ne vont pas beaucoup aimer, d’avoir des crottes de chien partout dans le jardin…
–Mmh.» Silence. On regarde tous les deux vers le rien. Puis il sursaute: «Mais non! On devra les ramasser, ses crottes! Comme ils font les gens, tu sais…» On fait tous les deux la grimace. Je dis: «Et ce sera tout tiède dans la main…
–Espérons qu’il n’aura pas la diarrhée…» On a tous les deux la bouche tordue de dégoût. Je me relève et conclus: «On mettra des billets dans la rue, et en attendant on le laissera dans le jardin. C’est pas notre chien, quand même…» Non mais. Je ne vais pas passer des plombes sous une pluie battante pour un petit machin poilu qui chie à tort et à travers, moi…
Le chien m’observe, la tête penchée et l’oreille supérieure haut dressée. Il est si mignon que je dis: «C’est pas grave que tu fasses caca, tu sais. Je vais quand même te donner à manger…»
Je retourne à l’intérieur et farfouille dans le frigo. Les chiens étant tendanciellement carnivores, je mélange les pommes de terre d’hier à un peu de la viande hachée que le précieux va cuisiner à midi. Cela fait, je redescends l’escalier, très contente de moi et je pose son assiette nourrissante devant le chien. Mais celui-ci, après une brève reniflade, fait une moue dédaigneuse de l’oreille et de la truffe. Il s’éloigne du plat, s’assied et se léchouille la patte avant en observant de temps en temps le jardin devant lui d’un air de parfaite distinction. Je dis: «Ben si t’as pas faim, c’est pas mes oignons.» Je laisse l’assiette où elle est; fâchée, je remonte l’escalier. L’escalier monté, réinstallée devant mon ordinateur, je rédige un avis de découverte que je vais ensuite scotcher dans tout le quartier.
Je devrais avoir la conscience tranquille, non? Et pourtant, mon cœur d’or (vous l’admettrez) s’est progressivement serré et serré la journée avançant. C’est que l’assiette du chien était pleine de tous les insectes du jardin, et qu’il restait, lui, couché dans l’herbe, la tête sur les pattes, sans un mouvement. Le ventre certainement creux, de plus en plus creux. J’ai juré entre mes dents: «Merde.» Les magasins fermaient dans une demi-heure.
J’ai pris mon sac à main et remis mes chaussures; d’un pas ardent, lancée sur les braises de la culpabilité, j’ai couru le long du petit sentier, j’ai traversé ruelles, routes et chemins pour parvenir enfin, le cœur battant, l’âme presqu’en paix, dans le supermarché au rayon «nourriture canine».
Mais faudrait-il plutôt de l’énergie? Une bonne digestion? Aimait-il le poisson ou le lapin? Et s’il préférait le porc? Avec légumes ou sans? Pour jeune chien? Quel âge pouvait-il bien avoir?
J’hésitais, perplexités farouches. Je me recule, je m’avance, enfin je m’agenouille vers le domaine «bon pour les dents», quand soudain, quelqu’un me percute violemment et tombe sur moi qui tombe par terre…
«Oh pardon pardon…» Je l’entends être désolé alors que je suis encore échouée au sol; il ramasse mon sac et me tend la main. Je le reconnais une fois debout; je dis: «Tiens, salut Saïd…»
Il me regarde un quart de seconde d’un air penché, puis sursaute: «Mais c’est toi?
–Mmh…» Je m’époussette les genoux. Il rigole. «Ah, si je n’ai pas tombé dessus, j’aurais plus reconnu! Tes cheveux sont longs!» Je me touche les cheveux, je dis en regardant ma main toute sale: «Oui, je les ai laissés pousser.
–Très joli, très féminin. Pour une fille, plus joli quand même!» Il sourit comme s’il était content pour moi. Je souris aussi. Ça fait plaisir, même si c’est un faux compliment pour une femme libérée, n’est-ce pas… Il insiste: «Ça te change beaucoup!» Tout comme si j’étais passée de grenouille à fille. Je propose plutôt: «Ça va?» Saïd a 40 ans, une belle gueule cabossée, et ma nouvelle proposition thématique le fait se renfrogner: «Non, ça va pas du tout.» Il a des problèmes de santé et il va se faire virer de son studio à la fin du mois.
Je l’ai lancé; il ne s’arrête plus. De temps en temps, pendant qu’il parle, je jette un œil du côté boîtes pour chien; bientôt je n’aurai plus le temps de choisir. Il me raconte des choses de plus en plus terribles, les tortures subies, les problèmes dorsaux. Et compromet un peu plus ma fuite à chaque détail horrifiant… Parfois je ne comprends pas ce qu’il dit, mais j’opine du chef, le regard aimanté vers la bouffe pour chien. «Le porc, c’est une valeur sûre. Ou le bœuf. Non, non. Il avait pas l’air d’aimer la viande hachée… Oui, le porc. Mais l’âge? Des petits légumes? Et surtout ne pas oublier le pain… Le riz…»
Saïd fait partie d’un groupe de musique traditionnelle kurde; c’est important pour… Cette fois c’en est trop! «Ecoute, il faut vraiment que je choisisse… une boîte pour mon chien. Ça va bientôt fermer, et j’ai pas… Enfin, tu comprends.» Ah, ce visage triste! Il dit en souriant, triste et seul qui a besoin de bavarder: «On pourrait aller boire un verre?
–J’ai pas le temps, je dois y aller… Une autre fois avec plaisir, vraiment.» Je souris fort avec toute l’hypocrisie disponible. Il me fait la bise; il s’éloigne. J’essaie de me concentrer. Je me sens coupable. Je prends le porc pour petit chien, et puis les croquettes. Les lumières clignotent; ça y est, le magasin est complètement vide. Je vais à la caisse, incertaine de mon choix, avec le sentiment d’avoir oublié quelque chose et en tête cette nouvelle culpabilité: des gens qui se font torturer, qui te parlent dix minutes par année, et toi tu ne penses qu’à te laisser bouffer par la société de consommation et ses mille choix. On veut nous manger la tête en nous proposant trois mille variantes de la même connerie, et… ça marche.
D’ailleurs… N’aurais-je pas dû prendre plutôt le lapin pour chien adulte? Ça avait l’air plus gourmet… Et là je m’arrête, figée d’exaspération sur le trottoir: j’ai oublié le pain. Il pouvait pas tomber ailleurs? Qu’est-ce qu’on en a à foutre, de ses histoires, hein?! Je suis pas son amie! J’en ai rien à foutre!!!
Et je remonte les routes et ruelles et chemins en martelant le béton d’une semelle irritée, mon petit cornet au bout du bras, soliloquant d’exaspération et bien coupable quand même.
«Mais oui c’est bon le cochon! Dans le cochon y a tout qui est bon…» Je remplis son assiette avec un enthousiasme feint. Les narines de Gabriel palpitent; il s’approche puis me regarde avec tristesse et s’éloigne, la queue entre les jambes. Moi-même j’en boufferais pas une bouchée de ce truc qui pue à 100 mètres. Mais c’est un chien. «Faut te recontextualiser mon vieux! Les chiens ça mange des restes et des boîtes qui puent, et c’est content! Si t’es pas content…» Je ne termine pas. Gabriel, la tête penchée, m’observe. On lui donnerait des steaks sans hésiter… Mais que ce soit tellement plus facile de plaindre un chienchien qu’un homme qui souffre, c’est dégueulasse, voilà ce que je me dis en remontant d’un pas martial furieux les escaliers de la maison. J’ai en tête le visage triste de Saïd et mon impatience, sa solitude rejetée pour une conserve à 5 francs dont personne ne veut. Je décide de ne plus m’occuper du chien.
Ce soir-là pourtant, mon précieux, divin cuisinier apte à apprêter n’importe quel mets à vous en faire saliver, avait préparé d’énormes gambas; à peine saisies et relevées d’un tantinet de citron, des délices au palais. Nous en avions mangé énormément; les doigts et les lèvres luisants, rassasiés, nous ne parlions plus et nous nous contemplions réciproquement avec amour.
Trois gambas cependant observaient ce manège. Roses et placides, elles attendaient.
«Tu peux y aller, moi je vais sûrement mourir si j’en mange encore», dis-je gracieusement.
«J’en peux plus, j’ai l’impression que ma panse va rester sur la chaise si j’essaie de me lever», rétorque-t-il.
Nous sourions, immobiles.
J’allume une cigarette.
Il boit une gorgée de vin blanc.
C’est un beau week-end.
Les gambas attendent.
Je les ai amenées à Gabriel. Il les a mangées, laissant sur l’assiette la tête et le bout de la queue. Il a l’air heureux. Il nous gratifie d’un ouaf ouaf élogieux et sa queue bat dans tous les sens.
La cuisine rangée, on observe le chien depuis le rebord de la fenêtre, côte à côte. Il a sa petite tête levée et il est si mignon de joie. Je dis: «On n’a qu’à lui laisser un petit peu de ce qu’on mange pour agrémenter ses menus.
–Bonne idée.» On regarde encore un moment le rien qui se déploie au-delà de notre jardin. On s’aime et quand la nuit tombe, les étoiles scintillent et la lune est toute nue. Des brises d’été nous amènent des parfums de fleurs, les feuilles des arbres se frottent doucement les unes aux autres; sur le balcon, nous sentons avec émoi que le monde existe et qu’il nous veut du bien.
On est heureux; on parle bas dans la tiédeur parfumée du soir; on est heureux.
2.
Il est un pays où rien ne se passe. Il est un lieu de calme plat, de rapports cordiaux, une réalité qu’on défend en tremblant parce qu’on craint l’irruption de la misère, la violence, et ces mille choses qu’on souhaite surtout ne jamais connaître.
On s’occupe à s’aimer, à procréer, et puis à brasser les problèmes qui nous viennent d’ailleurs. Il s’agit de gérer l’extérieur, explosif. Il faut le désamorcer. On a peur. L’Eden est plein de terreurs.