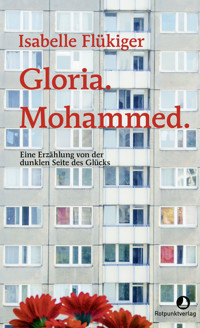Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Faim de siècle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Six ans après son très remarqué
Best-Seller (2011), qui a également été traduit en allemand et édité chez Rotpunkt Verlag, Isabelle Flükiger publie son cinquième roman, le deuxième chez Faim de Siècle. Dans ce roman elle part sur les traces de sa mère, à Bucarest. Accompagnée de cette dernière, elle découvre le pays d’origine de la branche maternelle de sa famille, pays dont elle n’avait qu’un vague souvenir d’enfance. À travers ce voyage se déploie toute la vie de sa mère et de ses ancêtres: on plonge au cœur de la Roumanie de Ceaucescu, mais on explore surtout le destin des juifs roumains, dont sa mère a fait partie. Isabelle Flükiger raconte aussi ses grands-parents, qui choisirent finalement de s’exiler vers Israël. C’est toute une histoire familiale qui se révèle dans ce texte où l’auteur se dévoile plus que jamais. Retour dans l’Est est une magnifique saga familiale et un livre superbe qu’une fille offre à sa mère. L’ouvrage est porté par la précision de la langue d’Isabelle Flükiger et par ce ton inimitable qui a fait son succès.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Née en 1979,
Isabelle Flükiger a suivi des études en science politique à l’Université de Fribourg. En 2003, elle se fait remarquer avec son premier roman
Du Ciel au ventre, où une jeune femme fuit l’ennui de sa vie en se lançant dans une course à l’extase et aux paradis artificiels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Retour dans l’Est
Isabelle Flükiger
Roman
Faim de Siècle
Ce livre a bénéficié du soutien de:
Service de la culture du canton de Fribourg
L’auteure remercie Pro Helvetia, dont la Bourse littéraire, octroyée en 2013, lui a permis de mener ce projet à terme.
Table des matières
Premier jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Deuxième jour
1.
2.
Troisième jour
1.
2.
3.
4.
Quatrième jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cinquième jour
1.
2.
3.
4.
Sixième jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Septième jour
1.
2.
3
4.
5.
6.
Lecture similaire
1.
Je m’appelle Isabelle et j’ai peur de l’avion.
J’ai peur, j’ai peur!
Je suis dans l’avion qui va en Roumanie et une petite fille me traite de grand-mère en roumain. Je lui dis que c’est elle la grand-mère. «Tu bunica» que je lui dis. Ça la fait rigoler, alors pendant tout le trajet on s’envoie des grands-mères parmi. Bien sûr, je ne sais pas le roumain et c’est ma mère qui fait toute la traduction. Mais à force de se traiter de grand-mère, l’avion a presque terminé sa course.
Si je m’appelle Isabelle, c’est d’après Isaac et Bella, qui sont mes arrière-grands-parents maternels. Mais je suis aussi Marianne parce que mon père est Suisse allemand. Je suis baptisée protestante mais ma mère est juive. On ne trouve pas ça très important, c’est pourquoi j’ai suivi l’enseignement catholique comme mes petits camarades de classe.
Vous pensez qu’il s’agit là d’un bon mélange, que j’ai sans doute une culture mixte? Détrompez-vous. J’ai la culture d’une école romande, d’un petit village de Suisse. J’ai appris, comme tous les Romands de ma génération: «Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Offizier.» Mais pas beaucoup plus. J’ai aussi été un peu élevée par la comtesse de Ségur, puis par Balzac. Avec mon copain Florian, on rêvait de partir du bled et on se racontait des histoires incroyables en regardant passer les nuages. On a continué toute notre adolescence, en mangeant des chips Zweifel au paprika sur des toits de garages, puis en se saoulant au gin tonic dans la rumeur du soir de la forêt voisine. Toute l’enfance et l’adolescence se sont nourries de rêves de départ, de visions de grandeur. En attendant, on regardait les nuages, et l’été, on descendait la rivière jusqu’au bas du village, où on se baignait tout habillés dans la fontaine du terrain de foot.
C’était un village trop petit pour nos grands rêves et toutes nos ambitions. J’ai vécu à Berlin quelque temps mais mes amis, ma famille et ma culture sont ici, disséminés en Romandie. Maintenant, pour rester près d’eux, j’habite à Fribourg –petite ville de 35000 habitants. Le royaume de l’amour est tout circonscrit.
Pourtant, que de mouvements dans mon sang! Que de pays, de voyages et combien d’amours pour en arriver à cela, cette petite personne au royaume de la taille d’un réduit!
Et c’est bien pour ça que me voilà dans cet avion tout blanc qui, de l’extérieur, doit scintiller sur le ciel si bleu, et que j’en suis maintenant à transpirer comme une oie parce qu’il descend sur ce qui semble être un grand champ de terre noire. Je dis: «Il fait quoi? C’est pas un aéroport, ça!» en serrant le bras de ma mère… Mais elle ne m’entend pas; tandis que l’avion semble tanguer sur ce foutu champ noir, elle est tout occupée à causer avec la mère de la petite fille. Personne ne regarde dehors; je suis seule à voir le sol qui se rapproche, et l’heure de notre mort. Je continue de couiner, en jetant des coups d’œil transpirés sur les autres passagers qui bouclent leur ceinture et regardent devant eux d’un air vide. Seule la petite fille fait attention à moi; elle a calé sa tête entre deux sièges pour me tirer la langue. La terre tangue encore un coup. J’aperçois un trait de goudron, des bâtiments. Un début de ville… On est maintenant très bas, et je vois passer la tour de contrôle… Je continue quand même de suer tout en couinant, parce que, quoi qu’il advienne –aéroport ou pas, en vol ou au sol– j’ai peur de l’avion.
Nous voilà donc à Bucarest, un jour de juin grisaillant. C’est un voyage mère-fille dans la terre d’origine de la mère, terre qu’elle a reniée, mais dont elle garde un accent plein de «r» roulés qui la complexent, et que je n’entends pas, et tous ses souvenirs d’enfance. Ma mère a passé maintenant bien plus d’années dans ce petit village de Suisse romande que dans sa Bucarest natale, et elle déteste qu’on lui demande d’où elle vient. Elle aimerait dire qu’elle vient d’ici, à force, mais c’est irrémédiable: elle vient d’ailleurs, c’est comme ça. Et même si, comme beaucoup d’immigrés, elle est plus patriote que ceux du cru, elle reste marquée par la provenance, et les odeurs, et tout ce qu’elle a appris là-bas, année après année jusqu’à ce qu’elle s’en aille.
C’est sans doute pour ça que j’ai voulu ce voyage: parce que cet accent qui roule les «r» et cette altérité font partie de moi et me constituent. Ils sont la musique de mon enfance; c’est eux qui m’ont guidée vers l’âge adulte, et pourtant, je ne les perçois pas. Je ne sais pas à quoi ressemble cet accent, j’ignore de quoi est faite cette altérité. Alors j’ai dit à ma mère: «Il faut qu’on aille à Bucarest.» Elle a refusé. Elle a dit: «Qu’est-ce que tu veux qu’on aille faire là-bas? Allons plutôt en Italie».
C’était au téléphone un jour de printemps de l’année 2011; ça faisait plus de 10 ans que je n’étais plus partie en vacances avec elle. Alors quand j’ai sorti l’argument imparable, quand j’ai dit: «C’est pour un livre, maman», elle a eu un moment de doute. C’est clair, l’affaire avait sauté dans le sac. Ma mère allait bien se sacrifier, si passer des vacances avec son enfant pouvait servir ses projets littéraires. Alors on a réservé le vol et l’hôtel; j’ai pris mon ordinateur portable et quelques bouquins. J’ai fait pour elle la liste des choses dont elle ne devait pas me parler –ces choses qui obsèdent les mères, vous savez, comme la cigarette et votre heure de coucher– et puis on est parties. On a pris le train, on est entrées dans l’avion, et tandis qu’il décollait, je souriais jaune à une petite fille qui ne voyait pas ma peur…
Tout ça, parce qu’à travers moi, sans cesse revient cet hier qui fut le présent des générations d’avant.
Tout ça, parce qu’à travers moi, hier n’arrête pas de passer.
Premier jour
1.
Je n’ai pas pris de livre ni étudié quoi que ce soit sur la ville; je suis vierge de toute idée sur ce qu’on va voir. Après tout, me voilà en compagnie d’une fille d’ici, c’est à Bucarest que ma mère a grandi, elle connaît les lieux, les usages, elle a passé sa jeunesse à arpenter ces rues… Bref, je suis convaincue qu’elle connaît cette ville sur le bout de ses dix doigts et que j’aurai digéré tout ça en moins de deux.
Pour notre première journée, ma mère a décidé de me montrer l’université où elle a étudié.
«On va voir l’université», me dit-elle en buvant le café du matin.
–Cool», dis-je en tartinant un croissant.
C’était le communisme; les gens laissaient tout en plan pour se précipiter dans les magasins quand ils entendaient parler d’un arrivage, quelle que soit la marchandise. Le bitume était de si mauvaise qualité qu’il fondait en été et se craquelait l’hiver. Mais elle était jeune; elle avait des copines avec lesquelles elle devait glousser bêtement, comme on fait à 20 ans et ses minijupes étaient bien plus courtes que celles que j’oserais porter aujourd’hui. C’était le communisme, mais c’est là où on est jeune qu’éclosent les fous rires et les espoirs fous. C’est la jeunesse qui est l’âge d’or de la vie, et ça reste vrai même quand cette jeunesse se vit derrière un rideau de fer. C’est ce qu’on se dit, n’est-ce pas, quand on va voir l’université où a étudié sa maman née chez les communistes. Des choses poétiques, on se dit.
Nous sommes donc pleines d’allant pour nous mettre en route. Notre hôtel se trouve près d’une artère centrale et, pendant les dix premières minutes de marche, on ne voit partout que chantiers et travaux. Bucarest est une ville qui se retape. Certains morceaux, bouts de rue, ont déjà repris leur ancien aspect; les façades XIXe sont flambant neuves. On sent comme ça toute une fièvre; sur les échafaudages là-haut, des marteaux cognent, les voix claires des ouvriers s’appellent d’un étage à l’autre; de temps en temps, c’est un marteau-piqueur qui assourdit toute la rue et qu’on fuit à grands pas. La capitale est affairée; elle a hâte de renouer avec le temps d’avant les dictatures…
À un moment donné, on bifurque à droite, puis à gauche, et ma mère dit:
«Voilà, c’est là que j’ai étudié.»
Je lève la tête. C’est un bâtiment gris avec beaucoup de murs et de fenêtres –assez grand, quoi. Je dis: «Ah». Elle fait: «On rentre?
–OK.»
Elle pousse une haute porte à deux battants: «Viens, on va voir la Faculté des lettres…» Je la suis, toujours avec allant. On monte un escalier, et puis un autre; on se retrouve dans un couloir jaune, sous un néon blafard qui éclaire les murs et du vieux lino. Je dis:
«C’est là?
–Je crois…»
On fait un aller jusqu’au fond du couloir, puis un retour… C’est les vacances universitaires; les étudiants ont déserté et on est les seules à traîner ici. On prend notre temps pour regarder à gauche, à droite, le plafond, le lino du sol… Ma mère ne dit rien; c’est qu’il n’y a rien à dire. Contre les murs, des feuilles punaisées donnent le programme des cours, de conférences. Bref. Ça ressemble à n’importe quelle autre université au monde, dans le genre pelé.
Je lance, pour dire quelque chose: «Attends, je fais une photo.» Et ma mère, gentiment, pose au centre du couloir étroit, le regard tout droit sur l’appareil. Elle a son air de toujours, ma pauvre petite maman. Elle fait bien attention à sourire pour la photo, mais le reste du corps ne pose pas. Les épaules de sa veste ont été déplacées par le sac en bandoulière, elle se tient un peu de travers, dans cette posture que j’ai héritée d’elle, une épaule plus haute que l’autre et la colonne un peu courbée. De l’autre côté du sac, elle tient un parapluie parce qu’il pleuvinait lorsqu’on est parties. Elle a l’air d’une touriste. Alors en faisant cette photo, avec ma mère qui a l’air toute petite au fond de ce couloir vide, déjà s’élève l’insidieuse, la perfide question: «Mais qu’est-ce qu’on fout là?» Les couloirs sont déserts, ces papiers punaisés ne nous disent rien; l’une comme l’autre, nous sommes des touristes perdues dans un couloir.
Mais ce n’est pas le moment de douter, n’est-ce pas, on vient juste d’arriver… Alors je me retourne –avec allant– et je photographie longuement un autre couloir tout aussi vide. «Pour documenter», dis-je à ma mère du ton de l’écrivain qui y croit.
Plus tard, j’ouvre une fenêtre, on regarde la cour intérieure. Là-bas, en bas, quelqu’un fume une cigarette devant une autre entrée. C’est tout gris; un pigeon picore près d’une poubelle. Je ferme la fenêtre. Finalement, elle dit: «On y va?» On redescend le long des murs jaunes tout râpés; on sort du bâtiment. C’était l’université où ma mère a étudié.
Elle dit: «Ça n’a pas beaucoup changé…»
Je demande:
«Vous étiez beaucoup, à étudier le français?
–Non, le concours d’admission était très sévère.»
On repart côte à côte dans la rue; on avance d’un bon pas, mais je n’ai aucune idée de la suite du programme. Je pensais que la visite de l’université prendrait plus de temps. Je dis: «On fait quoi maintenant?
–Ben on va manger. T’as pas faim?
–Si, bien sûr.»
En attendant, je la suis et tandis que nous allons de notre bon pas sur une large avenue tout asphaltée, j’essaie de jouer mon rôle, celui que m’impose le voyage jusqu’ici avec elle. C’est un rôle où je pose des questions auxquelles elle répond; ça a l’air facile. Je demande: «Pourquoi il y avait un concours?
–Beaucoup de gens voulaient étudier le français. Les langues étrangères, c’était une porte sur le monde et les Roumains adoraient le français.»
Un des premiers livres que j’ai achetés sur la Roumanie parle de ça, de ce lien d’amour et de fraternité que les Roumains éprouvent pour la langue et la culture françaises. On l’explique souvent en disant que le roumain est la seule langue latine des Balkans, mais une autre raison, évidente, c’est l’histoire de cette France qui a conquis sa liberté, chassant ses rois et accouchant bravement de la première république d’Europe. C’était comme ça au XIXesiècle: tout le monde aimait la France. Elle était une inspiration pour tous les peuples opprimés de la terre et les Roumains, qui vivaient depuis des siècles sous la domination tantôt des Turcs, tantôt des Russes, levaient vers ce grand frère latin des yeux pleins d’espérance. Les enfants de la bonne société s’en allaient étudier dans les universités françaises et ramenaient au pays, avec la culture de là-bas, de plus en plus de revendications.
D’ailleurs, lorsqu’est venu le moment de se battre pour que leur terre devienne une nation, c’est Napoléon III qui les a soutenus dans le micmac diplomatique de l’époque. Alors au moment où la Roumanie est devenue un pays indépendant, en 1877, des linguistes engagés par le gouvernement ont intégré une foule de mots français dans leur langue (22 % des mots roumains viennent du français), éliminant avec joie ceux de l’ancien oppresseur turc.
Ce rapport d’amour de la Roumanie et de la France a perduré à travers toutes les vicissitudes du XXesiècle. Même Ceauşescu, tellement fou d’indépendance, a maintenu des relations privilégiées avec la France de De Gaulle; la France est restée sa grande copine de l’Ouest. C’est comme ça que les étudiants roumains ont pu continuer d’apprendre le français et de l’aimer. Ils ne pouvaient plus sortir du pays, mais on laissait un peu de France venir chez eux. On continuait d’enseigner Zola et Molière, on faisait venir des touristes francophones qu’on pouvait même épouser –difficilement, mais quand même. Voilà pourquoi c’est dans la bibliothèque de ma mère que j’ai découvert tous les classiques de ma langue, et voilà pourquoi, de nous deux, c’est ma mère qui longtemps a connu par cœur le plus grand nombre de poèmes…
Les Turcs, les coups d’État, le communisme et son béton qui fond en été, tout cela me semblait terriblement exotique depuis la Suisse et j’imaginais que la ville serait à l’image de cette histoire. Et pourtant, j’ai beau regarder autour de moi avec avidité, je ne vois rien que de familier. «C’est une ville d’Europe», je me dis, «c’est pour ça que c’est familier…» Il y a les mêmes enseignes que partout, Mango et H&M, des filles à peine pubères qui tendent leurs lèvres sur toutes les affiches, la circulation, les ronds-points, les trottoirs; une ville d’Europe. Pour nous raconter l’autre histoire, celle dont la ville veut sortir, il ne reste que des chantiers, des zones défoncées, des trous dans le paysage qui bientôt seront comblés. On voit des fils électriques comme d’immenses cordes au-dessus de nos têtes; ça se réunit dans un bouquet noir au sommet des poteaux. Ça aussi, c’est une survivance du passé. Le chauffeur de taxi qui nous a amenées à l’hôtel nous a expliqué que la mairie avait déjà commencé à les enterrer, «comme on fait dans les villes civilisées».
Je n’ai rien demandé de plus –je n’aurais pas su quoi–, et on avance en silence à présent, fouillant de l’œil les devantures et regardant sans les voir les affiches qui tapissent les façades. À un moment donné, alors que je m’arrête pour photographier un poteau («pour documenter», n’est-ce pas), j’entends ma mère derrière moi: «Tu reconnais? C’est l’hôtel Intercontinental…»
2.
Les souvenirs que j’ai gardés de Bucarest sont clairsemés, mais ils ont une couleur et une atmosphère qui leur est propre. Ils datent de notre dernière visite dans leur petite maison, une année avant que mes grands-parents se décident à partir. C’était les vacances scolaires; en Suisse, l’automne était jaune, rouge et brun comme le sont tous les automnes de la campagne. Les souvenirs de Bucarest sont quant à eux intégralement gris, de la tonalité de cette année 1985 là-bas, qui a été suffisamment terrible pour décider mes grands-parents à quitter le pays. À l’extérieur, le régime se vantait de ne plus avoir de dettes. Tout ce qu’il y avait à vendre avait été vendu à l’étranger, pour renflouer les caisses. Dans le pays, il ne restait plus rien pour la population, alors les Roumains faisaient la queue des journées entières pour acheter des pattes de poulet; c’était la seule viande encore à disposition pour agrémenter la soupe.
Mais j’avais 6 ans. Je n’ai rien vu de tout cela, et je n’ai pas de souvenirs de la misère. Par contre, je me souviens d’une plaisanterie: on disait toujours que l’hôtel Intercontinental avait les toilettes les plus propres de Roumanie. Quand ma mère nous annonçait qu’on allait «boire un thé» là-bas, il y avait comme un frisson anticipé de bien-être. Tout le monde s’habillait bien; grand-mère mettait son rouge à lèvres et tapotait d’un geste délicat ses cheveux ondulés, grand-père inclinait d’un air content son éternel béret. On s’entassait tous dans un taxi et mon frère et moi, on répétait quinze fois la blague sur les toilettes les plus propres de Roumanie, tandis que ma mère et mes grands-parents parlaient au chauffeur de tout et rien, et surtout pas de politique.
L’hôtel Intercontinental, c’était le grand hôtel où on accueillait les étrangers. Il devait être truffé de micros; il devait y en avoir sous chaque lit, sous chaque table du restaurant, et dans tous les vases. Le gouvernement voulait tout savoir de ce que se disaient ces étrangers; un secret bien exploité, ça pouvait permettre de voler des plans de centrale nucléaire, d’armement, n’importe. Mais l’hôtel Intercontinental, c’était aussi l’endroit où les standards de confort étaient les plus hauts de la ville, parce qu’ils devaient correspondre aux nôtres, aux gens de l’Ouest. C’est à cause du contraste entre nos standards et leur quotidien que la blague était née, comme naissent les blagues quand seul reste le rire.
Alors quand ma mère a dit ça, j’ai levé la tête et j’ai dit: «Ah bon?» et elle a répondu avec la satisfaction de quelqu’un qui a aussi croisé l’insidieuse question: «Mais bien sûr, tu ne te souviens pas?…»
Mais si, justement, je me souviens… Je me souviens d’un ciel de plomb, et de la lumière chaude qui nous attendait à l’hôtel. Je me souviens de notre effervescence et de la blague. L’hôtel Intercontinental ne se fond pas dans la masse. Il est plus haut que le reste de la ville, il y fait plus chaud; il ne passe pas inaperçu. Mon regard de trentenaire, celui qui sait des choses, voit bien que ce bâtiment-là a dû être moderne un jour, dans les années70 sans doute. Mais c’est la mémoire de l’enfant qui cherche un point d’appui. Cette mémoire ne parle pas en termes d’architecture, elle ne raconte rien de l’agencement des fenêtres ni des formes du béton. Cette mémoire n’a enregistré que les contrastes: un bâtiment si haut qu’il devait aller jusqu’au ciel, plus chaud que toute la ville, et bien plus confortable. Tellement chaud et confortable qu’il nous aspirait tous, les grands-parents, Olga et Rubin Abermann, leur fille mariée à un étranger et nous, les petits Suisses qui retrouvaient là les habitudes de leur pays –un papier toilette soyeux, une lunette neuve où s’asseoir, un bon chauffage. Oui, de cela je me souviens. Mais je ne me rappelle pas une avenue comme tant d’autres, ni un bâtiment suivant poliment ses voisins comme ils font dans les villes. Comment aurais-je pu penser que ce bâtiment-ci, gris et donnant sur le trottoir comme les autres, était l’éden d’alors?
Alors j’ai dit: «On va voir?»
Dans mon souvenir, nous allions de l’obscurité de la ville vers une grande lumière d’intérieur. Ce jour-là, nous passons d’une avenue claire de juin à un quelconque lobby d’hôtel de luxe. Ma mère, qui se rappelle aussi, raconte: «L’hôtel Intercontinental, c’était quelque chose à l’époque…» Elle regarde vaguement autour d’elle mais l’œil ne s’accroche à rien; elle ajoute, pour souligner l’importance de l’endroit: «Il n’y avait pas n’importe qui qui pouvait entrer là; l’hôtel n’acceptait que les devises.» Dans cette société censément égalitaire, c’est ainsi qu’on voyait qui avait réussi. Ceux-là pouvaient payer en dollars, en francs suisses, en deutsche mark. Ils n’étaient pas nombreux; pour parler d’eux, on devait avoir ce même ton de respect mêlé de convoitise que j’entends dans la voix de ma mère. Si vous entriez à l’hôtel Intercontinental, on savait que vous en faisiez partie. Alors j’imagine mes grands-parents se pavaner, et puis ma mère contente, gardant chacun pour soi cette vérité qui donnait au chatouillement d’orgueil des pincements de douleur: en Suisse, on n’était que de la classe moyenne, ni plus ni moins que nos voisins.
Dans les albums de famille de ces années-là, mes parents viennent de construire leur maison et le jardin est encore nu. Le quartier naissait à peine; tous les voisins étaient comme mes parents: avec des enfants en bas âge, dans une maison qu’ils venaient de construire. La Suisse entière était à l’image de ce quartier: les enfants y poussaient avec les villas, et des routes naissaient de partout, un réseau de cordons ombilicaux pour relier les villes à ces villages embryonnaires. C’était les Trente Glorieuses et tout le monde allait avoir droit au trio magique: la maison, la voiture, les enfants.
Dans ces albums de famille, il y a aussi mes grands-parents. Ils sont vieux déjà, et ma grand-mère porte sa robe d’intérieur bleue. C’est une de ces robes informes qui lui descend jusqu’aux genoux, avec un cordon à la taille et ses motifs de petites fleurs, une de ces robes comme en portent encore aujourd’hui les vieilles dames du monde entier. Je me souviens très bien des robes de grand-mère, mais quand j’y pense, ce n’est pas son visage ou le ton de sa voix qui accompagnent le souvenir, mais le manque d’amour. Ma mère les laissait s’occuper de nous, lorsqu’ils venaient en visite et je détestais ça. Je revois ma grand-mère qui criait dans sa robe à fleurs; je ne comprenais pas ce qu’elle disait et je me répétais en boucle: «Maman va bientôt rentrer, maman va bientôt rentrer, maman va bientôt rentrer.»
Mon frère devait être comme moi, parce qu’un jour de cris trop stridents, il a décidé de rejoindre notre père au travail, et il a quitté la maison. Il avait six ans; mon père travaillait à quinze kilomètres de là. Grand-père l’a rattrapé alors qu’il était en train de sortir du village, bonhomme déterminé lancé sur la route cantonale.
En réalité, ils étaient des étrangers pour nous, et ils le sont restés.
Comment mes parents auraient-ils pu payer les frais de santé, les frais de logement, les frais pour la vie de ces deux vieillards? Ils n’étaient que de la classe moyenne et, sans les assurances, ils ne pouvaient pas. Alors finalement, qu’est-ce que ça veut dire, être riche et avoir des devises, quand on est enfermé dans son pays, quand on voit ses parents une fois par année, qu’est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose dans les termes, ces devises et ces «pas n’importe qui» que ma mère continue de souligner par habitude, qui est à pleurer.
Je me suis arrêtée devant un panneau de signalisation planté à côté d’un escalier; je cherche un restaurant. Mais c’est drôle: ce jour-là, à l’intérieur de ce lobby d’hôtel et plantée devant ce panneau, je n’ai rien vu. Ni restaurant à l’étage, ni la beauté du cadre ou son luxe. Ce n’est que des mois plus tard, quand est venu le moment de décrire et que je suis allée sur le site Internet de l’hôtel, que j’ai vu que le bâtiment était très haut, aussi haut que dans mon impression d’enfant, bien plus haut que ceux alentour. Alors j’ai regardé les photos du restaurant au sommet: elles correspondaient tout à fait à ce que j’avais cherché, alors figée et aveugle dans le lobby de cet hôtel de luxe…
Ce jour-là, je n’ai rien vu et je n’ai rien demandé à ma mère. J’aurais dû, sans doute, nous étions là pour ça. Et pourtant, même si j’avais insisté pour qu’elle fasse ce voyage avec moi, je n’ai pas osé soulever l’ultime barrière, la seule qu’il aurait fallu lever: celle qui protège et sert de rempart à l’identité. Derrière elle se cache le passé tel qu’il fut, avec ses peines, ses compromis, les détails qui font le sel de la vie; mais derrière elle, il y a aussi les erreurs, les lâchetés et tout l’égoïsme qu’on accumule dans une vie d’homme. Alors nous sommes toutes deux restées plantées dans le lobby d’un hôtel que nous ne voulions pas voir. Ma mère, les yeux ailleurs, n’a vu que la place forte de ses souvenirs, ceux qui arrangent et qu’elle a construits brique après brique, année après année. Dans ces souvenirs-là, on ne parle pas trop de mes grands-parents tout seuls en Roumanie, parce que ça fait mal. On n’aborde pas l’abandon, ni leur quotidien. Dans ces souvenirs-là, on ne garde que les blagues, les réussites d’alors et la lumière d’or que la jeunesse et l’espoir prêtent à tout ce qui les frôle. Le reste n’est que soupir.
Alors ma mère a soupiré en parlant du bon temps, lorsqu’on venait tous ensemble à l’hôtel Intercontinental; j’ai revu le sourire satisfait de grand-père pour enfiler son béret et j’ai demandé, paralysée avec elle dans ce passé immuable: «C’était vrai, qu’ils avaient les toilettes les plus propres de Roumanie?» Ma mère, lancée dans les récits tout faits, se met à rire: «En tout cas, vous préfériez ces toilettes-là à celles des grands-parents! Tu te rappelles leur salle de bains?»
3.