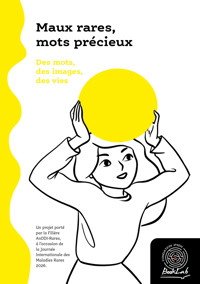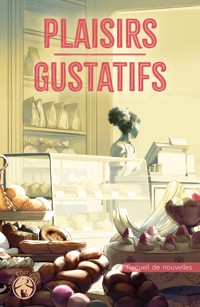Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Utopia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À travers douze nouvelles et une narration atypique qui permet la lecture à plusieurs niveaux, Biodiversité:no(s) futur(s) nous invite à retracer l’incroyable trajectoire des vivants et à enrichir nos imaginaires sur la Nature ainsi que sur notre manière d’habiter le monde.
Fondées sur des constats scientifiques authentiques se mêlant à la fiction pour les ancrer dans le réel, écrites par des auteur.es travaillant dans le domaine de la recherche sur la biodiversité, ces nouvelles nous appellent à changer nos visions du monde. Elles sont autant d’alertes pour une prise de conscience collective et massive et pour un changement transformateur de nos habitudes de vie afin de renouer des liens avec le reste des vivants, pour cesser de détruire notre maison commune.
Le lecteur suit Sécotine Fluet de sa naissance à 2050, en explorant les relations entre l’humanité et la biodiversité. Des sauts dans le temps, à rebours et dans le futur retracent ces trajectoires utopiques ou dystopiques.
Ce livre est la première œuvre collective portée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB).
À PROPOS DU COLLECTIF
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité est une fondation de coopération scientifique, créée en 2008 par les Ministères de la Recherche, de l’Écologie ainsi que par les principaux organismes de recherche publique français travaillant sur le sujet. Elle a pour mission d'accroître et de transmettre les connaissances sur la biodiversité
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Collection Ruptures
Les Éditions Utopia
61, boulevard Mortier – 75020 Paris
www.editions-utopia.org
www.mouvementutopia.org
Diffusion : CED
Distribution : DOD&Cie/Daudin
© Les Éditions Utopia, mai 2024
SOMMAIRE
Préface
Par Hélène Soubelet, Denis Couvet et Allain Bougrain Dubourg
Le baiser du diable
Par Hélène Soubelet
La ruée vers l’or rose
Par Agnès Hallosserie
Le rêve de l’albatros
Par Bernard Commere
Un ultime battement d’ailes
Par Marilda Dhaskali
Les loups sont entrés dans Paris !
Par Morgane Flégeau
Qui mal sème, mal récolte
Par Didier Bazile
Et les hirondelles ont bleui le ciel
Par Cécile Albert
Goupil renifleur
Par Jean-Louis Morel
Vert de rage
Par Hélène Soubelet
Auprès de mon arbre
Par Charlotte Navarro et Cécile Jacques
Chers grands-parents
Par Robin Goffaux
Sens dessus dessous ou la chute de Chronos
Par Philippe Billet
Bibliographie sélective
Notes
Livres des Éditions Utopia
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), créée en 2008, a pour mission de soutenir et d’agir avec la recherche pour accroître et transférer les connaissances sur la biodiversité. Elle contribue à l’essor des résultats de recherches sur la biodiversité et de leur impact sociétal. Son rôle d’intermédiation est au cœur de ses actions : la FRB est un point de rencontre entre deux mondes et de nombreux partenaires, académiques et sociétaux, publics et privés. Elle œuvre pour permettre à toutes et tous, acteurs de la société et décideurs, de dessiner notre avenir commun sur la base des résultats de la recherche afin de relever ensemble les défis scientifiques et sociétaux pour vivre en harmonie avec la biodiversité.
Site : www.fondationbiodiversite.fr
Contact pour cet ouvrage : [email protected]
Préface
Par Hélène Soubelet, Denis Couvet et Allain Bougrain Dubourg
La vie apparaît sur Terre il y a environ 3,5 milliards d’années. Elle s’est diversifiée de façon incroyable, à tel point qu’en 2024 environ deux millions d’espèces vivantes ont été décrites et plusieurs dizaines de millions existent probablement. L’être humain, une espèce parmi toutes les autres, joue un rôle clé dans l’évolution darwinienne des organismes vivants. Mais les scientifiques alertent depuis longtemps sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Dans son évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques, publiée en 2019, l’Ipbes, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, évalue à un million le nombre d’espèces animales et végétales menacées d’extinction en raison des pressions exercées par les activités humaines. Grâce à sa capacité à exploiter l’énergie, l’efficacité des actions humaines a été décuplée : détruire une forêt, labourer un champ, retourner une prairie, détourner un cours d’eau, construire une ville ou un barrage n’a jamais été aussi facile et rapide.
Comment être optimiste sur le sort de la biodiversité lorsque l’Agence française pour le développement nous apprend qu’au niveau mondial, pour un euro dépensé pour sa protection, huit sont, dans le même temps, dépensés pour sa destruction ? Comment pourrait-il en être autrement dans une économie dont la croissance est couplée à l’usage du vivant, fossile ou non, c’est-à-dire, dans la majorité des cas à sa destruction (couper du bois, pêcher des poissons, prélever de l’eau, « aménager » les paysages). Les humains ont aujourd’hui autant de capacité que les forces géologiques à modifier les trajectoires du vivant : nous sommes entrés dans l’ère de l’Anthropocène.
Alors que faire ?
Que faire dans un contexte où les actions en faveur de la biodiversité se multiplient dans le monde entier, mais où leur envergure reste faible par rapport aux tendances majoritaires non vertueuses ?
Communiquer ?
Expliquer ?
Proposer ?
Sans doute.
Il faut continuer à révéler les résultats scientifiques, leurs constats et leurs recommandations.
Mais il y a aussi une autre voix : changer les imaginaires, modifier les valeurs. Rêver et rendre réalisable un futur souhaitable et alerter sur un futur non désirable.
La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (l’Ipbes donc) dans ses différentes évaluations a déjà montré qu’il existait une corrélation entre l’érosion de la biodiversité et l’érosion des langages parlés dans le monde. En plus de l’homogénéisation des cultures, des modes de consommation, des paysages, il y aurait une homogénéisation du langage. Autrement dit, un appauvrissement de la façon d’appréhender la Nature, la biodiversité et la façon d’habiter le monde.
Posez-vous la question, considérez-vous vivre de la biodiversité ? Vivre avec la biodiversité ? Vivre au sein de la biodiversité ou encore vivre en tant que biodiversité ? De cette perception dépend aussi le degré de conscience éthique vis-à-vis du reste du vivant. Conscience qui s’exprime par des mots, des récits, des imaginaires, une façon de raconter le monde, de mettre en récit la biodiversité. Est-elle extraordinaire parce qu’on peut la copier, parce qu’elle est belle, parce que nous en dépendons, ou tout simplement parce qu’elle est là ? Que sommes-nous prêts à perdre ?
Autant de chemins de réflexions que les tribulations de Sécotine Fluet, une jeune, puis moins jeune scientifique, nous invitent à prendre.
Alors, pour ne pas appauvrir nos imaginaires, laissons-nous guider par ce personnage fictif qui dédie sa vie d’adulte à la compréhension des conséquences utopiques ou dystopiques de nos décisions individuelles ou collectives sur la biodiversité.
Le baiser du diable
Par Hélène Soubelet
France – Mai 1817
La famine durait depuis trop longtemps en France. Elle avait débuté pendant la tristement nommée « année sans été » en 1816 et était en grande partie due à l’hiver volcanique provoqué par l’éruption du volcan Tambora l’année précédente, aux Indes néerlandaises. La poussière et les aérosols s’étaient répandus rapidement, abaissant les températures moyennes et l’ensoleillement. En France, les récoltes avaient été catastrophiques dans un contexte où les guerres napoléoniennes avaient déjà épuisé le pays.
Jean Moriceau regardait sa terre avec tristesse. Que pouvait-il y faire ? Après les semis d’automne, il n’avait pas trouvé un seul fournisseur d’engrais organique : pas de paille, pas de fumier, même pas une seule fosse d’aisance à vidanger. Tout avait été acheté avant même d’avoir été mis en vente par des fermiers aussi désespérés que lui, mais sans doute plus malins. En France, à cette époque, les apports de fumiers ne couvraient déjà plus que la moitié des besoins en éléments fertilisants.
Alors qu’il aurait dû faire un premier apport d’engrais organique en février puis un second en mars sur l’ensemble de ses champs, il n’avait pu recourir qu’à un épandage parcimonieux du fumier de ses bovins, ce qui avait à peine couvert un quart de ses champs.
Il frissonna. Les guerres de 1815 avaient vidé les greniers, la récolte de 1816 ne les avait pas remplis et celle de 1817 s’annonçait également mauvaise.
Les troubles qui avaient émaillé, parfois de façon sanglante, toute l’année sans été, s’étaient poursuivis en 1817 : les régions riches s’opposaient à la libre circulation des précieux grains, les régions pauvres mouraient de faim et les autorités réprimaient les émeutes dans le sang, comme au marché de Fauville en janvier où la troupe avait fini par tirer sur les manifestants au prix de deux morts et plusieurs blessés.
Comment tout cela allait-il finir ?
Allemagne – 1909
Enfin !
Enfin c’était au point ! Il avait réussi ! Lui, Fritz Haber, après quinze années d’intenses travaux de recherche, avait finalement réussi à stabiliser le processus de formation d’ammoniac à partir de diazote, le composé le plus abondant de l’atmosphère que seules quelques minuscules bactéries arrivaient à transformer en azote assimilable par les organismes vivants.
Le chimiste allemand était sincère lorsqu’il imaginait avoir contribué au bien-être de l’humanité en mettant au point, avec son collègue Carl Bosch, ingénieur chez BASF, un procédé de fixation industrielle du diazote atmosphérique.
L’azote dit « réactif », ainsi synthétisé, est un puissant promoteur de la croissance des plantes. La production en masse de cet engrais de synthèse sous forme d’urée et d’ammonitrate a en effet résolu l’un des problèmes majeurs du xixe siècle : la demande croissante d’engrais organique et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’Amérique du Sud qui fournissait un engrais organique de premier choix, le guano, issu de l’accumulation des déjections d’oiseaux marins.
Cette découverte a fait l’objet d’un enthousiasme aveugle et, comme beaucoup d’autres, n’a révélé que progressivement ses effets secondaires délétères, souvent irréversibles.
Fritz Haber n’aurait certes pas pu imaginer que la commercialisation massive des engrais azotés, permise par son procédé, serait responsable d’une des pollutions les plus problématiques des écosystèmes au xxie siècle, pollution directement liée à une volonté d’accroissement mondial de la production qui avait guidé les politiques agricoles occidentales de la seconde moitié du xxe siècle. En revanche, il était tout à fait au courant que ses recherches ultérieures sur les armes chimiques à base de chlore seraient à l’origine de milliers de morts, la toute première d’entre elles étant celle de sa femme, qui se suicida en 1915 après avoir échoué à le faire renoncer à ses travaux sur les gaz de combat.
Il avait bien hésité un peu, mais finalement, l’attrait de la gloire – il reçut le prix Nobel de chimie en 1918 – et du gain l’avait emporté : il avait continué ses recherches.
1963 – La course à la productivité
Évidemment son livre était une abomination, un désastre et un coup de poignard. Rachel Carson était devenue depuis la publication du Printemps silencieux en 1962, l’ennemie jurée de Robert White-Stevens et l’éminent biochimiste, travaillant pour une importante firme de l’industrie chimique, multipliait depuis un an les déclarations dans la presse et en conférences. Le fait que l’ancien président des États-Unis Dwight Eisenhower soutenait ouvertement sa cause le confortait dans ses certitudes.
« On veut nous faire retourner au Moyen Âge » fulminait donc Robert White-Stevens sans retenue, aussi bien en privé qu’en public.
En revanche, sans surprise, la communauté scientifique avait pris le parti de la biologiste et écologiste. Et l’industrie avait beau multiplier les interventions d’experts, la pression médiatique et populaire commençait à porter ses fruits. On parlait même d’interdire le DDT, la fameuse « bombe anti-insectes » qui avait suscité l’euphorie des industriels et des agriculteurs au sortir de la guerre.
Dans le même temps, la spécialisation de l’agriculture était en marche. En France, on remembrait au rythme des expropriations et des arrachages de haies. Même les cours d’eau aux méandres trop tortueux furent rectifiés : tout obstacle à la mécanisation devait être aplani ou supprimé, y compris les vieux paysans mis de force à la retraite.
On ne plaisante pas lorsqu’il faut « nourrir le monde ».
Près de 15 millions d’hectares ont ainsi été « aménagés » en France, supprimant au passage 750 000 km de haies et 4 millions d’hectares de prairies entre 1967 et 2007, les cultures de légumineuses se sont effondrées au profit du maïs ensilage dont la culture est passée de 350 000 à 1,4 million d’hectares sur la même période.
Finalement, à partir des années 1970, l’usage du DDT en agriculture fut interdit dans les pays développés, six ans après la mort de Rachel Carson. La personnalité emblématique de la biologiste fut incontestablement à l’origine d’une large part des réflexions critiques modernes sur les risques associés au développement de l’agriculture industrielle et au recours immodéré aux intrants chimiques, mais l’importance de la menace représentée par les pesticides oblitéra celle représentée par les engrais azotés. Pendant que la querelle sur les produits phytosanitaires prenait de l’ampleur à grands coups d’expertises contradictoires et, il faut bien le dire, de mensonges et de conflits d’intérêts à peine dissimulés, insidieusement l’utilisation des engrais azotés explosait.
1972 – Le cercle vicieux
« Simplifions, simplifions » disait en écho aux discours gouvernementaux le maire d’une petite commune rurale bretonne, lui-même agriculteur avide de modernité.
Depuis 12 ans, ses efforts pour passer du statut de paysan à celui d’exploitant agricole avaient porté leurs fruits : il possédait un tracteur dernier cri, il avait doublé sa surface en bénéficiant du regroupement de ses parcelles autour de son corps de ferme et de la suppression des bosquets d’arbres gênants ; il avait abandonné la culture de pomme de terre, de luzerne, de pois, de chanvre et de sarrasin et triplé ses rendements en blé et surtout en maïs. Cependant une sourde rengaine revenait souvent hanter les nuits du maire : le bilan social de la petite commune était désastreux. Trois agriculteurs s’étaient donné la mort, incapables de supporter la pression de la modernisation. La disparition de huit petites exploitations avait poussé à l’exode un tiers de la population du village. L’école était sur le point de fermer ses portes faute d’enfants, le médecin n’avait pas trouvé de successeur et la boulangerie perdait sa clientèle, ce qui n’augurait rien de bon pour l’avenir.
Un autre problème commençait à l’inquiéter, une sorte de course en avant dont il avait du mal à estimer l’ampleur, mais qui, en bon chrétien qu’il était, lui rappelait étrangement les sept plaies d’Égypte : depuis plusieurs années, il déplorait une augmentation de ses consommations d’intrants chimiques, engrais et pesticides, et de ses consommations d’eau en plus de la multiplication des adventices, qu’il continuait à appeler mauvaises herbes, surtout l’ortie, le liseron, le chénopode ou encore le chardon, une explosion des maladies fongiques sur ses cultures, des pullulations incontrôlables de campagnols des champs, des inondations plus fréquentes de ses champs et l’érosion croissante et de plus en plus manifeste.
Et si tout était lié ?
Mais lorsqu’il se réveillait le matin, les sueurs froides disparaissaient. Il suffisait qu’il contemple ses champs, à perte de vue, bien rangés au carré, et son tracteur, le plus gros du département, pour retrouver le moral.
2011 – Enfin la lumière ?
Enfin, la publication était sortie. L’énorme travail de synthèse scientifique sur la présence de l’azote réactif dans l’environnement européen, coordonné par Mark Sutton, venait d’être publié aux Presses universitaires de Cambridge et son retentissement était déjà important.
Il faut dire que cette étude conduite pendant plusieurs années avait mobilisé 194 scientifiques et comptait 611 pages.
Et il y avait urgence. La production d’azote réactif, directement assimilable par les plantes, avait été multipliée par 10 en 100 ans. Au début des années 2010, l’Europe épandait ainsi sans sourciller sur ses sols chaque année onze millions de tonnes d’engrais azoté industriel comme principale substance nutritive pour les cultures et les prairies. En France, en 2013, c’étaient 2,2 millions de tonnes d’azote, soit 20 % de la consommation totale de l’Europe. Le pays parallèlement détenait 16 % de la surface agricole utile européenne et concourait pour 18 % à sa production globale.
Les conclusions des scientifiques étaient claires et sans appel : depuis la mise en place de la politique agricole commune, la fameuse PAC, l’Europe avait saturé ses sols, ses eaux et son air en azote réactif et cela avait des conséquences environnementales majeures pour une raison principale : l’azote est capable de sortir de son cycle biologique planétaire qui le fait transiter de sa forme atmosphérique gazeuse (sous forme de diazote, N2) à sa forme organique (composant des protéines et du matériel génétique des êtres vivants) en passant par une phase minérale dans le sol (ammoniaque, nitrites et nitrates).
Les fuites d’azote se produisent lorsque les molécules sont entraînées vers les eaux de surface ou les nappes phréatiques ou sont émises sous forme d’oxydes d’azote gazeux (NH3, NO2, NO et N2O).
Malheureusement, même le résumé du rapport était bien trop volumineux et trop technique pour être lu par les décideurs publics et privés. Sécotine Fluet, une jeune scientifique tout juste embauchée à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, avait donc décidé de s’emparer du problème et d’en extraire les conclusions principales. La biodiversité des plantes cultivées et l’impact des amendements chimiques sur les choix variétaux la passionnaient et éclairaient de façons différentes ses travaux de doctorat en philosophie des sciences.
Mais le défi posé par la vulgarisation d’un tel sujet était immense. En dehors de l’exploit que représentait la simple lecture du texte, elle avait copié chaque passage intéressant sur un document numérique, après l’avoir traduit en français. À son grand désespoir, après une semaine de travail sans relâche, elle était péniblement passée de vingt-cinq à quinze pages en Times New Roman 12. Une catastrophe éditoriale.
« Bon OK, soupira-t-elle. Je laisse tout de côté et je résume. »
Le rendement d’utilisation de l’azote par les agroécosystèmes est très faible : sur les 80 millions de tonnes d’azote répandues par an par l’agriculture mondiale, à peine la moitié est utilisée par les plantes cultivées. À 250 euros la tonne, ces pertes représentent tout d’abord un impact financier énorme pour les agriculteurs qui en payent le prix.
L’azote qui s’échappe ainsi du cycle biologique a trois impacts négatifs majeurs : sur le climat, sur la santé humaine et sur la biodiversité. Vous serez sans doute sensible au premier impact, puisque tout le monde en parle : il s’agit des émissions de N2O, un gaz 300 fois plus efficace en matière d’effet de serre que le dioxyde de carbone avec une durée de vie de 150 ans dans la troposphère. C’est le troisième gaz le plus important responsable du réchauffement climatique et de la dégradation de la couche d’ozone. Le second impact ne vous laissera pas non plus indifférent, car il s’agit de la santé humaine. L’ammoniaque et les oxydes d’azote sont en effet des précurseurs de particules fines en suspension dans l’air. Le premier serait responsable de la formation de 30 à 70 % d’entre elles. En 2005, une étude de la Commission européenne a conclu que ces particules, suffisamment petites pour pénétrer dans les alvéoles pulmonaires, seraient à l’origine de 100 000 décès par an et d’une perte de 8,6 mois de vie de chaque Européen, notamment les habitants des villes qui sont les plus exposés, via les industries, mais aussi et surtout les gaz d’échappement des véhicules. Les maladies les plus fréquentes sont les cancers du poumon et les maladies cardiorespiratoires, mais d’autres troubles comme l’athérosclérose ou le diabète pourraient également être liés.
Mais le troisième impact le plus insidieux est sans aucun doute l’impact sur les écosystèmes, la biodiversité, les paysages. La saturation des sols et des eaux a été fortement médiatisée dans les années 2010, avec des dépôts importants d’algues vertes sur les côtes bretonnes, sources d’émanations toxiques, mais la redéposition de l’azote atmosphérique sur les prairies, les forêts, les écosystèmes montagneux a des conséquences désastreuses et durables. Elle agit comme une fertilisation massive et continue qui peut aller jusqu’à 50 kg d’azote par hectare et par an, et acidifie les sols. Ces deux phénomènes contribuent à favoriser les plantes à croissance rapide, comme les graminées, au détriment d’autres, comme les plantes à fleurs, moins tolérantes aux sols riches en azote ou plus acides. Dans certains cas, l’érosion de la biodiversité végétale apparaît à partir de 5 à 10 kg d’azote par hectare et par an.
C’est sans doute dans les montagnes que le phénomène se voit le mieux, ces milieux étant parmi les plus sensibles à l’eutrophisation et l’acidification combinées aux augmentations des températures et à la diminution des précipitations. Ainsi, dans certaines régions, la flore spécifique des prairies de montagne est progressivement remplacée par une flore des plaines, plus généraliste et moins rare. Ce qui induit, par effet rebond, la disparition des pollinisateurs et autres organismes associés aux plantes à fleurs, puis des oiseaux et, à terme, mène à la déstabilisation de tout l’écosystème.
2050 – Le printemps est toujours silencieux
Sécotine regardait depuis le début de la séance tous les conseillers s’agiter sous l’effet d’une panique qui allait croissant au fur et à mesure qu’elle parlait. Elle avait choisi de faire un exposé long, une sorte de plaidoirie lente et implacable qui était une bien piètre victoire après toutes ces années où elle avait tenté de passer les mêmes messages, dans divers cénacles, y compris à la prestigieuse organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, aussi connue sous le nom de FAO, où elle avait pourtant passé le début de sa carrière, en vain.
Devenue experte des enjeux de biodiversité depuis son entrée dans la vie active il y avait près de 40 ans, elle avait écrit des pages et des pages, elle avait affûté ses arguments, peaufiné ses conclusions, multiplié ses références. Dans les années 2020, une sorte d’espoir était né avec une mobilisation sans précédent autour de la biodiversité et d’une nouvelle vision de la société. Mais cela avait été insuffisant et les grands changements nécessaires ne s’étaient pas produits.
Aujourd’hui, les faits lui donnaient raison, malheureusement.
« Les conséquences de ce détournement artificiel du cycle biologique de l’azote, vous les avez à présent devant vous. Évidemment, vous l’avez compris pendant la partie historique de mon exposé, tout cela aurait pu être évité dès 2011, mais comme vous le savez des choix différents ont été faits. Que ce soit sous la pression des industriels, ou en raison de l’inertie des décideurs politiques, n’a plus vraiment d’importance. Nous faisons face à un dérèglement majeur du fonctionnement des sols dont les deux principaux symptômes sont d’une part l’arrêt presque complet de la dégradation de la matière organique et, d’autre part, le dépérissement de tous les végétaux sauvages au niveau mondial et de fortes chutes de rendement des plantes cultivées. Je vais à présent vous en détailler les implications immédiates.
– Pardon, osa un homme bedonnant au visage luisant, pouvons-nous passer aux… solutions directement ? Je crois que l’urgence de la situation le justifie…
– Les solutions Monsieur Létude ? Quelles solutions ? Il n’en existe aucune à ma connaissance. À moins que vous n’ayez 3 milliards d’années devant vous.
– Je ne comprends pas…
– Ça j’imagine bien. Malheureusement, vous n’êtes pas le seul, sinon, nous n’en serions pas là. La solution, c’est de reconstituer la biodiversité du sol que l’excès chronique d’azote a décimé. Pour décomposer correctement la matière organique, celle qui s’accumule dans vos champs, sur vos trottoirs, dans vos jardins, il faut des décomposeurs, des insectes, des acariens, des champignons. Nous les avons tous éliminés. Nos sols ne sont plus qu’une immense soupe en putréfaction où seules les bactéries et quelques rares plantes généralistes et très résilientes arrivent à pousser. D’où l’odeur qui règne partout et qui, en plus de vous incommoder, est le signe de la présence de cyanobactéries, qui, comme chacun sait depuis la grande épidémie de 2043, sont mortelles. Cet écosystème unique et efficace qu’était le sol a évolué depuis l’apparition de la vie sur Terre. Il est probable que les choses s’arrangeront à l’avenir, mais ni vous ni moi ne serons là pour le constater.
– Mais, les grands programmes de réintroduction de plantes subventionnés par la Commission européenne à partir des banques de gènes…
– Belle tentative, en effet. Pour cent trente-cinq milliards d’euros nous avons fait germer en serre puis réimplanté des dizaines de millions de végétaux dans à peu près tous les écosystèmes. On peut dire qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Pour l’instant, aucun des essais n’a été concluant. Pour être claire, tout a crevé.
– Madame Fluet, nous vous avons fait venir pour nous présenter les faits, mais là, je trouve que vous êtes un peu négative. Certes la situation est grave, mais il y a forcément une solution. D’ailleurs, lorsque le problème de fertilité des sols s’est avéré impossible à corriger à court terme, nous avons pris un virage extraordinaire pour développer l’agriculture hors sol et l’aquaponie. Nous trouverons une solution.
Sécotine le regarda en soupirant, la technologie n’avait fait qu’aggraver les choses dans le cas de l’azote. Mais elle savait que ce genre d’individu ne serait jamais convaincu même en chute libre dans un gouffre, il continuerait à sourire niaisement en attendant que les secours le tirent de la mauvaise passe dans laquelle il s’était mis lui-même.
– Soyez un peu lucide, cette agriculture coûte plus cher qu’elle ne rapporte. Pour produire une calorie, elle nécessite 10 calories d’énergie, or avec la fin des stocks de pétrole et de gaz et les normes toujours plus drastiques sur le nucléaire, le prix de l’électricité, qui a déjà triplé, devrait encore augmenter dans la décennie. Bientôt, plus personne ne pourra s’acheter une tomate.
– Mais alors… qu’est-ce qu’on fait ?
Sécotine haussa les épaules :
– Vous allez sur internet pour apprendre à fabriquer du charbon actif, cela vous permettra de filtrer l’eau. Ensuite, vous recopiez à la main des recettes à base d’ortie, de ronce et de plantain, les seules plantes qui poussent encore à peu près correctement, et vous commencez à adapter votre estomac au changement de régime alimentaire drastique qui se profile !
Sur ce, elle rangea ses affaires avec le regard sévère et elle quitta la pièce en claquant la porte. Elle avait prêché dans le vide pendant quarante ans en pleurant de voir la situation lentement et inexorablement dégénérer. Ils pouvaient bien attendre un peu avant qu’elle leur donne des informations plus utiles.
La ruée vers l’or rose
Par Agnès Hallosserie
1246 – Irkoutsk : la caravane s’élance
Türgit le chaman atteint enfin l’escarpement sur lequel poussent les racines d’or. Il descend de son cheval, se courbe au-dessus des plantes, commence à les extraire en les saisissant délicatement à leur base, faisant progressivement émerger leurs racines à l’air libre. Quand il reviendra, dans deux mois probablement, il pourra emmener son fils, pour lui apprendre comment venir chercher l’orpin rose, « la racine d’or ». Türgit lui-même connaît cet endroit car son père l’y a emmené à chacune de ses cueillettes pendant quatre ans avant sa mort. Personne d’autre ne sait que la plante est là.
En revenant chez lui, il voit qu’un cheval inconnu est attaché au poteau devant sa yourte : le marchand est déjà là. Il le retrouve à l’intérieur, avec sa femme et la famille des voisins qui honorent l’invité. Après avoir échangé les politesses d’usage, le chaman remet une bourse brodée au marchand, qui lui tend en échange une peau de loup. Les racines d’or vont poursuivre leur périple.
Quelques jours plus tard à Irkoutsk, l’orpin rose séché est soigneusement calé dans un coffret de bois battant contre le flanc du chameau qui s’élance dans un renâclement caractériel. Il parcourt ainsi des kilomètres, à travers le désert de Gobi, puis celui du Taklamakan. Il évite les passages les plus dangereux du Pamir, abordant le massif par son passage au nord, avant de retrouver une route paisible mais monotone à travers les steppes d’Asie centrale.
Six mois plus tard : enfin, la mer ! Le marchand pousse un grand soupir en voyant le port de Poti devant lui et au loin, l’étendue de la mer Noire. Pour ses chameaux et lui, le voyage s’arrête ici, mais la racine d’or poursuivra son périple via Istanbul et jusque dans les flacons mystérieux des apothicaires de Gênes, Paris et Tolède.
1983 – Nijni Novgorod : Rhodiola rosea, souvent imitée, jamais égalée
Dans un laboratoire à proximité de la ville, au bord de la Volga, une équipe de chercheurs s’active autour d’une petite caisse reçue de l’extrémité est du pays. Les plantes ont parcouru plus de 9 400 kilomètres, dont une bonne partie en Transsibérien, mais elles en sortent en bon état, leurs feuilles encore vertes et charnues, grâce au soin qui leur a été apporté. Il s’agit de Rhodiola integrifolia, une cousine de Rhodiola rosea. La production pharmaceutique à base de cette dernière s’est largement déployée au cours du xxe siècle, grâce à la médecine de pointe soviétique. Étrangement, il semblerait que la racine d’or ait perdu en efficacité ces derniers temps. Les humains y seraient-ils tant habitués qu’ils n’en ressentiraient plus les effets ? Ou, comme certains médecins membres du parti l’affirment, les Soviétiques seraient-ils des humains plus évolués sur lesquels Rhodiola n’a plus de raison d’avoir de prise ?
Rhodiola rosea commence à se faire rare en Sibérie et ailleurs, on en a cueilli massivement au cours des dernières décennies. Heureusement, on peut la remplacer avec integrifolia