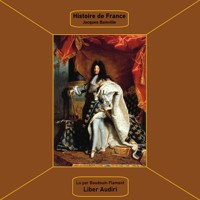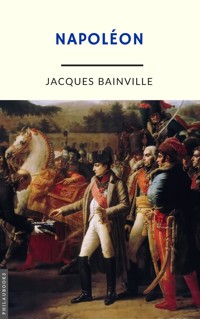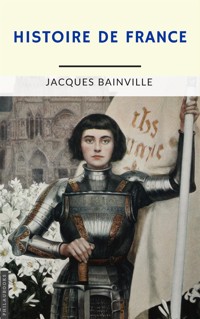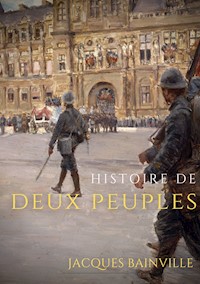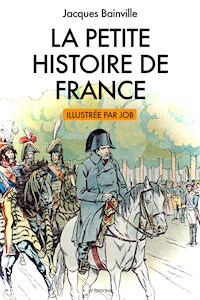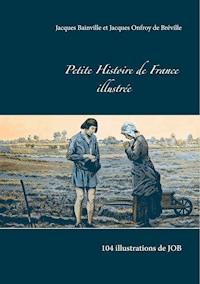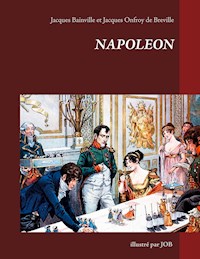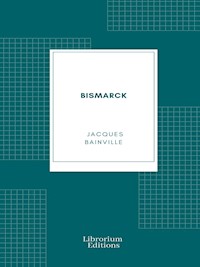
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’astre de Bismarck remonte. J’ai peine à croire que ce soit bon signe.
Le 11 novembre 1918, n’avait-on pas cru que son œuvre était détruite, que son nom, attaché à un âge de violences, appartiendrait au passé ? Était-ce, comme disait Mme Juliette Adam, « l’heure vengeresse des crimes bismarckiens ? » Ce que Bismarck avait construit, l’unité allemande, est resté debout. Sur ce piédestal, se dresse le forgeron du fer et du feu.
Le renouveau de sa gloire tient à cela. Il tient à autre chose encore.
Bismarck n’a eu qu’un disciple. Mais quel disciple ! Stresemann a été digne de son maître parce qu’il l’avait étudié et compris. Vive l’intelligence ! Vivent l’étude et la science ! Si les Allemands avaient médité les Pensées et Souvenirs, ils n’eussent pas commis l’énorme faute de 1914. Bismarck avait montré l’écueil qu’ils devaient éviter. Il expliquait à ses successeurs pourquoi l’alliance avec l’Autriche avait été conclue, pourquoi elle devait être conservée. Mais il leur recommandait expressément de ne jamais faire la guerre sur un prétexte autrichien, s’ils ne voulaient pas exposer l’Allemagne à une de ces coalitions dont il avait, lui, le cauchemar. Si Guillaume II avait mieux lu les mémoires de Bismarck, son trône et le traité de Francfort dureraient toujours. Stresemann les lut, s’en pénétra, y trouva des leçons pour tirer de l’abîme l’Allemagne vaincue.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bismarck
Jacques Bainville
1932
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383832447
AVANT-PROPOS
L’astre de Bismarck remonte. J’ai peine à croire que ce soit bon signe.
Le 11 novembre 1918, n’avait-on pas cru que son œuvre était détruite, que son nom, attaché à un âge de violences, appartiendrait au passé ? Était-ce, comme disait Mme Juliette Adam, « l’heure vengeresse des crimes bismarckiens ? » Ce que Bismarck avait construit, l’unité allemande, est resté debout. Sur ce piédestal, se dresse le forgeron du fer et du feu.
Le renouveau de sa gloire tient à cela. Il tient à autre chose encore.
Bismarck n’a eu qu’un disciple. Mais quel disciple ! Stresemann a été digne de son maître parce qu’il l’avait étudié et compris. Vive l’intelligence ! Vivent l’étude et la science !Si les Allemands avaient médité les Pensées et Souvenirs, ils n’eussent pas commis l’énorme faute de 1914. Bismarck avait montré l’écueil qu’ils devaient éviter. Il expliquait à ses successeurs pourquoi l’alliance avec l’Autriche avait été conclue, pourquoi elle devait être conservée. Mais il leur recommandait expressément de ne jamais faire la guerre sur un prétexte autrichien, s’ils ne voulaient pas exposer l’Allemagne à une de ces coalitions dont il avait, lui, le cauchemar. Si Guillaume II avait mieux lu les mémoires de Bismarck, son trône et le traité de Francfort dureraient toujours. Stresemann les lut, s’en pénétra, y trouva des leçons pour tirer de l’abîme l’Allemagne vaincue.
Nous nous représentons toujours un Bismarck brutal. Il ne commença à frapper du poing sur la table que le jour où il fut le plus fort. Et même à ce moment-là, il professait que la force s’émousse par un usage continu. En 1871, pendant les négociations de paix où il céda Belfort à Thiers, il disait à son secrétaire Moritz Busch avec un cynisme jovial :
« Quand on frappe un peu longtemps sans discontinuer, cela ne fait pas grand’chose ; mais si l’on met des intervalles entre chaque série de coups, cela ne fait point plaisir. Je sais cela du tribunal criminel où je travaillais autrefois ; on appliquait encore la bastonnade à ce moment. »
Mais au temps où la Prusse n’avait pas encore battu la France, Bismarck la ménageait, la cajolait, la trompait. Stresemann, pour la partie de campagne de Thoiry avec Aristide Briand, n’a eu qu’à prendre modèle sur la partie de bain de mer de Biarritz avec Napoléon III.
Lorsque Bismarck était entré dans la politique, c’était l’Autriche qu’il fallait ménager. L’Autriche venait de faire sentir sa puissance à la Prusse en lui infligeant l’humiliation d’Olmütz. Le jour de prendre une revanche et de l’expulser d’Allemagne n’était pas encore venu. Le 3 décembre 1850, Bismarck prononçait un discours pour la paix. Et après l’avoir reproduit dans ses mémoires, il commente : « Conformément aux idées du ministre de la Guerre, ma pensée directrice était d’obtenir que le conflit fût différé jusqu’à ce que nous fussions armés.» C’est tout l’esprit de la mémorable lettre de Stresemann au Kronprinz avant Locarno. « Ce n’était pas trop prétendre de notre diplomatie, ajoute Bismarck, que de lui demander, selon les cas, de reculer la guerre, de l’empêcher ou de la faire éclater. » Bismarck lui-même la fit éclater en 1866 et ce fut Sadowa… Où en serons-nous seize ans après Locarno ?
Au tome IV, tout récemment paru, des Documents diplomatiques français (1871-1914), on trouve une dépêche où Gambetta relève avec inquiétude une phrase prononcée par Bismarck au Reichstag. Le chancelier s’était abandonné à dire qu’il regardait « comme un malheur pour la France et pour le peuple français la ruine d’une monarchie héréditaire ». L’ambassadeur Saint-Vallier s’en étant expliqué avec Hatzfeldt, reçut cette réponse « qu’il s’agissait uniquement d’un argument de tribune dont le sens et la portée ne devaient nous causer aucun ombrage, le prince nous ayant prouvé par toute sa politique, dans ces dernières années, qu’il était bien éloigné de montrer aucune hostilité à la forme républicaine établie en France ».
Ce trait, fraîchement exhumé, achève la figure de Bismarck telle que nous avons essayé de la rendre et complète celle de Stresemann.Les épigones n’auront pas été tout à fait inégaux à l’homme qui domine son siècle dans le sublime de la duplicité.
11 novembre 1932.
LA JEUNESSEET LES PREMIÈRES ARMESDE BISMARCK
ILes années d’apprentissage
On peut dire que, de 1815 à 1870, la vie politique de l’Europe entière a été dominée par le souvenir de Napoléon. C’est l’influence, la volonté, le génie napoléoniens qui se faisaient partout sentir. Tyran des imaginations après avoir été tyran des peuples, ce souvenir de Bonaparte s’imposait en toute circonstance, son image obsédait les yeux, son histoire hantait les orateurs et les écrivains.
Il semble que, depuis 1870, ce rôle-là soit dévolu à Bismarck. L’Europe contemporaine est si fortement marquée de son empreinte qu’à tout moment on évoque l’homme d’État prussien. L’unité allemande, la triplice, la paix armée : autant de faits et de circonstances qui conditionnent toute la vie publique, et par conséquent aussi toute la vie privée de nos jours ; autant de faits et de circonstances dont la responsabilité remonte à Bismarck. Il n’est pas jusqu’au régime républicain en France qui ne porte sa signature et ne lui doive le jour. Quelques efforts qu’on ait tentés pour s’affranchir du chancelier prussien et de sa politique, l’Europe d’aujourd’hui est une Europe bismarckienne. Il est donc naturel que la personne même de Bismarck, sa vie et son caractère soient objets de curiosité. Le chancelier de fer n’a pas encore eu son poète, mais il a sa légende. On ne l’a pas encore choisi comme « professeur d’énergie » ni comme excitateur des jeunes ambitions, ce que sans doute il mériterait presque autant que Bonaparte. Mais si la littérature bismarckienne n’a pas donné jusqu’ici de chef-d’oeuvre, elle est pourtant déjà considérable, et la France même y a largement contribué. Après M. Andler, après M. Charles Benoist et leurs essais psychologiques, M. Paul Matter[1] a entrepris d’écrire une biographie complète et détaillée du prince de Bismarck. Nous allons essayer de résumer son récit des années d’apprentissage que fit Bismarck à diverses écoles. C’est, dans la vie de son héros, ce que M. Paul Matter appelle la Préparation, Cette période s’étend de 1815 à 1862. Certes, ce n’est, ni par les événements, ni par le caractère du personnage, ni aussi brillant ni aussi évocateur pour l’imagination que les débuts de Bonaparte. Mais ce qu’il y a d’âpre et de triste dans la jeunesse de Bismarck, le peu de ménagements que la vie eut pour lui au temps de la formation de ses idées, annonce et explique la brutalité de son œuvre, sa ténacité, sa misanthropie et cette espèce de névrose qui était la faiblesse secrète du colosse poméranien.
Les Bismarck étaient des hobereaux de caractère rude et violent, grands chasseurs, grands mangeurs, grands buveurs, fidèles serviteurs de la dynastie, soldats par goût et par tempérament. La difficile gestion de leurs biens dans un pays pauvre avait fait de ces gentilshommes fermiers et porchers d’assez bons administrateurs. Autant de traits communs à toute la lignée et dont hérita Bismarck. Sa mère, qui avait du penchant pour le bel esprit, ajouta peut-être à ce patrimoine la rapidité et l’ampleur de l’intelligence. Si l’on dit encore qu’Otto naquit en 1815, qu’il fut élevé dans l’exécration de la France, le souvenir des heures tragiques de la Prusse et l’enthousiasme du relèvement national qui devait finir par le grand mouvement de l’unité allemande, on aura les principaux éléments du caractère et de la personnalité de Bismarck.
Bismarck était un brutal. Il ne montra de douceur qu’à un seul être au monde : sa femme. Mais il faut reconnaître qu’il n’avait guère été dressé à la tendresse. Dès six ans, ses parents s’étaient déchargés du soin de son éducation sur les maîtres d’un pensionnat où les jeunes élèves étaient menés tambour battant. Bismarck garda toujours un mauvais souvenir de l’institution Plamann, où la discipline était de fer et la nourriture spartiate. À douze ans, il change de prison et il entre au gymnase. Là, il a la chance de rencontrer un professeur qui pressent que ce petit garçon sera quelqu’un : « Il avait, a écrit ce clairvoyant pédagogue, un bon visage joyeux et ouvert, des yeux limpides et brillants, quelque chose de jeune et de gai. Je me dis tout de suite : Voilà un gentil gamin. Je m’occuperai particulièrement de lui. » Et c’est ce professeur obscur qui donna à Bismarck le goût de l’étude, comprit, enrichit et développa ses dons.
À dix-sept ans, « c’était un grand garçon de taille élancée, le front haut sous la chevelure abondante, le regard droit et ferme ». Il était d’une franchise de caractère poussée jusqu’à la violence. Mauvaise disposition pour un futur diplomate. C’est pourtant à la diplomatie que sa mère le vouait par une surprenante intuition. Il n’entra d’ailleurs que beaucoup plus tard dans la carrière, après avoir essayé de bien des choses, achevé son éducation d’homme et fait son instruction de politique.
L’attitude de Bismarck dans la vie fut à peu près celle d’un autre Allemand célèbre vis-à-vis des idées : il ne méprisa presque rien. Ce n’était pas un dégoûté. Il se sentait assez robuste, assez bien équilibré, assez bien trempé, pour ne redouter aucun contact, aucune habitude. Entré à l’Université, il accepta, sans faire le délicat, les mœurs des étudiants. Il se fit remarquer par ses excentricités, ses duels et ses exploits bachiques. Il ne dédaigna point de se faire arrêter pour tapage nocturne. Il eut de nombreux démêlés avec le juge universitaire de Gœttingue. Il fit même de la prison. Bien plus, il donna dans le libéralisme, s’affirma quelque temps républicain. Inutile de dire que cette disposition d’esprit ne dura pas et qu’il domina rapidement cette crise d’adolescence.
Le jeune Bismarck s’était amusé. Il avait peu suivi les cours. Mais il avait lu beaucoup de livres et regardé beaucoup d’idées. Enfin il avait ses diplômes, et il se disposait, selon le vœu de sa famille, à entrer dans la diplomatie. Un échec l’attendait, et c’est là qu’il montra la fermeté de son caractère. Il fut présenté au ministre des Affaires étrangères, le pointilleux Ancillon.
Ancillon considéra ce robuste gaillard, de médiocre noblesse rurale, sans grosse fortune, trop grand, trop fortement charpenté. Il ne le trouva pas conforme au type alors en cours de l’attaché d’ambassade, souple et sceptique, brillant et délié, de haute naissance et de grande richesse. Il lui insinua que les débuts de la carrière diplomatique étaient difficiles, encombrés, et lui conseilla de subir d’abord l’examen d’assesseur de gouvernement provincial, puis, en collaborant aux travaux du Zollverein, de chercher, par ce détour, à se frayer une voie dans la politique allemande de la Prusse. C’était une défaite. Bismarck le comprit, mais résolut de prendre la voie détournée que lui indiquait le ministre. Il travailla opiniâtrement son droit, se présenta au concours judiciaire, et, le 20 mai 1835, il était nommé, auscultator au tribunal de Berlin.
Ainsi Otto de Bismarck « avait rêvé les intrigues de la diplomatie et il se réveillait commis-greffier ». Mais il ne perdait pas courage. Tout en grossoyant, il observait, il critiquait, il augmentait son bagage de connaissances. Et surtout il ne perdait pas de vue ses ambitions. Il s’amusait dans la société peu raffinée des jeunes nobliaux de Berlin, où l’on se grisait tous les soirs. Mais c’était afin d’approcher la cour plus aisément et par plus de côtés. À une fête, il obtint d’être présenté au prince qu’il devait si bien servir plus tard et qui lui montra également une fidèle affection. Le futur empereur d’Allemagne, alors prince héritier de Prusse, s’étonna seulement, en voyant Bismarck, « qu’un si robuste gaillard ne fût pas entré dans l’armée et que la justice exigeât de ses jeunes gens la taille de la garde royale ». Mais Bismarck ne se fâchait même pas qu’on le plaisantât sur ses fonctions, sans gloire et sans traitement, de stagiaire.
Il ne les occupa qu’un an. Un examen le fit entrer dans l’administration. C’était encore de la petite bureaucratie, un travail fastidieux, de la paperasse, mais aussi l’occasion d’apprendre des choses nouvelles et même de se pousser dans la direction nécessaire : Bismarck se fit nommer au gouvernement d’Aix-la-Chapelle, où se réglaient bien des questions de l’importante union douanière, — cette clef de l’avenir politique de l’Allemagne. Ainsi, par une voie détournée, Bismarck s’efforce toujours de parvenir à la carrière diplomatique. Ce n’est pourtant pas un ambitieux du genre ténébreux. Il aime tout, et particulièrement le plaisir. Le mot de Diderot sur Bougainville : « Il fit comme tout le monde : il se dissipa après s’être appliqué et s’appliqua après s’être dissipé », convient à cette période de sa vie. Aix-la-Chapelle, ville où l’on s’amusait en 1840, fut le lieu où le jeune Bismarck mena l’existence la plus désordonnée. Transféré au gouvernement de Potsdam, il comptait y continuer sa vie joyeuse, lorsqu’il fut surpris par une désagréable révélation : son père et sa mère, à force de légèreté et d’inattention, de mondanité et de bel esprit, avaient compromis leur patrimoine. Le jeune Otto avait vécu jusque-là insouciant et riche. Il se trouvait subitement aux prises avec les plus ennuyeuses difficultés. Dans cette circonstance, dit son biographe, « son caractère fortement trempé se montra dans tout son élan d’énergie : il fit face aux difficultés et, avec la rapidité qui devait plus tard « assurer sa force, il prit des décisions viriles ». C’était l’année où il devait accomplir son service militaire. Il quitte la garde royale de Potsdam, où la vie est coûteuse. Il se fait incorporer dans un régiment de petite ville. Dans ses loisirs, il lit, il complète son instruction, il s’initie à l’économie rurale. Son service fini, il est prêt à prendre en main la gestion des biens de famille si maladroitement compromis par son père.
On ne peut nier que Bismarck ait eu de là chance, même dans les occasions où la fortune semblait le desservir. Peu d’éducations d’homme public pourraient être plus complètes. À vingt-quatre ans, il a déjà traversé la magistrature, l’administration, l’armée, sans compter les mondes les plus différents. Il s’est révélé homme d’action en ceci qu’il ne s’attarde à rien et que les années semblent doubles pour lui à l’usage qu’il en fait. Voilà que des revers de fortune semblent devoir arrêter sa carrière. Nullement. À faire valoir son modeste domaine poméranien, il va mieux s’armer pour les luttes futures. Bismarck, dit M. Paul Matter, passa en Poméranie le « temps où la personnalité s’établit chez l’homme, où son caractère, son intelligence, se forment définitivement. Ce long séjour a eu sur Otto de Bismarck une influence profonde et ineffaçable. »
Le voilà qui se met avec acharnement à relever sa fortune, à exploiter d’une manière pratique et raisonnable le triste domaine de Kniephof. S’il eut de l’amertume de ses ambitions déçues, il ne s’en ouvrit à personne. Il semble qu’il ait voulu les oublier par un labeur opiniâtre et en utilisant tout ce que la vie d’un petit gentilhomme poméranien peut offrir de distractions. Il redevient, comme ses ancêtres, grand chasseur, grand mangeur, grand buveur. On le voit dompter ses nerfs par des chevauchées folles où il risque vingt fois de se briser la tête. Il commet des excentricités dont certaines sont héroïques, car il portera fièrement toute sa vie une médaille de sauvetage. Une légende se forme autour de lui. On le surnomme le hobereau fou. Il est bientôt populaire dans les campagnes. Et il semble accepter ce nouveau genre d’existence. On peut croire qu’il restera toute sa vie gentilhomme campagnard et lieutenant de landwehr. Il ne dit rien, mais déjà il a accepté quelques fonctions publiques. Il est membre du Conseil d’arrondissement. Il représente un peu plus tard la noblesse de Naugard à la Diète de Poméranie. C’est à cette Diète qu’il prononcera un discours « sur la consommation excessive du suif à l’assistance publique ». Bismarck ne méprisait presque rien en effet. Car tels furent les tout petits commencements de sa carrière politique. C’est grâce à eux que, servi, sans doute, par les circonstances, mais sachant les utiliser et n’en dédaigner aucune, il accomplit peu a peu ses primitives ambitions,
Bismarck était né sous une bonne étoile. Tout, pour lui, finissait par tourner heureusement, même ce qui avait d’abord paru contrarier ses projets et arrêter sa carrière. Les accidents de sa jeunesse, ses revers de fortune, ses stages dans la magistrature et l’administration, sa vie monotone de gérant d’un médiocre domaine poméranien, lui avaient donné, des hommes et des choses, une expérience complète et une instruction pratique comme en reçoivent peu d’hommes d’État. À son tempérament, à son tour d’esprit naturel, les événements avaient ajouté tout le nécessaire pour faire de Bismarck un grand réaliste. C’est avec cette figure qu’il restera dans l’histoire. Il en avait déjà quelques traits au moment où il entra dans la vie politique de son pays. Il les affirma dès ses débuts.
Lorsque la Diète unie s’ouvrit solennellement à Berlin en 1847, Bismarck n’en faisait pas partie : simple membre suppléant de l’ordre équestre au Landtag de la province de Saxe, il n’avait pas été convoqué. Mais un député de son ordre étant tombé malade, ce fut à Otto de Bismarck-Schoenhausen que revint l’honneur de prendre sa place. Cet honneur, il le goûta d’abord médiocrement, et n’y vit même qu’un embarras. Il était sur le point de se marier ; il surveillait ses terres, et son premier mouvement fut de sacrifier la politique à l’amour et à l’intérêt. Mais son parti, qui le connaissait et l’appréciait, insista tellement que Bismarck se décida à siéger à la Diète. Il vint s’asseoir sans hésiter à la droite la plus extrême.
Sa première impression fut nettement hostile au parlementarisme. « La séance d’aujourd’hui était ennuyeuse, écrivait-il un soir ;
bavardages sans fin, répétitions, temps perdu. C’est étonnant quelle effronterie à parler les orateurs montrent, en raison de leurs capacités, et avec quel impudent amour-propre ils se hasardent à importuner une aussi grande assemblée de leurs creux discours.
Cependant il n’entendait pas les autres énoncer des opinions contraires aux siennes sans être violemment tenté de leur répondre. Il finit, lui aussi, par faire son discours. Un jour, l’indignation le fit bondir à la tribune. Un député libéral avait nié le caractère nationaliste de la grande renaissance de la Prusse en 1813. Tous les souvenirs d’enfance, toute l’éducation anti-napoléonienne de Bismarck, lui revinrent à l’esprit. En phrases heurtées, saccadées, mais éloquentes, il exprima son indignation et traduisit son patriotisme. À mesure qu’il parlait, il s’aperçut en même temps qu’il n’était pas un véritable orateur et qu’il réussissait à se faire entendre, à dominer son auditoire. Jusqu’à la fin de sa carrière politique, il conservera la manière de ses débuts, brusque et familière, mais en la perfectionnant peu à peu, en tirant même de ses défauts d’élocution des effets qui n’appartenaient qu’à lui.
Cet essai de la tribune servait encore à lui donner confiance en lui-même. L’audace du « hobereau fou », qui l’avait un moment abandonné dans cette Diète compassée, lui revient tout entière. Non moins entières et absolues sont ses idées. Il est désormais décidé à les défendre. C’est pour affirmer son nationalisme prussien qu’il est intervenu une première fois dans les débats parlementaires. La seconde, ce sera pour venir au secours de l’autorité monarchique. Les libéraux réclamaient la périodicité de la Diète. Une assemblée siégeant régulièrement, sans être convoquée par ordonnance royale, c’était un autre pouvoir reconnu auprès de celui du roi, c’était la monarchie altérée et diminuée. Bismarck, loyaliste et autoritaire, n’y pouvait point consentir. C’est pourquoi il protesta violemment contre la thèse des orateurs libéraux. Mais il ne s’attaqua pas avec moins d’énergie à une autre invention libérale, car ces inventions se succèdent selon une sorte de rite. La gauche avait donc imaginé d’affranchir les juifs, de leur donner l’égalité de droits, de leur accorder même l’accès à toutes les fonctions.
Je suis, déclara Bismarck, pétri de préjugés, je les ai sucés avec le lait maternel, et je ne réussirai pas à m’en défaire en les discutant, car si je me figure devant moi comme représentant de la Majesté sacrée du roi un juif auquel je devrais obéir, je dois confesser que je me sentirais profondément abaissé et humilié, et que je perdrais le sincère plaisir et l’espèce de point d’honneur avec lequel je tâche à présent de remplir mes devoirs envers l’État.
Nationalisme, monarchisme, antisémitisme, telles étaient les causes pour lesquelles Bismarck avait tenté ses premières passes d’armes. Il faut avouer qu’il était apparu un peu comme un excentrique et un impulsif, et qu’il avait mis à défendre ses idées plus de sentimentalité que de politique. Le groupe des ultras le reconnut aussitôt pour son chef, et ce fut sans doute un peu pour cette raison. Cependant son caractère avait été apprécié en dehors du petit monde des hobereaux. « Je me suis fait beaucoup d’amis et beaucoup d’ennemis, écrivait-il à sa fiancée le 9 juin 1847, ceux-ci surtout dans la Diète et les premiers au dehors. Des gens qui ne me connaissaient pas, d’autres que je ne connaissais pas, m’accablent de prévenances, et je reçois surtout de bienveillantes poignées de mains inconnues. » D’ailleurs, il se rendait parfaitement compte que lui et ses amis avaient été battus à la Diète, battus à plates coutures. Il savait que ses idées étaient impopulaires, que son parti était une très petite minorité. Mais de pareilles considérations n’étaient point faites pour amener un homme de sa trempe à l’opinion contraire. Au surplus, la Diète dissoute, Bismarck se désintéressa quelque temps des affaires. Il venait d’épouser Mlle de Puttkamer. Et il acheva dans un voyage de noces sentimental l’année qu’il avait ouverte par des manifestations de loyalisme chevaleresque. C’est ainsi que le chancelier de fer lui-même eut ses faiblesse et ses attendrissements.
À peine était-il revenu d’Italie et avait-il repris sa vie de gentilhomme campagnard que la révolution de 1848 éclatait. On sait la violence qu’elle prit à Berlin. Les Hohenzollern faillirent y perdre leur couronne. En apprenant ce qui se passait dans la capitale, Bismarck, après avoir pris quelques mesures pour faire respecter l’ordre dans ses propriétés et chez ses paysans, se hâta d’aller offrir son dévouement à la personne du roi. Il voulait conseiller au souverain et à la cour une résistance énergique. Il avait raison, mais il le disait trop haut pour être écouté et pour plaire. Frédéric-Guillaume IV était un romanesque, un rêveur, un irrésolu. Il fut très touché et se souvint toujours de la fidélité que Bismarck lui avait montrée dans ces circonstances. Mais en même temps il craignit que le zèle de ce hobereau ultra-réactionnaire ne fût compromettant. Bismarck à Berlin s’agitait beaucoup en effet. Il allait et venait, exhortant les officiers, secouant les généraux, formant des plans de conspiration. Tout le Dumas et le Walter Scott qu’il avait lus dans les veillées de Schœnhausen lui revenaient certainement à l’esprit. Il se faisait jacobite et chouan. À la fin, le général Hedermann dut menacer Bismarck d’une immédiate arrestation pour crime de haute trahison. Bismarck « n’eut qu’à rejoindre son castel, déçu, navré, furieux ».
Il y avait de quoi. Si Bismarck avait déjà de grandes ambitions, il pouvait croire qu’il avait compromis son avenir par excès de zèle. Quelques mois après les terribles journées de mars, lorsque le calme commença à renaître, le nom de Bismarck fut proposé au roi pour une combinaison ministérielle. En face du nom de son meilleur serviteur, le souverain écrivit cette note un peu narquoise : « Ne pourra être ministre que si la baïonnette doit être maîtresse absolue ». Mais l’ironie n’était pas de force à désarmer Bismarck. De nouvelles élections avaient lieu en janvier 1849. Il s’y porta, sans faire la moindre concession aux temps ni aux circonstances. Ce fut au contraire l’occasion qu’il choisit de reformer avec quelques amis une droite extrême, absolument « pure de toute souillure révolutionnaire ». Aucune transaction avec la Révolution, intégrité de la couronne, lutte contre les abus des récentes libertés : tel était ce programme, plus royaliste que celui du roi. C’est pourtant sur ce programme presque paradoxal qu’il se fit élire. Sa hardiesse, sa brutalité, ses coups de boutoir, avaient plu aux électeurs autant que sa force de conviction et sa confiance en lui-même. Les élections, du reste, n’avaient guère été favorables aux amis de Bismarck. Son petit groupe intransigeant arrivait fort restreint à l’assemblée. Quelques timides et quelques faibles en gémissaient. Bismarck voyait plus loin et montrait un plus clairvoyant optimisme : « Nous n’avons pas encore vaincu, déclarait-il, mais nous avons attaqué, et c’est le principal ; la victoire doit encore venir, mais elle viendra. »
Ce sont de vraies paroles d’homme d’action. Au contact de la vie, à mesure que lui venait l’expérience, Bismarck en effet dépouillait tout doucement sa sensiblerie provinciale. Il conservait intégralement ses convictions, mais comprenait qu’il les servait mal en se satisfaisant de les affirmer par des cris pittoresques et violents. Déjà il commençait à fréquenter les groupes politiques les moins proches du sien.
Il trouvait ses coreligionnaires de la droite gens vertueux, mais gourmés et ennuyeux, et préférait causer amicalement avec les députés de gauche, plus vivants et personnels. Ses adversaires le tenaient pour un gaillard qui a le diable au corps, mais plaisant par l’originalité de ses saillies, son franc caractère, ses allures de bon garçon.
Pour être complet sur cette période de préparation de Bismarck, il faut encore mentionner deux faits où s’annonce sa politique de l’avenir.
C’est en 1849 qu’il a formulé sa première grande vue politique. Alors l’idée de l’unité allemande hante plus que jamais les esprits. Toutes sortes de tentatives et de propositions sont faites pour constituer un État germanique. Il semble qu’à Berlin on soit prêt à se laisser séduire par les offres qui viennent de Francfort et du Sud. Mais Bismarck en devine le danger. Il veut l’unité, certes. Il est patriote allemand. Mais, à ce moment, il est d’abord patriote prussien, car il sait que l’unité ne sera solide que si elle est faite par et pour la Prusse. Sous l’affectation de son particularisme prussien, tel est le vrai sens des discours qu’il prononce à cette date contre le projet de fédération. « Notre peuple, s’écriait-il, n’éprouve nullement le besoin de voir son royaume prussien se dissoudre dans cette fermentation corrompue de la licence allemande du Sud. Sa fidélité ne s’attache pas à une présidence fédérale qui n’est qu’une feuille de papier, ni à un conseil de souverains où la Prusse n’a que le sixième des voix. Elle s’attache à notre vivante et libre royauté, au roi de Prusse, à l’héritier de ses pères. Ce que veut le peuple, nous le voulons tous. Nous voulons que l’Aigle prussien étende son vol protecteur et domine depuis Memel jusqu’au Donnersberg. Mais nous voulons le voir libre, non pas enchaîné par une nouvelle Diète de Ratisbonne, non pas avec les ailes rognées par la serpe égalisatrice de Francfort, serpe qui n’est devenue un instrument de paix qu’à la réunion de Gotha, tandis que quelques semaines auparavant, à Francfort, elle était brandie comme une arme menaçante contre le prussianisme et contre les ordonnances de notre roi. »
Bismarck avait raison de conseiller à la monarchie prussienne de ne pas se presser. Il entrevoyait déjà la campagne de 1866, peut-être celle de 1870 : l’Unité réalisée en toute sécurité, d’une manière durable et au profit de la Prusse en écartant l’Autriche, en subjuguant l’Allemagne du Sud et en abaissant la France.
Quant à la France, dont il avait conservé la haine, il commençait à la bien connaître. Il venait d’observer les convulsions qui avaient suivi la révolution de février. Il portait déjà sur notre pays le jugement qui déterminera son intervention dans nos affaires intérieures après 1871. Le 24 septembre 1849, Bismarck combattait à la tribune une proposition de la gauche qui tendait à établir définitivement le régime parlementaire en Prusse, en accordant au Parlement le droit de refuser les impôts. Vous invoquez, disait-il à ses adversaires, l’exemple de certains peuples qui ont inscrit ce « progrès » dans leurs institutions. Or « l’exemple de la France, patrie de toutes ces théories, n’est pas très séduisant. Et je ne vois réellement rien dans sa situation actuelle qui nous engage à mettre sur notre corps vigoureux et sain la tunique de Nessus des théoriciens politiques français. » C’est le même homme qui, vingt-cinq ans plus tard, travaillera à remettre cette tunique sur nos épaules.
IILa formation des idées bismarckiennes
Il y a dans la vie de Bismarck une période difficile à suivre parce que les événements historiques auxquels il se trouva mêlé sont alors d’une confusion extrême. Il faudrait des pages et des pages pour débrouiller à-peu-près l’état de la question allemande au milieu du XIXe siècle. La vérité est que les contemporains ne voyaient pas ce qui en sortirait ni comment on en sortirait. Tous les principes et tous les hommes, toutes les Constitutions et tous les Parlements, s’usaient à mettre de l’ordre dans ce chaos. La Révolution n’avait pas pu et la Sainte-Alliance n’avait pas voulu. Les traditionalistes y avaient épuisé leurs souvenirs historiques et les légistes leurs subtilités juridiques. Le libéralisme avait en vain espéré que son souffle ferait naître l'unité du chaos féodal. Chaque année était marquée par la faillite d’une solution nouvelle. Les ministres étaient morts à la tâche ou bien avaient perdu leur portefeuille. Les autres prenaient tout doucement le parti d’éterniser les choses et d’y vivre le plus agréablement possible. Les diplomates étaient contraints de se rassembler à tout instant. Ils cherchaient à donner du charme à ces rencontres et à corriger la sévérité de leurs congrès par les plaisir des la vie mondaine. Ce fut, dans la carrière l’école de toute une génération élégante, et sceptique On cita longtemps la Diète de Francfort, sa douceur de vivre, l’impertinence, les déshabillés et les conquêtes du comte de Thun.
C’est cette période-là, qui va de 1850 à 1855 que Bismarck mit à profit pour l’élaboration définitive de ses idées politiques. Cette période, remarquons-le, est celle où l’Empire, rétabli en France commet ses primitives erreurs — la guerre de Crimée — et amorce toute une série de fautes. La formation du plan de Bismarck coïncide d’une manière remarquable avec les premiers actes qui devaient révéler à l’observateur attentif ce que le régime impérial allait faire de la France.