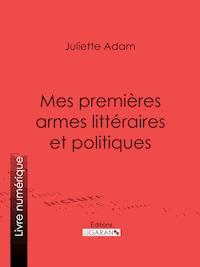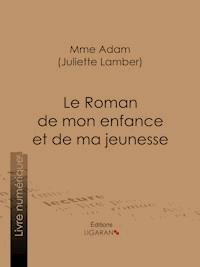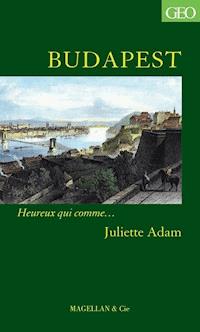
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme...
- Sprache: Französisch
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel.
Modèle de femme libre de mœurs et d’esprit, engagée en politique comme en littérature, Juliette Adam visite Budapest pour son plaisir, au temps de sa splendeur. Elle est reçue partout, donnant vie à cette cité essentielle de l’Empire austro-hongrois. Son récit plonge au cœur d’une des plus brillantes sociétés de l’époque et rend compte des grandes figures qui la composent ainsi que de son histoire tumultueuse au cœur de l’Europe.
Texte extrait de La Patrie hongroise publié dans La Nouvelle Revue en 1884.
Plongez dans ce portrait de la ville de Budapest à la fin du 19ème siècle !
EXTRAIT
Et avec un entrain, une belle humeur, un esprit adorables, le directeur des musées fait le boniment de son exposition des émaux hongrois. Il parle ceintures, aigrettes, brandebourgs, selles, gaines de sabre, couronnes, images saintes, trésors d’église, coupes à boire, bagues, montres, bijoux de femme, style de ces émaux qui ne sont ni byzantins, ni allemands, ni Renaissance, ni turcs, mais qui sont hongrois, d’une richesse, d’une variété, d’une grâce, d’une puissance de couleurs, d’une harmonie extraordinaires, comme j’ai pu m’en convaincre le soir même, impatiente d’admirer tant de choses décrites d’une façon si éblouissante.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Juliette Adam(1836-1936) est une femme de lettres française. Elle s’est prise de passion pour les sociétés exigeantes, en France où elle tient salon, au Portugal où elle s’exile, comme en Hongrie où elle voyage pour son plaisir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heureux qui comme…
Collection conçue et produite par Marc Wiltzen partenariat avec le magazine GÉO
UNE VISITE D’AMIE POLITIQUE
Présenté par Julie de La Patellière et Marc Wiltz
« Budapest est vraiment la ville des eaux chaudes et des bains. »
Juliette Adam préfère l’eau des lieux qu’elle fréquente pour son plaisir à celle des fonts baptismaux. Alors qu’enfant, on la bénit en l’absence de son père, elle crie au secours en recevant le sacrement: « Viens empêcher qu’on ne me jette dans l’Église catholique ! » Mais personne ne vient, et Juliette est baptisée. Tout un programme… C’est pourtant grâce à ce père, dont on contourne l’interdit, que Juliette, une fois adulte, devient cette féministe chevronnée, auteure de cinquante ouvrages, et franchement politisée.
Jean-Louis Lambert est un médecin de province, athée, et helléniste passionné. Il berce sa fille de récits homériques et la pousse à devenir quelqu’un. Ce sera chose faite. La petite Juliette commence par écrire des pastiches d’épopées qu’elle lui fait lire, puis quitte sa Picardie natale pour conquérir Paris. Un bébé sous le bras, elle se rend d’abord quotidiennement au musée du Louvre pour s’imprégner des œuvres antiques. Puis rêve de s’installer rue de Rivoli afin de n’avoir plus qu’à traverser… À vingt-deux ans, elle publie un réquisitoire contre Pierre-Joseph Proudhon qui affirme que « la femme ne peut être que ménagère ou courtisane ». En lisant ce premier écrit, Jean-Louis Lambert s’enflamme, sans oublier néanmoins le rôle qu’il a tenu dans l’éducation de sa fille : « C’est bon, c’est très bon, mais tu me le dois, c’est moi, moi seul qui ai mis dans ta cervelle ces idées anti-proudhoniennes ! Ma fille chérie, c’est le succès, c’est la délivrance ! »
Juliette compte alors parmi ses amies les féministes Julie-Victoire Daubié, première bachelière et première licenciée ès lettres en France, et Marie d’Agoult, alias Daniel Stern, compagne de Liszt (le couple a trois enfants, dont Cosima, future Mme Wagner). À partir de 1867, elle fréquente aussi George Sand dont elle devient une sorte de fille spirituelle. Lancée, elle se met à beaucoup écrire : du théâtre, de la poésie, des études de mœurs et des romans, parmi lesquels Païenne et Grecque. Mais c’est à partir de 1870 que Juliette Adam se révèle.
Ayant découvert le monde du journalisme, elle rédige de nombreux reportages ponctués de réflexions politiques. Républicaine farouche, profondément patriote, elle ouvre alors boulevard Poissonnière un salon politique qui va s’imposer. Elle vient d’épouser Edmond Adam, député de la gauche républicaine, bientôt préfet de police, puis sénateur inamovible. Juliette reçoit Adolphe Thiers, Georges Clemenceau, Louis Blanc, Edmond Arago, et Léon Gambetta dont elle est l’égérie (et l’une de ses maîtresses). Ce salon devient le foyer actif d’opposition à Napoléon III, et, à la chute de l’Empire, c’est parmi ce cercle en vue que se recrutent les membres du nouveau gouvernement. Informée, véritablement influente, Juliette est en plus très jolie. « L’œil d’un gris bleuté et plein de lumière ; dans les joues, deux fossettes ; une taille souple, une voix douce et métallique. »
Juliette séduit donc, par son esprit vif et intrépide, son allure rapide. Elle attire aussi dans son salon de nombreux écrivains. Quand elle fonde La Nouvelle Revue en 1879, elle fait logiquement appel à eux. Littré, Saint-Saëns, Tourgueniev, Hugo, Flaubert, Maupassant figurent tous les mois au sommaire. Juliette Adam publie aussi des correspondances inédites, signées Mérimée ou George Sand. Elle encourage les débuts littéraires d’Alexandre Dumas fils, Léon Daudet, et surtout Pierre Loti : son Pêcheur d’Islande paraît d’abord dans La Nouvelle Revue, dédié à « Madame Adam ». Juliette échange de nombreuses lettres avec celui qu’elle nomme « son fils Loti », le conseillant sur des questions de littérature, mais aussi de religion et de politique internationale.
Par la suite, elle publie courageusement des extraits du scandaleux Calvaire d’Octave Mirbeau (paru en 1886), récit autobiographique qui critique la famille, l’école, l’armée, considérées comme des structures d’oppression. Il y est aussi question de sexe et de violence. Mais cela ne l’effraye pas. Réputée de santé fragile, elle se réfugie régulièrement dans le sud de la France. Elle mourra d’ailleurs à Cannes en 1936… l’année de son centenaire !
***
En créant La Nouvelle Revue, Juliette Adam avait l’ambition d’accompagner la classe dirigeante républicaine, mettant à sa disposition des outils conceptuels et des données utiles pour mener à bien son action. Considérée comme l’incarnation de la « Grande Française » pour son côté militant d’une cause nationale face à Bismarck qu’elle accuse de « tyrannie diplomatique », elle cherche à imposer ses vues pragmatiques après le désastre de la chute du Second Empire. Elle le dit nettement dans le premier numéro de sa revue : « Jusqu’à présent, les hommes d’État, qui transmettaient les traditions gouvernementales, faisaient mystère de leur savoir, comme font les prêtres d’un culte profitable, et prétendaient, le croyant peut-être, qu’il faut, pour gouverner les hommes, une sorte d’initiation. »
C’est dans cet esprit qu’elle entreprend de visiter la Hongrie. Elle rencontre à Budapest tous les progressistes de ce royaume intégré au nouvel Empire austro-hongrois, qui a lui-même fort à faire face à la Prusse depuis la défaite de Sadowa en 1866. François-Joseph Ier, déjà empereur d’Autriche, a été couronné roi de Hongrie à Budapest en 1867, associant les élites hongroises au pouvoir. L’empire des Habsbourg est devenu ainsi une « double monarchie », expression que l’Autriche-Hongrie possède en propre avec un aigle à deux têtes pour symbole. Ce compromis a été pleinement accepté par l’aristocratie hongroise qui y trouve son intérêt, au détriment des autres peuples vivant sur ce vaste territoire. Cette alliance pleine de contradiction éclatera à la fin de la Première Guerre mondiale, au nom du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Dans ses « Lettres sur la politique extérieure », rubrique bi-hebdomadaire expressément consacrée à la politique internationale qu’elle rédige elle-même, Juliette Adam s’efforce ainsi de mettre à la disposition de ses amis politiques des éclairages sur la complexité des relations diplomatiques. Défendant farouchement l’idée d’une alliance franco-russe, elle milite par la même occasion pour le développement du slavophilisme en France.
Outre la fréquentation des hommes politiques, Juliette Adam profite de son séjour à Budapest pour évoluer dans les fastes d’une société brillante et éclairée, visiter assidûment tous les quartiers de la ville, se rendre aux bains comme à l’opéra, discuter avec les écrivains et les poètes, écouter les musiciens et s’efforcer dans son récit de définir au plus près ce qui constitue selon elle le « caractère hongrois ».
Cette insatiable curiosité, oscillant sans cesse entre culture et société des hommes – et des femmes –, dessine en miroir le prototype d’une femme engagée.
À ma mère bien-aimée
Mon voyage en Hongrie fut pour elle une inquiétude ; les pages qui le racontent ont distrait ses derniers moments.
Extrait de La Patrie hongroise,publié dans La Nouvelle Revue en 1884
BUDAPEST
AU DÉPART
Partir ! Comment peindre les impressions différentes que ce mot résume ou provoque dans l’esprit de chaque voyageur ?
Faire son voyage de noces, partir deux, dont l’un, libre pour la première fois, va chercher à s’enrouler, à chaque détour du chemin, dans la douce chaîne d’amour.
Voyager pour s’instruire, ne voir que l’utile, même s’il se présente sous la forme agréable, se mouvoir avec méthode, assimiler avec précision, ranger avec ordre, classer tout ce dont il faudra se souvenir, enfin partir, non pour voyager, mais pour avoir voyagé.
Aller devant soi lorsqu’on veut fuir l’ennui, tantôt le perdre et tantôt le rencontrer.
Faire une partie en troupe, n’avoir aucune idée personnelle, parce qu’un cri est jeté avant le vôtre, un jugement porté avant qu’on ait formulé le sien ; ne rien voir parce qu’on a regardé, au même moment, une même chose, dont il semble que chacun ait pris sa part ; discuter, rire, s’amuser.
Quitter brusquement ses affaires pour courir après la solution d’une autre, avoir l’unique pensée d’arriver, lire les journaux qu’on emporte, s’irriter de ce qu’ils vous suivent et ne vous apprennent rien, baisser les stores du wagon le jour, par crainte du soleil, dormir la nuit quand la lune veille, se dire : je reviendrai, je regarderai quand je serai moins occupé de mon but, quand j’aurai le temps.
Voilà bien des façons de voyager ; que d’autres il y en a, variables, diverses, comme l’homme et les causes qui le mènent !
À mon tour je le prononce, le mot: partir ! Mon moi haïssable impose l’absence à ceux qui m’aiment. Je les quitte gaiement pour leur prouver qu’ils ne me sont point nécessaires, et je leur en veux de ne m’avoir pas retenue.
Enfin, je suis seule et libre de toute occupation. C’est une jouissance indéniable que celle de sortir du cercle tracé par des devoirs, par des goûts, par une situation, de disparaître brusquement après avoir mis toutes choses en bel et bon étal, de rejeter au passé jusqu’à la minute qui accompagne le départ. Il faut avoir prévu les possibilités du lendemain pour arrêter ainsi le cours de ses travaux, pour se reposer ; mais quelle joie de partir où la curiosité vous appelle, d’aller où le désir de connaître vous porte ! Quel plaisir d’être un étranger chez les autres, de mieux sentir l’ardeur de son patriotisme, de penser qu’on fera faire la plus belle figure qu’on puisse à une Française.
En wagon, après les adieux, le sort jeté, on s’installe ; puis, à la hâte, déjà en grande vitesse, on repasse ce qu’on a fait dans les derniers jours : « N’ai-je rien oublié, ni personne ? Ai-je emporté, préparé tout ce qui doit rendre mon voyage moins fatigant ? »
Un beau oui répond-il à ces questions, alors on soupire allégé, on s’approuve, un mot aimable vient aux lèvres pour ceux qui vous accompagnent et pour soi.
La trépidation du chemin de fer a, dans le premier moment, des effets singuliers. Elle semble battre la cervelle et y amalgamer toutes les idées. Le mouvement est bon, car il berce, et ce va-et-vient de l’esprit, mêlé au fuyant des choses qui courent sous les fenêtres, fait tout à coup cesser de penser.
Selon le degré de fatigue qui a précédé mon départ, je puis rester ainsi, sans penser, une heure ou un jour. Quand je m’éveille, j’ai dormi, les yeux ouverts ou les poings fermés. Je n’ai plus en l’intelligence une seule notion précise, mon cerveau nage dans un grand vague. Deux mots seulement y flottent ; ceux-là mêmes qui sont inscrits sur mes bagages et les dirigent: de Paris à Budapest
Je regarde enfin hors de moi. Lorsqu’on a beaucoup voyagé, il faut plusieurs jours pour rencontrer autre chose que le déjà-vu ; mais que le souvenir est une chose étrange et qu’il fournit d’étonnements à celui qui l’a amassé.
De Paris à Modane, je me rappelle sans suite ce qui m’a peut-être le moins frappée lors de mon dernier voyage : l’ennui d’un changement de train, que j’évite d’ailleurs cette fois, grâce à d’aimables faveurs ; un wagon qui se retourne à Ambérieux ; une tache de neige oubliée dans une crevasse de rochers et dont je me souviens avec une netteté singulière ; le balcon d’une maison où jouaient des enfants ; des arbres en fleurs ; certaine harmonie remarquée entre l’eau d’un torrent et le ciel. Je recherche cet effet et j’y trouve la première pensée que j’aie eue depuis mon départ d’un rapport entre deux choses.
Voici le moment du réveil complet, de l’examen intérieur, du jugement porté sur soi. Le grand recul d’un milieu, la perspective très lointaine, permettent de donner aux choses quittées leur véritable proportion.
Qu’ai-je fait depuis mon dernier voyage ? Allons, il faut se confesser. Que valait ce dernier livre ? Non pas La Société de Berlin, dont je suis l’humble collaboratrice, l’auteur ayant grande figure et grand talent ; mais Païenne? Pauvre Païenne ! Ceux qui ne l’ont pas beaucoup aimée lui ont-ils pardonné?
À distance de ses ennemis, ce qui blessait d’eux touche moins. M. de La Palisse aurait trouvé cela tout seul. On philosophe sur soi, on se raisonne :
« Voyons, moins de colère ; il faut accepter les hommes tels qu’ils sont, être indulgent pour le prochain comme on voudrait qu’il fût, se dire que s’il a tort d’accuser, il a raison d’avoir, en art, des vertus farouches. »
Loin du monde, où l’orgueil toujours attaqué s’excite pour se défendre, un esprit sincère s’analyse, se critique. La flatterie amicale ou intéressée ne se fait plus entendre. Les bruits de la pensée qui couvrent les voix intérieures se taisent ; dans le grand silence, l’âme parle seule.
Elle est grave, sévère ; elle inspire tout d’abord le doute de soi ; elle fait le compte des dons reçus de la nature et des faveurs de la fortune. Tant de dons et de faveurs, peut-être immérités, exaltent la reconnaissance plus que la vanité. De quoi se plaindre ensuite et qu’oser réclamer ? Recueilli, on écoute les enseignements secrets. Le verbe est là. Il résonne dans la poitrine, il émeut ; de douces larmes viennent aux yeux, dont on est fier, car un peu de divin y est monté. On se jure d’être toujours meilleur, de laisser aux petits les grandes joies, de ne rechercher que sa part des biens de la vie, et, si le sort vous a donné une large place au banquet public, de ne pas trouver injuste qu’il vous marchande le bonheur intime.
Il n’y a qu’une richesse qu’on peut vouloir toujours plus grande, qu’on peut accroître sans la prendre à personne, et qui donne la sérénité dans la jouissance : c’est la richesse morale. Ceux qui la possèdent ne sont pas tenus de l’épargner ; récompensés par leurs propres dépenses, ils ne se croient nul droit à la gratitude des hommes, ils ne gémissent et ne se découragent point. C’est par le bien répandu que l’âme se dégage pour monter dans les voies supérieures. Allégée de ses devoirs terrestres, elle fait les voyages divins.
Se lancer à la découverte de son propre esprit éclairé, en même temps qu’on voyage dans la claire Italie, n’est-ce pas tout voir de soi sous sa forme vraie, obliger ce qui est petit et laid à fuir l’éclat du grand jour, désirer mettre le beau plus en lumière pour le mieux admirer ?
Quel repos, quel apaisement ceux qui ont beaucoup travaillé et beaucoup agi trouvent dans une route longue à parcourir ! L’action la plus heureuse, l’étude la plus goûtée, ont leur fièvre et leur mal. Voyager, c’est entrer en convalescence.
Le ciel bleu enveloppe la terre jusqu’aux confins de l’horizon. Apollon, qui est un dieu ardent, mord, en Italie, tout ce qu’il baise.
Le grand mont Cenis est traversé. Plus d’ombre, plus de discours sur la morale. L’eau chante son ouverture dans le pays musical. Vite on veut parler la belle langue dont on se souvient tout à coup. Elle vous apporte des sonorités longtemps oubliées, qu’on retrouve plus vibrantes et plus poétiques. Les mêmes pensées, avec d’autres mots, offrent des images renouvelées : primarera est plus frais que notre printemps, il spuntare del sole jaillit mieux des nuages italiens que notre soleil ne se lève, et comme : Partenza ! est plus joli que : Allez !
Le paysage, une ville traversée, l’altitude d’un Italien, une parole, un geste, et, comme en un tour d’esprit, l’Italie, son histoire, son art, sa campagne, traversent le souvenir, s’y déroulent, y réapparaissent tout entiers.
Et la Hongrie ? Il n’est pas de voyageur, méritant ce titre, qui ne se figure le pays qu’il va connaître. Lorsque la réalité, plus tard, a pris possession de sa pensée, les tableaux de son imagination s’effacent si complètement qu’il se persuade avoir deviné ce qu’il a vu.