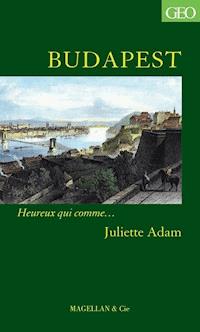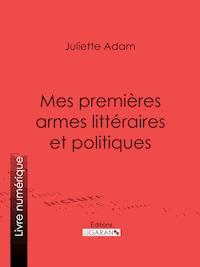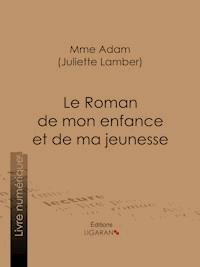
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "A mesure que j'avance en âge, l'une des choses qui m'étonne le plus, c'est la netteté singulière de mes souvenirs d'enfance. Quelques-uns m'ont été maintes fois redits, il est vrai – et ce sont justement les plus lointains, par la bonne qui m'a élevé, par mes grands-parents, pour lesquels tout ce qui me concernait leur unique petite fille prenait une importance à nulle autre pareille."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aujourd’hui l’œuvre d’un écrivain n’a tout son intérêt que si cette œuvre est étudiée dans les impulsions premières qui l’ont fait naître, dans le milieu où elle a été élaborée, dans ses relations avec le but poursuivi et le but atteint.
Autrefois l’écrivain avait peu d’importance. L’œuvre, et c’était assez ! La dualité de la recherche des causes de la production et de la production elle-même ne préoccupait qu’une minorité infime de lecteurs.
Mais, peu à peu, les écrivains s’y prêtant, on a jeté chaque jour des regards plus indiscrets dans la vie personnelle de ceux qui se consacrent à diriger, à éclairer ou à distraire la vie des autres.
Il y a quarante ou cinquante ans le lecteurlisait d’abord un livre, il jugeait l’écrivain à l’écrit, puis, au besoin, il appuyait son jugement sur celui d’un grand critique ayant fait lentement sa preuve de savoir et reconnu digne d’être consulté.
À cette heure il se produit tout le contraire. Le livre est annoncé avec tant d’indiscrétion que le grand public sait par avance quels en sont le thème et le développement. On a parcouru vingt petites analyses, autant d’interviews de l’auteur, et alors sur l’impression de cet ensemble on se décide à lire, ce qui est une faveur insigne pour l’écrivain, car on pourrait fort bien parler de son livre, le juger sans l’avoir lu.
La curiosité générale est insatiable de menus détails sur les faits et gestes de l’écrivain déjà célèbre ou gravitant autour de la notoriété.
Mais si les façons actuelles diluent à l’infini les éléments d’appréciation personnelle d’une œuvre, en revanche elles ajoutent au portrait de l’écrivain, qui se dégage de toutes ces enquêtes, de toutes ces indiscrétions, des traits de physionomie qui ont peut-être un intérêt plus vivant.
Il faut donc en prendre son parti et se demander si, à l’aide d’observations multipliées, étendues de l’œuvre à l’ouvrier, une critique plus large, plus éclairée, ne s’élabore pas, englobanttoutes les intentions de l’écrivain en même temps que tous les résultats obtenus par son livre.
Ou bien serait-ce que, toujours surmenés, nous sommes devenus impropres à ressentir l’onction de la lecture d’une œuvre pour elle-même, sans récits anecdotiques délassant en dehors d’elle quoique se rapportant à elle, que nous ne trouvons plus le loisir des réflexions profondes et mûries, des jugements qui se formulaient en axiomes dont les termes étaient longuement pesés ?
Il faut du temps pour découvrir quelle est la pensée maîtresse d’une œuvre de valeur, pour en dégager les moralités hautes, les hérédités d’art.
Savoir vite, vite étant la loi affolante de la vie nouvelle, on demande à l’auteur, dont on connaît par avance tous les mobiles, ce qu’il a voulu dire, faire, ou prouver ; que de temps on gagne ainsi, et nul risque alors de « rêvasser à faux ».
Ah ! oui, le rêve, parlons-en ! monnaie dorée qui n’a plus cours, qu’on sème derrière soi dans sa hâte à poursuivre ce qui est devant les autres. Si, par hasard, on le retrouve, au retour, ce rêve, comme il apparaît souillé dans la poussière du chemin !
Une question à poser, voire un phénomène à constater, lequel d’ailleurs peut vous « sauteraux yeux », cela se fait en courant, mais scruter seul les pourquoi, découvrir la loi des faits qu’on groupe avec quelque méthode, donner à cette loi son classement logique dans les causalités générales, en vérité quelques mots bien vulgaires peuvent seuls résumer l’impression que ces problèmes, qui nous passionnaient, nous, « les anciens », que ces « balançoires », que ces « machines » font éprouver à ceux qui entendent avant tout être « nouveaux ».
En écrivant vos souvenirs personnels vous encouragez, me dira-t-on, ce que vous paraissez condamner. Je ne condamne rien. Je constate un état d’esprit, des façons d’être. Je pense même que si « de mon temps » l’œuvre tenait toute la place, et que si aujourd’hui l’auteur excite un intérêt disproportionné, l’avenir pourra trouver entre ces deux extrêmes une moyenne équilibrée.
Si la vie littéraire se brûle maintenant par tous les bouts, c’est peut-être qu’à son foyer il n’y a plus que les tisons des torches lumineuses du passé. Il faut que le bois dont se chaufferont les écrivains futurs soit renouvelé et se consume normalement par le milieu.
Quoi qu’il en soit, il est utile peut-être de fixer une époque fuyante aux yeux de ceux qui se précipitentà la poursuite de l’époque qui la remplace.
Les vieillards ont le goût et la mission de raconter ce qui était hier, surtout lorsqu’ils n’imposent pas la supériorité et l’enseignement de ce qui a disparu, qu’ils narrent simplement et laissent aux jeunes le soin de dégager la leçon et de conclure.
Dans les esprits de ceux qui nous ont éduqués, le sentimentalisme, l’humanitarisme, brutalement puis glorieusement refoulés par la Terreur et par l’Empire, étaient rentrés triomphants.
Bien plus, la Révolution et Bonaparte avaient ouvert nos portes à l’afflux du dehors. Nos pères donnèrent asile à toutes les utopies venues d’Italie, d’Allemagne, d’Autriche, de Russie. Le mélange était si ahurissant que toutes tes extravagances en découlèrent.
Autour de la conception sociale des « classes souffrantes » de la conception politique des « crimes des grands », la conscience des « hommes de progrès » évolua.
De l’amour et de l’indignation furent les aliments dont on nourrit notre jeune cœur.
L’Évangile, le socialisme de Jésus, les exemples de sublimité tirés de la Grèce et de Rome, étrangement associés, guidaient les actes de nos pères, inspiraient les premiers des nôtres.
Les ennemis étaient naturellement et exagérément les gens de raison, ceux qui possédaient le lourd bon sens, le « bourgeois ».
Nous sommes, dans nos impulsions premières, les fils des hommes de 1848 ; nos réactions mêmes sont nées de leur action.
Nous n’avons marché qu’entraînés par eux, hantés comme eux de la nécessité d’ajouter à nos rêves illimités ce qu’ils ont cru le contrepoids de l’amour éperdu de l’humanité, la science ; mais la science qui, croyions-nous, apportait l’allégement au travailleur par la machine, le bon marché au pauvre, l’enrichissement égalitaire au misérable.
Les droits de l’homme, phrase ressassée sans qu’elle ait jamais entraîné sa compréhension par ceux qui s’en disaient les défenseurs avant, pendant et après 1848, n’avaient pour eux d’autre signification que de faire réaliser par la société la plus grande somme de bonheur possible pour l’individu.
Ceux qui se proclamaient alors socialistes, et la tradition en est restée, ne tenaient aucun compte de la société, ni de ses relativités, ni de ses moyennes nécessaires, ni de ses « cottes mal taillées », comme il faudrait dire. En face des droits de l’homme socialiste, ils ne consentaient pas à voir se dresser les droits sociaux, expressionsouvent dure des droits de chacun additionnés et devenant les droits de tous.
Les dogmes religieux seuls peuvent affirmer l’absolu du droit de l’âme individuelle, parce que celle-ci ne prend contact avec les autres âmes que dans l’infini. L’absolu ne se réalise que dans les évolutions vers la mort. Mais le contact des hommes dans la vie a des contingences que la société triture bien ou mal selon que les individus s’enchevêtrent bien ou mal, tiraillent la société ou la servent.
Les problèmes sociaux, qu’on les revête de forme dithyrambique ou qu’on les habille d’oripeaux offensants, ne peuvent faire pénétrer dans la société les réformes qu’on pose en leurs noms que si la société est prête à assimiler leurs solutions ; sinon ils la bouleversent, la convulsionnent, et la repoussent vers les réactions.
Je suis la fille d’un père sincèrement sectaire, désintéressé jusqu’au sacrifice, qui rêvait la liberté absolue, l’égalité absolue. Jusqu’à l’année terrible, son esprit a dominé le mien. Il ne crut son rêve réalisé qu’un instant, à la Commune. Aujourd’hui il serait le disciple de M. Brisson, dont il était l’ancêtre. Il ne poursuivrait qu’une idée : le chambardement.
Les chambardeurs et les Brissonnistes ne sontdonc que des intelligences attardées et vieillies que n’a pas délivrées des sophismes la fulgurante et terrible vision de 1870, que n’a pas galvanisées la plainte de la terre Française piétinée par les Prussiens, que n’a pas armées de combativité patriotique le spectacle de la chair pantelante des provinces arrachées à la France, et qui, sur la figuration de notre Patrie, occupaient la place du cœur…
JULIETTE ADAM.
À mesure que j’avance en âge, l’une des choses qui m’étonne le plus, c’est la netteté singulière de mes souvenirs d’enfance. Quelques-uns m’ont été maintes fois redits, il est vrai – et ce sont justement les plus lointains, – par la bonne qui m’a élevée, par mes grands-parents, pour lesquels tout ce qui concernait leur unique petite fille prenait une importance à nulle autre pareille.
Cependant, au travers de ces redites, lorsque je m’interroge, je retrouve des impressions, des actes, que nul des miens n’a pu connaître et qui surgissent à mes yeux avec une précision extraordinaire.
Mais alors je suis prise d’un autre scrupule et je me demande si ces impressions viennent à moi, telles, strictement, que je les ai éprouvées et vécues à leur heure, ou bien, si retournant vers elles avec le bagage de la vie je ne les surcharge pas inconsciemment.
Pour rassurer ma sincérité qui a des exigences troublantes, je m’efforce de me rappeler dans quels termes, à toutes les époques de ma vie j’ai parlé de mon enfance et de m’inspirer de la forme des quelques notes trop rares, hélas ! prises dans ma jeunesse et gardées par les miens. C’est donc avec une préoccupation jalouse de franchise que je commence ce récit.
Élevée par ma grand-mère, je parlerai beaucoup d’elle. Parviendrai-je à la faire revivre dans toute son originalité, dans sa passion du roman qu’elle nous a imposée à tous, faisant de la vie des siens, par l’impulsion première et dominatrice qu’elle donnait à leurs actions, une perpétuelle course au romanesque ?
Nulle femme n’a été plus enfermée dans le gynécée. Je n’ai pas vu ma grand-mère, sauf pour aller le dimanche à la messe de huit heures, sortir cent fois de sa grande maison et de son grand jardin ; en revanche je n’ai jamais rencontré dans un esprit un pareil amour de l’aventure, une telle horreur de l’existence attendue et subie, un appétit si journalier et si impérieux du roman lu ou vécu.
Sa tendresse pour moi fut si absorbante que j’ai pour ainsi dire dévoré sa vie à partir du jour où elle me l’eut consacrée.
Je l’ai aimée exclusivement jusqu’au jour où mon père, avec sa puissance d’arguments, la plupart négateurs, et sa bonté vivifiante, s’empara de mon esprit et m’entraîna dans ses idées.
Entre ces deux êtres exceptionnels et un peu fous, l’un d’une générosité de cœur admirable, d’une droiture de sectaire, passionnément convaincu dans ses exaltations et immodifiable, l’autre d’une vraie noblesse d’âme, de vertu rigide, mais d’une imagination fantaisiste sans limites entre les deux, les adorant tour à tour un peu plus l’un, un peu plus l’autre, j’ai été ballottée à tel point qu’il m’eût été impossible de trouver en moi un point d’appui à mes premières pensées, au milieu d’oscillations continuelles, si je ne m’étais constamment efforcée de me chercher et de me trouver. Et, malgré cet effort, quel temps j’ai mis à me dégager de la double empreinte de mes bien-aimés parents !
Ce qui m’a garée de l’absorption totale de l’un d’eux, ce qui m’a permis d’échapper à l’ardeur de chacun de me pétrir à sa ressemblance, si dissemblable de celle de l’autre, c’est la conscience très hâtive que j’ai eue des bienfaits protecteurs de la volonté personnelle.
Entre mon père et ma grand-mère, je me suis, intuitivement d’abord, puis sûrement plus tard, appliquée à être quelque chose. Est-ce là le point de départ de mon vouloir d’être quelqu’un ?
Dans la lutte sans trêve dont je fus l’enjeu entre mon père et ma grand-mère, nous étions trois.
Il flotte dans mes souvenirs vingt histoires plus bizarres, plus excentriques les unes que les autres, de mariages de bisaïeules, de trisaïeules dans la famille de ma grand-mère maternelle.
Leurs aventures ont tant intéressé mon enfance que je n’hésiterais pas à les livrer à l’ébahissement de mes lecteurs, si, en vérité, elles n’étaient trop nombreuses.
Ma grand-mère, qui causait et contait avec un esprit très vif, très goguenard, très mordant, se plaisait aux récits des romans de ses grand-mères. Elle aimait à faire revivre pour moi toutes ces figures apparentées « de son côté », ne me parlant jamais de la famille de mon père que je ne connus que très tard.
Elle avait l’orgueil de sa caste marchande et bourgeoise. J’ai par elle compris bien des choses obscures dans l’histoire des luttes de la royauté française contre les grands seigneurs féodaux, internationalistes d’alors.
Elle me disait des siens : Nous descendons de ces familles de marchands de Noyon, de Chauny, de Saint-Quentin, si influents dans les conseils des Communes, dont plus d’un membre fut échevin, fidèles à leur ville, à leur province avant tout, fidèles à la royauté, pas toujours au Roi, à la religion, pas toujours au Pape, libéraux, homme de progrès, de pure race gauloise, s’enrichissant avec une probité jalouse, avec mesure, et fort dédaigneux de ceux d’entre eux qui, pour des services rendus au souverain, sollicitaient des lettres de noblesse.
La mère de ma grand-mère était tombée à quatorze ans follement amoureuse d’un parent venu de Noyon pour causer d’affaires et qui, après une journée d’entretiens, plus sérieux que poétiques, continués au déjeuner et au dîner, avait reçu à son départ la déclaration suivante : « Mon cousin, quand vous reviendrez l’année prochaine ce sera pour me demander en mariage. » On rit beaucoup de cette folie, mais, comme la jeune personne fille unique était fort bien dotée, les parents de Noyon moins riches ne dédaignèrent pas l’invitation faite à leur fils.
À quinze ans la précoce Charlotte épousait son cousin Raincourt, fort beau garçon de vingt-deux ans, mais elle mourait en couches l’année suivante, donnant le jour à ma grand-mère.
Le très jeune veuf confia la petite Pélagie à la mère de sa femme, devenue veuve elle-même.
Tandis que mon arrière-grand-père se remariait à vingt-quatre ans et qu’il lui naissait trois filles très sages, très correctement instruites, Sophie, Constance et Anastasie, ma grand-mère poussait en sauvageon et stupéfiait quelquefois par ses excentricités d’enfant affreusement gâtée la paisible ville de Chauny.
Elle lisait, lisait, tout ce qui lui tombait sous la main, sans choix, refusant de se laisser conduire par qui que ce soit ou par quelque raison que ce fût.
Dès qu’elle eut treize ans elle déclara à sa grand-mère que son éducation était terminée. Elle sortit d’une pension où depuis cinq ans elle avait fort peu appris et se consacra alors tout entière, pour toute sa vie, à la lecture des romans.
Spirituelle, vivante, brillante et même quelque peu endiablée, ma grand-mère était rousse à une époque où la couleur des cheveux « carotte » avait peu de succès. Ses dents superbes, son nez fin aux ailes mobiles, ses yeux verts brillants, son teint très blanc pailleté de petites taches dorées, lui donnaient une physionomie de belle laide fort attrayante.
Romanesque comme sa mère et ses nombreuses grand-mères, elle cherchait elle-même celui qui fixerait son choix. Elle eut quinze ans avant de le trouver. Malgré le sort dramatique de sa mère morte en couches et mariée trop jeune, Pélagie commençait à se désespérer de rester si longtemps fille.
Les prédictions de Mlle Lenormand ayant fait surgir par toute la France une foule de nécromanciennes, ma grand-mère en consulta une qui lui dit :
« Vous épouserez un étranger à la ville. »
Et cela ne l’étonna point, car elle connaissait tous les prétendants qui pouvaient aspirer à sa main, et, parmi eux, aucun ne répondait à ce que son imagination cherchait dans un époux. Pas un jeune chaunois de bonne famille ne s’était encore jusque-là payé le luxe d’une aventure romanesque.
Ce n’est point à l’une de ses trois sœurs qu’elle eût été confier son impatience, leur père à toutes ayant déclaré que Pélagie ne se marierait qu’à vingt-et-un ans. Il désirait conserver l’administration des biens de sa première femme le plus longtemps possible au profit des trois filles nées de son second mariage.
Celles-ci d’ailleurs affirmaient que Pélagie était trop extravagante pour être mariable. L’aînée, Sophie, n’avait que quatorze mois de moins que Pélagie mais dix ans de plus comme sagesse et comme savoir.
Pélagie fit avec sa grand-mère le voyage de Noyon à la recherche d’un mari. Elle habita tout un grand mois une jolie maison ancienne, place de la cathédrale, possédée par un vieux parent qui eût désiré convoler en secondes noces avec sa grand-mère. Elle s’amusa de ce roman vieillot, mais ne vit point paraître la main de l’époux cherché, et elle s’en alla comme elle était venue…
Un beau jour il débarque à Chauny un jeune chirurgien en quête de clientèle.
Voilà « l’étranger à la ville » prédit par la sorcière, songe Pélagie même avant de l’avoir aperçu, et elle parle de son espoir à sa grand-mère.
« Il y a une chose à laquelle je ne consentirai jamais, répondit celle-ci, c’est que tu épouses quiconque ne serait pas de bonne famille bourgeoise. »
Et la grand-mère prit un air d’autorité dont sa petite-fille rit de tout son cœur.
Lejeune chirurgien s’appelait Pierre Seron. On ne pouvait être bourgeoisement mieux né. Il descendait d’un médecin de Louis XIV. Son père était le premier médecin de Compiègne ayant de la réputation jusqu’à Paris. Un cousin Seron avait été conventionnel avec Jean de Bien et jouait un grand rôle politique en Belgique d’où les premiers Seron français étaient venus.
« Bonne famille ! » répétaient en chœur Pélagie et sa grand-mère.
Pourvu qu’il n’ait pas eu une existence trop ordinaire, se disait Pélagie.
Pierre Seron passe et repasse dans toutes les rues de la ville pour faire croire qu’au débotté il a déjà une clientèle. Il a bien vite quelques succès qui le font apprécier.
Comme homme il est superbe, un peu trop grand peut-être. Sa taille est celle d’un grenadier de la garde impériale ; de visage il est moins bien. Il porte les cheveux plats à la Napoléon, il a le front un peu étroit et de grands yeux gris à fleur de tête. Son nez est gros, mais sa bouche – il est toujours fraîchement rasé – a un joli sourire gai et narquois malgré des lèvres sensuelles fort épaisses.
Jamais on ne le voit qu’en habit et en cravate blanche. Somme toute bien campé, de belle allure, Pierre Seron a bon air et vraiment c’est un très bel homme.
Il faudrait qu’il n’eût pas l’œil ouvert et l’extrême besoin de faire un mariage riche pour ne pas remarquer l’intérêt que Mlle Pélagie Raincourt prend à chacune de ses allées et venues.
« Pourquoi, son père étant médecin à Compiègne, ce jeune chirurgien est-il venu s’établir à Chauny ? répète la grand-mère. Il y a quelque chose. »
Oh ! oui, il y a quelque chose ! Et, comme Pierre Seron est assez bavard, que Compiègne n’est pas à cent lieues de Chauny, on la sait bien vite, « l’histoire ».
C’est tout simplement un héros de roman ! « Sa vie est un roman, un grand, un vrai roman, » s’écrie un jour Pélagie, rentrant d’une visite à une vieille parente que soigne Pierre Seron et chez laquelle elle a tout appris !
Et la grand-mère, émue de l’émotion de sa petite-fille, écoute le récit amoureusement conté, car déjà Pélagie est éprise de la triste aventure de Pierre Seron autant et plus peut-être que de lui-même.
Il est le second fils d’un père qui l’a exécré dès le jour de sa naissance. Le docteur Seron n’a jamais aimé que son aîné, son orgueil, celui qui aurait dû être « l’unique ».
Ce mot, il l’a répété sans cesse à la mère craintive, soumise, qui osait à peine protéger l’enfant malmené, battu, vivant avec les domestiques.
Pauvre petit, sauf un baiser rare, une caresse furtive de sa mère, il a été la victime des siens.
Un jour qu’il est très malade du croup, son père veut l’envoyer à l’hôpital à cause de la contagion pour l’aîné. La mère, cette fois, résiste, s’enferme avec lui dans sa toute petite chambre, le soigne, le veille, l’arrache à force d’énergie et de dévouement à la mort. Mais elle a épuisé toutes ses forces. Elle reste ensuite comme hébétée, et l’enfant souffre dans sa convalescence ; il est en danger presque autant que durant sa maladie.
À neuf ans, un domestique l’accuse d’un vol que lui-même a commis. Il est chassé de la maison paternelle un soir d’automne, n’ayant pour tout bien que les pauvres vêtements qu’il porte et quelques écus péniblement amassés par sa mère qui les lui glisse dans la main sans même l’embrasser.
Il se couche en travers de la porte lorsqu’elle se referme sur lui et il espère que quelqu’un en passant l’écrasera. Il crie, il supplie. Les voisins s’ameutent autour de lui, le plaignent, répétant haut, très haut, que c’est abominable, que la justice devrait protéger ce malheureux petit, mais pas un n’ose l’emmener chez lui.
Dès que Pierre est seul, de nouveau abandonné, il regarde une dernière fois « les grands yeux luisants et méchants des fenêtres éclairées de la maison ».
C’est, dit Pélagie à sa grand-mère, la phrase dont Pierre Seron s’est servi en contant son histoire. Le pauvre enfant va droit devant lui. Où ? il ne le sait pas. Instinctivement il se dirige vers la ferme où l’envoyaient chaque matin à la première heure et par tous les temps, les domestiques de son père chercher du lait.
La fermière, plus d’une fois, l’a pris en pitié lorsqu’il lui a dit sa peine, et il se rappelle l’une de ses paroles.
« Tu serais plus heureux gardeur de vaches. »
Il entre. Les fermiers soupent. Il s’assied auprès d’eux et éclate en sanglots. Il ne peut parler.
« On t’a chassé ? » lui demande la fermière. Il fait signe que oui. Alors les braves gens le consolent, l’obligent à souper, vont le coucher sur de la paille fraîche à l’écurie et le gardent, l’occupant à la ferme où il gagne sa nourriture.
L’année suivante le vacher étant parti, à dix ans, ayant l’air d’en avoir quatorze tant il a grandi, il le remplace. Tout ce qu’il peut faire pour prouver sa reconnaissance à ceux qui l’ont recueilli, il le fait. Très appliqué, dévoué, intelligent, il supplée à sa jeunesse par une bonne volonté sans cesse en éveil.
Le fermier, dès le lendemain de l’entrée de Pierre chez lui, refusa de servir du lait au docteur Seron. Plus tard il alla le braver, pensant l’humilier lorsque son fils devint vacher.
« Tant mieux, répondit le père avec dureté, c’est probablement le seul métier qu’il pourra jamais faire. »
Ces paroles, répétées à Pierre, au lieu de le désespérer, fixèrent sa destinée.
« Je serai un jour le docteur Seron, » se dit-il.
Sa mère lui avait appris à lire dans un vieux petit dictionnaire de médecine latin-français qu’il ne quittait pas et à l’aide duquel il se perfectionnait dans sa connaissance bien imparfaite de l’assemblage des mots.
À partir de ce jour, durant qu’il gardait ses vaches, non seulement il s’exerçait à bien lire, à écrire les lettres avec un bâton sur la terre, mais il apprenait un à un les mots latins et français du dictionnaire, et sa jeune cervelle s’éclairait au contact de cette science brute et informe.
Dès qu’il gagna quelque argent il acheta des livres de médecine et il étudia avec rage le jour, le soir sous la lampe fumeuse du fermier, la nuit au clair de lune.
Il ramassa des simples pour un herboriste rencontré dans les champs et reçut de lui d’utiles leçons. Cet herboriste s’intéressa au pauvre enfant, dirigea un peu ses études et lui acheta des livres utiles.
Pierre inventa un panier de jonc très joli pour mettre le fromage frais en été, et la fermière qui vendait dans ces paniers ses fromages quelques sous de plus en partagea le bénéfice avec Pierre.
Il confiait ses économies à son protecteur l’herboriste qui prêtait aux uns et aux autres de petites sommes, et en tirait quelques rentes au profit de la maigre bourse du vacher.
Quelques années se passèrent. Pierre essaya plusieurs fois de revoir sa mère. Elle vivait enfermée, séquestrée peut-être, et il ne put jamais parvenir jusqu’à elle.
Son frère qui avait cinq ans de plus que lui et qui étudiait la médecine à Paris festoyait durant les vacances avec les jeunes messieurs de la ville.
Pierre l’entendit un jour nommer par un camarade dans une troupe de jeunes gens et de belles demoiselles qui venaient boire du lait chaud à la ferme.
« Ce lait vous est servi par le vacher d’ici, qui est votre frère légitime, lui dit Pierre en lui présentant un bol mousseux.
– Mon frère est mort, répondit l’aîné.
– Vous le retrouverez avant quelques années bien vivant en face de vous à Paris, monsieur, » répliqua Pierre.
On parla dans tout Compiègne de l’histoire oubliée de l’enfant chassé et abandonné.
Comme l’aîné des Seron donnait peu de satisfaction à son père, on se dit que c’était Dieu qui punissait ce dernier de sa cruauté, mais on ne prêta aucune attention à la prédiction du vacher.
À dix-neuf ans Pierre possédait onze cents francs d’économie. Un jour d’automne que son père prenait la diligence, comme il le faisait chaque quinzaine pour aller embrasser son fils aîné à Paris et surtout pour le recommander à ses professeurs qui ne pouvaient rien faire de cet étudiant ennemi de l’étude, Pierre Seron, le cadet, se dirigeait pieds nus, pour ne pas user ses souliers, et sa besace au dos vers la capitale.
On devine dans quel bouge du quartier latin il se logea. Avant de se faire inscrire à la Faculté il chercha sur les quais un travail de nuit. Sa haute taille lui devint la meilleure des recommandations. Il fut engagé comme déchargeur de bateaux de huit heures du soir à deux heures du matin au prix de quarante-cinq sous. Il ne lui en fallait pas plus pour vivre, et il espéra même ajouter à son pécule qu’il craignait ne pouvoir lui suffire pour ses inscriptions et ses livres.
Combien de fois moi-même ai-je fait raconter à mon grand-père cette époque de sa vie qu’il se rappelait fièrement.
Pélagie continuait son récit à sa grand-mère qui écoutait bouche bée, attendrie aux larmes.
Pierre avait emporté ses habits de travail, et chaque soir il devenait, non un débardeur de bal public comme son frère, mais un déchargeur sur les quais de la Seine.
Le jour, il suivait les cours avec un zèle, une application, une ardeur passionnés, qui le firent bien vite distinguer par ses professeurs.
Son nom les frappa ; ils l’interrogèrent et l’un d’eux, que le docteur Seron avait blessé en lui faisant d’aigres reproches sur sa sévérité envers son fils aîné, exalta le cadet, s’en occupa spécialement, et bientôt il y eut deux camps : celui des travailleurs amis de Pierre, celui des bambocheurs amis de Théophile Seron. Une fois on en vint aux mains. Le cadet prit son aîné à bout de bras et le secoua fortement.
« Je vous avais bien dit que votre frère le vacher vous retrouverait à Paris, » lui dit-il en le laissant retomber d’un peu haut.
Tandis que son frère festoyait grassement, Pierre gelait sous les toits en hiver, cuisait en été, mangeant et dormant mal, travaillant chaque nuit sur les quais. Le dimanche il raccommodait ses habits achetés chez le fripier et fort peu solides, il faisait la lessive de son pauvre linge. Pierre ne portait que des plastrons et des manchettes, sa chemise était de toile grossière, ses chaussettes n’avaient que des sous-pieds et pas de pieds. Il connut toutes les misères et toutes les privations.
Il eut en revanche la joie de comprendre l’avantage d’être né de parents affinés. Les bonnes manières lui furent faciles et son intelligence aidée par l’hérédité lui sembla toute préparée à s’ouvrir aux études médicales les plus ardues. Il se découvrit des facultés d’assimilation qui l’étonnèrent lui-même. Bref, il passa brillamment ses examens, tandis que monsieur son frère était refusé à tous.
Le docteur Seron, que Pierre rencontra plus d’une fois en compagnie de son frère, lui parut un vieillard courbé par le poids des chagrins ; son fils bien-aimé le ruinait.
Lorsqu’il eut terminé ses études et conquis ses titres, Pierre Seron écrivit deux lettres, une à son père et une à sa mère, leur disant qu’il revenait à eux comme un fils seulement éloigné, qu’il pardonnait. Il ne reçut aucune réponse de sa mère, mais une malédiction furieuse de son père.
Son ami, l’herboriste de Compiègne, découvrit la situation de Chauny et lui fit quelques avances nécessaires pour l’occuper. Il ne trouva d’aide qu’auprès de ce fidèle protecteur.
« C’est ainsi, continua Pélagie Raincourt, que Pierre Seron vint s’établir dans la ville où je l’attendais, » et elle ajouta : « Grand-mère, il me le faut pour mari ! »
« Sans doute répondit la grand-mère, je l’aime déjà, moi aussi, ce brave cœur, mais il faut que tu lui plaises. »
Pélagie n’avait pas pensé à cela.
Un ami fut chargé de demander au docteur Seron, – on l’appelait déjà ainsi, sans ajouter son nom de baptême, pour le venger des cruautés de son père, – un ami fut chargé de l’interroger sur les sentiments que pourrait lui inspirer Mlle Pélagie Raincourt.
« Belle-fille, répondit-il, mais elle est rousse, et je déteste les rousses. »
On devine ce que dut éprouver Pélagie, lorsque sa grand-mère, avec d’infinies précautions oratoires, lui communiqua cette réponse, à elle qui s’était crue jusque-là irrésistible.
Son désespoir et sa colère furent tels qu’elle menaça de se jeter par la fenêtre. Comme elle était dans sa chambre, au premier étage, elle se pencha si brusquement, que sa grand-mère prise de frayeur l’enlaça avec force et l’attira brusquement en arrière, mais elle se prit dans la robe longue de Pélagie, tomba et se démit le poignet.
On fit appeler le docteur Seron qui accourut, et, cric-crac, en rebouteur désireux de frapper l’imagination de clients d’importance plus qu’en chirurgien prudent, il remit le poignet.
Pélagie prodigua à son adorée grand-mère, qu’elle voyait souffrir par sa faute, toutes ses tendresses. Elle fut hautaine, presque insolente avec le docteur Seron qui n’aimait pas les rousses, mais elle le frappa par son extrême élégance et par un esprit qu’il s’étonna de trouver si original, si brillant chez une provinciale. Il vint deux fois le jour, et le cruel plut davantage encore avec son joli accent de Compiègne et de Paris un peu grasseyant.
Mais Pélagie, remuée par trop d’émotions, eut la fièvre et s’alita. Pierre prit goût à la cure et il eut bientôt une sorte de folie en se sentant adoré par une attirante et riche jeune fille de seize ans à peine, et maternellement aimé par la grand-mère, lui qui considérait l’affection familiale comme le bien le plus rare et le plus enviable de tous.
Pierre, un soir, fit sa déclaration brûlante, telle que Pélagie pouvait la désirer ; séance tenante, tous deux vinrent s’agenouiller devant la grand-mère ravie, et enlever son consentement.
Le docteur Seron demanda sur l’heure qu’on fixât la date du mariage, mais il fallut le mettre au courant de la situation, lui révéler quels étaient les obstacles à une si prompte solution.
Pierre très pauvre, et qui n’était nullement insensible aux beaux deniers de la fiancée, trouvait un peu dur d’abandonner au beau-père, comme le conseillait la grand-mère tout ou majeure partie de la fameuse dot de sa première femme que M. Raincourt ne voulait pas lâcher. Il proposa de réfléchir quelques jours aux moyens de s’y prendre, de consulter le notaire ; mais le notaire ne vit aucune possibilité de se passer du consentement du père et d’échapper aux conditions que la grand-mère de Pélagie supposait qu’il dût y mettre.
« Je doublerai, dit celle-ci, ce que je comptais donner à Pélagie, si son père marchande le bonheur de ma bien-aimée petite-fille. »
Le docteur Seron s’en alla donc demander à M. Raincourt la main de sa fille Pélagie, qui lui fut refusée jusqu’au moment où il proposa de ne réclamer, s’il obtenait cette main, fort belle d’ailleurs, aucun compte de tutelle.
L’accord conclu, on fixa le jour du mariage.
Pierre Seron, une fois encore, écrivit à son père et à sa mère, s’acharnant à mendier une part de leur tendresse. Rien, toujours rien de sa mère, mais plus une seule malédiction de son père.
Il apprit par une lettre de son ami l’herboriste, qui acceptait d’être l’un des témoins de son mariage, que son frère était mourant à Compiègne ; son père aux trois quarts ruiné, ayant à peu près perdu sa clientèle à la suite de ses trop fréquents voyages à Paris pour arracher son fils à la débauche, avait été frappé de paralysie.
Ainsi le malheur accablait celui qui s’était endurci dans l’injustice, dans la cruauté, tandis que le pauvre enfant, chassé honteusement de la maison paternelle, voyait sa situation grandir, l’heure de ses joies complètes approcher.
Il allait être heureux, posséder une jolie fortune, une femme captivante, dont il était de plus en plus épris et qui l’aimait follement.
Mais voilà que la veille du jour tant désiré Pélagie éprouva le besoin d’exaspérer ses sœurs, déjà irritées d’un mariage qui la rendait si insolemment heureuse. Elle voulut se venger de l’éternel mot si blessant que lui avait tant de fois répété sa sœur cadette, Sophie : « Tu es immariable ! »
Alors que le contrat était signé, que tout était prêt, sans une anicroche, pour la noce du lendemain, une scène eut lieu, très violente, entre la future Mme Pierre Seron et ses trois sœurs.
La belle-mère de Pélagie prit parti pour ses filles, le mari pour sa femme, et tout fut rompu, M. Raincourt reprenant sa parole, reniant ses engagements de père.
La grand-mère de Pélagie, cette fois, perdit patience, Pierre se désespéra et la jeune fille alla se coucher, furieuse contre elle-même, pleurant, mordant son oreiller, hantée dans sa fiévreuse insomnie par les projets les plus bizarres, s’arrêtant aux résolutions les plus violentes.
Au lever du soleil, affolée, ne sachant ce qu’elle faisait, elle sortit de la maison en robe de chambre, en bonnet de nuit, partant à pied pour Noyon, se disant qu’elle demanderait asile au vieil ami de sa grand-mère, son propre parent.
Ce qu’elle voulait avant tout, c’était d’échapper aux reproches de Pierre, de ne pas subir le blâme de sa grand-mère, de ne pas entendre le bruit des ragots de la ville, qui, lui semblait-il, parviendrait jusqu’à ses oreilles. L’humiliation d’être condamnée par l’opinion générale, le chagrin de faire souffrir Pierre, qui déjà avait tant souffert, l’angoissaient au point de l’obliger à fuir. Elle essayait d’échapper à sa propre condamnation, qui courait après elle.
Ayant fait quelques kilomètres, peu habituée à marcher, exténuée, elle s’assit sur un tas de pierres, la tête dans ses mains, criant tout haut son désespoir.
Un cavalier passe, en habit et cravate blanche, sans chapeau, monté à poil nu : c’est Pierre. Il l’a vue…
« Votre père consent à nouveau : vite, lui dit-il en mettant pied à terre, venez, je vous prends en croupe, et, pour être sûr qu’il ne retirera pas sa parole encore une fois et que vous ne recommencerez pas quelque coup de tête, nous irons droit à l’église, où votre grand-mère a fait tout préparer. C’est elle qui a deviné que vous deviez être sur la route de Noyon, si vous n’étiez pas chez moi, car elle vous a soupçonnée de cette abomination, folle que vous êtes. »
Il la hissait sur le cheval, la maintenait d’un bras, tenant de l’autre une simple longe passée au cou de la bête.
« Allons, allons, il est bien temps qu’on vous donne un maître, lui dit-il. Ce que vous méritez d’être battue !…
– Mais, répond-elle égayée par le romanesque de l’aventure, je ne vais pas me marier en bonnet de nuit.
– Pourquoi pas ? C’est une pénitence comme une autre, et vous avez grandement besoin d’absolution. Vous vous habillerez en mariée quand vous le serez et pour la fin de la noce. »
C’est en croupe que ma grand-mère fait sa rentrée à Chauny. Il est neuf heures du matin. Toutes les commères sont aux fenêtres, dans la rue, à la porte de l’église.
Pélagie descend de cheval, ébouriffée sous son bonnet de nuit, les yeux encore gonflés par les larmes. Une femme du peuple attache un œillet blanc à son bonnet. Elle fait son entrée dans l’église au bras de Pierre. C’est un éclat de rire général. Jamais on n’a vu mariée pareille. Les sœurs et la belle-mère sont bien vengées.
Le vieux doyen, qui cependant aime Pélagie pour sa charité active, ne peut dominer un bon rire.
Il se hâte, souriant jusqu’à la fin de la cérémonie.
Pélagie se retourne. On croit que sa confusion va la faire rentrer sous terre.
« C’est un mariage gai, dit-elle. »
Et c’est ainsi que fut mariée ma très romanesque grand-mère, scandalisant un grand nombre de gens et amusant les autres.
L’œillet et le bonnet de nuit devinrent des reliques. Je les ai vus et touchés, sachant leur histoire.
Vingt jours après son mariage, quoiqu’il ait ou l’un des premiers numéros au moment du tirage au sort, le docteur Seron reçoit l’ordre de partir pour l’armée impériale comme chirurgien. Il faut trouver un chirurgien qui le remplace, et cela coûte une très grosse somme.
Au bout de l’année, Mme Pierre Seron est mère de deux jumelles. L’union est parfaite dans le ménage. Le pauvre enfant abandonné est un père attendri, heureux, qui rentre à la maison pour bercer et promener ses filles en chantant.
Les petites n’ont pas huit mois que le pauvre chirurgien reçoit à nouveau l’ordre de rejoindre l’armée impériale. Elle est en Allemagne. Pierre Seron ne cherche même plus un remplaçant. La dot s’amaigrit par trop, à la fin, et il faut songer à celle des jumelles. Il part, le cœur déchiré.
La grand-mère de Pélagie vient habiter avec elle, parce qu’il est impossible de laisser seule une jeune femme, d’autant que le père, les sœurs, la belle-mère de Pélagie, fort peu ménagés par le docteur Seron, qui les a ridiculisés par ses bons mots et auxquels il est parvenu à rendre la vie intenable, voient dans le départ du jeune chirurgien l’occasion de se venger ; mais Pélagie, mais sa grand-mère, sont défendues par les nombreux amis de Pierre ; toute la ville prend parti pour la jeune demi-veuve ; blâmé, chansonné, irrité, M. Raincourt, finalement, quitte Chauny, pour aller se fixer dans le Soissonnais, pays de sa femme.
Pélagie respire, car elle n’a cessé d’être harcelée par son père. Hélas ! le malheur l’accable. Elle perd sa grand-mère et la voilà seule, chef de famille, forcée avant dix-huit ans d’administrer sa fortune, ne recevant qu’à des intervalles de moins en moins rapprochés des nouvelles de son mari.
Un matin, Chauny s’éveille, menacée. Les alliés sont aux portes de la ville. On dit qu’ils saccagent tout sur leur passage. Mais il y a pire encore. Au pont du canal, les huit premiers Prussiens qui se présentent sont abattus. Deux heures après, les habitants de Chauny apprennent que s’ils ne paient pas dans les vingt-quatre heures une énorme indemnité de guerre ils seront tous passés au fil de l’épée.
Mme Seron seule, sans défenseurs, est l’une des plus taxées, et elle est forcée, pour payer la part qu’on exige d’elle, de prendre des engagements ruineux.
Elle passe une nuit à creuser le sol de sa cave, sous un tonneau qu’elle roule avec des difficultés inouïes et qu’elle remet en place, aidée de la nourrice de l’une de ses petites filles ; c’est elle qui nourrit l’autre. Mme Seron a caché là ses bijoux, son argenterie, une caisse dans laquelle sont ses papiers les plus importants. Cela fait, elle songe, comme beaucoup d’autres, à abandonner sa maison, qui est très en vue sur la place et dans laquelle vont venir se loger les envahisseurs.
On perd la tête, on fuit, on va « se cacher dans les bois » où les ennemis, dit-on, ne s’aventurent pas.
Elle emporte à peine quelques vêtements, un peu de linge, qu’elle charge comme une pauvresse, dans un sac, sur ses épaules. La nourrice porte les deux petites, et les voilà sur la route de Viry.
En chemin Mme Seron avise un convoi de mulets qui reviennent à vide de la ville où ils ont porté du bois. Chaque bête a deux paniers accrochés à son bât. Elle hisse la nourrice sur l’un des mulets et arrange dans chacun des paniers l’une des petites jumelles. La nourrice est une paysanne qui sait conduire un mulet, mais la jeune femme en ce moment a peur de tout ; au lieu de monter elle-même sur un autre mulet, elle reste à côté de celui qui porte ses petites, la main appuyée à l’un des paniers.
Elle rencontre MM. de Sainte-Aldegonde à cheval gantés de blanc, qui, dit le muletier, attendent leurs « bons amis » les ennemis depuis plusieurs jours et vont au-devant d’eux.
Les Messieurs de Sainte-Aldegonde galopent, et l’allure de leurs chevaux met les mulets en gaieté. Ils s’emportent follement. La nourrice est semée sur la route. Les petites poussent d’affreux cris de douleur ; la mère appelle au secours, épouvantée, courant, pleurant, suppliante.
« Jamais, disait-elle plus tard, je n’ai souffert pareille torture. »
Le muletier enfourche l’un des derniers mulets et galope vers celui dont les paniers contiennent les jumelles. Il l’arrête. La mère et la nourrice, qui est seulement blessée sans gravité au front et à la joue, accourent, et chacune enlève l’une des petites qui ont les mains, la figure en sang, et sont évanouies. Les malheureuses tiennent les jumelles dans leurs bras ; elles les regardent étranglées par le chagrin, comme hébétées, sans un mot : elles pleurent…
Machinalement elles rebroussent chemin, reviennent à Chauny ne sachant où elles sont ni ce qu’elles font, les yeux rivés au petit visage immobile et sanglant ; elles entrent dans une maison, demandent de l’eau, lavent les écorchures. La pauvre mère a conservé sa besace, le sac de linge. On déshabille les mignonnes, on change leurs robes maculées, on les frotte avec du vinaigre, avec de l’eau-de-vie. Presque en même temps elles rouvrent les yeux pour se plaindre douloureusement.
Leurs plaies continuent de saigner et elles font pitié. Lorsque Mme Seron arrive devant sa maison, des cosaques s’apprêtent à faire sauter la porte fermée ; la nourrice s’approche avec la clef pour ouvrir. Elle aussi a le front et la joue entourés d’un linge ensanglanté. L’enfant qui est dans ses bras gémit, l’autre dans les bras de sa mère crie.
Les cosaques apitoyés parlent un peu le français. Ils sont quatre : deux prennent les petites, les bercent, tandis que leur mère et leur nourrice lavent une fois encore le douloureux visage et appliquent du taffetas gommé sur les écorchures.
Mme Seron, au bout de quelques heures, est un peu rassurée sur ses petites, elle l’est complètement sur les cosaques qu’elle traite de son mieux ; les jours suivants ils aident au ménage, la cuisinière s’étant enfuie « dans les bois » ; ils promènent les jumelles, les amusent, les soignent avec dévouement, car elles ne se remettent pas de l’ébranlement qu’elles ont subi et elles boivent du lait de nourrices qui ont été trop bouleversées, qui restent fiévreuses.
Les petites filles dépérissent, et un ami de leur père, malgré l’énergie de sa médication, ne peut les sauver ; elles sont prises de convulsion et meurent toutes deux le même jour. Les cosaques pleurent les enfants avec la mère.
Seule, toute seule, souffrant des malheurs de son pays, car elle est très Française, désespérée de la mort de ses adorées petites, de la mort de sa grand-mère, de l’absence de son mari, des dangers qu’il court, exploitée par des gens d’affaires contre lesquels elle se débat, la vie devient si atroce pour la jeune femme qu’elle tente de se suicider. Un cosaque la sauve ; ses camarades et lui la consolent si naïvement, de façon si touchante, qu’elle se laisse tristement vivre.
Mme Seron a répété toute sa vie et elle l’a profondément gravé plus tard en moi, sa petite-fille, un axiome : « Il faut haïr les Anglais, craindre la brutalité prussienne, aimer les Russes. »
Mon grand-père revint de l’armée suivi d’une Allemande qui ne l’avait pas quitté et qui refusait de croire à son mariage. Il eut toutes les peines du monde à s’en débarrasser, et il n’y parvint que parce que sa femme s’en mêla. Blessée au cœur, Pélagie ne trouva la force de réagir que dans sa passion du roman. Elle en vécut un et sa lutte avec sa rivale fut des plus mouvementées. Finalement elle obtint, après avoir été assaillie chez elle par « l’Allemande », que celle-ci fût conduite à la frontière.
Le docteur Seron avait assisté à des batailles parmi lesquelles celles de Lutzen et de Bautzen occupaient la première place. Il en parlait sans cesse comme aussi des bras et des jambes coupées avec son maître Larrey, chirurgien en chef des armées impériales, jambes et bras dont le nombre croissait d’année en année.
La fidélité conjugale de Pierre, émiettée dans ses campagnes, ne se retrouva plus. Il acquit la réputation d’une sorte de don Juan, sur les conquêtes duquel les mauvaises langues de la ville ne tarissaient pas.
Quand je suis devenue grande, combien de grands-oncles m’a-t-on dénoncés !
Ayant été privé de vin en Allemagne il l’aima davantage à son retour en France. Très sobre le matin jusqu’à l’heure du déjeuner, heure à laquelle il rentrait après avoir fait ses opérations à l’hôpital ou en ville, il buvait régulièrement par jour à la maison douze bouteilles d’un vin de mâcon léger, toujours le même. Dire qu’il se grisait, ce si grand et si gros homme, serait excessif, mais il était, l’après-midi, bavard, goguenard, hâbleur, au point que toutes les plaisanteries, tous les demi-mensonges étaient à Chauny et aux environs appelés des « seronnades ».
La passion de ma grand-mère pour son mari s’en était allée illusion par illusion, malgré l’effort prodigieux qu’elle avait fait pour ne pas juger mon grand-père sur les premières preuves données par lui de ses appétits matériels, de sa façon brutale de jouir de la vie. La force de Pierre était telle dans tous les exercices du corps, à la chasse, à la pêche, qu’il lassait les plus intrépides ; son amour du remue-ménage était si naïf, sa gaîté si exubérante qu’on pardonnait à ce tempérament des emportements, des excès même qu’on n’eût point pardonnés à d’autres.
Mais peu à peu il fatiguait à la maison tandis qu’on se l’arrachait au dehors. Sa femme le vit partir à l’aube, rentrer tard dans la nuit sans aucun regret. Jamais à l’heure des repas il ne se faisait attendre, et il lui fallait prendre pour cela une peine extrême.
« Il est de la dernière galanterie, répétait-il, traînant son accent grasseyant sur le mot dernière, de ne pas laisser la compagne de sa maison, sinon de sa vie, seule à table. »
Une fille, Olympe, était née dans le ménage après le départ de l’Allemande ; sa mère la nourrit, l’éleva avec amour, et l’on devine si l’imaginative Pélagie rêva de bonne heure au roman du mariage de celle qui devait rester son unique enfant.