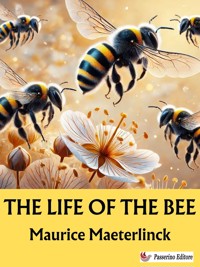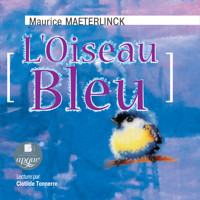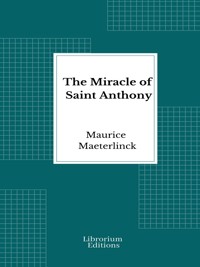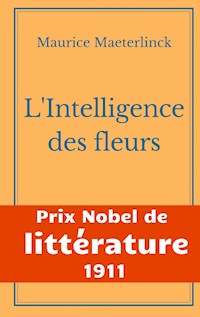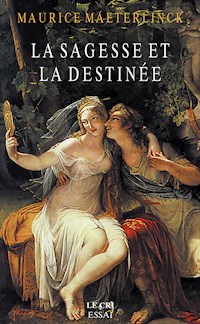Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : « Les véritables souvenirs, les seuls qui survivent, les seuls qui ne vieillissent pas, les seuls qui soient enracinés, sont les souvenirs de l’enfance et de la première jeunesse. Jusqu’à la fin de nos jours, ils gardent la grâce, l’innocence, le velouté de leur naissance et ceux qui naissent contrefaits, malpropres, malheureux ou stupides tombent dans les ténèbres où ils rejoignent les souvenirs de l’âge mûr qui méritent rarement d’être recueillis. »
Comme le film des premières années se déroule dans la mémoire de celui qui est sur le point de quitter la vie, ces
Bulles bleues apparaissent à
Maeterlinck quelques mois avant son dernier appareillage. Elles s'imposent à lui, il ne les rédige pas, les dicte à sa femme au fil de ses souvenirs lointains. Et c'est tout un univers qui ressurgit de l'oubli, nimbé de poésie, mais précis comme des enluminures médiévales.
Maeterlinck n'idéalise pas ce qu'il se remémore. Il est quelquefois féroce, satirique, insolemment espiègle. Mais ce qu'il nous confie en toute simplicité, sans la moindre tentation d'autocélébration, c'est l'enfance d'un artiste qui deviendra poète, inspirera plasticiens et musiciens, sera l'un des pionniers de la modernité dont on mesure, plus encore aujourd'hui que jadis, quel découvreur il était.
Il est rare de pouvoir rejoindre avec une telle intimité la source de ce qui deviendrait un destin d'exception et une oeuvre d'une importance essentielle. Les
Bulles bleues nous réservent cette grâce.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice MAETERLINCK (Gand 1862-Nice 1949) est un des plus grand écrivains belges d'expression française. Il a obtenu le Prix Nobel en 1911.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BULLES BLEUES
Maurice Maeterlinck
Bulles bleues
Souvenirs heureux
Édition présentée et annotée
par Raymond Trousson
La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
ISBN 978-2-8710-6783-2
© Le Cri édition,
Avenue Léopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
En couverture :La Tréfilerie(détail), aquarelle d’Albrecht Dürer (1489/1490)
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
« Tous mes morts me reviennent… »
Bulles bleuesest le dernier ouvrage de Maurice Maeterlinck, conçu au terme d’une existence bien remplie. Réfugié aux États-Unis en 1939, il y passa toute la durée de la guerre et ne regagna l’Europe qu’en août 1947. Il continua de travailler pendant son exil.L’Autre monde ou le Cadran stellaireparaît à New York en 1942, et il n’a pas renoncé au théâtre :Le Miracle des mèressera publié en 1944, uneJeanne d’Arcen 1948, d’autres pièces –L’Abbé Sétubal, Les Trois Justiciers, Le Jugement dernier– ne paraîtront, posthumes, qu’en 1959. Ces années sont aussi celles où il dicte à sa femme, Renée Dahon, des souvenirs de jeunesse intitulésBulles bleues, parus aux Éditions du Rocher, à Monaco, en juin 1948, moins d’un an avant sa mort, le 5 mai 1949.
Autobiographie ? Mémoires ? Plus simplement, annonce le sous-titre, des « souvenirs heureux », remémoration souriante, parfois attendrie, d’un lointain passé. Même si l’œuvre respecte – sans s’y asservir – une certaine chronologie en allant de la naissance à l’accueil fracassant fait par Octave Mirbeau àLa Princesse Maleine, elle n’a rien d’une narration linéaire, continue, l’auteur choisissant d’égrener des portraits, des scènes, des moments qu’il se plaît à revivre. Pas de révélations sensationnelles, point de représentation de l’artiste en prix Nobel, et pas davantage de mise à nu d’une personnalité jusque dans ses aspects les moins avouables, de cette analyseintus et in cutequi caractériseLes Confessionsd’un Jean-Jacques Rousseau. Ce n’est pas non plus, comme chez Stendhal dans laVie de Henry Brulard, une démarche heuristique où l’écrivain parti en quête de lui-même attend de l’acte d’écriture un dévoilement progressif : « Qu’ai-je été ? Que suis-je ? […] je serais bien embarrassé de le dire. » L’auteur deLa Chartreuse de Parmenarre son existence dans l’espoir que sa propre vérité finira par se révéler à lui au fil de la narration : « Je cherche à atteindre cette vérité qui me fuit. » Pour lui, l’autobiographie n’est pas portrait, mais enquête, investigation au résultat incertain.
Il ne pouvait en être ainsi pour celui qui écrivait déjà à Léon Dommartin, le 20 novembre 1890 : « Je n’ai pas de biographie ; il ne m’est jamais rien arrivé de plus étonnant que ma naissance1. » Maeterlinck ne bâtit pas son récit pour structureraposteriorison existence, lui conférer un sens, transformer une succession d’événements en destin, voire en mythe, à la manière d’un Julien Green qui tentait, regardant par-dessus son épaule, de dégager du chaos des faits et de l’accumulation des jours, un sens, un itinéraire : « Je voudrais, disait-il, retrouver le fil plus fin qu’un cheveu qui passe à travers ma vie, de ma naissance à ma mort, qui guide, qui lie et qui explique. » Maeterlinck n’a pas cette ambition. Bien plutôt, pour échapper à la tristesse des années de guerre, à la hantise du vieillissement et de l’approche de la mort, il se retourne vers l’ensoleillement des années de jeunesse, privilégie l’enfance et l’adolescence heureuses, navigation, à travers le temps, vers les rivages des Îles Fortunées. Au soir de sa vie, il écrit aussi pour vivre la pure volupté du souvenir – pourrevivreen triomphant du temps et de la fin prochaine. D’où cette émotion dans laquelle il se complaît en retrouvant les sensations de jadis. Cette émotion, tous les autobiographes l’ont partagée. Le récit de vie, même fragmentaire, procède de la nostalgie, même chez ceux qui, comme Sartre, ont prétendu s’en affranchir ou la renier – « Le lecteur a compris, dit l’auteur desMots, que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit ». À mesure qu’il la revit, le narrateur se retrouve et souhaite communiquer aux autres ce qu’il a ressenti, à la manière de Lamartine au seuil des sesConfidences : « C’est l’heure […] de jeter quelques regards en arrière et de ressaisir, à travers les ombres qui commencent déjà à s’étendre et à vous les disputer, les sites, les heures, les personnes, les douces mémoires que le soir efface et qu’on voudrait faire revivre à jamais dans le cœur d’un autre homme comme elles vivent à jamais dans votre propre cœur. »
Maeterlinck ne veut donc retenir de son passé que les souvenirs heureux, « les seuls à qui je permette de vivre ». Quant aux autres, « les bulles du malheur ou d’ennui qui surgissent des tristesses ou des déceptions de toute existence, elles sont mortes en moi parce que je ne les ai pas nourries de mon souffle ». Tant de souvenirs ainsi s’effacent, se décolorent, sombrent dans l’oubli ! « Les véritables souvenirs, les seuls qui survivent, les seuls qui ne vieillissent pas, les seuls qui soient enracinés, sont les souvenirs de l’enfance et de la première jeunesse. »
Peut-être, dit-il, peut-être ses lecteurs seront-ils surpris de constater que ces souvenirs si précieux concernent davantage ceux qui jadis l’entouraient que lui-même, surpris qu’ils parlent, bien moins de l’écrivain célèbre retraçant sa carrière et se statufiant pour la postérité, que de ses grands-parents, de ses parents, de ses oncles et tantes, de ses frères et sœurs, cousins et cousines, de ses amis, qu’ils réveillent même les fantômes de domestiques familiers depuis longtemps rejetés dans l’anonymat. C’est que, explique-t-il, l’enfant « n’existe pas encore en soi ni par soi » mais « se nourrit de ce qui l’environne », et le vieillard qui rédige ses souvenirs ramène les disparus à l’existence, car les morts ne disparaissent pas tout entiers, ils vivent en nous, leurs ombres nous habitent. C’est pourquoi Bulles bleues sonne, sans tristesse, l’appel aux morts et les convie à reparaître, conviction que partageait Charles Van Lerberghe, ami de Maeterlinck depuis le collège : « Nos chers morts, confiait-il à Albert Mockel, ne vivent pas seulement dans notre souvenir, mais en nous-mêmes, et ce n’est pas seulement en image, mais en vérité2. » Maeterlinck le répète en 1934 dans Avant le Grand Silence :
Remarquez que [nos morts] ne vivent pas seulement en nous à cause des souvenirs qu’ils ont laissés dans notre mémoire accidentelle, éphémère et précaire. Leur véritable vie, leur vie peut-être immortelle, c’est la vie qu’eux et tous ceux qui les ont précédés, ont accumulée dans nos cellules invisibles, qu’ils nous ont transmise, que nous portons en nous, et qu’à notre tour, nous transmettrons à nos enfants. Voilà les véritables souvenirs de la matière et de l’esprit, de l’atome ou de l’espèce, qui sont indestructibles, n’ont jamais connu la mort et ne la connaîtront peut-être jamais3.
Ces morts, il les fait revivre dans une série de scènes souriantes, ironiques ou narquoises parfois, ou émues. La bonne grand-maman maternelle de Zwijnaerde et les sucreries de la Saint-Nicolas, le jovial oncle Hector qui se plaît à pousser la chansonnette dans les réunions de famille et aux repas de noces et l’oncle Florimond, l’obèse glouton, la jolie cousine Louise dont il espéra en vain les faveurs, ses jeux d’enfant un peu turbulent, les fessées que lui valent ses incartades, sa mère indulgente et tendre, qui tempère les sévérités d’un père possédé de la manie de l’horticulture et de la pomologie – n’y eut-il pas un « raisin Polydore » et une « pêche Maeterlinck » –, sa sœur Marie, l’artiste de la famille, mais qui ne peignait qu’au « jus de pipe »… Famille bourgeoise, catholique et conservatrice, parfaitement imperméable à la littérature. On lira l’amusante scène du mariage de la cousine Louise où Maeterlinck et son ami Van Lerberghe s’enhardissent à lire des vers accueillis avec une réjouissante incompréhension par les assistants qui les écoutent gilets déboutonnés devant une table croulant sous les victuailles comme dans un tableau de Breughel ou de Jordaens. Ces Béotiens familiers, il ne les renie pas, et d’ailleurs il tient d’eux sa robustesse, sa vigueur physique qui contrastent curieusement avec son âme éthérée de symboliste. Point non plus de révolte ni de « Familles, je vous hais ! » à la manière de Gide. Il voulait faire médecine, mais son père le voulait avocat, ce qu’il sera sans conviction comme sans négligence, conquérant même sa peau d’âne « avec distinction », tandis que ses amis Grégoire Le Roy et Charles Van Lerberghe échouent piteusement et abandonnent. N’a-t-il pas même rêvé de quelque poste modeste de juge de paix dans un village où il pourrait écrire tranquille ? Famille bourgeoise et pharisienne un peu, avec le respect des apparences. Son père et ses oncles se distraient du bonheur terne du foyer dans les amours ancillaires ou en entretenant – sans dépenses inconsidérées – l’une ou l’autre de ces filles du peuple qu’ils nomment leurs « Petites Ailes », pratiquant ainsi un adultère feutré et, somme toute, bientôt aussi monotone que le mariage.
Petits souvenirs, mais si vivants et qui illuminent une fin de vie en ramenant le vieillard aux côtés de l’enfant qu’il a été. Tout le contraire d’un Sartre, qui entendait bien « tenir son enfance à distance respectueuse ». Un critique parlait naguère de bluette insipide : « C’est charmant et insignifiant. » Les comptes rendus furent curieusement d’une navrante indigence, comme si l’on hésitait à retrouver Maeterlinck dans ce livre inattendu. Dans Les Nouvelles littéraires4, Guillot de Saix résume la biographie complète du grand homme, égrène quelques « pensées » extraites du théâtre et des essais, cite deux poèmes tirés des Serres chaudes et des Chansons, propose quelques passages – dont celui, incontournable, concernant Villiers de l’Isle-Adam – et, pour l’ouvrage lui-même, s’abstient du moindre commentaire. Dans Le Figaro littéraire5, Célia Bertin raconte sa visite à Orlamonde, rapporte deux ou trois propos d’une désolante pauvreté, ignore Bulles bleues, mais annonce que Maeterlinck prépare « un second volume de souvenirs qui paraîtra bientôt ». Dans Le Thyrse6, Léopold Rosy ne retient que les anecdotes littéraires et fait l’impasse sur des « aventures enfantines » sans intérêt. Dans Synthèses7, Nelly Cormeau évoque à son tour Villiers, Van Lerberghe, Verlaine et, pour le reste, salue « un livre joli, délicieux » qui s’étend sur les souvenirs d’un « petit garçon naïf » baignant dans « une atmosphère de sérénité et de détachement »…
Insignifiant donc ? Moins peut-être qu’il n’y paraît, et pas seulement parce que l’auteur y fait revivre le milieu d’une bourgeoisie fin de siècle et qu’il y rend en effet hommage à Villiers de l’Isle-Adam ou à Charles Van Lerberghe, mais parce que ces souvenirs renaissent intacts en lui : « Les vrais paradis, disait Proust, sont ceux qu’on a perdus. » Que le vieil homme célèbre se plaise à rappeler ces menues anecdotes suffit à souligner leur importance à ses yeux. Rousseau aussi s’est plu à narrer les « niaiseries » et les « bêtises » de son enfance pour le bonheur de les revivre, et Maeterlinck aurait pu reprendre à son compte ce qu’en disait l’homme des Confessions :
Depuis qu’ayant passé l’âge mûr je décline vers la vieillesse, je sens que ces mêmes souvenirs renaissent tandis que les autres s’effacent, et se gravent dans ma mémoire avec des traits dont le charme et la force augmentent de jour en jour ; comme si, sentant déjà la vie qui s’échappe, je cherchais à la ressaisir par ses commencements. Les moindres faits de ce temps-là me plaisent, par cela seul qu’ils sont de ce temps-là. Je me rappelle toutes les circonstances des lieux, des personnes, des heures. […] Je sais bien que le lecteur n’a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j’ai besoin, moi, de le lui dire. Que n’osé-je lui raconter de même toutes les petites anecdotes de cet heureux âge, qui me font encore tressaillir d’aise quand je me les rappelle ! Cinq ou six surtout… Composons. Je vous fais grâce des cinq ; mais j’en veux une, une seule, pourvu qu’on me la laisse conter le plus longuement possible, pour prolonger mon plaisir...
Sa carrière ? Maeterlinck n’en évoque que les débuts, mais en mettant en lumière l’essentiel. Ainsi de ses amitiés fidèles. Celle qui l’unissait, jamais démentie, à Grégoire Le Roy, au point que, élu dès 1920 à l’Académie, il refusa toujours d’y siéger tant que Le Roy n’en serait pas. Celle surtout qu’il portait à Charles Van Lerberghe, dont il se souvient trente-six ans après sa disparition et dont il fait l’éloge. Cela faisait, depuis le collège, un singulier attelage que celui de Maeterlinck, rude, flegmatique et peu communicatif, et du féminin poète des Entrevisions et de La Chanson d’Ève. Ils se lisaient, se critiquaient impitoyablement, s’estimaient et s’admiraient, se nourrissaient l’un de l’autre, fraternellement, même s’ils se rencontraient, disait le timide Van Lerberghe « comme des ours blancs sur d’étincelants blocs de glace ». Charles eût été heureux de lire, dans Bulles bleues, l’hommage que lui rend Maurice : « Il me doit quelque chose, je lui dois beaucoup8. »
Autre hommage, celui qui salue Villiers de l’Isle-Adam, qu’il donne pour son initiateur à un univers suprasensible et mystérieux et qu’il a entendu parler, en 1886, à Montmartre, dans cette brasserie Pousset où le Maître réunissait ses disciples, à qui il donnait « l’impression du génie », de « l’homme providentiel […] qui, plus que tout autre, compte dans une existence littéraire ». Dès 1891, il a confié à Jules Huret : « Tout ce que j’ai fait, c’est à Villiers que je le dois9. » Maeterlinck savait payer ses dettes.
Autre thème, ni futile ni insignifiant : la mort, omniprésente tout au long de son œuvre. Il venait de loin, des années du collège Sainte-Barbe. En dépit de leurs efforts, ses maîtres ont échoué à lui communiquer une foi sans faille : « Bien qu’élevé par les Jésuites, dira-t-il toujours en 1936, j’ai l’impression que je n’eus jamais qu’une foi précaire et provisoire, mais j’avais fini par croire qu’il fallait croire et que je croyais10. » Il leur en voudra, s’en prenant d’ailleurs moins aux personnes qu’aux principes : « Maeterlinck, disait Georgette Leblanc, ne pardonnera jamais aux Pères jésuites du collège Sainte-Barbe leur étroite tyrannie. […] Je lui ai souvent entendu dire qu’il ne recommencerait pas la vie au prix de ses sept années de collège. Il n’y a selon lui qu’un crime que l’on ne peut pas pardonner, c’est celui qui empoisonne les joies et détruit le sourire d’un enfant11. »
Dans Bulles bleues, il a laissé en effet une description sans tendresse de l’atmosphère déprimante, malsaine du collège, de son église aux décorations sulpiciennes, de son réfectoire malpropre et gluant comme la salle à manger de la pension Vauquer du Père Goriot. Ici, tout s’organise, même les divertissements, comme dans un couvent ou une prison, la cloche scande les interminables heures d’étude sous une surveillance tracassière qui encourage la délation. La promenade elle-même y est morne, accomplie en rangs, trois par trois, les Pères menant les élèves engoncés dans leurs capes à capuchon, tels que les évoque Rodenbach dans La Jeunesse blanche :
En longue file noire et morne, nous allons
Comme enrégimentés et nous parlant à peine
À travers la banlieue isolée et malsaine
Écoutant dans le soir mourir les carillons…
Pour les études, la première qualité appréciée n’est pas l’intelligence ni même l’application, mais la piété, et l’imitation dévote du bienheureux Jean Berchmans et de Louis de Gonzague séduit plus d’un de ceux que Maeterlinck appelle « les mal cuits », benêts candidats à la sainteté. Aussi ne manque-t-on pas de dénoncer aux adolescents les tentations honteuses de la chair, seule la chasteté passant pour « la belle vertu », et les sermons agitent invariablement devant les impurs la menace de l’enfer.
On vit enfin dans l’obsession du memento mori. Maeterlinck y insiste, rancunier : « Ils vivaient trop dans la mort, mais dans une mort sans grandeur et sans horizon, une petite mort pratique, économique, commercialisée et avantageuse. » Au temps de la retraite annuelle, raconte Rodenbach, qui précéda Maeterlinck de quelques années à Sainte-Barbe, un prédicateur les accablait, quatre jours durant, de prêches véhéments sur la brièveté de la vie, le péché, l’enfer, le brasier éternel :
La Mort ! C’est elle que les prêtres qui furent nos maîtres, installaient parmi nous dès la rentrée. […] On nous enseigna à nous préparer à bien mourir.
Et tout était mortuaire, comme à dessein ! Même les promenades. […] Presque chaque fois nous rencontrions un corbillard, grande voiture drapée, avec des croque-morts coiffés de tricornes noirs et sinistres. […] De quelque côté que notre bande d’enfants se dirigeât, aux quatre coins de la ville, elle aboutissait à des cimetières. […] Rien que les noires chevelures des saules, les sapins géométriques, une ordonnance de fatalité et d’abandon.
J’avais la sensation que nous étions nous-mêmes conduits en troupeau à la mort. […] C’est ainsi qu’on nous vicia pour jamais la joie de la Nature12.
Les avis concordent. Rien de surprenant si, sortis du collège, les jeunes gens gardaient l’empreinte de ces terreurs et subissaient longtemps encore l’étouffement de cette oppression des âmes. Rien de surprenant non plus si les trois condisciples composeront, quasi simultanément, une pièce sur la mort :Les Flaireursde Van Lerberghe, L’Intruse deMaeterlinck,L’Annonciatrice(inachevée) de Grégoire Le Roy. On sait à quel point elle sera présente chez Maeterlinck. Ne projetait-il pas déjà, à vingt-deux ou vingt-trois ans, unManuel de la mort13 ? Elle ne le lâchera plus, ni au théâtre –La Princesse Maleine,Les Aveugles,Intérieur,La Mort de Tintagiles… –ni dans les essais –Le Trésor des humbles,La Sagesse et la Destinée,La Mort,Avant le grand silence,Devant Dieu,La Grande Porte,Le Sablier14… Elle n’est pas non plus absente dansBulles bleues.
Elle y apparaît en effet à plusieurs reprises. Dans le chapitre intituléLa Noyade, Maeterlinck raconte qu’il faillit, enfant, se noyer en s’ébattant dans le canal de Terneuzen avec sa sœur et un ami. Perdant pied, il est sur le point de couler à pic, s’agrippe vainement à la jambe de son camarade et va sombrer quand un jeune charpentier se jette à l’eau et le ramène sur la berge. Ce fut sa première approche, nullement terrifiante – fascinante plutôt –, de la mort :
Je fus donc tout près de la mort. Je crois que si je l’avais réellement touchée, je n’aurais pas éprouvé autre chose. J’avais franchi la grande porte sans m’en apercevoir. J’avais vu, un moment, une sorte de ruissellement prodigieux. Aucune souffrance, pas le temps d’une angoisse. Les yeux se ferment, les bras s’agitent et l’on n’existe plus.
Est-ce la mort ? Pourquoi pas ? Ou bien y a-t-il autre chose après la perte totale de la conscience ?
Cet incident n’est pas imaginaire, car l’anecdote apparaît à peu près dans les mêmes termes dans une lettre du 18 avril 1918 à Herman Baltia, bien placé pour en apprécier l’authenticité, puisqu’il était l’ami auquel l’enfant s’était cramponné au risque de l’entraîner dans les profondeurs15. L’accident a marqué Maeterlinck, qui en fera encore le même récit en 1936 dans Le Sablier et toujours à peu près dans les mêmes termes que dans Bulles bleues16. Il lui a même inspiré un projet de transposition « littéraire » dans les notes du Cahier bleu, en 1888 :
Imaginer ceci : que enfant (vers cinq ans) je suis tombé à l’eau ; une nuit, sous l’emprise de certains excitants et de circonstances (on aura parlé de noyés dans la soirée), je rêve que je me noie et il se trouve que toutes les circonstances (de temps, de lieu, etc.) sont exactement telles qu’elles ont eu lieu (ma mère par exemple me le dit), même la circonstance de la vie antérieure présentée comme un miroir (vie d’enfance, et dans le rêve rien que sensations d’enfants sans idée de responsabilité)17.
En effet, ce schéma se développe dès l’année suivante dans Onirologie, une nouvelle parue en juin 1889 dans La Revue générale18, qui traite des phénomènes du rêve et de la télépathie dans un désir d’entrer en communication avec le monde invisible :
Sans nul préliminaire, je fus au fond d’un puits. […] En ce moment, j’étais assez près de la mort. […] Au moment où je mourais ainsi au fond de l’eau, se produisit d’abord un phénomène extrêmement anormal. […] Était-ce un souvenir de lectures anciennes, où j’avais appris que les noyés, à l’instant de leur mort, revoient, en une espèce de miroir, leur vie entière avec ses incidences les plus minutieuses ? Ou cette vision de l’existence est-elle réellement inséparable de la mort par immersion et se trouvait-elle naturellement amenée ici ? Je ne sais19…
La mort par l’eau fait une nouvelle apparition dans Le Cuvier, où Maeterlinck, toujours enfant, réussit, avec l’aide de son frère, à pousser dans le canal un grand cuvier servant aux lessives semestrielles. Bravement, il s’y blottit, se pousse loin du bord à l’aide d’une longue perche, mais l’esquif se met à tourner sur lui-même et à tanguer dangereusement, tandis qu’une stridente sirène annonce l’approche d’un cargo… Il s’en sort avec plus de peur que de mal et sans autre dommage qu’une fessée paternelle, mais, de nouveau, il avait frôlé la mort par l’eau. Une dernière épreuve aura lieu plus tard, vers sa quinzième année, quand, en compagnie encore de son frère et par jour de tempête, il s’embarque témérairement sur un frêle bateau à voiles qui ne tarde pas à chavirer, les laissant barboter dans le canal tentateur. Il y avait dans ces expériences de quoi faire naître un fantasme aquatique qui se développera dans son œuvre, où abondent canaux, étangs, marais, puits, fontaines, vases, bassins ou aquariums20.
Il s’agit jusqu’ici, si l’on peut dire, de morts avortées, mais Bulles bleues en rapporte une hélas aboutie, fût-ce indirectement : celle de son jeune frère Oscar, le cadet de la famille, qui a donné lieu à une curieuse confusion dans la mémoire de Maeterlinck. Il la rapporte ainsi dans La Mort d’un frère : « Il mourut, en effet, très jeune, peu après sa première communion, à la suite d’un accident de patinage qui l’immergea dans l’eau glacée et entraîna une double pneumonie qui l’emporta en quinze jours. » À l’en croire, ce deuil l’entraîna, deux années durant, dans une dépression profonde, et il ajoute : « C’est dans cette atmosphère de deuil que plus tard fut écrite L’Intruse. » Né en 1870, Oscar aurait donc eu une douzaine d’années au moment de l’accident, soit vers 1882. Or L’Intruse fut composée en décembre 1889 et n’a aucun rapport immédiat avec les faits. Mais ceux-ci sont aussi rapportés en 1896 dans le chapitre Les Avertis21, dans Le Trésor des humbles, où Maeterlinck parle de ceux qui, mystérieusement, semblent avoir été « avertis » de leur fin prochaine :
Souvent, nous n’avons pas le temps de les apercevoir ; ils s’en vont sans rien dire et ceux-là nous demeurent à jamais inconnus. Mais d’autres s’attardent un peu, nous regardent en souriant attentivement, semblent sur le point d’avouer qu’ils ont tout compris, et puis, vers la vingtième année, s’éloignent à la hâte, en étouffant leurs pas. […] Un frère est mort ainsi. On eût dit que lui seul avait été prévenu, tandis que nous savions peut-être quelque chose sans avoir reçu cet avertissement organique qu’il recelait depuis les premiers jours22.
L’enfant en âge de première communion est devenu un jeune homme d’une vingtaine d’années, et l’on est ici plus proche de la réalité, puisque Oscar, né le 20 avril 1870, mourut en réalité le 20 mai 1891, un an et demi après la composition de L’Intruse. Comme l’a fort bien montré Joseph Hanse, cette pièce, la première représentée, fut jouée en répétition générale le 20 mai 1891, le jour même de la mort d’Oscar. Écrivant Bulles bleues à plus de cinquante ans de distance, Maeterlinck a pu associer inconsciemment les deux dates23.
La mort apparaît enfin dans l’étrange récit symboliste qui précède l’épilogue des Bulles bleues, intitulé L’Île du cimetière. L’étrange rencontre que celle du narrateur avec un vieux couple, derniers habitants d’un îlot rocheux dont on menace de les expulser bientôt et où depuis trois siècles sont enterrés les morts qui en ont fait un vaste cimetière qui peu à peu a envahi même leur jardin et encercle la maison. Les deux vieux sont persuadés que les morts « font ce qu’ils veulent et savent ce qu’ils font », mais chacun d’eux croit que son conjoint l’ignore et qu’il ne faut pas lui révéler une vérité qui le rendrait fou. Donc : « N’habitons-nous pas la même île ? Essayons d’y vivre comme y vivaient les deux vieillards, la bouche close, qui, par amour, gardaient le même secret. » Ceux qui ne sont plus sont encore – « Il n’y a pas de morts », disait Tyltyl dans L’Oiseau bleu –, parce qu’ils nous habitent et que chacun les porte avec soi, invisibles mais présents, comme l’écrivait Maeterlinck dans Le Sablier : « Tous nos morts, que nous croyons aux cimetières, sont encore en nous. Ils n’ont pas d’autre refuge, d’autre séjour. » Tout au long de Bulles bleues, il les a rappelés à lui. Un an avant de franchir lui-même la « grande porte », il attendait avec sérénité qu’elle s’entrouvre devant lui, pour lui dévoiler enfin, comme à ceux qui l’ont précédé, l’inconnu qui l’a hanté toute sa vie. C’est ce qu’il dit dans l’Épilogue…
Raymond Trousson
BULLES BLEUES
C’est ainsi qu’on pourrait appeler les souvenirs heureux. Ce sont les seuls à qui je permette de vivre.
Elles ne sont pas toutes d’un bleu immaculé, l’immaculé est extrêmement rare sur cette terre, même dans les vies qui n’eurent pas à se plaindre des rigueurs du destin, mais si pâles qu’elles soient, elles planent encore dans les rayons d’azur qui les revêtirent d’illusions.
Les autres, les bulles du malheur ou d’ennui qui surgissent des tristesses ou des déceptions de toute existence, sont mortes en moi parce que je ne les ai pas nourries de mon souffle, parce que je les ai laissées s’évaporer dans l’espace.
Néanmoins, ne croyons pas qu’elles ne soient plus. Rien ne meurt véritablement, en ce monde ou dans l’autre.
Savons-nous, si ce que nous avons oublié n’est pas aussi important que ce que nous nous rappelons ? Quelle est la loi qui garde ou élimine ce que nous avons vu ou vécu ? Pourquoi l’un meurt-il au lieu que l’autre survit qui ne valait pas mieux ? Quelle influence le souvenir mort a-t-il sur notre vie ? N’est-ce pas une des grandes inconnues de notre destinée ?
Quoi qu’il en soit, j’ai nettement constaté que notre volonté peut agir sur ces inconnues en ressuscitant ce que nous avons aimé de préférence à ce que nous avons haï, ce qui nous a fait du bien, à ce qui nous a fait du mal.
On parvient assez facilement à discipliner ce qui reste dans notre mémoire ; et le bonheur ou le malheur de notre existence dépend de cette discipline. Il ne faut pas croire que nos souvenirs soient immuables. Ils changent d’aspect selon nos années. Ils s’élèvent et se purifient selon que notre existence s’élève et se purifie, selon ce que nous avons fait, pensé ou subi. Si j’avais fixé les miens le jour qui les vit naître, je ne les reconnaîtrais plus.
Si je les avais écrits il y a vingt, trente ou quarante ans, les faits qui forment leur squelette seraient peut-être ce qu’ils furent, mais ils n’auraient plus la même chair, ils ne se baigneraient plus dans la même atmosphère, ils n’auraient plus la même couleur et leur choix même eût été différent.
Les souvenirs sont les traces incertaines et fugaces que nous laissent nos jours. Que chacun recueille les siens, ils ne rempliront pas le creux de la main ; mais ce qui reste de poussière est le seul trésor que nous voudrions arracher à la mort et emporter avec nous dans un autre séjour ; nous croyons que les années qui prolongent nos misères ou nos joies augmentent leur nombre. Je crois plutôt que ceux que nous acquérons ne compensent pas ceux que nous perdons. À mesure que nous avançons en âge, ce qui nous advient n’a plus le temps de se transformer en souvenir. Le centenaire qui n’est qu’un enfant au prix de l’éternité n’a que ce qu’il avait avant sa vieillesse et ce qu’il pourrait se rappeler ne prend plus la peine de naître.
Les véritables souvenirs, les seuls qui survivent, les seuls qui ne vieillissent pas, les seuls qui soient enracinés, sont les souvenirs de l’enfance et de la première jeunesse. Jusqu’à la fin de nos jours, ils gardent la grâce, l’innocence, le velouté de leur naissance et ceux qui naissent contrefaits, malpropres, malheureux ou stupides tombent dans les ténèbres où ils rejoignent les souvenirs de l’âge mûr qui méritent rarement d’être recueillis.
Rien n’est plus capricieux que les sélections de notre mémoire. L’enfant se souvient surtout des enfants de son âge. Nos parents que nous rencontrons dans notre passé ne commencent d’y vieillir que lorsque nous quittons l’enfance pour entrer dans l’adolescence. En revanche les grands-parents y demeurent immobiles à l’état de vieillards. Durant le temps que je connus les miens, ils n’évoluèrent pas et me parurent toujours aussi vieux. Ils s’étaient arrêtés au point où les années ne comptent plus.
Parmi les compagnons de la septième à la seizième année, je revois le mieux ceux qui étaient aussi jeunes que moi. On dirait que la mémoire vieillit plus vite que la vie et s’engourdit comme si elle se demandait à quoi bon retenir ce qui bientôt ne sera plus.
Et quand nous mourons que deviennent-ils ? Où s’en vont-ils ? Meurent-ils aussi et tout s’éteint-il pour toujours ?
On me dira sans doute : « Vos souvenirs, surtout vos souvenirs d’enfance, parlent de vous beaucoup moins que de ce qui vous entourait. » Les plus bienveillants me feront remarquer que dans les confessions, les mémoires, les soliloques autobiographiques, ce n’est pas les parents, les frères et sœurs, les amis, les compagnons, les instituteurs ou les domestiques, mais l’auteur seul que nous espérons connaître. C’est la vie d’un enfant qu’on attend et non point celle de ceux qui l’élèvent.
Mais l’enfant n’existe pas encore en soi ni par soi. Sa vie n’a d’autres éléments que ses réactions à l’égard de son entourage. Il a déjà une vie personnelle, mais elle est encore vide, sans visage et sans événements. Elle se nourrit de ce qui l’environne et la submerge. Elle est formée des reflets de ce qu’elle voit, des échos de ce qu’elle entend. Ils deviennent sa substance. Si l’on ne s’occupait que de l’enfant seul et nu dans l’espace et le temps, on aurait tout dit en trois mots. On ne peut le voir ou le reconnaître qu’à travers ce qui l’environne.
Je ne me fais pas d’illusions sur l’intérêt de ces souvenirs. C’est tout au plus un documentaire qui ne peut avoir quelque valeur que pour ceux qui veulent bien s’occuper de la psychologie enfantine. Il a du moins le mérite d’être sincère et dépourvu d’ornements inventés.