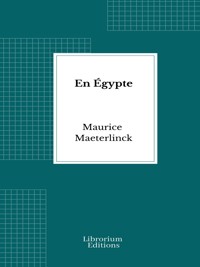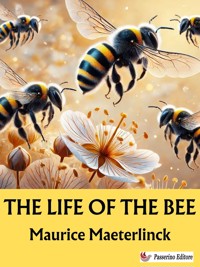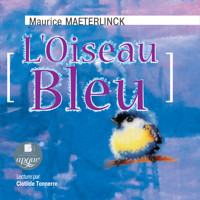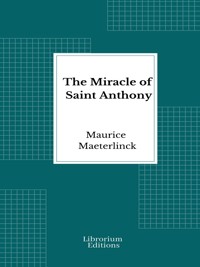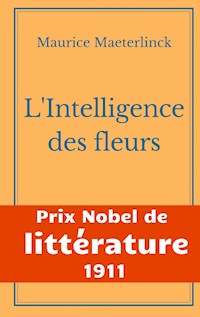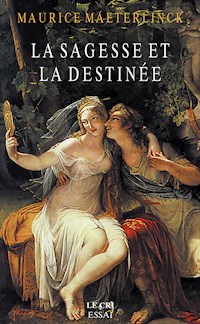0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pelléas avait un grand front bombé et puissant, pareil à celui de Socrate ou de Verlaine ; et sous un petit nez noir et ramassé comme une affirmation mécontente, de larges babines pendantes et symétriques faisaient de sa tête une sorte de menace massive, obstinée, pensive et triangulaire. Il était beau comme un beau monstre naturel qui s’est strictement conformé aux lois de son espèce. Et quel sourire d’obligeance attentive, d’innocence incorruptible, de soumission affectueuse, de reconnaissance sans bornes et d’abandon total illuminait, à la moindre caresse, cet adorable masque de laideur ! D’où émanait-il, au juste, ce sourire ? Des yeux ingénus et attendris ? des oreilles dressées vers les paroles de l’homme ? du front qui se déridait pour comprendre et aimer, des quatre dents minuscules, blanches et débordantes, qui sur les lèvres noires rayonnaient d’allégresse, ou du tronçon de queue qui, brusquement coudé, selon la coutume de la race, s’évertuait à l’autre extrémité pour attester la joie intime et passionnée qui remplissait un petit être heureux de rencontrer une fois de plus la main et le regard du dieu auquel il se livrait ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LE DOUBLE JARDIN
1904 © 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383832041
Table
LE DOUBLE JARDIN
SUR LA MORT D’UN PETIT CHIEN
LE TEMPLE DU HASARD
EN AUTOMOBILE
ÉLOGE DE L’ÉPÉE
LA COLÈRE DES ABEILLES
LE SUFFRAGE UNIVERSEL
LE DRAME MODERNE
LES SOURCES DU PRINTEMPS
LA MORT ET LA COURONNE
VUE DE ROME
FLEURS DES CHAMPS
CHRYSANTHÈMES
FLEURS DÉMODÉES
DE LA SINCÉRITÉ
PORTRAIT DE FEMME
LES RAMEAUX D’OLIVIER
LE DOUBLE JARDIN
SUR LA MORT D’UN PETIT CHIEN
J’ai perdu ces jours-ci un petit bouledogue. Il venait d’accomplir le sixième mois de sa brève existence. Il n’a pas eu d’histoire. Ses yeux intelligents se sont ouverts pour regarder Le monde et pour aimer les hommes, puis se sont refermés sur les secrets injustes de la mort.
L’ami qui me l’avait offert lui avait donné, peut-être par antiphrase, le nom assez imprévu de Pelléas. Pourquoi l’aurais-je débaptisé ? Un pauvre chien aimant, dévoué et loyal déshonore-t-il un nom d’homme ou de héros imaginaire ?
Pelléas avait un grand front bombé et puissant, pareil à celui de Socrate ou de Verlaine ; et sous un petit nez noir et ramassé comme une affirmation mécontente, de larges babines pendantes et symétriques faisaient de sa tête une sorte de menace massive, obstinée, pensive et triangulaire. Il était beau comme un beau monstre naturel qui s’est strictement conformé aux lois de son espèce. Et quel sourire d’obligeance attentive, d’innocence incorruptible, de soumission affectueuse, de reconnaissance sans bornes et d’abandon total illuminait, à la moindre caresse, cet adorable masque de laideur ! D’où émanait-il, au juste, ce sourire ? Des yeux ingénus et attendris ? des oreilles dressées vers les paroles de l’homme ? du front qui se déridait pour comprendre et aimer, des quatre dents minuscules, blanches et débordantes, qui sur les lèvres noires rayonnaient d’allégresse, ou du tronçon de queue qui, brusquement coudé, selon la coutume de la race, s’évertuait à l’autre extrémité pour attester la joie intime et passionnée qui remplissait un petit être heureux de rencontrer une fois de plus la main et le regard du dieu auquel il se livrait ?
Pelléas était né à Paris, et je l’avais emmené à la campagne. De bonnes grosses pattes, informes et pas encore figées, portaient mollement par les sentiers inexplorés de sa nouvelle existence sa tête énorme et grave, camuse et comme alourdie de pensées.
C’est qu’elle commençait, cette tête ingrate et un peu triste, pareille à celle d’un enfant surmené, le travail accablant qui écrase tout cerveau au début de la vie. Il lui fallait, en moins de cinq ou six semaines, faire pénétrer et organiser en elle une représentation et une conception satisfaisantes de l’univers. L’homme, aidé de toute la science de ses aînés et de ses frères, met trente ou quarante ans à esquisser cette conception ou plutôt à entasser autour d’elle, comme autour d’un palais de nuages, la conscience d’une ignorance qui s’élève ; mais l’humble chien doit la débrouiller seule en quelques jours ; et cependant, aux yeux d’un dieu qui saurait tout, n’aurait-elle pas à peu près le même poids et la même valeur que la nôtre ?…
Il s’agissait donc d’étudier la terre que l’on peut gratter et creuser, et qui parfois recèle de surprenantes choses : vers de terre et vers blancs, taupes, mulots, grillons ; il s’agissait de jeter vers le ciel, qui n’a pas d’intérêt puisque rien n’y est comestible, un seul regard qui le supprime une fois pour toutes ; de reconnaître l’herbe, l’herbe admirable et verte, l’herbe élastique et fraîche, champ de courses et de jeux, couche bienveillante et sans bornes où se cache le bon chiendent utile à la santé. Il s’agissait encore de faire pêle-mêle, des milliers de constatations urgentes et curieuses. Il fallait, par exemple, sans autre guide que la douleur, apprendre à calculer l’élévation des objets du haut desquels on peut s’élancer dans le vide, se convaincre qu’il est vain de poursuivre les oiseaux qui s’envolent, et qu’on ne peut grimper aux arbres pour y rattraper les chats qui vous conspuent ; distinguer les nappes de soleil, où le sommeil est délicieux, des flaques d’ombre où l’on grelotte ; remarquer avec stupéfaction que la pluie ne tombe pas dans les maisons, que l’eau est froide, inhabitable et dangereuse, tandis que le feu est bienfaisant à distance, mais terrible de près ; observer que les herbages, la cour des fermes et parfois les chemins sont hantés de gigantesques créatures pourvues de cornes menaçantes, monstres peut-être débonnaires, en tout cas silencieux, qu’on peut flairer assez indiscrètement sans qu’ils s’en formalisent, mais qui ne livrent pas leur arrière-pensée ; éprouver, à la suite d’expériences humiliantes et pénibles, qu’il n’est pas permis d’obéir indistinctement à toutes les lois de la nature dans la demeure des dieux ; reconnaître que la cuisine est le lieu privilégié et le plus agréable de cette demeure divine, bien qu’on n’y puisse séjourner à cause de la cuisinière, puissance considérable mais jalouse ; s’assurer que les portes sont des volontés importantes et capricieuses qui parfois mènent à la félicité, mais qui le plus souvent, hermétiquement closes, muettes et rigides, hautaines et sans cœur, restent sourdes à toutes les supplications ; admettre, une fois pour toutes, que les biens essentiels de l’existence, les bonheurs incontestables, généralement emprisonnés dans les marmites et les casseroles, sont inaccessibles ; savoir les regarder avec une indifférence laborieusement acquise, s’exercer à les ignorer en se disant qu’il s’agit là d’objets probablement sacrés, puisqu’il suffit de les effleurer du bout d’une langue respectueuse pour déchaîner, magiquement, la colère unanime de tous les dieux de la maison…
* * *
Et puis, que penser de la table sur laquelle se passent tant de choses qu’on ne peut deviner ? des fauteuils ironiques où il est défendu de dormir, des plats et des assiettes qui ne contiennent plus rien lorsqu’on vous les confie ? de la lampe qui chasse les ténèbres, et de l’âtre qui met en fuite les jours froids ?… Que d’ordres, que de dangers, que de défenses, que de problèmes, que d’énigmes qu’il faut classer dans la mémoire surchargée !… Et comment concilier tout cela avec d’autres lois, d’autres énigmes plus vastes et plus impérieuses, qu’on porte en soi, dans son instinct, qui surgissent et se développent d’heure en heure, qui viennent du fond des temps et de la race, envahissent le sang, les muscles et les nerfs, et s’affirment soudain plus irrésistibles et plus puissantes que la douleur, l’ordre même du maître et la crainte de la mort ? Ainsi pour ne citer que cet exemple, lorsque l’heure du sommeil a sonné pour les hommes, on s’est retiré dans sa niche, entouré des ténèbres, du silence et de la solitude formidable de la nuit. Tout dort dans la maison du maître. On se sent très petit et très faible en présence du mystère. On sait que l’ombre est peuplée d’ennemis qui se glissent et attendent. On suspecte les arbres, le vent qui passe et les rayons de lune. On voudrait se cacher et se faire oublier en retenant son souffle. Pourtant il faut veiller ; il faut, au moindre bruit, sortir de sa retraite, affronter l’invisible et troubler brusquement le silence imposant des étoiles au risque d’attirer sur soi seul le malheur ou le crime qui chuchote. Quel que soit l’ennemi, fût-il l’homme, c’est-à-dire le frère même du dieu qu’il s’agit de défendre, il faut l’attaquer aveuglément, lui sauter à la gorge, planter des dents, peut-être sacrilèges, dans de la chair humaine, oublier les prestiges d’une main et d’une voix pareilles à celles du maître, ne jamais se taire, ne jamais fuir, ne jamais se laisser tenter ni corrompre, et, perdu dans la nuit sans secours, prolonger l’alarme héroïque jusqu’au dernier soupir. Voilà le grand devoir légué par les ancêtres, le devoir essentiel et plus fort que la mort, que la volonté même et la colère de l’homme ne peuvent rebuter. C’est toute notre humble histoire liée à celle du chien dans nos premières luttes contre tout ce qui respirait ; c’est toute cette humble et effrayante histoire, qui renaît chaque nuit dans la mémoire primitive de notre ami des mauvais jours. Et quand, dans nos demeures plus sûres, il nous arrive de le punir d’un zèle intempestif, il nous lance un regard de reproche étonné, comme pour nous signifier que nous sommes dans l’erreur, et que, si nous perdons de vue la clause capitale du pacte d’alliance qu’il a fait avec nous au temps où nous habitions les cavernes, les forêts et les marécages, il y reste fidèle malgré nous et demeure plus près de la vérité éternelle de la vie qui est pleine d’embûches et de forces hostiles.
* * *
Mais que de soins et que d’études pour arriver à remplir sagement ce devoir ! Et qu’il s’est compliqué depuis le temps des grottes silencieuses et des grands lacs déserts ! C’était si simple, alors, si clair et si facile ! L’antre solitaire s’ouvrait au flanc du mont, et tout ce qui s’avançait, tout ce qui remuait à l’horizon des plaines ou des bois, était l’ennemi indubitable !… Mais aujourd’hui, on ne sait plus… Il faut se mettre au courant d’une civilisation qu’on désapprouve, avoir l’air de comprendre mille choses incompréhensibles… Ainsi, il paraît évident que désormais le monde entier n’appartient plus au maître, que sa propriété consent à d’inexplicables limites… Il est donc tout d’abord nécessaire qu’on sache exactement où commence et où finit le domaine sacré. Que doit-on tolérer, que faut-il interdire ? — Voilà la route où tout le monde, le pauvre même, a le droit de passer. Pourquoi ? — On n’en sait rien ; c’est un fait qu’on déplore mais qu’on doit accepter. Heureusement, par contre, voici le beau sentier, le sentier réservé, que nul ne peut fouler. Ce sentier est fidèle aux saines traditions ; il importe de ne pas le perdre de vue ; c’est par lui que les problèmes difficiles font leur entrée dans l’existence quotidienne. Voulez-vous un exemple ? — On dort tranquillement dans un rai de soleil qui recouvre de perles mouvantes et folâtres le seuil de la cuisine. Les pots de porcelaines s’amusent à se pousser du coude et à se bousculer au bord des tablettes garnies de dentelles de papier. Les casseroles de cuivre jouent à éparpiller des taches de lumière sur les murs blancs et lisses. Le fourneau maternel chantonne doucement en berçant trois marmites qui dansent avec béatitude, et par le petit trou qui éclaire son ventre, pour narguer le bon chien qui ne peut approcher, lui tire constamment une langue de feu. L’horloge, qui s’ennuie dans son armoire de chêne en attendant qu’elle sonne l’heure auguste du repas, fait aller et venir son gros nombril doré, et les mouches sournoises agacent les oreilles. Sur la table éclatante reposent un poulet, un lièvre, trois perdreaux, à côté d’autres choses qu’on appelle fruits ou légumes : petits pois, haricots, pêches, melons, raisins, et qui ne valent rien. La cuisinière vide un grand poisson d’argent et jette les entrailles (au lieu de les offrir !) dans la boîte aux ordures. — Ah ! la boîte aux ordures ! trésor inépuisable, réceptacle d’aubaines, joyau de la maison ! On en aura sa part, exquise et subreptice, mais il ne convient pas qu’on ait l’air de savoir où elle se trouve. Il est strictement interdit d’y fouiller. L’homme défend ainsi maintes choses agréables, et la vie serait morne et les jours seraient nus s’il fallait obéir à tous les commandements de l’office, de la cave et de la salle à manger. Par bonheur il est distrait et ne se souvient pas longtemps des ordres qu’il prodigue. On le trompe aisément. On arrive à ses fins et l’on fait ce qu’on veut, pourvu qu’avec patience on sache attendre l’heure. On est soumis à l’homme et il est le seul dieu ; mais on n’en à pas moins sa morale personnelle, précise, imperturbable, qui proclame hautement que les actes défendus deviennent très licites par le fait même qu’ils s’accomplissent à l’insu du maître. C’est pourquoi fermons l’œil attentif qui a vu. Ayons l’air de dormir en rêvant à la lune. — Tiens ! on frappe doucement à la fenêtre bleue qui donne sur le jardin. — Qu’est-ce donc ? — Rien, une branche d’aubépine qui vient voir ce qu’on fait dans la cuisine fraîche. — Les arbres sont curieux et souvent agités ; mais ils ne comptent point, on n’a rien à leur dire, ils sont irresponsables, ils obéissent au vent qui n’a pas de principes. — Mais quoi ? — J’entends des pas !… — Debout, l’oreille en pointe et le nez en action !… — Non ! c’est le boulanger qui s’approche de la grille, tandis que le facteur ouvre une petite porte dans la haie de tilleuls. — Ils sont connus, c’est bien… Ils apportent quelque chose, on peut les saluer ; et la queue, circonspecte, s’agite deux ou trois fois, avec un sourire protecteur. Autre alerte ! Qu’est-ce encore ? — Une voiture s’arrête devant le perron. Ah ! ceci est plus grave !… Le problème est complexe. — Il importe avant tout de copieusement injurier les chevaux, grandes bêtes orgueilleuses, toujours endimanchées et toujours en sueur, qui ne répondent pas. Cependant on examine du coin de l’œil les personnages qui descendent. — Ils sont bien mis et semblent pleins d’assurance. Ils vont probablement s’asseoir à la table des dieux. Il convient d’aboyer sans aigreur, avec une nuance de respect, pour montrer que l’on fait son devoir, mais qu’on le fait avec intelligence. Néanmoins on nourrit quelque arrière-soupçon, et dans le dos des hôtes, à la dérobée, on hume l’air avec persévérance et d’un air entendu, afin de démêler les intentions cachées.
* * *
Mais des pas clopinants sonnent autour de la cuisine. Cette fois c’est le pauvre qui traîne sa besace ; l’ennemi essentiel, l’ennemi spécifique, l’ennemi héréditaire, le descendant direct de celui qui rôdait autour de la caverne encombrée d’ossements qu’on revoit tout à coup dans la mémoire de la race. Ivre d’indignation, l’aboi entrecoupé, les dents multipliées par la haine et la rage, on va saisir aux grègues l’irréconciliable adversaire, lorsque la cuisinière, armée de son balai, sceptre ancillaire et parjure, vient protéger le traître ; et l’on est obligé de rentrer dans sa niche, où, l’œil rempli de flammes impuissantes et torves, on gronde des malédictions effroyables mais vaines, en songeant à part soi que c’est la fin de tout, qu’il n’y a plus de lois et que l’espèce humaine a perdu la notion du juste et de l’injuste…
Est-ce tout ? — Pas encore, car la plus petite vie se compose d’innombrables devoirs, et c’est un long travail que de s’organiser une existence heureuse sur la limite de deux mondes aussi différents que le monde des bêtes et le monde des hommes. Comment nous en tirerions-nous s’il nous fallait servir, tout en restant dans notre sphère, une divinité non plus imaginaire et semblable à nous-mêmes puisqu’elle est née de nos pensées, mais un dieu bien visible, toujours présent, toujours actif et aussi étranger, aussi supérieur à notre être que nous le sommes au chien ?
* * *
A présent, pour en revenir à Pelléas, il sait à peu près ce qu’il faut faire et comment se conduire dans l’enceinte du maître. Mais le monde ne finit pas aux portes des maisons et de l’autre côté des murs et de la haie il y a un univers dont on n’a plus la garde, où l’on n’est plus chez soi, où les relations sont changées. De quelle façon se tenir dans la rue, dans les champs, sur le marché, dans les boutiques ? A la suite d’observations difficiles et délicates, il comprend qu’il sied de ne pas obéir aux appels étrangers, d’être poli avec indifférence envers les inconnus qui vous caressent. Il faut ensuite accomplir consciencieusement certains devoirs de mystérieuse courtoisie envers ses frères les autres chiens, respecter les poules et les canards, n’avoir pas l’air de remarquer les gâteaux du pâtissier qui se prélassent insolemment à portée de la langue, témoigner aux chats qui, sur le seuil des portes, vous provoquent par d’affreuses grimaces un mépris silencieux mais qui se souviendra, et ne pas oublier qu’il est licite et même louable de poursuivre et d’étrangler les souris, les rats, les lapins sauvages et généralement tous les animaux (on doit le reconnaître à des marques secrètes) qui n’ont pas encore fait leur paix avec l’homme.
* * *
Tout cela et tant d’autres choses !… Était-il étonnant que Pelléas parût souvent pensif en face de ces problèmes sans nombre, et que son humble et doux regard fût parfois si profond et si grave, si chargé de soucis et si plein de questions illisibles ?
Hélas ! il n’a pas eu le temps d’achever la lourde et longue tâche que la nature impose à l’instinct qui s’élève pour se rapprocher d’une région plus claire… Un mal assez mystérieux et qui semble spécialement punir le seul animal qui parvienne à sortir du cercle où il est né, un mal indéfini qui emporte par centaines les petits chiens intelligents, est venu mettre fin aux destinées et à l’éducation heureuse de Pelléas. Je le vis, durant deux ou trois jours, et chancelant déjà tragiquement sous le poids énorme de la mort, se réjouir encore de la moindre caresse… Et maintenant tant d’efforts vers un peu plus de lumière, tant d’ardeur à aimer, de courage à comprendre, tant de joie affectueuse, tant de bons regards dévoués qui se tournaient vers l’homme pour demander son aide contre d’injustes et d’inexplicables souffrances, tant de frêles lueurs qui venaient de l’abîme profond d’un monde qui n’est plus le nôtre, tant de petites habitudes presque humaines reposent tristement sous un large sureau et dans la froide terre, en un coin du jardin.
* * *
L’homme aime le chien, mais qu’il l’aimerait davantage s’il considérait, dans l’ensemble inflexible des lois de la nature, l’exception unique qu’est cet amour qui parvient à percer, pour se rapprocher de nous, les cloisons, partout ailleurs imperméables, qui séparent les espèces ! Nous sommes seuls, absolument seuls sur cette planète de hasard, et parmi toutes les formes de la vie qui nous entourent, pas une, hors le chien, n’a fait alliance avec nous. Quelques êtres nous craignent, la plupart nous ignorent, et aucun ne nous aime. Nous avons, dans le monde des plantes, des esclaves muettes et immobiles, mais elles nous servent malgré elles. Elles subissent simplement nos lois et notre joug. Ce sont des prisonnières impuissantes, des victimes incapables de fuir mais silencieusement rebelles, et sitôt que nous les perdons de vue elles s’empressent de nous trahir et retournent à leur liberté sauvage et malfaisante d’autrefois. S’ils avaient des ailes, la rose et le blé fuiraient à notre approche comme fuient les oiseaux. Parmi les animaux, nous comptons quelques serviteurs qui ne se sont soumis que par indifférence, par lâcheté ou par stupidité : le cheval incertain et poltron qui n’obéit qu’à la douleur et ne s’attache à rien, l’âne passif et morne qui ne reste près de nous que parce qu’il ne sait que faire ni où aller, mais garde cependant, sous la trique ou le bât, son idée de derrière les oreilles ; la vache et le bœuf, heureux pourvu qu’ils mangent et dociles parce que depuis des siècles ils n’ont plus une pensée à eux ; le mouton ahuri qui n’a d’autre maître que l’épouvante ; la poule fidèle à la basse-cour parce qu’on y trouve plus de maïs et de froment que dans la forêt prochaine. Je ne parle pas du chat pour qui nous ne sommes qu’une proie trop grosse et immangeable, du chat féroce dont l’oblique dédain ne nous tolère que comme des parasites encombrants dans notre propre logis. Lui du moins nous maudit dans son cœur mystérieux, mais tous les autres vivent près de nous comme ils vivraient près d’un rocher ou près d’un arbre. Ils ne nous aiment pas, ne nous connaissent pas, nous remarquent à peine. Ils ignorent notre vie, notre mort, notre départ, notre retour, notre tristesse, notre joie, notre sourire. Ils n’entendent même pas le son de notre voix dès qu’elle ne menace plus, et quand ils nous regardent, c’est avec l’effarement méfiant du cheval, dans l’œil duquel passe encore l’affolement de l’élan ou de la gazelle qui nous voit pour la première fois ; ou avec la morne stupeur des ruminants qui ne nous considèrent que comme un accident momentané et inutile de l’herbage.
* * *
Depuis des milliers d’années ils sont à nos côtés aussi étrangers à nos pensées, à notre affection, à nos mœurs que si la moins fraternelle des étoiles les avait laissés choir d’hier sur notre globe. Dans l’espace sans bornes qui sépare l’homme de tous les autres êtres, nous n’avons réussi à leur faire faire, à force de patience, que deux ou trois pas illusoires. Et si demain, laissant intacts leurs sentiments à notre égard, la nature leur donnait l’intelligence et les armes nécessaires pour nous vaincre, j’avoue que je me méfierais de la vengeance emportée du cheval, des représailles obstinées de l’âne et de la rancune enragée du mouton. Je fuirais le chat comme je fuirais le tigre ; et même la bonne vache, solennelle et somnolente, ne m’inspirerait qu’une confiance sur ses gardes. Quant à la poule, l’œil rond et rapide, comme à la découverte d’une limace ou d’un ver, je suis sûr qu’elle me dévorerait sans se douter de rien.
* * *