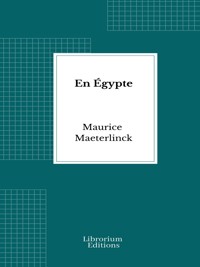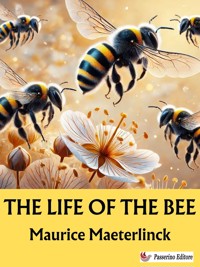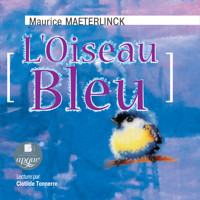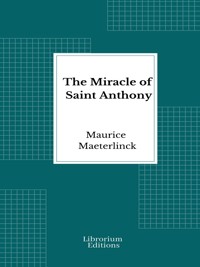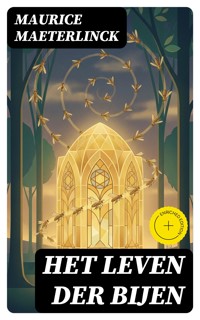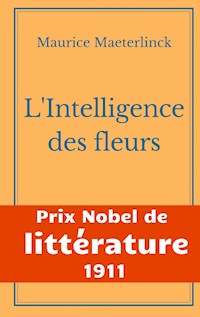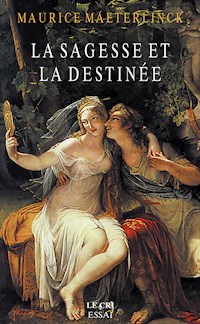
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Il y a bien des phrases de ce livre qui nous bouleversent par leur incontestable prescience de notre monde. Que signifient encore aujourd’hui les mots sagesse, fatalité, justice, âme, bonheur, amour ? Ne sont-ils pas à ce point discrédités qu’il faille les rejeter sans appel ?
La Sagesse et la destinée nous remet en mémoire les vrais enjeux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice MAETERLINCK (Gand 1862-Nice 1949) est un des plus grand écrivains belges d'expression française. La nouveauté radicale et le retentissement du premier théâtre de
Maurice Maeterlinck (1862-1949), le succès de son oeuvre d'essayiste et celui de ses livres consacrés à la nature, le prix nobel obtenu en 1911, font de lui l'auteur le plus célèbre de sa génération. Il a provoqué une véritable révolution dans plusieurs domaines et son influence littéraire fut énorme. Après un long purgatoire,
Maeterlinck est aujourd'hui redécouvert, réédité et joué un peu partout dans le monde. Le temps n'est plus où la mention de
Péléas et Mélisande n'évoquait en France que le nom de
Debussy, et rien de plus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Sagesse et la destinée
Maurice Maeterlinck
La Sagesse et
la destinée
Essai
Catalogue sur simple demande.
www.lecri.be [email protected]
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6796-2
© Le Cri édition,
Av Leopolod Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
En couverture : Jean-Joseph Ansiaux,Renaud et Armide,1817.
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
PRÉFACE
Le retour de la vie intérieure
En notre époque postmoderne, il est important de redécouvrir les textes d’essence philosophique publiés avant les grandes catastrophes morales et matérielles du xxe siècle. La Sagesse et la Destinée paraît en 1898. Écrit sous l’influence déterminante de Georgette Leblanc1 dont l’intelligence et l’absence de préjugés émurent plus d’une fois son compagnon2, cet essai d’un moraliste de trente-six ans, nourri d’Emerson et de Ruysbroeck, lecteur de Saint-Simon et de Fénelon, se mesure à la vie. Méditations et considérations composées dans une langue épurée et musicale, celle d’un véritable écrivain3, sont exemptes de la griffe germanique qui va marquer pour un siècle la pensée française dominante. Il y aura les kantiens, les hégéliens, les marxistes et les marxologues, les husserliens et les heidegerriens, les sartriens, etc., mais tous auront perdu la rapidité et la légèreté des moralistes français qui faisaient l’admiration de Nietzsche.
Maeterlinck s’explique sans détour sur sa méthode. « Son livre, reconnaît-il, n’est composé que de méditations interrompues, qui s’enroulent avec plus ou moins d’ordre autour de deux ou trois objets. Il ne prétend persuader personne, il n’entend rien prouver. Au demeurant, poursuit le poète, les livres n’ont guère, dans la vie, l’importance que la plupart des hommes qui les écrivent ou qui les lisent veulent bien leur accorder. » Voilà un programme que peu d’œuvres d’aujourd’hui oseraient soutenir, de peur sans doute d’être rejetées comme manquant de sérieux. Et pourtant, cette méthode bien modeste a l’avantage de la liberté. L’auteur dit en effet le plus simplement du monde ce qu’il pense. Il nous parle du bonheur. Il nous entretient de la vie intérieure. En 2000, c’est un luxe qu’il redevient urgent de s’offrir. Tout simplement pour continuer à vivre. Il y a un siècle, Maeterlinck était déjà conscient du reproche que le penseur, l’écrivain ou l’artiste ayant déjà atteint un certain degré de conscience, en fait celui qu’il nomme « le sage », pouvait encourir : « C’est grâce à quelques hommes qui paraissent inutiles qu’il y aura toujours un certain nombre d’hommes incontestablement utiles. La meilleure partie du bien qu’on fait autour de nous à cette heure, est née d’abord dans l’esprit de ceux qui négligèrent peut-être plus d’un devoir immédiat et urgent pour réfléchir, pour rentrer en eux-mêmes, pour parler. »
Il y a un domaine qui est tout à fait propre à Maeterlinck dans cet essai, je veux dire une polémique, des passions qui étaient étrangères à Georgette Leblanc et qui sont incontestablement de la seule responsabilité morale de l’auteur. Se plaçant du point de vue de l’univers, Maeterlinck affirme : « Il est sage de penser et d’agir comme si tout ce qui arrive à l’humanité était indispensable ». Et il avance aussitôt un exemple qui nous fait froid dans le dos aujourd’hui, mais qui à son époque occupait sur le terrain des idées tant les profonds esprits que le commun des journalistes.4On aurait eu l’intention, paraît-il, de « demander aux penseurs de l’Europe s’il faudrait considérer comme un bonheur ou un malheur qu’une race énergique, opiniâtre et puissante, mais qui nous semble à nous autres Aryens5, en vertu de préjugés trop aveuglément acceptés6, inférieure par l’âme et par le cœur, la race juive en un mot, disparût ou devînt prépondérante ». Il ajoute, « persuadé que le sage peut répondre, sans qu’il y ait dans sa réponse ni résignation ni indifférence répréhensibles » : « Ce qui aura lieu sera le bonheur ». Nous qui savons que les Juifs d’Europe faillirent en effet disparaître, une position si équanime nous stupéfie. Mais il faut se garder de faire un procès à ce Maeterlinck de 1898. À la recherche d’un exemple catastrophique (dans tous les sens du terme) et en son temps actuel, il fait référence à la question juive, pour beaucoup assez obsédante en cette fin de siècle, avec une innocence qui ne doit pas le classer parmi les antisémites. Écrivant qu’« On ne fait vraiment son devoir dans la vie intérieure qu’en le faisant toujours au plus haut de son âme, au plus haut de sa vérité propre », il a voulu frapper l’imagination, tout en restant dans le domaine de l’hypothèse, et pour cela s’est servi des débats enfiévrés qui avaient cours partout en Europe, y compris dans les milieux intellectuels belges. Du reste, il fut dénoncé par La Libre Parole de Drumont et soutint les poètes Gustave Kahn et Catulle Mendès alors attaqués par le journal antisémite. Mais il est certain que ces quelques phrases, étant donné le succès de librairie de LaSagesse et la Destinée, ne passèrent pas inaperçues et durent prêter à confusion.7
Lorsque Marcel Proust écrit à un ami, à qui il envoie le livre, ce qu’il en pense, il ne fait qu’exprimer son trouble : « C’est très beau, reconnaît-il, mais le livre m’avait laissé, autant que je me rappelle, une impression plus particulière de méchanceté. C’est du reste ce qui me le rendait assez incompréhensible. Mais il me semble que cette méchanceté s’évapore un peu sur les sommets, point du tout orageux de Maeterlinck. De plus ces réflexions si hautes, si vraies pourraient s’appliquer à bien d’autres et mieux. Car s’il est au contraire une œuvre qui suppose soit dans le cœur de l’auteur, soit dans les exemples voisins, un modèle original et ininventable de méchanceté, c’est bien ce livre-là. » Malentendu entre un écrivain en pleine maturité et un débutant qui se cherche encore ? Décalage entre des êtres nés dans des milieux et des pays à la fois proches et étrangers, que la différence d’âge accentuerait ? Mais Proust n’est que de neuf ans plus jeune que Maeterlinck. La lettre n’est pas datée et le destinataire toujours inconnu. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre ce que Proust entendait par là, à moins de le croire choqué par le passage dont nous avons parlé et qui se trouve dans la méditation Quatrième, celle commençant par : « Est-il nécessaire de se croire meilleur que l’univers ? ». Cependant, concède-t-il : « Tout cela n’empêche pas ce que dit Maeterlinck d’être admirable, consolant et juste. Et ce que je dis, moi, d’être impertinent et ridicule, comme si ce n’était pas assez que Maeterlinck nous dise ce qu’il faut penser d’Emily Brontë et qu’il faille que moi je vous dise à vous qui savez tout ce qu’il faut penser de Maeterlinck. »8
>Le malentendu surmonté (ces lignes qui ont peut-être glacé Proust), La Sagesse et la Destinée devrait étancher bien des soifs contemporaines. Car l’air de rien, avec l’humilité qui le caractérise bien souvent, Maeterlinck nous aide à ne pas désespérer de la sagesse, de la justice, de l’âme, du bonheur, de l’amour, ces grands mots qu’on n’oserait plus tracer aujourd’hui sans ricaner. Et puis, nous trouvons dans son livre bien des méditations qui nous bouleversent par leur incontestable prescience de notre monde et nous aident à nous remémorer les vrais enjeux. « L’agrandissement de la conscience ne doit être désiré que pour l’inconscience de plus en plus haute qu’elle dévoile ; et c’est sur les hauteurs de cette inconscience nouvelle que se trouvent les sources de la sagesse la plus pure. » En 1898, la phrase : « il n’est pas impossible que, demain, on nous envoie du fond de la planète Mars, dans la vérité définitive sur la constitution et sur le but de l’univers, la formule infaillible du bonheur » pouvait être considérée comme relevant de la science-fiction. Aujourd’hui que des expéditions se préparent pour étudier cette planète de près et même y envoyer des hommes, cela prend une tournure qui mérite que l’on y réfléchisse. Cela veut dire que de l’étude de l’univers, de sa formation, dépend la connaissance que nous acquerrons de nous-mêmes, ici sur la Terre. Ce qui rend évidemment dérisoire les soubresauts des guerres — même si les souffrances sont réelles — que les empires du Nord sont impuissants à juguler. « Certes, il est désirable entre tous, le jour où nous vivrons enfin dans la certitude, dans la vérité scientifique totale, inébranlable, mais en attendant il nous est donné de vivre dans une vérité plus importante encore, la vérité de notre âme et de notre caractère, et quelques sages nous ont prouvé que cette vie était possible du sein même des plus grandes erreurs matérielles. »
Ici même, à l’orée du xxie siècle, sachons goûter cette pensée qui a mûri au soleil de l’amour et qui s’est affranchie de toute crainte. La sagesse nous rend réceptifs au bonheur. Le bonheur nous protège du destin — l’accident fatal qui peut interrompre ou précipiter dans une direction non voulue le cours d’une vie —, car le bonheur nous donne la grâce. Notre destinée alors nous appartient, sans oublier, comme nous le rappelle Maeterlinck, que « Nous ne sortons jamais de l’inconscience, mais nous pouvons améliorer sans cesse la qualité de l’inconscience qui nous baigne. »
À Madame Georgette Leblanc
Je vous dédie ce livre, qui est pour ainsi dire votre œuvre. Il y a une collaboration plus haute et plus réelle que celle de la plume ; c’est celle de la pensée et de l’exemple. Il ne m’a pas fallu péniblement imaginer les résolutions et les actions d’un sage idéal, ou tirer de mon cœur la morale d’un beau rêve forcément un peu vague. Il a suffi que j’écoutasse vos paroles. Il a suffi que mes yeux vous suivissent attentivement dans la vie ; ils y suivaient ainsi les mouvements, les gestes, les habitudes de la sagesse même.
Maeterlinck
I
En ce livre, on parlera souvent de sagesse, de fatalité, de justice, de bonheur et d’amour. Il semble qu’il y ait quelque ironie à évoquer ainsi un bonheur peu visible, au milieu de malheurs très réels, une justice peut-être idéale, au sein d’une injustice, hélas ! trop matérielle, et un amour assez malaisément saisissable dans de la haine ou de l’indifférence bien manifeste. Il semble qu’il ne soit guère opportun d’aller chercher, à loisir, en des replis cachés au fond du cœur de l’humanité, quelques motifs de confiance ou de sérénité, quelques occasions de sourire, de s’épanouir et d’aimer, quelques raisons de remercier et d’admirer, quand la plus grande partie de cette humanité, au nom de laquelle on se permet d’élever la voix, loin de pouvoir s’attarder aux jouissances intérieures et aux consolations profondes, mais si péniblement atteintes, que le penseur satisfait préconise, n’a même pas l’assurance ni le temps de goûter jusqu’au bout les misères et les désolations de la vie.
On a reproché ainsi aux moralistes, à Epictète entre autres, de ne jamais s’occuper que du sage. Il y a du vrai dans ce reproche, comme il y a du vrai dans presque tous les reproches qu’on peut faire. Au fond, si l’on avait le courage de n’écouter que la voix la plus simple, la plus proche, la plus pressante de sa conscience, le seul devoir indubitable serait de soulager autour de soi, dans un cercle aussi étendu que possible, le plus de souffrances qu’on pourrait. Il faudrait se faire infirmier, visiteur des pauvres, consolateur des affligés, fondateur d’usines modèles, médecin, laboureur, que sais-je, ou tout au moins ne s’appliquer, comme le savant de laboratoire, qu’à arracher à la nature ses secrets matériels les plus indispensables. Seulement, un monde où il n’y aurait plus, à un moment donné, que des gens se secourant les uns les autres ne persisterait pas longtemps dans cette œuvre charitable si personne n’usurpait le loisir nécessaire pour se préoccuper d’autre chose. C’est grâce à quelques hommes qui paraissent inutiles qu’il y aura toujours un certain nombre d’hommes incontestablement utiles. La meilleure partie du bien qu’on fait autour de nous, à cette heure, est née d’abord dans l’esprit de l’un de ceux qui négligèrent peut-être plus d’un devoir immédiat et urgent pour réfléchir, pour rentrer en eux-mêmes, pour parler. Est-ce à dire qu’ils aient fait ce qu’il y avait de mieux à faire ? Qui oserait répondre à cette question ? Ce qu’il y a de mieux à faire semble toujours, aux yeux de l’âme humblement honnête qu’il faut s’efforcer d’être, le devoir le plus simple et le plus proche, mais il n’en serait pas moins regrettable que tout le monde s’en fût toujours tenu au devoir le plus proche. À toutes les époques, il y eut des êtres qui purent s’imaginer loyalement qu’ils remplissaient tous les devoirs de l’heure présente en songeant aux devoirs de l’heure qui allait suivre. La plupart des penseurs affirment volontiers que ces êtres ne se trompèrent point. Il est bon que le penseur affirme quelque chose. Il est vrai, pour le dire en passant, que la sagesse se trouve parfois dans le contraire de ce que le plus sage affirme. Qu’importe ? on ne l’y eût pas aperçue sans cette affirmation ; et le sage a fait son devoir.
II
Aujourd’hui, la misère est une maladie de l’humanité comme la maladie est une misère de l’homme. Il y a des médecins pour la maladie, comme il faudrait des médecins pour la misère humaine. Mais, de ce que l’état de maladie est malheureusement très commun, s’ensuit-il qu’on ne doive jamais s’occuper de la santé, et que celui qui enseigne l’anatomie, par exemple, qui est la science physique correspondant le plus exactement à la morale, ait uniquement à tenir compte des déformations qu’une déchéance plus ou moins générale inflige au corps de l’homme ? Il importe qu’il parte d’un corps sain et bien constitué, comme il importe que le moraliste qui s’efforce de regarder par delà l’heure présente, parte d’une âme heureuse, ou qui du moins a ce qu’il faut pour l’être, hormis la conscience suffisante.
Nous, vivons au sein d’une grande injustice, mais il n’y a, je pense, ni indifférence ni cruauté, à parler parfois comme si cette injustice n’était plus, sans quoi l’on ne sortirait jamais de son cercle.
Il faut bien que quelques-uns se permettent de penser, de parler et d’agir comme si tous étaient heureux ; sinon, quel bonheur, quelle justice, quel amour, quelle beauté, trouveraient tous les autres le jour où le destin leur ouvrira les jardins publics de la terre promise ? On peut dire, il est vrai, qu’il conviendrait d’aller d’abord « au plus pressé ». Mais aller « au plus pressé » n’est pas toujours le parti le plus sage. Mieux vaut souvent aller tout de suite « au plus haut ». Si les eaux envahissent la demeure du paysan hollandais, la mer ou la rivière voisine ayant percé la digue qui défend la campagne, le plus pressé, pour lui, sera de sauver ses bestiaux, ses fourrages et ses meubles, mais le plus sage, d’aller lutter contre les flots, au sommet de la digue, et d’y appeler tous ceux qui vivent sous la protection des terres ébranlées.
L’humanité a été jusqu’ici comme une malade qui se tourne et se retourne sur son lit pour trouver le repos, mais cela n’empêche pas que les seules paroles véritablement consolantes qui lui aient été dites, l’ont été par ceux qui lui parlaient comme si elle n’eût jamais été malade. C’est que l’humanité est faite pour être heureuse, comme l’homme est fait pour être bien portant, et quand on lui parle de sa misère, au sein même de la misère la plus universelle et la plus permanente, on a l’air de ne lui dire que des paroles accidentelles et provisoires. Il n’y a rien de déplacé à s’adresser à elle comme si elle se trouvait toujours à la veille d’un grand bonheur ou d’une grande certitude. En réalité elle s’y trouve par son instinct, dût-elle ne jamais atteindre le lendemain. Il est bon de croire qu’un peu plus de pensée, un peu plus de courage, un peu plus d’amour, un peu plus de curiosité, un peu plus d’ardeur à vivre suffira quelque jour à nous ouvrir les portes de la joie et de la vérité. Cela n’est pas tout à fait improbable. On peut espérer qu’un jour tout le monde sera heureux et sage ; et si ce jour ne vient jamais, il n’est pas criminel de l’avoir espéré.
En tout cas, il est utile de parler du bonheur aux malheureux, pour leur apprendre à le connaître. Ils s’imaginent si volontiers que le bonheur est une chose extraordinaire et presque inaccessible ! Mais si tous ceux qui peuvent se croire heureux disaient bien simplement les motifs de leur satisfaction, on verrait qu’il n’y a jamais, de la tristesse à la joie, que la différence d’une acceptation un peu plus souriante, un peu plus éclairée, à un asservissement hostile et assombri ; d’une interprétation étroite et obstinée à une interprétation harmonieuse et élargie. Ils s’écrieraient alors : « N’est-ce donc que cela ? Mais nous aussi nous possédons dans notre cœur les éléments de ce bonheur. » En effet vous les y possédez. À moins de grands malheurs physiques, tout le monde les possède. Mais ne parlez pas de ce bonheur avec mépris. Il n’y en a point d’autre. Le plus heureux des hommes est celui qui connaît le mieux son bonheur ; et celui qui le connaît le mieux est celui qui sait le plus profondément que le bonheur n'est séparé de la détresse que par une idée haute, infatigable, humaine et courageuse.
C’est de cette idée qu’il est salutaire de parler le plus souvent possible ; non pas pour imposer celle que l’on possède, mais pour faire naître peu à peu dans le cœur de ceux qui nous écoutent le désir d’en posséder une à leur tour. Cette idée est différente pour chacun de nous. La vôtre ne me convient point ; vous aurez beau me la répéter avec éloquence, elle n’atteindra pas les organes cachés de ma vie. Il faut que j’acquière la mienne en moi-même, par moi-même. Mais tout en ne parlant que de la vôtre, vous m’aiderez sans le savoir à acquérir la mienne. Il arrivera que ce qui vous attriste me réconfortera, que ce qui vous console m’affligera peut-être, peu importe ; ce qu’il y a de beau dans votre vision consolante entrera dans mon affliction, et ce qu’il y a de grand dans votre tristesse passera dans ma joie, si ma joie est digne de votre tristesse. Ce qu’il faut, avant tout, c’est préparer à la surface de notre âme une certaine hauteur pour y recevoir cette idée, comme les prêtres d’anciennes religions dénudaient et débarrassaient de ses épines et de ses ronces le sommet d’une montagne pour y recevoir le feu du ciel. Il n’est pas impossible que, demain, on nous envoie du fond de la planète Mars, dans la vérité définitive sur la constitution et sur le but de l’univers, la formule infaillible du bonheur. Elle ne changera, n’améliorera quelque chose, en notre vie morale, qu’autant que nous vivions depuis longtemps dans l’attente et le désir de l’amélioration. Chacun de nous profitera et jouira des bienfaits de cette formule, cependant invariable, en proportion de l’espace désintéressé, purifié, attentif et déjà éclairé que cette formule trouvera dans son âme. Toute la morale, toute la science de la justice et du bonheur, ne devrait être qu’une attente, une préparation aussi vaste, aussi expérimentée, aussi accueillante que possible. Certes, il est désirable entre tous, le jour où nous vivrons enfin dans la certitude, dans la vérité scientifique, totale, inébranlable ; mais en attendant, il nous est donné de vivre dans une vérité plus importante encore, la vérité de notre âme et de notre caractère ; et quelques sages nous ont prouvé que cette vie était possible au sein même des plus grandes erreurs matérielles.
III
Est-il vain de parler de morale, de justice, de bonheur et de tout ce qui s’y rapporte, avant l’heure définitive de la science qui peut tout bouleverser ? Peut-être sommes-nous dans des ténèbres provisoires, et bien des choses ne se font pas de la même façon dans les ténèbres qu’à la clarté du jour.
Néanmoins, les événements essentiels de notre vie physique et de notre vie morale ont lieu dans l’ombre, aussi nécessairement, aussi complètement qu’à la lumière. Il nous faut vivre, en attendant le mot de l’énigme, et c’est en vivant le plus heureusement, le plus noblement que l’on peut, qu’on vivra le plus puissamment et qu’on aura le plus de courage, le plus d’indépendance, le plus de clairvoyance, pour le désir et la recherche de la vérité. Et puis, quoi qu’il arrive, le temps consacré à l’étude de nous-mêmes ne sera pas perdu. Quelle que soit la manière dont nous ayons un jour à envisager ce monde dont nous faisons partie, il y aura toujours bien plus de sentiments, de passions, de secrets inaltérés, inaltérables en l’âme humaine, qu’il n’y aura d’étoiles reliées à la terre, ou de mystères éclaircis par la science. Au sein de la vérité la plus irrécusable et la plus pénétrante, l’homme s’élèvera sans doute, mais il s’élèvera selon la direction invariable de l’âme humaine ; et l’on peut affirmer que plus l’universelle certitude sera forte et consolante, plus les problèmes de la justice, de la morale, du bonheur et de l’amour prendront, aux yeux de tous, l’aspect dominateur et passionnant sous lequel ils se sont toujours présentés aux regards du penseur.
Il importe de vivre comme si l’on se trouvait toujours à la veille de la grande découverte et de se préparer à l’accueillir, le plus totalement, le plus intimement, le plus ardemment qu’on pourra. Et la meilleure manière de l’accueillir un jour, sous quelque forme qu’elle se doive révéler, c’est de l’espérer dès aujourd’hui, aussi haute, aussi vaste, aussi parfaite, aussi ennoblissante qu’il nous est donné de nous l’imaginer. Nous ne saurions lui prêter trop d’ampleur, trop de beauté, ni trop de majesté. Il est certain qu’elle sera meilleure que nos meilleurs espoirs, car si elle en diffère, si elle va jusqu’à les contredire, par le fait même qu’elle nous apportera la vérité, elle nous apportera quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus conforme à la nature humaine que ce que nous avions attendu. Pour l’homme, dût-il y perdre tout ce qu’il admirait, l’admirable par excellence ce sera la vérité intime de l’univers. En supposant qu’au jour où elle sera manifestée, les plus humbles cendres de nos espérances soient dispersées, il nous restera en tout cas notre préparation à l’admirable, et l’admirable entrera dans notre âme à flots plus ou moins abondants, selon la largeur, selon la profondeur du lit que notre attente aura creusé.
IV
Est-il nécessaire de se croire meilleur que l’univers ? Nous aurons beau raisonner, toute notre raison ne sera jamais qu’un bien faible rayon de la nature, une infime partie de ce tout qu’elle s’arroge le droit de juger, et faut-il qu’un rayon, pour qu’il fasse son devoir, souhaite de modifier la lampe dont il émane ?
Le sommet de notre être, du haut duquel nous entendons absoudre ou condamner la totalité de la vie, n’est évidemment qu’une inégalité que notre œil seul remarque sur la sphère sans limite de la vie. Il est sage de penser et d’agir comme si tout ce qui arrive à l’humanité était indispensable. Il n’y a pas longtemps, pour ne citer qu’un seul de ces problèmes que l’instinct de notre planète est appelé à résoudre, il n’y a pas longtemps, on eut, paraît- il, l’intention de demander aux penseurs de l’Europe s’il faudrait considérer comme un bonheur ou un malheur qu’une race énergique, opiniâtre et puissante, mais qui nous semble, à nous autres Aryens, en vertu de préjugés trop aveuglément acceptés, inférieure par l’âme ou par le cœur, la race juive en un mot, disparût ou devînt prépondérante. Je suis persuadé que le sage peut répondre, sans qu’il y ait dans sa réponse ni résignation ni indifférence répréhensibles : « Ce qui aura lieu sera le bonheur. » Souvent, ce qui a lieu nous paraît avoir tort, mais qu’a donc fait de plus utile jusqu’ici toute la raison humaine que de trouver une raison supérieure aux torts de la nature ? Tout ce qui nous soutient, tout ce qui nous assiste, dans la vie physique comme dans la vie morale, vient d’une sorte de justification lente et graduelle de la force inconnue qui nous parut d’abord impitoyable. Si une race absolument conforme à notre idéal disparaît, c’est que notre idéal n’est pas absolument conforme à l’idéal par excellence, qui est, comme je l’ai dit, la vérité intime de l’univers.
Déjà, nous avons su tirer de notre expérience, déjà nous avons vu confirmer par la réalité d’admirables rêves, d’admirables désirs, de grandes idées et de grands sentiments d’amour, de beauté, de justice. S’il en est dans notre imagination, de plus vastes et de plus consolants, mais qui ne supporteraient pas l’épreuve de la réalité, c’est-à-dire de la puissance anonyme et mystérieuse de la vie, c’est qu’il faut qu’ils soient autres, mais non qu’ils soient moins beaux, moins vastes, ni moins consolants. En attendant que la réalité se manifeste, il est peut-être salutaire d’entretenir un idéal qu’on s’imagine plus beau que la réalité ; mais après que celle-ci s’est enfin révélée, il devient nécessaire que la flamme idéale que nous avons nourrie de nos meilleurs désirs, ne serve plus qu’à éclairer loyalement les beautés moins fragiles et moins complaisantes de la masse imposante qui écrase ces désirs.
Je ne crois pas qu’il y ait en tout ceci acceptation servile, fatalisme endormi, optimisme passif. Il est possible que le sage perde en mainte occasion une partie de l’ardeur obstinée, exclusive et aveugle, qui fit réaliser par quelques-uns des choses pour ainsi dire surhumaines, par cela même qu’ils ne possédaient pas la plénitude de la raison humaine. Mais il n’en est pas moins certain qu’il n’est permis à aucune âme honnête d’aller chercher de l’énergie, de la bonne volonté, des illusions ou de l’aveuglement dans une région inférieure à celle des pensées de ses meilleures heures. On ne fait vraiment son devoir dans la vie intérieure qu’en le faisant toujours au plus haut de son âme, au plus haut de sa vérité propre. Et si, dans l’existence pratique et quotidienne, il est parfois licite de composer avec les circonstances, s’il n’y est pas toujours opportun d’aller jusqu’au bout de soi-même, comme Saint-Just, par exemple, qui, voulant, avec une ardeur admirable, la justice, la paix et le bonheur universels, envoyait de bonne foi à l’échafaud des milliers de victimes, dans la vie de la pensée, le devoir est d’aller, en tout cas jusqu’à l’extrémité de sa pensée. Au reste, savoir que l’on n’agit qu’en attendant la vérité n’empêchera d’agir que ceux qui n’eussent pas davantage agi dans l’ignorance. La pensée qui s’élève encourage ce qu’elle décourage. Il semble naturel à ceux qui regardent de haut et admirent d’avance ce qui détruira leur action, de faire tout ce qu’ils peuvent pour améliorer ce qu’il n’est pas interdit d’appeler la raison, la justice, la beauté de la terre, l’instinct de la planète. Ils savent qu’améliorer, ici, ce n’est, au fond, que découvrir, comprendre, respecter. Avant tout, ils ont confiance dans « l’idée de l’univers ». Ils sont persuadés que tout effort vers le mieux les rapproche de la volonté secrète de la vie, mais ils apprennent en même temps à tirer de l’échec de leurs plus généreux efforts et de la résistance de ce grand monde, un aliment nouveau pour leur admiration, pour leur ardeur, pour leur espoir.
Si vous gravissez vers le soir une haute montagne, vous voyez diminuer peu à peu, se perdre enfin dans l’ombre envahissante de la vallée, les arbres, les maisons, le clocher, les prés, les vergers, la route et la rivière même. Mais les petits points lumineux que l’on trouve, au fond des plus obscures nuits, dans les lieux habités par les hommes ne s’affaibliront pas à mesure que vous vous élèverez. Au contraire, à chaque pas que vous ferez vers la hauteur, vous découvrirez un plus grand nombre de lumières dans les villages endormis sous vos pieds. La lumière, si fragile qu’elle soit, est peut-être la seule chose qui ne perde presque rien de sa valeur en face de l’immensité. Il en est de même de nos lumières morales quand nous regardons la vie d’un peu plus haut. Il est bon que la contemplation nous apprenne à nous désintéresser de toutes nos passions inférieures, mais il ne faut pas qu’elle affaiblisse ou décourage le plus humble de nos désirs de vérité, de justice et d’amour.
D’où vient-elle, cette règle que je formule ainsi ? Je n’en sais rien moi-même. Elle me paraît humaine et nécessaire, voilà tout ; et je n’en saurais donner d’autres raisons que des raisons sentimentales. Mais les raisons sentimentales sont parfois les moins méprisables. Et si j’atteignais un sommet d’où cette loi ne me paraîtrait plus utile, j’écouterais l’instinct secret qui me dirait de ne pas m’arrêter, de m’élever encore, jusqu’à ce que j’aperçoive de nouveau toute son utilité.
V
Après cette introduction générale, parlons plus particulièrement de l’influence que la sagesse peut avoir sur notre destinée. Et puisque l’occasion s’en présente, il est peut-être utile de faire observer, dès l’abord, qu’on chercherait en vain une méthode bien rigoureuse dans ce livre. Il n’est composé que de méditations interrompues, qui s’enroulent avec plus ou moins d’ordre autour de deux ou trois objets. Il ne prétend persuader personne, il n’entend rien prouver. Au demeurant, les livres n’ont guère, dans la vie, l’importance que la plupart des hommes qui les écrivent ou qui les lisent veulent bien leur accorder. Il suffirait de les écouter dans l’esprit où l’un de mes amis, qui est un grand sage, écoutait un jour le récit des derniers instants de l’empereur Antonin le Pieux. Antonin le Pieux qui, à plus juste titre encore que Marc Aurèle, peut être considéré comme l’homme le meilleur et le plus parfait que la terre ait porté, car à toute la sagesse, à toute la profondeur, à toute la bonté, à toutes les vertus de son fils adoptif, il joignait je ne sais quoi de plus viril, de plus énergique, de plus pratique, de plus simplement heureux et de plus spontané, qui le rapprochait davantage de la vérité quotidienne, Antonin le Pieux, étendu sur son lit, attendait la mort, les yeux voilés de larmes involontaires et les membres baignés des pâles sueurs de l’agonie. À ce moment, le chef des gardes du palais entra dans sa chambre, pour lui demander, selon l’usage, le mot d’ordre. Æquanimitas, égalité d’âme, répondit-il en tournant la tête du côté de l’ombre éternelle. Il est beau d’aimer et d’admirer cette parole, disait mon ami. Il est plus beau encore, ajoutait-il, de savoir sacrifier sans que personne le remarque, sans que soi-même on songe à s’en apercevoir, le temps que le hasard nous accorde pour l’admirer, à la première venue des petites œuvres utiles et simplement vivantes que le même hasard offre sans cesse à la bonne volonté de notre cœur.
VI
« Leur destinée voulait sans doute qu’ils fussent opprimés par les hommes ou par les événements partout où ils se planteraient », dit un auteur en parlant des héros de son livre. Il en est ainsi de la plupart des hommes. Il en est ainsi de tous ceux qui n’ont pas appris à séparer leur destinée extérieure de leur destinée morale. Ils sont semblables au petit ruisseau aveugle que je contemplais un matin du haut d’une colline. Tâtonnant, se débattant, trébuchant et chancelant sans cesse au fond d’une vallée obscure, il cherchait sa route vers le grand lac qui dormait de l’autre côté de la forêt, dans la paix de l’aurore. Ici, c’était un quartier de basalte qui l’obligeait à quatre longs détours, là-bas, les racines d’un vieil arbre, plus loin encore, le simple souvenir d’un obstacle à jamais disparu le faisait remonter vers sa source en bouillonnant en vain, et l’éloignait indéfiniment de son but et de son bonheur. Mais, dans une autre direction, et presque perpendiculairement au ruisseau affolé, malheureux, inutile, une force supérieure aux forces instinctives avait tracé à travers la campagne, à travers les pierres écroulées, à travers la forêt obéissante, une sorte de long canal, ferme, verdoyant, insoucieux, pacifique, allant sans hésiter, de son pas calme et clair, des profondeurs d’une autre source cachée à l’horizon, vers le même lac lumineux et tranquille. Et j’avais à mes pieds l’image des deux grandes destinées qui sont offertes à l’homme.
VII
À côté de ceux qui sont opprimés par les hommes et par les événements, il y a en effet d’autres êtres en qui se trouve une sorte de force intérieure à laquelle se soumettent non seulement les hommes, mais même les événements, qui les entourent. Ils ont conscience de cette force ; et cette force n’est d’ailleurs autre chose qu’un sentiment de soi-même qui a su s’étendre au-delà des bornes de la conscience habituelle aux hommes.
On n’est chez soi, on n’est à l’abri des caprices du hasard, on n’est heureux et fort que dans l’enceinte de sa conscience. Au reste, ces choses ont été dites trop souvent pour que nous nous y arrêtions, si ce n’est pour fixer notre point de départ. Un être ne grandit que dans la mesure où il augmente sa conscience, et sa conscience augmente à mesure qu’il grandit. Il y a ici d’admirables échanges ; et de même que l’amour est insatiable d’amour, toute conscience est insatiable d’extension, d’élévation morale, et toute élévation morale est insatiable de conscience.