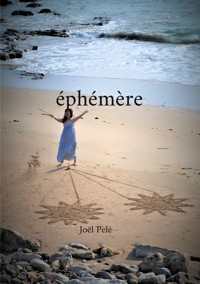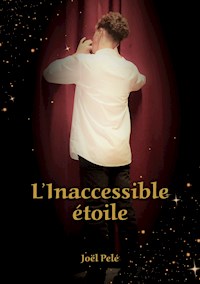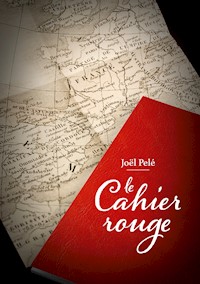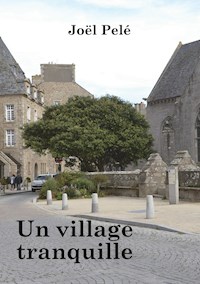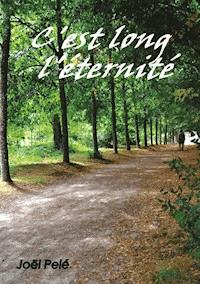
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alain a 95 ans. Célibataire, sans enfant, il décide d'écrire l'histoire de sa vie, il est vrai, peu commune. Il veut laisser une trace. Enfant d'une prostituée, il est retiré à sa mère à l'âge de cinq ans et placé dans un établissement spécialisé. L'infirmière de cet établissement, une religieuse, se prend d'affection pour ce petit garçon sur lequel elle va veiller tant que Dieu lui prêtera vie. Car le destin a réservé au gamin, à l'adolescent, et enfin à l'homme qu'il est devenu, son lot d'épreuves et d'expériences. L'amour, le jugement des adultes, l'incompréhension, l'Occupation allemande et ses méthodes, et bien d'autres événements vont jalonner le chemin de ce personnage attachant qui vouera toute sa vie une véritable dévotion à sa protectrice. L'oeuvre qu'il rêve d'écrire au bout de son long parcours côtoiera peut-être un jour, sur les étagères d'une bibliothèque, les grands noms de la littérature ? C'est là le dernier fantasme d'un homme que Dieu semble avoir oublié sur terre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Des jours presque ordinaires - Éditions Les 2 Encres (2012)
Aux confluents de la vie - Éditions Les 2 Encres (2013)
Je t’attends - Éditions Baudelaire (2016) - BoD (2018)
Remerciements
À mon épouse, Denise, qui a réalisé la photographie de la couverture, mais qui m’a aussi accompagné et guidé par ses très précieuses critiques dans l’écriture de ce roman.
À mes amis :
Brigitte et Gérard Lefebvre,
Éliane et Jacques Moret,
Catherine et Jean-Marie Raimbault,
Mes premiers lecteurs qui ont su corriger mes fautes de frappe et d’orthographe tout en m’exprimant leurs sentiments à la lecture de ce roman.
À Nathalie Costes qui m’a très efficacement conseillé et aidé pour la publication de ce livre.
Aussi loin que me porte ma mémoire, le premier mur auquel je me suis adressé, fut le mur Ouest de ma petite chambre, située au premier étage d’un immeuble ancien, pour ne pas dire vétuste, d’une ville de province. Le papier peint souffrait visiblement du temps et de l’humidité qui régnait dans cet espace de huit mètres carrés. Les lés, surtout ceux qui recouvraient le mur situé au nord, outre le fait qu’ils avaient pâli avec les années, sans doute nombreuses, se décollaient et pendaient lamentablement en lambeaux de tailles différentes découvrant un mur qui avait dû être blanc. Il était maintenant maculé de marques grises et jaunâtres. J’avais cinq ans. Ma mère, régulièrement, m’enfermait dans cet espace, ne bénéficiant que d’une fenêtre heureusement située au sud, afin que je ne découvre ni ne dérange, je l’ai su plus tard, son commerce avec les hommes. La chambre était sommairement meublée d’un sommier sur pieds, d’un matelas, d’une table, d’une chaise et d’une étagère pour y poser mes vêtements, le tout plutôt en bon état puisque fourni par le Secours catholique. Au sol, un linoléum gris et fatigué venait donner le sentiment d’une pauvreté qui n’avait pourtant pas alerté les services sociaux. Lorsqu’elle recevait, ma mère m’amenait dans ma chambre, posait sur la table une bouteille d’eau, un verre, quelques tartines de pain blanc, un bout de jambon, de saucisson ou de boudin, selon le jour, un laitage et un gâteau. Elle n’oubliait jamais de déposer dans l’un des coins de la pièce, un seau orange avec un couvercle dessus, au cas où… ce qui prouvait à l’enfant que j’étais, qu’elle m’aimait. Puis elle me laissait avec trois voitures miniatures et quatre coureurs cyclistes en plastique aux couleurs incertaines. Elle s’agenouillait pour déposer un baiser sur ma joue, me demandait de ne surtout pas faire de bruit et fermait le verrou situé dans le couloir. Sans doute par précaution. Mon temps de réclusion était plus ou moins long, allant généralement de deux heures, dans le meilleur des cas, à la journée, dans le pire. Une seule fois, un week-end, la porte s’est ouverte après plus de vingt-quatre heures. Je suppose que l’homme avait dû être particulièrement performant ou exigeant et certainement fortuné. Cette fameuse fois, aussitôt après avoir ouvert la porte, elle s’est précipitée vers moi, m’a serré dans ses bras jusqu’à m’étouffer, me suppliant de lui pardonner, prétextant n’avoir pas vu le temps passer et répétant, à maintes reprises, qu’elle m’aimait plus qu’elle n’avait jamais aimé aucun homme. Elle m’appelait son petit amour, puis son grand amour. Moi, j’ai bien compris que cette mère-là m’aimait et j’ai vite oublié l’angoisse qui m’avait un temps submergé, la peur de ne plus voir la porte s’ouvrir et d’être abandonné. Ma mère m’aimait et c’est bien tout ce qui comptait.
Les cloisons n’étaient pas très épaisses et il m’arrivait d’entendre derrière le mur Ouest des gémissements, des rires, des mots prononcés dont je ne comprenais pas le sens, une discussion et quelques bruits que je n’identifiais pas. L’idée m’était quelquefois venue de pousser ce mur Ouest, de le faire tomber pour voir un peu qui étaient ces gens qui parlaient si longtemps avec ma mère et pourquoi je ne pouvais assister à leurs conversations. Je posais alors mes deux mains bien à plat sur la cloison et poussais de toutes mes forces pour qu’elle s’écroule, mais ce foutu mur résistait, ne donnant aucun signe de défaillance. Je me suis mis à le haïr, le trouver fier, lui qui recevait, et c’était le seul, un cadre dans lequel trônait derrière une vitre tavelée de chiures de mouches et de graisse laissée par les doigts, un homme à la moustache abondante et tombante de chaque côté de la bouche. Il portait une chemise blanche et une cravate dont je ne sus jamais la couleur puisque la photo était en noir et blanc. J’ai toujours ignoré qui était cet homme. Ma mère, interrogée à ce sujet, se contenta de hausser les épaules en affirmant qu’elle l’ignorait elle-même, prétendant qu’il était déjà là lorsqu’elle avait loué l’appartement. Je haïssais donc ce mur Ouest et l’agonisais de tous les mots les plus désagréables, voire injurieux, y compris ceux dont je ne saisissais pas le sens, mais que j’avais entendu prononcer à l’école par des camarades en colère : « enculé, cocu », j’en passe et des plus vulgaires. Je le méprisais, lui balançais à voix basse tout mon courroux, et me vengeais oralement sur lui de mes contrariétés sans que cela, il est vrai, semble l’affecter tellement il se montrait hautain, fier d’être le seul sur lequel on avait posé un semblant de décoration. Chaque fois que je le regardais, je lui jetais un regard noir et définitivement hostile. En revanche, je me pris d’affection pour le mur Nord, le plus abîmé, sans doute le plus exposé à la froidure qui, malgré cela, me protégeait. Je lui promis de le rendre plus joli, plus agréable au regard et il m’apparut alors satisfait de cette décision, en laissant encore plus rapidement les lés se détériorer. Je l’aidais de mon mieux en arrachant, à la limite que me permettait ma taille, les lambeaux miteux qui pendaient, lamentables, et confectionnais de grosses boules de papier que je glissais sous mon lit.
Un jour, désirant effectuer quelques achats, ma mère entra dans le bazar situé en bas de notre rue. Pendant qu’elle demandait je ne sais quoi au propriétaire, un certain monsieur Robert qui semblait subjugué par sa beauté et lui offrait un regard qui ne laissait aucun doute sur sa concupiscence, j’eus l’idée soudaine de m’approprier deux pots de peinture et un pinceau, au hasard et en vitesse. J’engouffrai le tout dans mon cartable judicieusement laissé ouvert. Arrivé chez moi, je vis qu’il s’agissait de deux couleurs différentes. J’avais chapardé un pot de peinture rouge et un autre de jaune. Je cachai aussitôt mon butin sous le lit. Ma décision était prise et je le fis savoir au mur Nord : j’allais le peindre, le rendre beau, tout en promettant aux murs Sud et Est que leur tour viendrait. Je lorgnai le mur Ouest qui ne montra aucune espèce de sentiment, mais il me sembla qu’il était quand même un peu vexé, car j’eus l’impression que le cadre tremblait légèrement. Ah, ça, il ne l’avait pas volé ! Et je ne me fis pas prier pour lui en faire la remarque.
Il n’est jamais aisé pour un enfant de cinq ans de passer des intentions aux actes et les difficultés sont nombreuses qui se dressent sur son chemin. Moi, je fus dans l’impossibilité d’ouvrir la boîte au couvercle rouge. Malgré mes courageux efforts, ce satané couvercle refusait de se séparer du reste. Avec mes petits doigts boudinés, je tirais de toutes mes forces… en vain. Je changeai de pot avec l’espoir que le jaune serait plus coopérant. Ce ne fut pas le cas. Je pris un coureur en plastique, insérai la roue avant dans l’intervalle entre le couvercle et le fût du pot en poussant vers le bas l’élégant coursier. Le résultat ne tarda pas : la roue fut brisée et je restai interdit avec le vélo mutilé dans la main, que je jetai de dépit à travers la pièce. Je pris le manche du pinceau, mais le bout était trop large et ne rentrait pas dans l’intervalle prévu pour utiliser un levier. Le sort était contre moi et, désappointé, je vins m’assoir sur mon lit, les yeux tournés vers le mur Nord pour lui exprimer mon regret. Je savais qu’il me comprenait et qu’il regrettait tout autant que moi cet échec patent. Il me fallait trouver une solution, car je n’avais pas l’intention d’abandonner mon projet, ce qui eut comblé d’aise le mur Ouest, ce que je ne voulais en aucun cas ! Mon cerveau fut mis à contribution et quand ma mère, la visite terminée, vint ouvrir la porte, je lui fis part de mon projet – sans souligner mon aversion pour le mur Ouest – en lui montrant les objets récalcitrants. Elle ouvrit des yeux plus grands que la gare Montparnasse, me demandant où j’avais récupéré ce matériel. Je dus avouer que je l’avais subtilisé au propriétaire du grand Bazar, un jour où elle était allée y faire des achats et pendant qu’il lui faisait les yeux doux. Elle prit d’abord un air sévère, affirmant qu’un petit garçon de cinq ans ne devait pas voler dans les magasins, qu’elle pouvait quand même payer deux pots de peinture et un pinceau. Je lui répondis que je n’aimais pas la façon dont ce monsieur, par ailleurs bedonnant et plein de gras, la regardait avec ses petits yeux de cochon. Il avait les cheveux sales, les ongles noirs. Il me dégoûtait. Son regard s’adoucit et elle m’avoua qu’elle-même n’appréciait pas particulièrement l’individu, mais que, comme il lui faisait régulièrement bénéficier de ristournes importantes, elle ne pouvait changer de fournisseur. Je me pose aujourd’hui la question des raisons de ces ristournes. Me passant les mains dans les cheveux, elle admit que, compte tenu des ressources financières du monsieur, ce petit chapardage ne représentait pas pour lui un manque à gagner important. Elle me fit cependant jurer de ne jamais recommencer. Quand on est dans le besoin, la morale est parfois élastique, mais je me suis aperçu depuis que chez les plus riches il en était souvent de même.
Elle s’émerveilla de mon intention, me laissant libre d’exercer mon art à ma convenance, au gré de mon imagination qu’elle savait fertile. Cela confirma, s’il en était encore besoin, que ma mère m’aimait plus que n’importe quel être au monde et cela me remplit de joie, ce qui redoubla mon amour pour elle en même temps que mon inspiration quant à l’œuvre que j’allais accomplir. Elle me donna plusieurs journaux que j’aurais à poser sur le sol pour ne pas le tacher. Avec l’aide d’un manche de cuillère, elle ouvrit les deux boîtes, me montra comment il fallait, avec une petite baguette de bambou qu’elle dégota je ne sais où, remuer régulièrement le liquide de couleur, et me laissa à mon enthousiasme.
Je pris du recul, tel l’artiste qui jauge le support de sa future œuvre avant de le dominer, de le transformer, de le posséder au gré de son talent. J’enlevai quelques nouveaux lambeaux disgracieux, ponçai du plat de ma main le mur qui prit cela pour une caresse. Je le sentais frémir sous mes doigts et lui promis qu’il serait sous peu beau comme il ne pouvait l’imaginer. J’hésitais sur les motifs que je ferais naître puisqu’il n’était pas question de badigeonner l’ensemble de sa surface de façon uniforme. Compte tenu de ma taille, j’en aurais bien été incapable. Il méritait mieux, beaucoup mieux qu’une couche de peinture ordinaire à en devenir banale. Je voulais de l’original, de l’expressif. Je désirais ainsi lui montrer toute mon affection en le parant de la plus belle des manières, en l’ornant des plus merveilleux motifs qu’un gamin de cinq ans puisse réaliser.
Allais-je entamer d’abord le pot rouge ou le pot jaune ? J’hésitai assez longuement. L’art mérite réflexion. Après quoi, furieux dans mon délire artistique, je me lançai. Du jaune ici, du rouge là, une superposition de couleurs dans ce coin, une fleur ailleurs, un soleil au zénith, une tache de sang. Je ne sais combien de temps l’art pictural me posséda. De temps à autre, je prenais de la distance, pour voir, pour corriger, pour admirer, avant de revenir toujours aussi débordant d’imagination et d’amour grandissant pour mon support, pour ce mur protecteur des agressions extérieures. Je lui devais l’excellence. Le pinceau se promenait léger, puis plus lourd sur la blancheur relative avec laquelle je jouais inconsciemment. Jamais je n’avais ressenti pareille émotion, presque de la volupté, que certains aujourd’hui qualifient de jouissance. Moment incroyable, instant de création intense, sentiment de faire corps avec ce mur à qui je ne cessais de répéter qu’il allait être magnifique. J’étais d’autant plus dans l’extase que je savais que l’autre, le mur Ouest, allait en devenir blême de jalousie. Le pied ! La vengeance intégrale ! Le nirvana ! J’eus d’autant plus de chance que cet après-midi là, le soleil pénétrant par la fenêtre du mur Sud venait illuminer l’œuvre lui donnant une luminosité presque céleste.
Je peignis jusqu’à la dernière goutte de peinture. Je raclai le fond des boîtes, ne voulant rien perdre. Je m’étais exprimé jusqu’à l’ultime limite des possibilités qui m’étaient offertes avant de m’assoir, éreinté, mais tellement heureux, sur la chaise. J’étais fier. Je jure n’avoir jamais connu pareille fierté. Je voulus que ma mère puisse partager ce sublime instant. Je me dirigeai vers la porte et l’ouvris avant d’appeler et demander à ma génitrice de venir. À aucun moment je ne doutai qu’elle allait adorer, s’extasier devant le talent naissant, mais réel de son rejeton, de son petit et grand amour comme elle me qualifiait si souvent. J’avais raison. À peine entrée, elle poussa un cri d’admiration, me prit dans ses bras, m’embrassa, me félicita.
– C’est beau, dit-elle, c’est beau ce que tu as fait mon petit amour. Si beau !
À mon tour, je l’embrassai sur les deux joues, fort, très fort. Je sentais son parfum m’envahir, me faire chavirer de bonheur. Le mur Nord était radieux, le mur Ouest grincheux. Elle fut si heureuse qu’elle me proposa de m’acheter d’autres pots de peinture pour que je poursuive mon œuvre. Elle ne se fâcha même pas quand elle découvrit l’état de mes vêtements. Aucun n’y avait échappé, ni le pantalon ni la chemise, maculés de rouge et de jaune. En me serrant contre elle, j’en avais mis également sur son corsage.
– Bah, me dit-elle, c’est pas grave, on ira au Secours catholique en chercher d’autres, et puis c’est tout.
Je ne parle pas des cheveux, du visage et des mains, colorés à souhait. Contrairement à ce que certains voulurent, par la suite, me faire croire, j’avais de la chance d’avoir une pareille mère, car je ne connais pas beaucoup de parents qui auraient laissé leur bambin gribouiller, certains diraient saloper, de cette façon un mur de sa chambre. J’étais heureux auprès d’elle et ne me posais pas la question de l’absence d’un père. Nous étions si bien tous les deux, si proches dans notre tolérance mutuelle dictée par l’amour.
Une ou deux semaines plus tard, je ne me souviens plus bien, il y a si longtemps, la porte était verrouillée de l’extérieur et, tandis que je jouais avec mes voitures qui suivaient deux coureurs cyclistes, le troisième ayant pris quelques centimètres d’avance à ses adversaires, j’entendis derrière le mur Ouest des voix s’élever plus que de coutume. Ce qui n’était au départ qu’un semblant de contestation devint vite une dispute, puis carrément une engueulade. Les voix devinrent violentes. Je crus même ouïr une plainte avant d’entendre ma mère hurler et appeler au secours. Je me levai aussitôt pour pousser de toutes mes forces le mur Ouest, en vain. Cette saloperie de mur ne voulait rien entendre. Il se faisait complice d’un mauvais coup. Il refusait que j’aille secourir ma génitrice. Je me rabattis sur la porte verrouillée, mais c’était, à l’époque, des portes en plein bois, contrairement à celles d’aujourd’hui qu’un brodequin chaussé défonce sans avoir besoin d’appartenir à un costaud. Elle ne céderait pas, de plus, elle donnait sur le couloir et non dans la pièce où se déroulait le drame. Affolé, sans réfléchir, j’ouvris la fenêtre et me jetai dans le vide, frôlant dans ma chute la frêle et gentille madame Gerber que j’aurais, à coup sûr, tuée si je lui étais tombé dessus. Mon atterrissage fut immédiatement suivi d’une vive douleur qui se répandit dans toute ma jambe droite. Je hurlai à la mort.
Un groupe de passants s’agglutina autour de moi. Un homme fit savoir aux autres qu’il ne fallait pas me toucher, il savait de quoi il parlait, il était secouriste. On risquait de me faire plus de mal encore. Une femme prit l’initiative d’aller à la cabine téléphonique prévenir un médecin ou une ambulance, je ne sais plus ; toujours est-il que l’un et l’autre débarquèrent quelques minutes plus tard tandis que le secouriste m’intimait, inlassablement, l’ordre de ne pas bouger d’un poil. J’eus quand même le temps de voir un homme grand, aux cheveux bruns, s’enfuir de l’immeuble en ramassant sa chemise dans son pantalon, et disparaître dans la première rue adjacente. Il fut suivi quelques secondes plus tard de ma mère qui hurla comme un animal blessé. Elle vint s’agenouiller près de moi, maintenue par le secouriste qui répétait qu’il ne fallait surtout pas me toucher. Elle avait le bord de l’œil gauche abîmé, cerclé de deux ou trois couleurs variant entre le bleu, le rouge et le caca d’oie. Moi, je pleurais. Ma mère m’appelait « mon petit amour » et les gens s’interrogeaient sous cape sur cette défenestration d’un si petit enfant. Des hommes en blouse blanche me saisirent avec précaution. Le médecin émit rapidement son diagnostic tant il était évident. J’avais la jambe cassée au niveau du tibia, avec perforation de la peau. Ma mère exigea de monter avec moi dans l’ambulance et durant tout le trajet me caressa le front d’une main tandis que l’autre enserrait la mienne à m’en faire mal. Elle tenta de ne jamais se départir de son sourire rassurant, ce qui me rassurait.
– C’est rien, mon petit amour, mon grand amour, les médecins vont t’arranger ça, tu vas vite guérir ne t’en fais pas.
Je pus remarquer qu’elle ne portait pas ses éternels bas résille noirs, que son corsage était plus ouvert que d’habitude et que ses cheveux, dont elle prenait grand soin, étaient en bataille.
À l’hôpital, je partageai la chambre avec trois autres enfants qui devaient avoir approximativement mon âge bien que l’un d’eux fut de taille supérieure et semblât jouer les caïds. Le médecin de service était déjà occupé à une opération que l’infirmière qualifia de délicate, nous prévenant qu’il ne pourrait s’occuper de moi que le lendemain dans la matinée. Ma mère décida d’aller me chercher des vêtements de rechange et un pyjama.
Les murs étaient blancs, propres, trop blancs, trop propres. Ils n’avaient aucun intérêt particulier, badigeonnés, javellisés, sentant l’éther et le médicament. Les résidents, êtres de passage, n’avaient pas eu le temps d’y déposer leur odeur. Il n’y avait aucune décoration. Ils étaient aussi tristounets que leurs patients, si j’excepte le grand dégingandé qui cachait son angoisse derrière un flot de paroles et d’airs supérieurs. Je n’eus aucune envie de confier ma douleur à ces murs-là. Trop impersonnels, voyant trop de misère pour s’attendrir, et desquels on effaçait régulièrement la mémoire à grands coups de produits d’entretien. Je souffrais donc en silence tout en pensant que bientôt je retrouverais ma chambre à moi et mon magnifique mur Nord, ainsi que mon triste et sournois mur Ouest. Lui, mon mur Nord, c’était un vrai mur, qui avait vécu, qui avait eu le temps de s’imprégner de l’odeur des ses habitants successifs. Il portait, certes, les stigmates du temps, et c’est justement ce qui le rendait, vivant, allais-je dire, du moins réceptif. Il m’écoutait, à l’inverse de bien des êtres humains qui, trop accaparés par leurs propres soucis, ne vous entendent pas et font semblant d’écouter.
L’infirmière passa pour me donner une médication censée diminuer la douleur. Elle me donna deux ou trois comprimés que je dus avaler à l’aide d’une gorgée d’eau fraîche. Je me souviens de son physique : petite, brune avec des yeux verts, souriante et sûrement gentille, mais débordée, ne pouvant pas s’attarder auprès de chaque malade. Elle me tapota quand même le bras en m’exhortant au courage et en me promettant de revenir parler un peu avec moi. Je me souviens également très bien que, quelques minutes plus tard, un monsieur, de taille moyenne, presque chauve, de petites lunettes rondes posées sur le nez, une chemisette bleu et blanc, un pantalon bleu-marine, vint vers moi et, d’une voix grave qui ne correspondait pas à son physique, m’informa qu’il était de la police. L’hôpital avait signalé avoir reçu dans ses services un enfant d’un peu plus de cinq ans qui s’était défenestré du premier étage d’un immeuble situé dans un quartier qualifié de chaud par la vox populi. Il sortit calepin et crayon puis commença à me poser des questions sur le déroulement des événements, en mettant le ton qui sied quand on interroge un jeune enfant.
– Qu’est-ce que tu faisais dans la chambre, parce que tu étais dans ta chambre, n’est-ce pas ?
Ma mère m’avait dit de ne jamais parler dans la rue à un monsieur que je ne connaissais pas, de ne jamais le suivre non plus. Je ne savais pas si je devais lui répondre. Nous n’étions pas dans la rue, c’est vrai, mais n’empêche que je ne le connaissais pas, moi, ce monsieur. L’homme renouvela sa question d’une façon moins solennelle encore, tentant de gagner ma confiance en m’affirmant qu’il ne me voulait aucun mal, bien au contraire. J’étais bien embêté et j’aurais voulu que ma mère soit là, mais elle n’était pas là et je sentais bien qu’il attendait une réponse de ma part. Il insista, toujours sur le ton de la gentillesse :
– Tu sais, tu ne dois pas avoir peur de la police. Je suis là juste pour savoir ce qu’il s’est passé, c’est tout. Je ne ferai de mal à personne, ni à toi ni à ta maman, ajouta-t-il. Alors tu étais dans ta chambre ou dans la cuisine ?
– Dans ma chambre, balbutiai-je.
– Et tu jouais à quoi, dans ta chambre ?
– Au tour de France.
– Au tour de France ? C’est quoi ce jeu-là ?
– C’est des voitures qui suivent des coureurs avec leur vélo qui gagnent quand ils vont plus vite que les autres.
– Bien ! Et après ? Qu’est-ce qui s’est passé, mon petit bonhomme ?
– Après, j’ai entendu maman crier derrière le méchant mur.
– Pourquoi elle criait, ta maman ?
– Je sais pas. Alors moi, j’ai poussé fort, très fort le méchant mur, mais il a pas bougé.
– Pourquoi n’as-tu pas essayé d’ouvrir la porte de ta chambre ?
– Parce qu’elle est toujours fermée par le verrou quand maman elle reçoit les gens. Toujours.
– Quelles gens ?
– Je sais pas, je les vois jamais. Maman elle a crié, alors moi j’ai voulu sauver maman et j’ai sauté par la fenêtre.
Le policier parut se satisfaire de ce court entretien. Il rangea calepin et stylo avant de me tapoter gentiment la joue :
– Au revoir, mon bonhomme, me dit-il simplement.
Ma mère revint au moment où il s’apprêtait à poser sa main sur la poignée de la porte. Il se présenta, lui demanda si elle était la mère du petit garçon qui venait d’arriver. Elle répondit par l’affirmative en présentant un regard inquiet. Il souhaita qu’elle le suive dans le couloir car il désirait s’entretenir quelques minutes avec elle. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il emmenait ma maman, pourquoi il ne parlait pas avec elle ici, dans cette chambre d’hôpital. J’étais inquiet, car le temps passait et elle ne revenait pas. Je me mis à haïr ce monsieur qui avait enlevé ma mère. Lorsqu’elle revint enfin, son visage était défait, ses yeux rougis. Je la connaissais bien, ma mère, elle était mon centre du monde, mon seul vrai point d’attache, entretenant peu, pour ne pas dire pas, de relation avec les autres. J’étais son petit solitaire préféré. Il me tardait de rejoindre ma chambre, mon antre, mon mur Nord, le royaume où j’étais roi.
On m’opéra le lendemain matin. Je ne vis rien, n’entendis rien, ne sentis rien. Une infirmière, différente de celle de la veille, me fit une piqûre tout en me plaisantant et en vantant mon courage. Je regardai intensément ma mère avant de me laisser avaler par le néant.
Quand je me réveillai, j’étais dans mon lit tandis que les trois autres enfants jouaient à une partie de petits chevaux. Le grand disait qu’il était le plus fort. Je me demande s’il ne trichait pas un peu. En soulevant le drap, je vis qu’une grande partie de ma jambe droite était enserrée dans un plâtre qui me faisait comme une lourde botte blanche montant presque jusqu’à l’aine. Dans l’après-midi, deux des enfants partageant ma chambre (dont le grand dégingandé) quittèrent l’hôpital et je me retrouvai avec le blondinet, comme l’appelaient les agents de service qui nous apportaient les repas, notamment une femme maigre comme un clou, gentille comme une mère, qui s’entretenait avec chacun de nous d’une voix douce et chaude. Un gamin calme, voire un peu bizarre, avec un faciès particulier, rond comme une bille, avec des yeux proéminents, qui feuilletait en permanence un livre d’images. Je ne me souviens pas lui avoir parlé ni même qu’il eut, de son côté, entamé un début de conversation.
Ma mère passa la journée à mon chevet. Elle semblait triste, d’une tristesse que je ne lui connaissais pas, quand bien même il lui arrivait d’avoir des accès d’angoisse. Là, elle me semblait toucher le fond de l’abîme. Sans cesse, elle caressait mes cheveux, mon visage, et ne me quittait jamais des yeux, comme si elle voulait imprimer en elle ma présence. Au soir, une infirmière, une autre, vint nous dire que vraisemblablement je resterais hospitalisé trois jours, ce qui étonna ma génitrice, car on lui avait dit que dès le lendemain de l’opération, je pourrais rentrer chez moi. Elle interrogea l’informatrice qui, haussant les épaules, prétendit qu’elle se contentait de rapporter ce que le chef du service lui avait dit, sans en connaître les raisons. L’inquiétude de ma mère atteignit son paroxysme. Elle se mit à retrouver les tics que je lui connaissais uniquement en fin de mois, quand elle craignait de ne pouvoir faire face à ses difficultés financières, notamment se gratter le lobe de l’oreille droite ou passer sa main dans ses cheveux de façon quasi permanente.