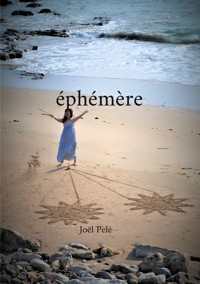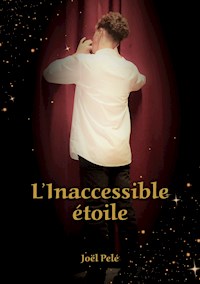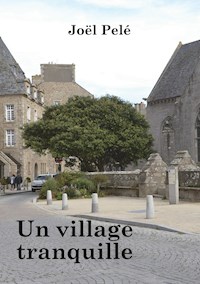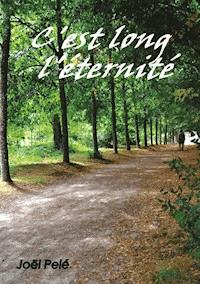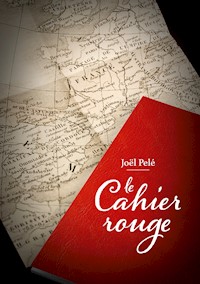
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ils étaient entrés dans la grande salle vide. Là, dans l’angle, un carré de parquet paraissait légèrement moins gris que les autres. À l’aide d’une lime à ongles, Juan, fils d’émigrés espagnols, l’avait soulevé, sans trop de résistance, comme s’il attendait cela depuis longtemps. Au fond de la cavité reposait une boite en fer. — Regarde avait dit Lisa, un cahier à spirales, un stylo et deux photos en noir et blanc. Sur l’une d’elle posait un groupe d’hommes et femmes. Parmi eux, Juan avait reconnu sa mère et son père, jeunes et enlacés. Que faisait cette photo dans la maison d’un homme qui l’avait abandonnée avant de disparaître, sous prétexte que celle-ci portait malheur à ceux qui l’habitaient ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Des jours presque ordinaires – Editions les 2 encres (2012)
Aux confluents de la vie – Editions Les 2 encres (2013)
Je t’attends – Editions Baudelaire – BoD (2018)
C’est long l’éternité – BoD (2018)
Un village tranquille – BoD (2019)
L’homme qui voulait imiter Zorro – BoD (2020)
Contact auteur :joë[email protected]
A mon épouse, Denise, qui m’a accompagné et guidé par ses précieuses
critiques dans l’écriture de ce roman.
A mes amis :
Dominique Berthemont et Guy Fribault
Brigitte et Gérard Lefebvre
Eliane et Jacques Moret.
Catherine et Jean Marie Raimbault…
Qui ont su, comme pour chacun de mes romans, corriger mes fautes de
frappes… et les autres et me témoigner leur ineffable amitié.
A mes amis de très longue date :
Jacqueline Delaunay Maire de Trémentines
Nicole et André Colineau
Marie Madeleine et Bernard Delaunay
Maryvonne et Guy Supiot…
Qui se sont intéressés à ce roman, soit en me fournissant des
renseignements sur Trémentines, soit en me questionnant régulièrement
sur le déroulement de mes écrits.
A Nathalie Coste qui pendant 4 ans a mis en forme et aux normes mes
écrits. Elle a quitté ce monde il y a peu.
La mort n’a pas de couleur politique et un crime sera toujours un crime.
Alberto Reia Tapia
Je n’espère rien
Je ne crains rien
Je suis libre.
Nikos Kazantzakis
A tous ceux que j’aime
Juan a vu le jour en terre française, mais de parents émigrés ayant fui le régime dictatorial de Franco. Sa mère et son père défendaient le camp républicain mais l’adversaire était bien trop fort. Il était soutenu par des puissances étrangères, dont l’une fit de l’Espagne son terrain d’entrainement en vue d’une ambition autrement plus grande et plus meurtrière encore, sous le regard, qui se voulait neutre, de pays comme la France. La vérité historique oblige à préciser que Blum n’a accepté la non intervention de la France que sous la pression de la Grande Bretagne et des radicaux. Discrètement, il a organisé, avec Jean Moulin, une contrebande légale qui a fourni des armes aux républicains.
Ces pays ont, quelques années plus tard, regretté leur neutralité qui s’est retournée contre eux.
Jamais son père ne lui a parlé de la violence inouïe de ce conflit qui a opposé des êtres issus d’un même peuple, d’un même village et parfois de la même famille.
Un jour, il devait avoir quinze ans, il a posé à son géniteur des questions sur cette guerre civile. Le père lui a répondu laconiquement que c’était hier et qu’il est plus important de vivre le présent et d’envisager l’avenir que de se morfondre sur le passé. Devant cette obstination à ne pas répondre, il s’est tourné vers sa mère, avec l’espoir qu’elle serait plus prolixe. Hélas, ce ne fut pas le cas. Son argument majeur était qu’il fallait oublier cette maudite période où régnaient la peur, la haine, la violence, la trahison et la mort. Cette parenthèse, honteuse dans la vie d’un peuple, ne méritait pas autre chose que le dédain. Il fallait plutôt rêver d’un avenir plus humain et ne pas donner, aux salauds qui ont déclenché les massacres, le plaisir de se croire des héros dignes de rester dans l’histoire. Il n’est jamais aller en Espagne non plus, peu tenté de séjourner dans un pays dirigé par un dictateur. La seule mémoire de ces années fratricides c’était la photo noir et blanc encadrée de Dolorès Ibarruri, surnommée la Pasionaria, posée sur le manteau de la cheminée du salon. Cette femme, assise dans un fauteuil aux accoudoirs cloutés, arbore, dans ses habits sombres, un sourire qui cache difficilement un caractère bien trempé. On lui attribue le slogan très connu : no pasaran, (ils ne passeront pas) et une citation célèbre : Mejor morir de pie que vivir de rodillas. (Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux). Adulée par les uns, haïe par les autres pour sa cruauté et sa versatilité, elle reste l’une des figures emblématiques des républicains.
En classe de cinquième, le professeur d’histoire avait d’abord abordé cette guerre de façon très scolaire, apparemment très détachée, ne citant que des chiffres : nombre de morts, nombre de gens qui ont fui leur pays. Progressivement, il était devenu plus engagé. Visiblement, il ne partageait nullement l’idéologie des républicains. Le mot : « rouges » lui avait même échappé lorsqu’il avait abordé leur lutte quasi désespérée. Le professeur avait ensuite abordé la retirada. Ce mot, en Castillan et en Catalan signifie retraite, c’est-à-dire la fuite de 450 000 républicains vers des pays plus accueillants que le leur. Ce professeur, quelque peu partial, avait précisé que la France avait subi, plus que souhaité, cet envahissement de gens dont il fallait se méfier. Il avait même fini par les traiter de bandits affiliés à Moscou.
Juan, avait relaté cet enseignement partisan à ses parents. Il avait vu la colère crisper leur visage. Son père avait retenu un juron qui affleurait ses lèvres. Sa mère s’était, discrètement, passé son index droit sous les yeux, pour sécher l’humidité qui perlait. C’est dire combien, cette satanée guerre restait gravée dans leurs cœurs. Vingt-deux ans plus tard ! Ils n’ont pu que murmurer que chacun a ses idées, qu’il faut les respecter, quand bien même elles ne correspondent pas à la réalité. Le père avait clos la discussion par un propos fataliste :
— C’est comme ça. Il ne sert à rien d’essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas l’être. La vie continue. Nous avons fait ce que nous dictait notre honneur.
Le père était sorti de la cuisine sous le prétexte d’aller donner à manger à ses lapins tandis que la mère s’était affairée auprès de ses fourneaux, alléguant qu’il était l’heure de cuisiner. Juan comprit qu’il ne fallait plus aborder le sujet sous peine de perturber gravement ses parents. Dans le même temps, il s’était juré d’aller, dorénavant, chercher lui-même les réponses aux questions qu’il se posait.
Il s’était mis en quête de tous les auteurs qui se sont penchés sur cet affrontement espagnol. Il avait lu qu’Argelès sur mer, ville du sud-est de la France, a accueilli dans un camp en bordure de plage, 100 000 réfugiés, de février 1939 à fin 1941. L’article reproduisait l’épigraphe gravée sur la stèle commémorative :
A la mémoire de 100 000 espagnols
Internés dans le camp d’Argelès lors de la
Retirada de février 1939. Leur malheur : avoir
Lutté pour défendre la Démocratie et la République
Contre le fascisme en Espagne de 1936 à 1939.
Homme libre, souviens-toi !
Il avait su que cette guerre fratricide avait duré trente-deux mois et causé la mort de 600 000 personnes. Il avait également découvert les destinations des réfugiés notamment la France où ils ont été accueillis sans enthousiasme. Il avait noté le nom des camps où ils furent enfermés dont celui d’Argelès sur mer. Il avait retenu les lieux emblématiques de la lutte et ceux d’humiliation et d’extermination des républicains : Guernica, massacre dont Picasso a tiré une œuvre immortelle, le pont de Ronda, la vallée de los Caïdos entre autres. Il avait pu mesurer la barbarie des deux camps. Hélas ! Les combattants étant pris dans un cercle infernal qui veut que la violence de l’un, entraine les représailles de l’autre et ainsi de suite, jusqu’à l’extermination de l’un des deux camps. L’homme perd alors sa qualité d’humain pour devenir objet ou sujet de vengeance dans une spirale sans fin.
Juan était déterminé. Il voulait savoir. Il allait savoir. Il devait agir en toute discrétion pour ne pas alerter ses parents. Il ne voulait pas leur imposer une blessure supplémentaire.
A l’aube de ses dix-sept ans, il s’était juré d’y parvenir, quels que soient les moyens et les conséquences. Il ne pouvait pas vivre dans l’ignorance de ce qu’ont vécu les deux êtres qu’il aime le plus au monde. Leur souffrance était trop évidente, durable, profonde comme un gouffre sans fond. Souffrance qu’ils voulaient lui cacher.
En vain.
Il ignorait où tout cela le mènerait.
Juan n’avait aucune idée de la façon dont il allait procéder. En fait, il ignorait ce qu’il cherchait vraiment. C’était flou. Bien sûr, il voulait connaître ce passé douloureux vécu par ses parents, mais comment y parvenir ? Par où et par quoi commencer ? Son instinct ou son inconscient, (vaste débat qui me dépasse) lui dictait de se faire confiance. Un renseignement est un élément qui permet d’aller plus loin. Il lui fallait partir du commencement, c’est-à-dire du lieu de naissance de son père et de sa mère. Peut-être, alors, le reste suivrait.
Peut-être.
Mais que ferait-il ensuite de ses découvertes ?
Persuadé que le début commençait par un avis de naissance, le sien, sur lequel, théoriquement, étaient également mentionnés les lieux de naissance de ses parents, il se rendit à la mairie du village. Il avait quelques appréhensions car le secrétaire de mairie, p’tit Louis, comme tout le monde le surnommait, était un ami de son père. Si par malheur il informait le chef de famille de la démarche de son rejeton, cela entrainerait obligatoirement des questions auxquelles il devrait répondre. Mais, partant du principe que celui qui ne risque rien n’a rien, il avait décidé de se rendre à, ce que certains appelaient, encore à l’époque, la maison du peuple.
Le rez-de-chaussée était occupé par une grande salle dans laquelle avaient lieu les repas de mariage, les bals, les manifestations populaires et expositions diverses. Il avait gravi une à une les marches de l’escalier extérieur menant de la place au premier étage. A gauche on trouvait la salle du conseil, le bureau du maire et celui des adjoints, à droite le secrétariat ouvert au public.
P’tit Louis n’était pas là. En revanche, une jeune fille qu’il ne connaissait pas, vaquait à ses occupations. Elle avait attiré tout de suite son attention. De taille moyenne, les cheveux d’un blond couleur des blés en été, les yeux verts, vifs, le visage expressif et fort agréable lui procurèrent une sensation nouvelle, proche de l’admiration.
— Bonjour, vous désirez ?
La voix était douce, mais affirmée. Il lui fallut quelques secondes pour se ressaisir, quelques secondes suffisantes à la demoiselle pour comprendre qu’elle venait de troubler l’adolescent.
— Euh… J’aurais besoin d’un certificat de naissance… S’il vous plait.
— Pas de problème. Monsieur Louis est chez monsieur le maire mais je peux fort bien vous fournir ce document. C’est à quel nom ?
— Juan… Juan Moreno.
— Quelle est votre date de naissance ?
— 25 Février 1946.
La jeune fille, d’un pas alerte et le sourire aux lèvres, avait ouvert la porte d’un placard mural, passé ses doigts sur les tranches de livres, en avait sorti un pour le poser sur un bureau en bois, avant de le feuilleter.
— Voyons. Vous m’avez dit…
— 25 février 1946.
— C’est cela. Alors… Février… 1946. Voilà. Vous êtes bien, Juan Moreno fils de Esteban Moreno et de Dolorès Banera ?
— Oui. C’est cela.
— Je vous l’établis tout de suite.
La jeune fille avait posé une feuille de papier à en-tête de la mairie de Trémentines sur une machine à écrire. Elle avait actionné deux ou trois fois le rouleau qui se situait sur le côté droit de l’engin mécanique avant de commencer à frapper les touches tout en se référant à la page du livre consulté. Elle lisait à haute voix en même temps qu’elle appuyait sur les touches noires :
— Le vingt-cinq février mille neuf cent quarante-six, à trois heures du matin, est né, au domicile des parents, à Trémentines, Juan, Estéban, Pablo, de sexe masculin, de Estéban, Pedro, Ramon Moreno né à Alfarras (Espagne) Maçon et de Dolorès, Maria, Carmen Banera, son épouse née à Almacelles (Espagne) ouvrière en chaussures demeurant à Trémentines.
Dressé le vingt-cinq février 1946 à onze heures sur la déclaration de Estéban Moreno le père, qui a signé avec nous, Louis Mincheneau secrétaire de mairie à Trémentines, Officier de l’Etat Civil par délégation.
Elle avait arrêté la frappe et fait bouger deux fois le rouleau avant de frapper à nouveau sur les touches.
Retransmission certifiée conforme au registre de la mairie de Trémentines.
Le 5 juin 1973.
L’Officier de l’Etat Civil délégué.
Lisa Aubusson.
Elle avait tourné la manette à plusieurs reprises, puis retiré la feuille, l’avait signée avant de la remettre à Juan.
— Voilà, c’est fait. Tenez.
— Merci beaucoup, avait balbutié Juan tout en se demandant comment il pouvait prolonger l’instant.
Il était partagé entre deux impératifs : continuer à parler à la jeune fille ou s’en aller rapidement pour éviter le retour du secrétaire de mairie. En effet ce dernier, s’il le rencontrait, voudrait, à coup sûr, savoir ce qu’il était venu chercher ici. Il lui fallait prendre une décision.
— Vous n’êtes pas là depuis longtemps, je ne savais pas que p’tit Louis était secondé par une demoiselle.
— Je suis arrivée il y a une vingtaine de jours. En fait, je suis en période d’essai pendant trois mois. Si tout va bien, le maire a promis de m’embaucher. Je seconderai monsieur Louis qui a trop de boulot et puis qui part à la retraite dans un peu plus d’un an. Enfin, je crois. Nous aurons sans doute l’occasion de nous revoir. En tout cas, c’est mon souhait car je voudrais… mieux connaitre… les administrés. Une employée municipale doit entretenir une relation proche avec tous les gens de la commune… pour mieux les servir… Il est aussi possible que je poursuive mes études. J’hésite. Je verrai ça en septembre selon la décision du maire. Je n’habite pas ici, c’est pour ça que vous ne me connaissez pas.
— Je suis en vacances en ce moment donc relativement disponible. Je veux bien être la première personne de cette commune avec qui vous dialoguerez… Si cela peut vous être utile, évidemment, avait répondu Juan en souriant. Il avait poursuivi :
— Disons que le plus tôt sera le mieux. Je suis disponible ce soir. Je peux être sur la place à dix-huit heures, si j’ai bien lu l’heure de fermeture des bureaux.
Juan était ravi d’avoir entendu et compris le message caché derrière la proposition émise sous le sceau du professionnalisme d’une employée municipale.
— D’accord, faisons comme cela. Avait répondu Lisa, elle-même enchantée d’avoir visé juste.
Juan, satisfait par la tournure des évènements, avait souri de contentement. Il était sorti en faisant un petit signe de la main :
— A tout à l’heure donc.
Cette rencontre impromptue avait perturbé sérieusement Juan. Cette jeune fille le troublait. Il avait une furieuse envie de la revoir, de lui parler et de la connaitre. Il ne pensait qu’à cela. Le reste n’existait plus, y compris le serment qu’il avait fait de tout savoir sur le passé espagnol de ses parents. Jamais il n’avait connu pareille sensation. Jamais il n’avait vécu un tel émoi. Bien sûr, il allait revenir à dix-huit heures sur la place de la mairie. Il serait le plus discret possible, mais il serait là pour qu’elle le voie.
Lisa était toute aussi chamboulée. Ce garçon lui plaisait et l’intriguait à la fois. Il y avait chez lui un mystère, une beauté. Elle avait regardé l’horloge fixée au mur du bureau et calculé le nombre d’heures qui la séparait du rendez-vous. Trois heures vingt, exactement. P’tit Louis, le secrétaire de mairie l’avait surprise à interroger, à plusieurs reprises, la compteuse de temps et à se lever pour se rendre à la fenêtre, et scruter la place.
— Qu’est-ce qui se passe Lisa ?
— Rien, Pourquoi ?
— T’es un peu ailleurs non ?
— Non. Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
— Ton comportement, tes œillades à la pendule, tes voyages à la fenêtre.
— C’est vrai que je suis un peu nerveuse, aujourd’hui. Ce soir, ma cousine que je n’ai pas vue depuis plusieurs mois, vient nous rendre visite alors…
— Ah, c’est donc cela avait répliqué le secrétaire de mairie en faisant semblant de gober ce fabuleux mensonge.
Lisa s’était promis de ne plus se laisser distraire afin de ne pas éveiller l’attention de p’tit Louis. Elle s’était penchée sur les dossiers en cours avec un zèle peu commun. Lorsque la pendule avait marqué dix-huit heures, elle ne s’était pas précipitée vers son manteau, au contraire. Elle avait pris son temps, vérifié que chaque chose, sur son bureau, était bien à sa place. Elle avait ouvert la porte lentement et dit au revoir à son supérieur hiérarchique en prenant le temps de lui souhaiter :
— Bonne soirée et à demain, d’une voix claire avant de franchir l’huis et de la refermer sans précipitation.
Elle n’avait pas couru dans le couloir où les pas résonnaient. Elle n’avait pas descendu les marches extérieures en sautant un degré sur deux, persuadée que monsieur Louis était à la fenêtre.
A chaque marche, elle cherchait, le plus discrètement possible Juan. Où pouvait-il bien l’attendre ? Était-ce possible qu’il ne soit pas venu ? Était-ce possible que pour lui, son invitation n’était que paroles en l’air ? Un jeu d’adolescent pervers ? S’était-il, à ce point montré désobligeant ? Elle avait ralenti son pas. Sa mobylette Motobécane, refilée par son frère ainé lorsqu’il avait passé son permis voiture, était, comme chaque jour, posée sur sa béquille, le long du mur de la mairie. L’âme en peine, le cœur lourd, elle avait eu envie de pleurer. Elle avait attendu encore un peu, pas trop longtemps pour ne pas interroger son supérieur qui, sûrement, de là-haut…
Elle allait rentrer chez elle et méditer sur la perfidie et l’inconsé-quence des garçons.
Et puis, elle l’avait vu. Assis sur le siège biplace de sa mobylette bleue, planqué derrière le mur de la maison qui faisait l’angle. Invisible de la mairie. En une fraction de seconde, tout avait changé. Il lui souriait. Rapidement, il l’informa qu’elle devait tourner à droite juste après le pont sur l’Evre. Il la rejoindrait dans quelques minutes. Elle lui apprit que p’tit Louis était à la fenêtre du premier étage et, sans perdre de temps, avait tourné la poignée d’accélérateur de son engin, sans oublier de respecter le stop. Heureuse, elle avait pris la route de Cholet.
Il avait attendu une minute. C’est long une minute en de telles circonstances. Certain que l’observateur, à la fenêtre de la mairie, devait avoir quitté son poste, il avait pris le même chemin, le cœur aussi léger qu’une libellule. Il avait le sentiment d’être devenu l’égal des amants de romans d’amour. Il était Julien Sorel. Il était l’amant de lady Chatterley, sans qu’il y ait, pourtant, aucune réelle correspondance.
Lorsqu’ils s’étaient retrouvés seuls, il lui avait proposé d’aller dans un endroit qu’il aimait bien. Ce n’était pas un lieu charmant, merveilleux, non, mais il reflétait le calme et la sérénité. C’était un petit étang que les gens du coin appelaient : la Réserve. En semaine, et à cette heure de la journée, il n’y avait généralement pas grand monde et même sans doute personne. Il se situait tout près d’ici. Il suffisait de reprendre la route de Cholet, de rouler pendant cent ou deux cents mètres, de poser les mobylettes contre le mur de la dernière maison sur la gauche et de terminer à pied. Lisa avait acquiescé, d’autant plus facilement que c’était, en quelque sorte, sa route pour rentrer chez elle puisqu’elle demeurait à Nuaillé, à moins de trois kilomètres de là.
Ils s’étaient assis sur la berge, l’un à côté de l’autre. Sans doute aussi intimidés l’un que l’autre. La première question qu’il avait osé poser, fut
— Comment trouves-tu l’endroit ?
— Bien. Non, c’est vrai, c’est sympa.
— Pendant la saison de pêche, il y a beaucoup de monde, surtout le samedi et le dimanche.
— Ça ne m’étonne pas.
— De tous les âges, des jeunes, des adultes, des vieux et même deux vieilles demoiselles, des sœurs qui tiennent un bazar dans la grande rue et adorent ce passe-temps, même si elles ne prennent rien enfin, presque rien.
— Et toi ?
— J’y viens régulièrement, parce que c’est calme, mais je ne pêche pas. Non, jamais. Rien que de penser qu’il faut retirer l’hameçon de la gueule du poisson, ça me fait mal. Non, j’aime bien la sérénité des lieux, le respect des uns et des autres. Ici, pas de compétition. On ne jalouse pas celui qui en prend plus que les autres, sans explications si ce n’est celle du feeling, du savoir-faire ou de la chance. On se réjouit pour lui. Quelquefois, même, on partage les bouteilles, on trinque à la santé de l’un ou de l’autre. Comment te dire ? Y’a une certaine ambiance.
— Je comprends. Comme ça, t’es espagnol ?
— Né en France de parents espagnols.
— Et pourquoi ils sont venus en France ?
— La guerre, enfin la guerre civile.
— Mon père des fois, il en parle de la guerre civile espagnole. Il dit que c’est quand même con de se battre entre gens d’un même pays. Déjà que ce n’est pas fameux quand il faut le faire contre des gens qu’on ne connait pas ou qui ne parlent pas la même langue que nous. Alors quand on est du même pays…
— Je crois qu’ils sont marqués par leur fuite et qu’ils y pensent souvent, mais ils ne m’en parlent jamais, même quand je pose des questions… Ils changent de conversation, me disant que c’est du passé. Quitter son pays, ça doit faire mal, c’est sûr. Pourtant, moi, j’aimerais savoir…
— Savoir quoi ?
— Comment ça s’est passé. Les choses qu’ils ont vécues.
— Ça servirait à quoi ?
— A savoir. Peut-être que je comprendrais mieux pourquoi, des fois, ils sont tristes. Et toi, tes parents ?
— Ni plus ni moins barbants que les autres. Ils ont peur pour moi, me mettent en garde contre les garçons comme si j’étais incapable de me défendre. Parce que les filles, c’est bien connu, attirent les garçons qui ne sont pas tous de gentils garçons et qui pensent à…
— A quoi ?
— Tu veux que je te fasse un dessin ?
— Non, non. Inutile. Tous les garçons ne se ressemblent pas. Certains, sûrement, sont des voyous, mais avant de faire ce à quoi ils pensent, il faut apprendre à se connaître… Non ? Tout dépend de ce que l’on cherche.
— Et toi qu’est-ce que tu cherches ?
— A te connaitre, à être ton ami. J’aime mieux être l’ami d’une jolie fille, intelligente et qui me plait que celui d’un laideron bête à manger du foin. Pour le reste, on verra un peu plus tard, Non ?
— Oui. C’est exactement ce que je pense. Je vais être obligée de partir, parce que si j’arrive trop tard, ils vont me poser plein de questions : T’étais où ? Avec qui ? Ils sont très à cheval là-dessus. Ils disent qu’ils sont responsables de moi, qu’une fille doit obéir à ses parents et respecter la loi de Dieu.
— Quelle loi ?
— L’obéissance, la chasteté avant le mariage etc…
— Ils sont cathos ?
— D’après toi ?
— Un peu quand même, Non ?
— Très cathos. Chez nous, dans les Mauges, C’est très catho. Dieu est au-dessus de tout. Je dois toutefois avouer que tout n’est pas à jeter non plus…
— Moi, mes parents, il faut pas leur parler de religion. Ils en veulent à la hiérarchie catholique espagnole d’avoir soutenu les fascistes. Mais là aussi, certains curés ont épousé la cause des républicains, ils étaient apparemment trop rares pour qu’ils se convertissent.
— Bon, cette fois, j’y vais. J’ai passé un super moment avec toi. Ce serait bien, qu’on se revoit… de temps en temps… Pas demain soir, je vais à Cholet avec ma mère après le boulot. Mettons après-demain, ici, vers dix-huit cinq, dix. D’accord ?
Le visage de Juan s’était illuminé et la réponse avait fusé sans attendre :
— Oui, ça marche.
Elle s’était approchée de lui, avait déposé sur sa joue droite un baiser en lui serrant la main avec force.
Il aurait voulu que le temps s’arrête, là, maintenant, au bord de l’étang. Il avait fermé les yeux, en lui rendant son baiser sur la joue, baiser qu’il aurait souhaité éternel.
Ils s’étaient séparés à regret. Un sourire radieux éclairait leur visage respectif. Un sourire plein de promesses.
Elle était partie en courant, en levant le bras droit et l’agitant au-dessus de sa tête.
Il l’avait suivi des yeux. Il la trouvait belle, si belle.
Il avait hâte d’être plus vieux de quarante-huit heures.
Ce n’est qu’après s’être retrouvés seuls, qu’ils prirent conscience, chacun de leur côté, d’avoir abandonné le vouvoiement au profit du tutoiement.
Il était arrivé tôt, très tôt.
Lorsque les cloches de l’église firent résonner leurs tintements annonçant l’arrivée du dernier quart d’heure de dix-sept heures, il était déjà assis sur l’herbe, les pieds rasant l’eau de l’étang. Le spectacle était bucolique. Des libellules, majestueuses de légèreté, voletaient, se croisaient, se posaient sur une herbe haute pour s’envoler à nouveau dans l’azur bleuté. Les grenouilles sautaient de nénuphar en nénuphar en coassant gaiement avant de plonger et de reparaitre, ne laissant émerger que le haut de leur corps, puis elles recommençaient leurs joyeuses sarabandes. Les oiseaux, peureux, s’approchaient, à petits sauts, du bord pour picorer quelques graines ou miettes de pain laissées par les pêcheurs, tout en continuant d’épier le moindre mouvement. Un vent léger ondoyait la surface de l’eau. C’était une belle fin d’après-midi d’été. Une journée à aimer la vie.
Pendant les quarante-huit heures précédentes, hormis le temps du sommeil, et encore, il n’avait pensé qu’à Lisa. Elle occupait son esprit d’une douce contrainte. Elle n’avait concédé la place à personne, ni à rien d’autre. Elle était toujours là, omniprésente. Souriante et gracieuse. Belle à se laisser damner. Il avait tenté, sans conviction il est vrai, de lutter contre cette attrayante hégémonie. Rien n’y faisait. Elle s’imposait comme une tendre compagne. Elle se penchait vers lui, lui caressait les cheveux. Il souriait béatement à cette apparition idyllique. Il lui avait fallu se méfier de ne pas semer le doute chez ses parents en se contrôlant en leur présence, en faisant le maximum pour ne rien laisser deviner. Et il était là, attendant, ne sachant pas ce qu’il lui fallait espérer. Les jeunes filles sont dangereuses à cet âge, mais y-a-t-il vraiment, chez elles, un âge pour cela ?
Il ne savait pas non plus quelle conduite adopter lorsqu’elle allait apparaitre à la sortie du chemin. Devait-il rester assis ?
Sûrement pas !
Devait-il se lever précipitamment et se tenir debout à l’attendre ? Devait-il courir vers elle en ouvrant les bras pour qu’elle s’y blottisse ? Devait-il l’embrasser sur les joues comme le font les copains et les copines ? Devait-il lui prendre la main et la serrer fort dans la sienne ? Oserait-il déposer un baiser sur ses lèvres, au risque de la désappointer et se montrer trop audacieux ? Trop pressé ? Goujat ? Il n’en savait rien. Rien du tout. Il manquait d’expérience en ce domaine. Il n’avait jamais aimé une fille. Il avait, bien sûr, connu des copines, des amies, mais aucune ne lui avait procuré un sentiment aussi puissant que celui qu’il ressentait pour Lisa. Il ignorait, jusqu’à son entrée dans le bureau de la mairie, que son cœur puisse battre aussi vite, que son esprit soit accaparé par une seule et unique personne. C’était à la fois, magnifique et douloureux. Magnifique parce que la vie s’était colorée des couleurs de l’arc en ciel, douloureux par le doute qui l’étreignait. Lisa partageait-elle sa passion naissante, mais déjà forte et envahissante ?
La nature semblait indifférente. Elle se foutait pas mal des émois d’un jeune homme brûlant d’amour. Tout autour de lui régnait un calme qui contrastait avec son tumulte intérieur. Les arbres, sous le vent, murmuraient un langage inconnu. Les rares nuages défilaient lentement, sans hâte ni précipitation. Le soleil continuait, son immuable rotation jouant à mouvoir les ombres. Calme. Sérénité d’un monde qui se laissait bercer par un été complice.
Lisa, de son côté, connaissait également quelques turbulences. Juan, lui plaisait.
Lui plaisait beaucoup.
Elle le trouvait beau, mais au-delà de sa beauté il émanait de lui quelque chose qu’elle n’arrivait pas à définir mais qui l’attirait comme un puissant aimant. Elle prit conscience de la double signification du mot aimant. D’un côté le matériau qui produit un champ magnétique extérieur (comme le définit le dictionnaire) et de l’autre un être affectueux doux, caressant… Les deux ayant la capacité d’attirer l’un mécaniquement, l’autre humainement. Juan l’attirait. Il l’attirait tellement qu’elle ne pensait plus qu’à lui. Elle avait bien connu quelques amoureux, ou plutôt quelques amourettes, sans conséquences, sans effusions exagérées, quelques baisers, quelques caresses, mais rien de semblable à ce sentiment qu’elle éprouvait depuis deux jours. Elle rêvait de se laisser aller dans ses bras. Elle brulait du désir qu’il l’embrasse tout en se méfiant plus d’elle que de lui. Elle se craignait primaire, résistant peu à ses appétences. Elle brûlait d’envie mais ne voulait pas se brûler. Elle savait que les gens des villages n’hésitaient pas à qualifier une fille qui se soumettait à ses instincts. Elle n’ignorait pas les mots qu’ils employaient pour désigner pareille créature : dévergondée, trainée, pute… Elle connaissait la honte des parents de ces filles qui avaient cédé à leur concupiscence, sans parler de celles qui s’étaient retrouvées enceintes. Ces jeunes filles-là, si elles voulaient se marier, pour régulariser leur situation, ne pouvaient pas le faire chrétiennement dans l’église du village. Le couple devait aller s’unir devant Dieu dans la petite église de Notre Dame de Béhuard, érigée sur une île sur la Loire, dédiée à la Vierge Marie. Pourquoi Béhuard ? Parce que la Vierge, sans doute, comprenait mieux les jeunes filles fautives et savait pardonner. Ce n’est là qu’une hypothèse personnelle.
Toute cette journée, elle avait compté, discrètement les heures. Elle s’était plongée dans l’étude de quelques dossiers censés l’accaparer complètement. Tentative à demie réussie seulement. Dans sa tête s’imposait, en quasi permanence, la rencontre du soir qu’elle espérait chasser d’un revers de mains, comme on écarte, en été, une mouche obstinée. Peine perdue. Philosophe, elle avait fini par s’en remettre à l’instant. Elle déciderait ou pas en fonction de la tournure des événements et des comportements mutuels. Elle se rassurait en supputant qu’ils n’étaient, ni l’un ni l’autre, des voyous mais des jeunes pleins de vie, capables de respect tout en s’abandonnant à des gestes amoureux.
Les six coups bien frappés par le marteau de la cloche de l’église mirent fin à leurs interrogations et doutes mutuels.
Sachant que Lisa arriverait par-là, Juan s’était levé et dirigé vers la sortie du petit chemin ramenant les pêcheurs dans le village. Il avait marché lentement, la tête emplie d’idées contradictoires, alternant entre espoir, déception et le no man’s land de l’indécision. Dans quelques minutes, si tout allait bien, elle serait là. Elle s’acheminerait vers lui. Et alors ?
Lisa fidèle à ce qu’elle qualifiait de discrétion, avait pris le temps de ranger ses affaires avant de se diriger vers la sortie ce qui avait fait sourire furtivement monsieur Louis. Il n’en doutait plus, la jeune fille était amoureuse et allait, de ce pas, retrouver son galant. De la fenêtre du bureau, il l’avait vue passer l’angle de la maison des Landreau et prendre, sur son engin, la route de Cholet. Il se souvenait de ce qu’il avait vécu, lui, pendant trop peu de temps, il y avait très longtemps, mais il s’en souvenait encore, avec tendresse.
— Les jeunes ont raison d’en profiter, le temps passe si vite, se dit-il en retournant à ses dossiers. Nous n’en profitons jamais assez.
Juan avait entendu d’abord la pétarade du vélomoteur. Il vit Lisa descendre la béquille et poser son engin motorisé le long du sien. Elle venait légère, et court vêtue comme Perrette la laitière et son pot au lait.