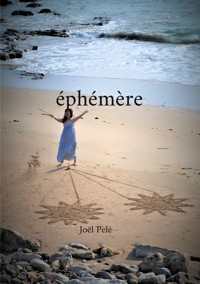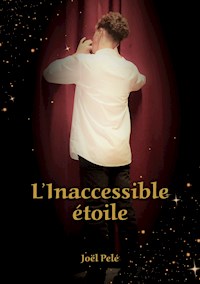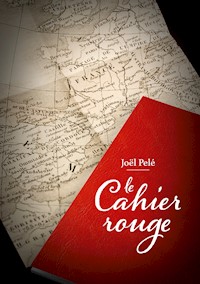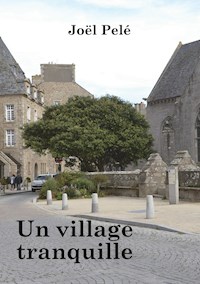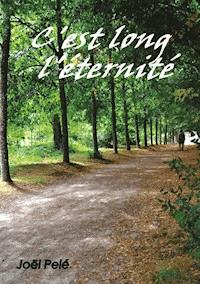Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quelques jours après les fêtes de fin d'année 1990, Bauland, patron d'une usine de chaussures, est contraint à rencontrer le personnel. Il doit lui annoncer la fermeture de l'entreprise victime de la concurrence des pays d'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord. C'est la stupéfaction générale. Seuls quelques uns voient un signe du destin, l'opportunité d'oser enfin, se lancer vers une nouvelle orientation professionnelle dont ils rêvaient secrètement. Les circonstances obligent les deux délégués syndicaux à parler d'une même voix. Ils exhortent leurs collègues à se battre pour sauver leur emploi. Ils proposent une grève illimitée et l'occupation imédiate des locaux. Les erreurs d'hier, les conflits que l'on croyait oubliés ressurgissent . L'unité pourtant indispensable se fissure. L'accusation hâtive ayant entraîné le départ d'un employé, va-t-elle, cinq ans plus tard, être indirectement un facteur d'espoir acceptable par tout le monde?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Des jours presque ordinaires - Editions les 2 encres (2012)
Aux confluents de la vie - Editions les 2 encres (2013)
Je t’attends - Editions Baudelaire - BoD (2018)
C’est long l’éternité - BoD (2018)
Un village tranquille - BoD (2019)
L’homme qui voulait imiter Zorro - BoD (2020)
Le cahier rouge - BoD (2021)
L’inaccessible étoile - BoD (2022)
Ephémère - (BoD) (2023)
Contact auteur : [email protected]
Si les passions et les rêves
ne pouvaient pas créer
des avenirs nouveaux
la vie ne serait
qu’une duperie insensée.
H.R. Lenormand
A tous ceux que j’aime.
Louis Faloud, dit P’tit Louis, du haut de ses cent-soixante-huit centimètres et son ventre bedonnant ne fait plus sourire. Ernest Marchal dit Nénesse, non plus. Son crâne sérieusement dégarni, ses moustaches et sa barbiche grisâtres, son élocution et ses diatribes contre tous les pouvoirs rappellent plus ou moins Lénine, le père de la révolution bolchévique. Les délégués syndicaux C.F.D.T. et C.G.T sont visiblement abattus. Le personnel de l’usine, sans exception, soit cinquante-trois salariés, est inquiet. Tout le monde, à l’invite des représentants du personnel, s’est massé devant la porte donnant accès aux bureaux. Nénesse lève les deux bras pour obtenir le silence :
- Camarades ! Camarades ! S’il vous plait. Silence. Le comité d’entreprise extraordinaire convoqué ce matin vient de se terminer. Il a été long. Très long. Nous avons, P’tit Louis et moi, une tâche bien difficile à accomplir.
Il est ému aux larmes, ce qui ne s’est jamais vu chez ce personnage à l’aspect généralement austère. Il est de ceux qui vilipendent en permanence, avec force, et quelquefois violence, le patronat, les politiciens et politiciennes en général, ceux de droite en particulier, inféodés au grand capital.
- Nous venons d’apprendre que l’usine fermera ses portes mercredi soir… Après-demain. Oui, vous avez bien entendu. Après-demain.
Un murmure d’étonnement et de panique réunis, pour l’instant, contenu mais puissant, monte de l’assistance la plongeant dans la sidération.
- Incroyable mais vrai ! Après-demain en fin d’après-midi. Ce n’est pas croyable et pourtant c’est la vérité implacable que vient de nous asséner un patronat irresponsable. C’est notre cadeau d’après Noël et de nouvel an ! Sympa, non !
Retrouvant son assurance et sa verve coutumières, redevenu lui-même, il poursuit, se faisant incisif :
- Comme d’habitude, le patronat se fout du monde ouvrier. Il le piétine après l’avoir pressuré et s’être enrichi sur son dos. Camarades ! Nous n’allons pas nous laisser faire. Nous n’allons pas accepter que la classe ouvrière paye pour les erreurs volontaires d’un patronat voyou. Au lieu d’investir dans du matériel plus performant et travailler en relation avec nous, il a préféré s’en mettre plein les poches. L’usine ferme mais Bauland ne sera pas malheureux pour autant. Il a ses réserves personnelles et familiales. Il a son capital. Pour lui, ce n’est pas vraiment un drame, tout juste un échec. Camarades ! Organisons la lutte pour notre survie.
Il est applaudi par l’assistance qui, médusée, ne semble pas encore saisir l’ampleur du drame qui leur est présenté. C’est si soudain. Si inimaginable. P’tit Louis à son tour prend la parole. Ce n’est plus le gai luron estimé de tous. II a perdu son éternelle bonne humeur. Il est grave et solennel :
- Nos lettres de licenciement partent ce soir…
Devenant ironique, il poursuit :
- Dans sa grande bonté, dans son immense gentillesse, le patron…
Des sifflets fusent de l’auditoire.
- Dans son infinie complaisance, le patron n’a pas voulu nous informer plus tôt de sa décision de fermer la boite. Il voulait, selon lui, que nous passions de bonnes fêtes de fin d’année !
Nouveaux sifflets.
- L’affaire, si je peux l’appeler comme ça, a pourtant été décidée, toujours d’après lui, début décembre. C’est tout juste si nous ne devrions pas le remercier pour sa délicatesse.
Cette fois c’est le tollé général.
- Ouh, ouh… Salaud… Voyou !
- Il a ajouté, complaisant, que les primes de licenciement nous seront intégralement versées avant la fin de ce mois… Merci patron !
Les orateurs se taisent. La consternation s’allie à la colère. A côté de Julien, Maria Faloud sanglote :
- Qu’est-ce qu’on va devenir ? Nous voilà tous les deux au chômage en même temps.
Roland Germain sent monter en lui une violence qu’il a du mal à contenir. Il murmure rageur :
- Des salauds ! Tous des salauds ! Des pourris ! On devrait pouvoir leur casser la gueule.
La majorité des ouvriers et des ouvrières présents est abasourdie. KO debout. Une chape de plomb vient de s’abattre sur chacun des salariés. Ils sont devenus des zombies. Ils sont au chômage. On vient de leur dire. Ils ont du mal à y croire, à réagir. C’est vrai qu’il y a beaucoup de chômeurs autour de soi mais, on se croit toujours protégé, à l’abri. Et puis, dans cette entreprise familiale de chaussures de luxe, il n’y a jamais eu de gros problèmes. Cela tournait bien un peu au ralenti depuis quelques temps, mais le patron, paternaliste, était rassurant. Il avait, disait-il, de grosses commandes en vue. La qualité de la production était une garantie sur l’avenir. On fabriquait pour les riches et ce n’est pas, quoi qu’on dise, une espèce en voie de disparition. Il y avait bien les discours alarmistes de Nénesse, mais Nénesse, c’est Nénesse. On le connait. Toujours défaitiste. Antipatrons. Il prétendait que l’entreprise n’investissait pas assez, n’achetait pas suffisamment de matériel moderne et qu’un jour, la classe ouvrière, comme il dit, allait payer la note de cette politique catastrophique. N’empêche, il y avait toujours du boulot. On n’allait pas chercher plus loin. On faisait confiance. Apparemment, Nénesse avait raison. Sa crainte était justifiée.
Il prend à nouveau la parole :
- Il y a des gens, ici, qui savaient, qui connaissaient la situation. Ils n’ont rien dit. Pourquoi ? Et nous, nous nous sommes contentés des propos rassurants du patronat au lieu d’agir. La CGT vous a pourtant alertés à plusieurs reprises. Camarades, il n’est pas trop tard. Nous allons réagir. Nous allons sauver cette usine. Pas le patron. L’usine ! Notre outil de travail. On doit se mobiliser. Lutter. Nous allons, sans doute, connaitre quelques mois difficiles, mais la classe ouvrière va triompher en prenant en mains sa destinée. Nous sommes capables. Oui, nous sommes en mesure d’accomplir, ensemble, de grandes choses.
Julien Lepage s’attend à entendre, d’un moment à l’autre, l’Internationale. Cela finira le tableau, pense-t-il. Il est le seul à ne pas être particulièrement affecté par cette annonce pourtant grave de conséquences. Il y voit un signe. Comme une chance pour lui. Il se place au-dessus de la mêlée, pour mieux voir, mieux observer, mieux comprendre. Un jour, sans doute proche, il le sent, il pourra raconter par écrit ces événements.
Pierre Bardais, anti-syndicats, antipatrons, anti tout en somme, se détache du groupe agglutiné pour se donner l’illusion de ne former qu’un être unique, un bloc compact et indestructible :
- Ce n’est pas à vous, les délégués syndicaux de nous faire savoir qu’on est virés. C’est au patron lui-même. C’est lui et personne d’autres qui doit nous informer et nous fournir les explications qui nous sont dues. Comme d’habitude, vous les syndicats et surtout toi, Nénesse, vous essayez, même dans cette triste situation, de vous mettre en vedettes, en sauveurs de l’humanité.
L’interpelé, retient sa colère. Il s’avance vers l’homme qui l’a salement agressé :
- Ce n’est pas le moment de polémiquer Pierre. Mais tu vois, pour cette fois, je te donne raison. Oui, c’est à Bauland de venir nous dire, en face, les raisons de cette fermeture. Je vais le chercher.
Comme une seule voix, comme un seul cri, tout le monde hurle :
- Bauland… Bauland.
Quelques minutes plus tard, celui-ci apparait à la porte de l’atelier. La pâleur de son visage est extrême. Son pas, mal assuré. Lui, que les femmes admirent pour sa prestance fait piètre impression. Nul doute, il a peur. S’arrêtant à quelques mètres du groupe resté compact, il respire profondément avant de se confronter à la masse hostile :
- Mes amis… Mes amis…
Le silence est total. Glacial. Tous les ouvriers, toutes les ouvrières fixent intensément l’homme de haute taille, vêtu d’un élégant costume gris perle, d’un pull ras le cou bleu pétrole. Il porte bien sa quarantaine, les tempes à peine grisonnantes, le cheveu coupé court. Pendant quelques secondes, on peut imaginer que les acteurs de cette scène posent devant un peintre ou un photographe venu immortaliser l’événement, tant rien ne bouge. Tout est figé. P’tit Louis rompt le silence redonnant un semblant de vie à un moment, un lieu, à des gens statufiés pour l’éternité :
- Monsieur Bauland ! Premièrement, nous ne sommes pas vos amis. Nous ne l’avons jamais été, ni hier, ni aujourd’hui et nous le serons encore moins demain… Deuxièmement, nous voulons seulement que vous nous expliquiez pourquoi l’usine doit fermer. Un point c’est tout. Pas besoin de baratins inutiles.
L’interpellé prend un temps de réflexion. Il joint ses deux mains comme pour supplier le Puissant de lui venir en aide. D’une voix blanche, il se lance, conscient qu’il ne peut prolonger plus longtemps l’attente de ceux qui lui font face :
- J’ai tout fait pour éviter cela. J’ai tout fait pour nous sauver… Enfin je veux dire pour sauver l’usine. Je tiens tout autant que vous à cette entreprise créée par mon grand-père et mon père. La concurrence est rude. Surtout les Italiens, les Portugais et le Maghreb. Leurs salaires ne sont pas les mêmes que les nôtres, d’où leurs coûts de production très bas. Depuis des mois, je me bats sans relâche pour trouver un repreneur. En vain.
Louis Leduc lance méchamment :
- Gouverner, c’est prévoir. Visiblement…
P’tit Louis ne veut pas que les réactions individuelles prennent le pas sur la lutte syndicale. L’index levé, il coupe l’élan de celui qui n‘a jamais pris la moindre carte à quelque syndicat que ce soit :
- Pourquoi les travailleurs n’ont-ils pas été prévenus ? Il existe un comité d’entreprise, des représentants du personnel. Pourquoi leur avoir caché la situation ?
Bauland est de plus en plus déconfit :
- Je ne voulais pas… Je craignais… certaines réactions qui auraient pu faire capoter les transactions, faire peur aux repreneurs éventuels. Ils ne sont pas si nombreux et surtout, ils n’aiment pas, mais pas du tout, l’agitation.
- Au fait ! Au fait, crie Leduc.
- En septembre, la société Carmat pour laquelle nous travaillions a été rachetée par un groupe plus important. Carmat était très spécialisée dans la chaussure de luxe. Médicis, la nouvelle société a rapidement abandonné ce créneau jugé peu rentable. J’ai été prévenu fin octobre que les commandes passées par Carmat seraient honorées jusqu’au trente et un décembre. Passé ce délai, on nous ignorait. J’ai cherché, cherché partout, certain que la chaussure de luxe avait encore un avenir. Nos liquidités ne nous permettent pas de faire cavalier seul. J’ai cherché des repreneurs. Nous avons eu quelques pistes, quelques promesses. Ce n’est pas facile en ce moment. Voilà.
- C’est un peu court, estime Louis Leduc.
- Mais c’est hélas comme ça. Je n’ai rien d’autres à dire. On ferme et je le regrette autant que vous.
- Monsieur Bauland, la CGT et les travailleurs ont, à plusieurs reprises, fait part de leurs inquiétudes, notamment devant l’insuffisance des investissements… Vous n’en avez pas tenu compte que je sache.
Bauland, pâle comme un linge de maison, hoche la tête :
- Non, Marchal, non. Je ne discute plus. Cela ne sert à rien. Je suis, ne vous en déplaise, tout autant affecté que vous. Même si vous ne me croyez pas, c’est la vérité. Je n’ai plus rien à ajouter.
C’est sous les huées de la grande majorité des employés que l’homme quitte l’atelier dans lequel les machines se sont tues depuis le matin. Quelques minutes plus tard, on entend un bruit de moteur. Bauland quitte définitivement le navire. Les cris s’arrêtent. Les regards s’évadent vers un univers incertain, un point d’interrogation qui s’apparente au néant. Nénesse ne veut pas laisser les choses en l’état. II hurle dans un silence de mort :
- Camarades ! C’est maintenant à nous de prendre en mains notre destinée. Nous ne voulons pas croire, ni même imaginer que le combat est perdu. Nous allons nous organiser, prendre les contacts qui s’imposent, chercher et trouver des financeurs et pourquoi pas, lancer notre propre marque. Nous devons montrer notre détermination, notre capacité à agir, à réagir, notre volonté de continuer à vivre, à travailler. Nous devons croire que tout est encore possible. Ensemble, nous y arriverons.
Julien Lepage murmure :
- Emouvant, mais inefficace et surtout trop tard.
Roland Germain, son voisin, a l’oreille fine. En le fixant méchamment, il lance, courroucé :
- Tu as peut-être quelque chose à proposer.
- Oh non, tu sais très bien que je ne propose plus rien depuis cinq ans.
- Monsieur a la rancune tenace.
Germain fait allusion à la démission de Julien suite au désaveu quasi général subi à l’époque par celui qui était alors le responsable de la C.F.D.T remplacé depuis par son ami P’tit Louis. Il avait défendu un salarié injustement soupçonné de vol. Peu de collègues l’avaient suivi, persuadés du contraire. L’accusé avait quitté l’usine en clamant son innocence. Dix mois plus tard la vérité avait éclaté disculpant, trop tard, l’incriminé. Germain, imperturbable poursuit :
- J’espère au moins que ce qui se passe aujourd’hui ne te fait pas plaisir.
- Je ne veux même pas répondre à cette supposition tellement elle est conne.
Pendant ce temps, Nénesse, omniprésent, continue à organiser le présent et à promettre un avenir possible à des gens qui ne souhaitent que cela. Ils sont prêts à tout croire, prêts à prendre la moindre bouée d’espoir pour éviter le naufrage. Ils sont prêts à suivre n’importe qui si ce n’importe qui promet la poursuite de leur activité professionnelle.
- Nous allons commencer par rencontrer le maire. C’est un grand ami de Bauland. Il est forcément au courant de la situation et pas seulement d’aujourd’hui. Le contraire m‘étonnerait. Il doit nous entendre. Il va nous écouter, nous aider. C’est son rôle. Il n’a pas été élu seulement pour les inaugurations et les gueuletons. Camarades ! Nous allons aller à la mairie, maintenant.
- D’accord, dit P’tit Louis qui trouve que son collègue syndical occupe trop le devant de la scène. - D’accord, mais il faut que quelques-uns d’entre nous restent ici pour montrer que nous n’abandonnons pas les lieux. Ceux-là en profiteront pour confectionner les banderoles que nous afficherons dehors. Tout le monde doit être au courant de notre action.
Les gars du service entretien approuvent :
- Ouais, ouais ! P’tit Louis a raison. Confectionnons des banderoles.
S’en suit un débat sur les libellés. Plusieurs propositions fusent : Usine en grève… Usine occupée… L’usine aux travailleurs… Il est décidé d’opter pour les trois slogans. Ce n’est pas le moment de diviser. Les gars du service entretien se regroupent pour passer immédiatement à l’action. Ils sont rejoints par Roger Millot. Tout le monde connait les raisons de son choix. Nul ne le conteste. Il n’est pas simple de rencontrer le maire de façon conflictuelle lorsque ce dernier est le patron de son épouse.
- Camarades, allons à la mairie.
C’est un mini cortège d’une quarantaine de personnes qui suit, grave et silencieux, les deux leaders syndicaux marchant, fronts levés, en tête de la délégation ouvrière.
Julien, toujours observateur, emboite le pas. Il est un peu surpris par l’attitude de ses amis. Il y a bien eu dans l’atelier quelques propos de révolte mais il s’attendait à une réaction plus violente. Là, dans la rue, c’est quasiment le silence complet. Ceux qui les regardent défiler connaissent déjà l’infortune des ouvriers de chez Bauland. Les nouvelles, surtout les mauvaises, vont vite. Ils détournent presque les yeux, fuient leurs regards, exactement comme lorsqu’ils voient passer le corbillard. La compassion se lit sur les visages… et la peur aussi. La peur d’être un jour dans la même situation. Les manifestants, pour leur part, semblent ressentir une sensation de culpabilité, de honte, tout à fait inexplicable. Ils font maintenant et officiellement, partie de la cohorte des sans boulot, de ceux qui risquent d’être traités de fainéants, de profiteurs du système. Ils seront sans doute demain au centre des discours des politiciens, mais hélas uniquement des discours, affichant leurs soutiens, tout en admettant à demi-mot leur impuissance. Il faut reconnaitre que cela n’incite guère à défiler avec un faux nez rouge, à danser, à crier et chanter sa joie de vivre. Les attitudes des grévistes sont très différentes et nullement en rapport avec leur genre. Nénesse marche en tête, le front haut, les bras croisés sur sa poitrine. Martial. P’tit Louis a la démarche plus modeste, les mains dans les poches, l’air inquiet, la casquette un peu de travers. Un fils du peuple. D’autres déambulent en baissant la tête, le regard braqué vers le sol, tels des pénitents. Hugues Marolles croise ses bras dans le bas de son dos comme si ses mains étaient entravées par des menottes. Des femmes pleurent en silence, avec beaucoup de dignité. Julien s’est fondu dans le groupe. Il regarde droit devant lui. Son regard se veut neutre, impénétrable.
Et le silence. Un silence rare dans ce style de manifestation.
Parmi ceux qui regardent passer ce triste défilé, un homme se fait discret. Walter Legendre est le correspondant local de Ouest France, le journal quotidien. Son fils l’est également mais pour le concurrent : Le Courrier de l’Ouest. Nul n’est dupe dans le village. C’est le père qui écrit les deux articles et prend les photos. Le fils se contente de les revendiquer. L’homme, à l’abri des regards, prend plusieurs clichés de la manifestation silencieuse. Les rédactions des deux journaux accepteront les articles. Toutefois elles préviendront leurs auteurs que dorénavant, compte-tenu de l’importance de l’évènement, les futurs reportages seront confiés à des journalistes professionnels. Le père en sera meurtri et blessé dans son honneur. Le fils s‘en moquera comme de la teneur de son pseudo premier article. Il y a dix ans de cela.
Heureusement, il n’y a que quatre à cinq cents mètres entre l’usine et la mairie. N’empêche le parcours parait à tous interminable. Dans le bas de la rue de la Victoire, (nul ne sait de laquelle il s’agit) qui porte aujourd’hui bien mal son nom, la mairie apparait. Les premiers voient s’enfuir, dans la rue de l’église, la Renault vingt-cinq turbo Baccara de Bauland.
- Merde alors, il était à la mairie l’enfoiré. Il a dû prévenir le maire de notre arrivée. Il n’a pas perdu de temps l’animal.
- La voiture du maire est là. Il ne peut pas nous éviter. Lance P’tit Louis.
Inconsciemment, tout le monde presse le pas en remontant la courte rue de la mairie se terminant sur un imposant bâtiment du siècle dernier. Cette bâtisse appartenait jadis à un gros industriel de la chaussure, symbole, dirait Nénesse de l’exploitation du monde ouvrier par le patronat. Elle avait fière allure mais, ironie du sort, elle est devenue la maison du peuple. La commune l’a acquise cinquante ans plus tôt lorsque l’industriel en question avait quitté le monde rural, que sa femme exécrait. Il a rejoint la ville plus en rapport avec ses ambitions, industrielles, mais surtout politiques.
En arrivant devant le perron, Nénesse, véritable général en chef et fin tacticien, place deux hommes, et pas des mauviettes, près de la voiture du premier magistrat. Il est important de lui couper ainsi toute possibilité de retraite. Deux autres, tout aussi costauds, se plantent devant la porte de secours située à l’arrière du bâtiment qui perd du même coup son nom et son utilité. Le reste de la troupe pénètre dans le hall en même temps que le garde-champêtre que l’on nomme dorénavant le policier municipal, ce qui change tout. D’un ton qui se veut dissuasif, il apostrophe le groupe :
- Allons, messieurs-dames, du calme. Que se passe-t-il ?
P’tit Louis, le sourire moqueur répond :
- Arrête tes conneries, Gustave. Va dire à ton patron que nous voulons le rencontrer tout de suite.
- Il est en rendez-vous, les gars. C’est pas possible maintenant.
Madeleine Sudres ironise :
- Hé, beau militaire…
Le propos faire rire les présents. Gustave n’a rien d’un Apollon. Contrairement aux idées reçues, son uniforme ne lui procure aucun prestige. Amateur de bonne chère et d’excellents crus il fait plutôt penser au sergent Garcia dans la série des Zorro. Nénesse, d’un ton qui n’admet aucune contestation, l’interpelle à son tour.
- Va dire à celui que certains ont élu que c’est maintenant qu’on veut le voir et qu’il a intérêt à venir s’il ne veut pas qu’il y ait du grabuge.
P’tit Louis, devant l’air soudain paniqué du représentant local de la loi, tente d’apaiser les esprits :
- Du calme, du calme. Monsieur le policier municipal… (des rires fusent) allez dire à Monsieur le Maire que les employés de l’usine Bauland exigent, vous m’avez bien entendu, exigent un entretien immédiat. Tu peux ajouter que nous ne quitterons pas les lieux sans l’avoir rencontré. Est-ce clair ? Je précise que les issues sont bloquées et qu’aucune fuite ne lui est possible. M’as-tu bien compris ?
Le policier est blême. Il n’est jamais simple d’être entre le marteau et l’enclume. Position délicate, s’il en est.
- Je vais voir. Je vais transmettre. Je promets rien… Les gars.
Nénesse et P’tit Louis restent debout en bas de l’escalier. Certains s’assoient sur les chaises disposées dans le hall tandis que d’autres, plus hardis, ouvrent la grande porte de la salle du conseil et s’y installent démontrant leur réelle détermination. Ça risque d’être long. L’édile n’est pas homme à se laisser intimider mais il sait que lors des dernières élections, il a été réélu de justesse. Il n’a obtenu le siège avec seulement huit voix de plus que son adversaire, ce qui est peu. Très peu. On le sait également capable d’appeler la gendarmerie, mais il risque un désaveu de la population. Il ne peut pas se le permettre. La politique n’est pas un art mineur. Il a failli l’apprendre à ses dépens lors du dernier scrutin municipal. Gustave revient quelques instants plus tard. Légèrement penaud.
Il s’est visiblement fait sermonner par son patron qui lui a rappelé assez vertement son rôle qui consiste à faire respecter l’ordre et la loi.
- Il va falloir attendre un peu, les gars. Monsieur le maire est en ce moment en rendez-vous. Il traite une affaire urgente qui ne peut être différée.
Nénesse n’apprécie qu’à moitié, pour ne pas dire qu’à la moitié de la moitié, la réponse que vient de transmettre le policier municipal.
- Les représentants du monde ouvrier n’attendront pas longtemps. Je crains qu’une trop longue attente échauffe, à juste titre, les esprits. La situation actuelle exige que nous soyons pris très au sérieux. Nous n’accepterons pas que l’on nous ignore. Je lui donne un quart d’heure monsieur le policier municipal. Dites-le au maire. Pas une minute de plus. Un quart d’heure !
Tout le monde applaudit et rit en voyant le rictus de Gustave. Il hoche la tête à plusieurs reprises :
- Un quart d’heure !
- Je le répète, pas une minute de plus. D’ailleurs, maintenant il ne reste plus que quatorze. Le temps passe vite. C’est fou, hein !
P’tit Louis, constatant le désarroi de l’homme en uniforme, vient de nouveau à son secours :
- Ecoute bien Gustave, tu vas dire au maire qu’il est préférable qu’il ne traine pas trop. D’accord ? Nous sommes un peu susceptibles aujourd’hui. Il doit pouvoir comprendre ça. Non ?
Pour la seconde fois, et en maugréant, le relayeur municipal remonte l’escalier afin de délivrer le message qui vient de lui être transmis. Fichu métier !
Du côté des envahisseurs on imagine tout.
- Il téléphone au préfet…
- A la gendarmerie… plutôt…
- Penses-tu. Il est emmerdé. Il se demande bien ce qu’il va nous dire. Crois-moi…
- Il cherche peut-être une solution pour nous sortir de là…
- Lui, tu rigoles. Il se fout complètement de nous. Tu connais sa fibre sociale ! Proche du zéro. Par ailleurs, il n’est pas responsable de ce qui nous arrive. Il joue sur du velours…
- Pas d’accord. Tout ce qui concerne ses administrés doit l‘intéresser. On est ses électeurs…
- Toi, peut-être. Pas moi…
- Il doit défendre tout le monde, ceux qui ont voté pour lui et les autres qui ont été quand même assez nombreux…
- Tu penses ! Tu l’intéresses avant les élections, pas après…
- C’est quand les prochaines ?
- Pas tout de suite, hélas…
- Et merde !
Julien ne dit rien. Il finit par trouver pitoyable cette situation. Comment un seul homme, de surcroît étranger au monde industriel, peut-il trouver une solution à ce problème qui n’en possède aucune ? Il est trop tard. Il n’y aura pas de miracle. Il attend impatiemment les belles paroles que Leroy va prononcer tout à l’heure. Ce qui est certain c’est qu’il est obligé de venir rencontrer la délégation. Franchement, à ce moment précis, il ne souhaite pas être à la place du premier élu de la commune. Il ne le plaint pas pour autant. Il a tout fait pour obtenir l‘honneur de gérer la communauté, tremplin à d’autres ambitions, l’avouable et l’inavouable. Il fréquente en permanence la bourgeoisie locale et se pavane avec son âme damnée et féal adjoint dans toutes les manifestations. Il mange à tous les râteliers. Un opportuniste. Julien ne l’apprécie guère tout en reconnaissant que s’il y a de bons côtés à sa fonction, il y en a également de plus difficiles. L’ouvrier en chaussures est curieux de voir comment le maire va s’y prendre.
Au fil des minutes, l’attente devient insupportable. Nénesse consulte régulièrement sa montre. Il crie :
- Plus que trois minutes.
Lucien Merlin commence à scander le nom du maire :
- Leroy ! Leroy !
Il est très rapidement imité par la quarantaine d’autres manifestants. Qui a pris le premier, ou la première, une chaise pour en frapper les quatre pieds au sol ? Impossible à dire. Là encore tout le monde suit. C’est un véritable vacarme qui envahit les locaux. Le bruit métallique est accompagné par des cris stridents :
- Leroy ! Leroy !
Enfin, celui-ci apparait en haut de l’escalier, précédé par Auguste qui tente désespérément de ramener le calme. Il hurle de sa voix de fausset :
-Ça suffit ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ecoutez monsieur le maire.
Tout le monde se tait. Les chaises cessent leur tintamarre. Leroy est assurément envahi d’une colère indescriptible. Ses mains cramponnent la rampe de l’escalier. Il déteste, par-dessus tout, qu’on l’oblige à agir contre son gré. Personne, surtout pas des manifestants braillards, ne peut lui dicter ses actes. Mais là, impossible d’y échapper.
- Je refuse de dialoguer avec des excités. Il n’en sort jamais rien de bon.
Nénesse réagit aussitôt :
- Monsieur le maire, il n’y aura aucun problème si vous daignez nous recevoir. En revanche, je ne réponds de rien si vous refusez.
- Tout le monde sait, Marchal, que vous êtes un agitateur.
- Puisque vous le dites ! Cette fois il nous semble que le coupable de notre légitime colère n’est autre que votre ami Bauland, l’homme par qui le scandale est arrivé. Nous ne faisons que demander votre aide. C’est tout !
- Il n’est pas bon que notre discussion débute sur ce ton.
P’tit Louis se veut conciliateur. Il poursuit son propos :
- Il est préférable que vous nous receviez. Nous ne sommes pas des voyous, mais des gens désemparés qui viennent de perdre leur emploi. Mettez-vous à notre place. Entrons dans la salle du conseil municipal et essayons d’échanger de façon positive.
Chacun, conscient qu’il s’agit là d’une démarche de sagesse, franchit la lourde porte. Sur l’immense cheminée les attend une magnifique Marianne en marbre blanc. Julien, se veut avant tout observateur. Il remarque que le maire s’assoit à la place qui est la sienne dans toutes les réunions officielles. Il siège sous le regard attentif du président de la République Française, Monsieur François Mitterrand, qui, dans son cadre en bois, semble lui donner son aval en même temps qu’une importance démesurée. La photo du président actuel est assurément de meilleure qualité que celle de son prédécesseur, Monsieur Valéry Giscard d’Estaing. Le papier de la photo de ce dernier devait être de qualité très moyenne tant l’édile ressemblait à un petit bonhomme vert venu tout droit d’un autre espace sidéral.
Sur le premier rang de chaises se sont installés P’tit Louis, Nénesse mais également Roland Germain, Pierre Roulaud ainsi que Madeleine Sudres. Elle veut montrer, à juste titre, que les femmes existent et qu’elles ont des choses à dire. Les autres sont assis, un peu en arrière, inquiets.
Les sentinelles, postées par Nénesse aux points stratégiques, viennent rejoindre leurs camarades. Leur mission étant terminée, inutile de poireauter là où ils ne sont plus d’aucune utilité. Bizarrement, ils restent en fonction devant la porte de la salle pour interdire, si besoin est, l’accès à toute personne non concernée par les événements. Julien, malgré la gravité de la situation, sourit tout en pensant qu’ils se prennent pour les gardes du corps des manifestants. Le policier municipal a battu en retraite, vaincu, presque humilié. Mais que pouvait-il faire seul contre tous ?
L’atmosphère est lourde. Chacun ressent un malaise indéfinissable. Les esprits sont tendus comme la corde d’un arc prête à expédier sa flèche sans savoir où se trouve la cible, la vraie, celle qui, transpercée, permettrait de crier victoire. N’est-on pas dans un combat perdu d’avance ? Face au silence pesant qui a envahi la salle, Leroy, d’un ton faussement décontracté, ouvre le débat :
- Je vous écoute.
Nénesse, qui veut toujours planter les premières banderilles, leadership oblige, lui répond aussitôt :
- Vous en savez autant que nous, sinon plus. L’entreprise Bauland ferme ses portes, licenciant ainsi plus de cinquante salariés, pas tous diplômés ni qualifiés, loin de là. Nous savons que beaucoup vont avoir du mal à retrouver un emploi. Nous venons donc, tout simplement et naturellement, vous demander ce que vous comptez faire pour nous.
Leroy se donne le temps de la réflexion avant de prononcer les mots qui conviennent en pareille circonstance. Il se veut grave et surtout compréhensif :
- Mesdames, messieurs, je comprends votre… angoisse et suis… honoré que vous veniez me trouver pour m’en faire part. Je ressens cela comme une preuve de… confiance envers moi. Je vous en remercie. Je me dois toutefois, avant de…
- Assez de belles et inutiles paroles.
Lance Germain stoppant ainsi le discours préparé de l’édile. Il prolonge son intervention orale :
- Nous voulons des réponses claires aux questions claires qui nous préoccupent. Par exemple : Depuis quand êtes-vous au courant des difficultés de l’entreprise ? Avez-vous des solutions pour que nous conservions nos emplois ? Vous affirmez constamment et en tous lieux que vous saisissez toutes les opportunités pour créer des emplois…
Visiblement courroucé le maire l’interrompt :
- Monsieur Germain, non seulement je l’affirme, mais je le prouve. J’ai fait venir depuis trois ans six entreprises sur les différentes zones artisanales et industrielles de la commune ce qui représente un nombre d’emplois de…
Pour une fois plus rapide que son collègue syndical de la CGT, P’tit Louis interrompt à son tour, et de façon déterminée, l’envolée qui se veut lyrique :
- Vous n’êtes plus en campagne électorale. Notre camarade Germain vient de vous poser les vraies questions. Nous attendons, pour l’avenir, des vraies réponses de votre part et non un bilan, si bon soit-il, du passé.
L’ensemble des salariés présents opine du chef en soutenant la voix du délégué CFDT :
- Oui, oui, P’tit Louis a raison.
Leroy fronce les sourcils. Son sourire est de plus en plus convenu. Nénesse se voit dans l’obligation d’expédier une flèche supplémentaire :
- Ne nous dites pas que vous n’étiez pas au courant de la situation actuelle de l’entreprise. Nous savons que vous êtes trop intime avec Bauland pour l’ignorer. Quant à votre bilan sur les créations d’emploi, il est discutable.
P’tit Louis est passablement énervé par la tournure que prend la conversation :
- On ne peut pas mélanger tous les sujets. Restons sur les difficultés de notre entreprise et les solutions envisageables, si vous le voulez bien.
Leroy saute sur l’occasion que lui offre la divergence entre les deux délégués syndicaux :
- Si vous parlez à ma place, je n’ai plus rien à faire ici. Je remarque que vous mélangez sans vergogne ma vie privée, c’est-à-dire mes relations avec monsieur Bauland et ma fonction de premier magistrat de la commune. Je ne nie pas que Bauland est un ami. Je prétends même que c’est un homme remarquable…
Des sifflets se font entendre, accompagnés de quelques grondements synonymes de désaccord sur le dernier qualificatif du patron de l’usine. Leroy les ignore. Sur un ton qui se veut imperturbable, il poursuit :
- Si un maire a le devoir de chercher des emplois, il n’a également, et cela est préférable, aucun droit sur la gestion des entreprises installées sur la commune. Ce serait faire preuve d’une ingérence inacceptable. Vous ne pouvez en aucun cas incriminer les élus dans cette affaire. Ici, aujourd’hui, devant vous, je suis un élu, n’en déplaise à certains.
Madeleine Sudres, fidèle à sa réputation d’être une femme qui possède l’art de la synthèse, réplique :
- En quelques mots, monsieur le Maire, vous n’y êtes pour rien, vous n’y pouvez rien, nous sommes venus pour rien, nous repartirons sans rien.
L’auditoire applaudit ces mots d’esprit. Le Maire, mortifié par cet humour grinçant, répond. Il est aisé de s’apercevoir qu’il s’impose un sérieux effort pour ne pas exploser :
- Je n’ai pas dit cela madame. J’ai simplement voulu affirmer que les entreprises privées sont responsables de leur gestion, de leurs stratégies et qu’un élu municipal, fusse-t-il le premier, n’a rien à en redire publiquement. Je ne me moque nullement de votre situation. Bien au contraire. Mais je ne peux accepter d’être traité comme un complice dans les difficultés que connait l’usine Bauland aujourd’hui. Que ne dirait-on pas si une municipalité dictait sa loi à un entrepreneur. C’est tout ce que j’ai voulu dire. Je m’élève contre tout procès d’intention. J’espère avoir été très clair.
Germain hoche la tête à plusieurs reprises. Il est visiblement très en colère. Le ton est rauque et la voix tremblante, ce qui ne le caractérise guère :
- Oui ou non, la question me parait simple. Savez-vous depuis longtemps que notre boite est en grandes difficultés ?
Leroy, reprenant son désir de convaincre et de rester non pas neutre, mais calme, regarde droit dans les yeux son interlocuteur :
- Depuis environ un mois et demi. J’affirme, ici, solennellement, que monsieur Bauland cherchait, avec une force peu commune, une solution.
- Vous l’avez aidé ?
- De mon mieux, bien évidemment.
Nénesse qui n’est pas intervenu depuis un certain temps ironise :
- Apparemment sans résultat.
La réponse ne se fait pas attendre. Elle se veut acérée. L’édile dégage chaque mot pour bien montrer son sentiment :
- Monsieur Marchal, tout est facile pour ceux qui ne savent que critiquer. Pour ceux qui n’exercent pas de lourdes responsabilités et n’ont pas de décisions importantes à prendre. Ce n’est pas un scoop. Tout le monde le sait. Dans le domaine de la critique, vous êtes un expert. Il est moins aisé de trouver des solutions.
P’tit Louis craint que le débat dégénère. Il intervient aussitôt pour éviter toute escalade verbale inutile et improductive :
- Monsieur le Maire, nous ne sommes pas venus pour chercher et trouver la polémique gratuite. Nous sommes décontenancés. Nous vous posons les questions qui nous paraissent essentielles pour la survie de notre outil de travail. C’est, et vous le comprenez sûrement, vital pour nous. Nous avons presque tous des familles à nourrir, des emprunts à rembourser. Nous ne sommes pas vos ennemis mais des gens en quête de solutions éventuelles et salvatrices. Avez-vous en vue, à ce jour, des repreneurs à nous proposer, des solutions envisageables ? Nous sommes très inquiets pour nos emplois et espérons tous les conserver.
L’assistance presque unanimement acquiesce :
- Oui, oui.
Le délégué syndical termine son discours qui se veut coopérant :
- Si possible, nous aimerions chercher avec vous. Nous sommes persuadés qu’ensemble, nous avons plus de chance de gagner cette bataille pour nos emplois. Cela nous parait légitime de quérir votre aide.
Le maire, apaisé, répond en émettant un sourire teinté de complicité :
- Je ne vous en fais aucun reproche. J’ai même eu l’occasion de vous exprimer ma gratitude concernant votre démarche. Cela dit, je comprends votre désarroi. Il est normal. Je veux simplement vous redire que ce n’est pas simple dans le contexte actuel de trouver des repreneurs. Il y a une telle concurrence et pas seulement nationale. J’affirme qu’avec monsieur Bauland, nous avons multiplié les recherches, les appels… en vain.
Madeleine Sudres, sans aucune ironie cette fois, intervient. Son visage est grave :
- Je crains d’avoir eu raison tout à l’heure.
Le Maire hausse les épaules. Sur un ton qui se veut humble, il acquiesce :
- Hélas, je le crains également sans me décourager pour autant. Rien n’est encore perdu, quand bien même je ne veux exprimer aucune certitude. Nous devons encore y croire. Je me tiens à votre entière disposition et vais mettre en œuvre toutes mes forces pour trouver, avec vous, une solution à ce fléau qu’est la fermeture de nos entreprises.
L’assistance est muette. Divers sentiments traversent les esprits : Le Maire est-il en train de nous jouer une grande scène ? Est-il sincère ou fait-il semblant ? Est-il si fin politicien pour limiter la casse et sembler se ranger du côté des affligés ? Pas facile de trouver une réponse à ces questionnements. Julien Lepage ex délégué C.F.D.T se lève lentement. Ses deux mains agrippent le dossier de la chaise qui est devant lui. Il est personnellement persuadé que cet entretien ne va faire qu’augmenter la rancœur des salariés licenciés. Ce serait logique. Il n’existe aucune piste véritable. Le monde de la chaussure est en pleine mutation. Les salariés de chez Bauland vont être, comme beaucoup d’autres avant eux, sacrifiés sur l’autel de la productivité et du profit. Il sait aussi que le maire ne peut pas vraiment tenir un autre discours que celui qu’il offre actuellement. C’est une impasse. Un mur infranchissable. D’une voix chevrotante, il s’adresse à ses collègues, à ceux qui depuis des années partagent avec lui, un métier que chacun a aimé et qui ne les nourrissait pas trop mal :
- Je sais que mon geste va vous déplaire. Je sais que vous allez m’en vouloir. Je ne veux pas rester plus longtemps à écouter des échanges qui n’aboutiront à rien. La lutte doit continuer, c’est vrai, mais ce sera sans moi. Je vous salue. Je vous souhaite bon courage et de tout mon cœur espère que vous réussirez.