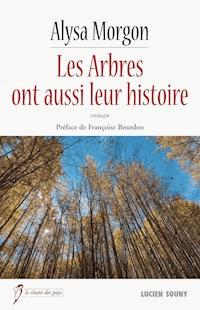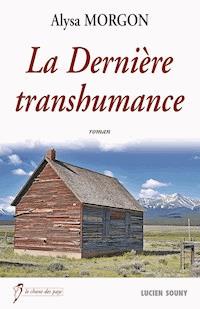La grande plaine de la Chauffagne, aux formes arrondies, déployait ses terres alanguies, tel un grand éventail. Elle était traversée par une jolie rivière, la Braie. Le long de son parcours, celle-ci était rejointe par des ruisseaux plus ou moins gros, plus ou moins fous, dont le
plus tumultueux de tous se nommait le Couriouz, le « Curieux ». Lui, c’était un puissant, un violent qui grondait tout le temps, parce qu’il était le fils des neiges éternelles. Il descendait des plus hauts sommets pour se fracasser le front sur d’énormes pierres, provoquant de nombreuses cascatelles. Au fil des siècles, il avait creusé ce long goulet qu’on appelait la vallée Curieuse. Là s’élevaient des éperons rocheux, qui se découpaient en dentelle, et se cachaient des combes dangereuses. À se demander si cette ravine abritait quelques habitants. Pourtant, à seulement quatre kilomètres de l’entrée du défilé apparaissait, comme par magie, le gros bourg de Saint-Claudet. Il se
blottissait si bien derrière une colline boisée qu’on ne l’apercevait qu’une fois arrivé à ses pieds. Niché dans un site enchanteur, ce village ne semblait pas être celui de la misère, mais plutôt celui du bonheur.
Son clocher était chapeauté d’une jolie croix ciselée. Il s’élançait face aux vents et aux tempêtes pour combattre les nues, tandis que ses cloches sonnaient à tue-tête dès le soleil venu. Contre son échine se tenait pelotonné le petit presbytère occupé aujourd’hui par l’abbé Baguelet. De l’autre côté s’élevait une jolie propriété, entourée d’un jardinet, qui appartenait au vieux docteur Masset. Il était gaillard pour son âge, et il n’envisageait point de céder son cabinet ni de laisser ses malades entre les mains d’un carabin tout droit sorti de la faculté. En léger retrait, la mairie montrait une haute façade grise surmontée d’un fronton où était gravée la devise Liberté-Égalité-Fraternité. Plus bas se tenait la boulangerie de Milou Derivat. Un homme bienveillant et
jovial, qui cuisait des tourtes aux pommes de terre le vendredi, ainsi que des
tartes aux pruneaux le dimanche. Le reste de la semaine, il n’offrait à ses clients que de grosses miches de pain bis ou de pain blanc.
Dans un renfoncement appelé la Placette, il y avait une maisonnette avec une large cour sur le devant. Près de la porte d’entrée était fixée une grosse boîte aux lettres visible de loin et à portée de main de tous les Saint-Claudiens. C’était pour cela qu’on nommait cette demeure la maison postale. Là vivaient le facteur rural, Justin Angelvin, avec son épouse Prudence. Ils étaient propriétaires de plusieurs terrains qui se tenaient serrés autour de l’habitation. Seule, la femme les entretenait du mieux qu’elle pouvait, l’homme étant pris tous les jours par le courrier, même le dimanche. De toute façon, le dimanche, le Bon Dieu exigeait qu’on ne touche point à la terre. Pour lors, si Justin avait été là, la journée aurait été consacrée au repos et à la prière. D’ailleurs, l’abbé Baguelet le rappelait à ses ouailles qui, suivant la saison ou le temps qu’il faisait, avaient tendance à l’oublier. Malgré tout, Prudence se plaignait : « Si j’étais seule, ce ne serait pas pire. Il aurait mieux valu que j’épouse un bon paysan ; au moins, il m’aiderait dans les champs. » Son mari soupirait : « Rien n’est jamais parfait, ma belle, tu le sais… » Puis il la serrait dans ses bras pour la consoler, rajoutant pour la taquiner : « J’en connais, au contraire, qui seraient très heureuses d’être débarrassées. » Prudence faisait celle qui ne comprenait pas : « Débarrassées de quoi ? du courrier à distribuer ? » Ravi, Justin concluait : « Non, de leur mari, pardi ! »
Ils étaient mariés depuis une dizaine d’années ; cependant, cela faisait longtemps qu’ils avaient renoncé à avoir un enfant. Ils avaient tout essayé, allant jusqu’à consulter un docteur de la ville parce qu’ils croyaient que celui de Saint-Claudet, moins à la page, n’avait pas su prescrire ce qu’il fallait. Pour terminer, ils s’étaient tous les deux résignés. Parfois, ils évoquaient les hameaux, perchés dans la montagne, où les foyers étaient miséreux et oubliés. Là-haut, nombre de gosses peuplaient la campagne, étant donné qu’ils ne se rendaient point à l’école. « Elle est trop loin ! disaient les vieux. De toute manière, qu’est-ce que cela changerait pour eux, demain, d’être savants ? Ce n’est pas ça qui ferait mieux pousser leurs champs ! Savoir labourer la terre ou guider un mulet est bien plus important. »
Le facteur et sa femme pensaient qu’ils avaient eu de la chance, bien qu’ils n’aient pas de marmot. Ceux de la montagne en avaient à tire-larigot, sans pouvoir les élever avec amour ni avec patience. « La vie est mal faite, se plaignait Prudence. Trop pour les uns, pas un seul pour
d’autres… » Justin plaisantait pour la consoler : « Le plus simple serait de s’installer vers les sommets où l’air est différent. Il est vivifiant, il paraît. Qui sait si ce ne serait pas ça, la recette pour avoir des bébés ? » Avant de terminer, le front plissé : « À quoi sert d’en faire des dizaines si c’est pour qu’ils souffrent sans arrêt ? » Prudence renchérissait : « Pas besoin d’une dizaine, moi, un seul me suffirait ! » Justin hésitait, finissant par la rassurer pour qu’elle oublie sa peine : « Un jour, le ciel nous entendra… Du reste, la prochaine fois, je vais crier beaucoup plus fort ! » La femme, que le sujet ne faisait plus sourire, lui rétorquait sur un ton de fatalité ou de résignation : « En ce cas, il ne faut pas qu’il tarde, ou bien, l’âge venant, mon ventre ne pourra que rester plat. »
La vallée filait vers les cimes, formant un long couloir sculpté de plusieurs abîmes. Passés les premiers lacets, on découvrait, sur chaque versant, ubac, adret, accrochés de bas en haut, semblables à des lanternes ou à des joyaux, de très nombreux hameaux. Pour les rejoindre, deux passages étaient tracés sur le flanc de chaque coteau : le premier, le plus large, était emprunté par les charrettes ou les traîneaux ; le second, plus rustique, plus étroit, laissait la place à deux sandales, dessinant au loin une fine ligne de la main.
Au bout de la vallée Curieuse se dressaient des faces abruptes, plus lisses qu’un miroir, impossibles à franchir sans tomber dans un précipice. De profondes failles serpentaient, dans lesquelles parfois un mouflon s’égarait. Ces montagnes se serraient, épaule contre épaule, genoux collés. Elles se tenaient si fort les coudes qu’on ne distinguait rien de ce qu’il se passait de l’autre côté. La nuit, dans le silence, elles tendaient leurs cous, prêtes à effleurer les étoiles filantes du mois d’août. Toutefois, celles-ci s’échappaient, indifférentes, en pleine course en direction de la Grande Ourse.
Là se cachait l’endroit le plus haut perché, celui de Freïde-Moùnt. Dans son nom, « Montagne-Froide », résonnait l’âpreté du lieu. Anthime Grimaud était le plus actif des hommes du hameau. C’était surtout lui qui avait le plus de terres et de bois. Chez lui, autre fait d’importance, il y avait plus de garçons que sous les autres toits. Il en avait quatre. Les deux aînés l’aidaient pour les plus gros travaux des champs. Les deux plus jeunes se
contentaient de nettoyer les fossés, d’élaguer les haies ou d’épandre le fumier. Il y avait en plus quatre filles, ce qui ne faisait pas
sourire le père : « Ce ne sont que des bouches inutiles. Aucune ne se mariant, elles ne ramènent ni terres ni argent dans mon gousset ! » criait-il lorsqu’il était en colère de ne pas pouvoir s’en débarrasser.
Albert, le fils aîné, était bien plus vigoureux que son père. Il avait son caractère froid, son visage fermé. Il vivait à la ferme avec sa femme et leur premier-né, âgé de quelques mois. Le deuxième fils, Victor, était, lui, célibataire. Moins costaud que son frère, dès l’âge de vingt ans il avait annoncé à son père qu’il les quitterait pour aller vivre ailleurs. De toute façon, il n’y aurait pas assez de terre pour nourrir les quatre garçons, leur famille, sans oublier leurs sœurs. Ce qui était, en effet, une bonne raison. Le père n’avait pas répondu tout de suite. Il l’avait regardé, les yeux fulminants de colère : « On ne choisit pas sa place pour naître. Tu as eu la deuxième, faudra t’en contenter. Tu ne peux ni en tenir rigueur à ton frère ni t’en aller. Il me faut ton appui pour entretenir les terres. À mon âge, j’ai les reins brisés. Tu n’as pas le droit de nous abandonner ! » Victor lui avait déclaré, pour qu’il comprenne bien qu’il était déterminé : « Si j’ai envie d’être boulanger, c’est mon affaire. » Sur quoi, Anthime avait grondé : « Tu n’as qu’à demander à Milou Derivat, de Saint-Claudet, de t’embaucher. J’en discuterai avec lui. » Or, l’année passa, sans qu’il ait entrepris une quelconque démarche à ce sujet. Jusqu’au jour où, agacé, Victor avait reparlé du boulanger. Anthime s’était écrié : « Tu crois que j’ai du temps à perdre pour aller supplier qu’on te donne un travail ! Tu as le tien qui t’attend chez moi, c’est suffisant. Tu dois rester, parce que je ne veux pas me retrouver dans l’embarras sans tes bras ! » Ce qui avait incité Victor à partir au plus tôt pour Marseille. Il savait qu’il y trouverait sans difficulté un emploi. Le travail, ce n’était pas ce qui manquait. En tout cas, il ne reviendrait pas. « Il y a Louis, avait-il rappelé à son père pour le consoler. Il me remplacera. Dans un an, il sera plus robuste que moi. » Anthime avait ignoré ses arguments. Las de discuter, il lui avait lancé, après avoir craché par terre : « Tu feras ce que tu voudras. Par contre, si tu t’en vas, sache que ce ne sera pas pour revenir demain. Tu ne remettras plus les
pieds chez moi et tu ne seras plus mon gamin ! Quant à l’héritage, pschitt ! Tant pis pour toi. » Il avait fait glisser son doigt sous ses narines, pour lui faire comprendre que
tout lui passerait sous le nez. La mère, qui avait été le témoin de ces bavardages, n’avait pas dit un mot. En pleurs, elle s’était appliquée à poursuivre son ouvrage, même si l’émotion lui labourait le cœur.
Baluchon sur l’épaule, Victor quitta le domaine de la Pisse point encore éveillé. Il venait de fêter ses vingt et un ans et il se sentait libre comme le vent. Par le fenestron
de la cuisine, la mère le regarda s’en aller. Lui se tourna deux ou trois fois pour lui faire un signe de la main,
disparaissant ensuite dans le premier repli de la montagne couverte d’une forêt de sapins. Louis accompagna son aîné en se taisant, jusqu’à ce que, essoufflé, il lui avoue qu’il ne désirait plus rester à Freïde-Moùnt, parce qu’Albert devenait pire que le père. De toute façon, il n’aurait pas sa force pour le remplacer. Quant à son frère Riton, il était trop jeune, et sa jambe folle ne l’aiderait guère pour travailler. En conséquence, il avait décidé de le rejoindre dans le Midi. Il suffisait qu’il lui donne l’adresse où il comptait s’installer.
Victor se taisait, persistait à regarder sa route, à allonger son pas. À ses côtés, Louis marchait plus vite pour lui faire voir qu’il était déterminé.
Agacé par ce manège, l’aîné trancha :
— Si tu viens, je m’occuperai de toi. En revanche, tu n’auras pas intérêt à m’encombrer ou cela n’ira pas !
La dernière hésitation passée, en véritable secret, il lui expliqua qu’il avait un ami à Marseille, dont l’oncle tenait une boulangerie, rue de Lodi. Celui-ci s’appelait Fernand Blanc. C’était chez lui qu’il se rendait.
— Retiens bien le nom et l’adresse, car si tu te perds, tant pis pour toi, je n’irai pas te chercher, où que tu sois.
Enfin, il conclut d’un ton catégorique qu’il devrait attendre un an pour venir. Il fallait d’abord que lui fasse ses preuves et que Louis, de son côté, prenne un peu plus de poils au menton s’il voulait quitter sans problème la maison.
Déçu, Louis lui confirma malgré tout qu’en avril prochain il le retrouverait. Puis, d’un ton résolu, il ajouta avec un sourire qui lui mangeait la moitié du visage :
— Dès demain, je me laisse pousser la barbe, et, pour être plus vite rendu, je ferai le voyage sur le dos des cloches de Pâques !
Il plaisantait pour dérider son frère, qui, lui, se contenta d’emmêler un peu plus ses cheveux filasse et roux, en lui frottant la main sur sa tête. Il lui recommanda de s’occuper de la mère qui était triste d’avoir perdu un fils, ainsi que d’attendre un peu pour lui annoncer qu’il partirait aussi.
— Évite d’en parler au père ou à Albert. Ils ne te comprendront pas et feront tout pour te retenir, que tu sois
majeur ou pas ! Écoute-moi.
Avant de lui ordonner de rentrer, sinon le père risquait de lui filer une sacrée raclée, il ajouta sur un ton péremptoire :
— Si tu n’es pas en bas à la date convenue, je ne compterai plus sur toi et je préviendrai mon patron. C’est compris ?
Louis hocha la tête. Il lui serra la main, car entre hommes on ne s’embrassait pas.
Il regarda son frère descendre les lacets superposés qui menaient dans la forêt. Il soupira en reprenant le chemin de Freïde-Moùnt. Il avait la tête en vrac ; son départ, la vie avec le père, l’absence de son frère, les pleurs de sa mère, les cris de ses sœurs…, tout se mélangeait. De quoi sentir son cœur en miettes puisqu’il ne pouvait rien partager avec personne, si ce n’était avec le ciel. Mais savoir ? Peut-être que lui non plus ne voulait rien entendre. En effet, voilà que le soleil, à peine levé, partait se cacher derrière un amas de nuages plus noirs que blonds, qui ne semblaient rien présager de bon.
Chaque matin, Justin descendait à pied à Tressin, au cœur de la plaine de la Chauffagne. Certes, le bourg était moins grand que Saint-Claudet, mais c’était là que le train s’arrêtait et qu’on déchargeait du wagon postal le courrier de l’ensemble des vallées. Cela faisait toute la différence entre les deux patelins et toute l’importance de Tressin.
Justin apportait les lettres à expédier. Son sac était souvent léger, car on écrivait peu dans ces coins retirés. Il en prenait un autre en échange, guère plus lourd, qui renfermait cette fois les plis à distribuer. Un travail qui lui mangerait pourtant toutes ses heures, du jour
levé jusqu’à la nuit tombée. En fait, il sillonnait le canton tout entier, passant le plus clair de son
temps à marcher, parcourant plus de trente kilomètres dans la montagne. Un drôle de métier que celui de facteur rural.
Dans ce val reculé, Justin montait d’un côté, descendait de l’autre, afin de déposer deux ou trois enveloppes. Il ne s’arrêtait que quelques minutes, pour ouvrir sa gamelle et dévorer le déjeuner que sa femme lui avait préparé. L’été, il faisait une partie de sa tournée à bicyclette ; du moins, tout le bas de la vallée. Après quoi, il rentrait chez lui, trempé d’avoir beaucoup transpiré. Dès l’automne installé, il rangeait son vieux vélo qu’il avait nettoyé et graissé. Il le pendait par les roues à une poutre du grenier pour qu’il ne s’abîme pas ni ne rouille durant ces mois de repos forcé. Il reprenait sa route à pied, parfois sous la pluie ou sous la grêle. Il marchait du matin au soir dans la boue, et ses gros souliers ferrés s’enfonçaient si fort qu’il ne pouvait plus les soulever, soit parce qu’ils étaient trop lourds, soit parce qu’ils restaient collés dans la glaise. Aux premiers frimas, les sentiers devenaient risqués, et, suivant la hauteur de neige qui tombait, le facteur chaussait les skis. D’une autre façon, il appréhendait tout autant le printemps, où le soleil l’éblouissait dès qu’il s’approchait des sommets. À plusieurs reprises, il s’était affalé dans la pierraille grise, ce qui l’avait fait souffrir toute la journée. Il se méfiait des pierres qui tombaient des parois, qui jaillissaient, qui sautaient
dans tous les sens, tels des chamois. Il s’agissait parfois d’énormes rochers qui déboulaient, fracassant des arbres entiers sur leur passage, pour s’arrêter dans un vacarme du diable et barrer sa route sans pitié. Ce qui obligeait Justin à contourner l’obstacle avec difficulté, afin de rejoindre plus loin la piste qu’il avait dû abandonner. Force était donc de constater que les quatre saisons exigeaient de lui une extrême attention.
Pour le travail, l’important était de ne rien laisser dans le fond de sa sacoche, au risque de devoir revenir
en arrière ou d’ajouter une étape supplémentaire. En vérité, Justin n’oubliait jamais personne. S’agissant de mandats, il commençait sa tournée par leur distribution pour s’en débarrasser, prenant une allure plus cadencée que lorsqu’il apportait une simple lettre. « Cet argent n’est pas le mien, insistait-il. Celui auquel il est adressé en a besoin. Je dois, plus que pour un autre, presser mon pas. Je redeviendrai
serein, sitôt que je toquerai à l’huis de cet Alpin. Il ne me prendra pas dans ses bras ; néanmoins, je verrai un semblant de sourire sur son visage. Les gamins, eux,
regarderont avec admiration le billet et les pièces posés sur la table, sans pouvoir les toucher ni les compter. »
Justin devait franchir tous les cols, tous les versants. Il lui arrivait d’aller au pied de la Mongite dont les parois rocheuses les plus hautes, les plus
abruptes, fermaient l’endroit de leurs lourdes portes de granit. Ce chemin traversait à plusieurs reprises le torrent. Quelquefois, Justin passait à gué, en particulier l’été, ce qui était le plus facile, le plus plaisant, et il se rafraîchissait un instant. À l’inverse, au printemps, à la fonte des neiges, l’eau était glacée. Elle était abondante, turbulente, avec des remous de mousse blanche, légère, qui montaient au-dessus de ses genoux et le faisaient trembler. En automne,
la pluie s’ajoutait à l’eau sombre qui devenait tumultueuse autant que dangereuse. Quant à l’hiver, l’eau, qui était gelée, se cachait sous les rochers couverts de glace. Il devait être vigilant pour ne pas glisser, car il risquait de se blesser sur les pierres
devenues coupantes ou bien de se retrouver trempé, vite frigorifié. Même une seule missive, il était obligé de la porter, quitte à grimper jusqu’au dernier lieu-dit. Il perdait ainsi une bonne moitié de l’après-midi et il ne rentrait chez lui qu’à la nuit tombée. Toutefois, cela ne le faisait ni reculer ni ralentir. C’était son métier, celui qu’il accomplissait année après année, avec sérieux, sans oublier cette célérité que tout le monde lui connaissait, et dont il usait parfois au péril de sa vie.
Ce soir, dehors, l’automne était tout cotonneux de brume. Dedans, Justin et Prudence étaient blottis dans leur lit, sous le gros édredon de plume parce que l’air avait fraîchi à cause de la pluie. Elle se pelotonna contre la poitrine de son mari pour
soulager ce chagrin obsédant qui la rongeait sans fin. Il pesait si lourd sur son cœur qu’avec un sanglot dans la gorge, elle lui soutint que c’était à cause d’elle s’ils étaient seuls. Elle n’était qu’une femme stérile. Il aurait mieux valu qu’il en épouse une autre. Elle pensait à Germaine qui lui plaisait, qui lui aurait donné de beaux enfants, de sorte que maintenant il serait heureux d’avoir une grande famille. Il ne l’avouait pas, pourtant son cœur n’était pas comblé autant qu’il l’aurait souhaité. Elle lui chuchota d’une voix blanche qu’elle se rendait compte que ce grand vide était en train d’occuper toute la place dans leur vie.
Justin la réconforta :
— Tu ne dis que des bêtises. Il est fort possible que ce soit moi qui ne sache pas les fabriquer. Le
docteur a conclu, tu le sais, qu’il faudrait des examens supplémentaires. À quoi bon ! Que ce soit toi ou moi, le résultat est similaire. Nous ne sommes, ni l’un ni l’autre, responsables de ce constat. C’est la vie et le Bon Dieu qui l’ont voulu. Il n’y a plus à revenir là-dessus.
Il lui rappela qu’ils devaient se contenter de ce que qu’ils avaient, c’est-à-dire une vie paisible, qui n’était pas celle qu’ils désiraient, sans être pour autant si terrible.
— Faut croire en l’avenir, ma douce. Il faut espérer…
La pluie venait de cesser de tomber. La nuit s’était installée, s’était posée en silence dans le moindre recoin de la petite chambre de Justin et de
Prudence.
Freïde-Moùnt était quillé sur un éperon rocheux. Le village cognait sa tête aux cieux, front à tous les vents de la vallée. Des vents qui balayaient les pentes, qui faisaient s’envoler les toits de chaume plus facilement que les feuilles des arbres à l’automne. Au fil des années, ces terres, que personne n’avait voulu travailler, s’étaient transformées en glèbes dures et calleuses. Le hameau se fondait parmi les pierres, entre les
maigres bois, ou dans les replis de la roche escarpée qui le retenait prisonnier dans ses bras. Pourquoi les gens s’étaient-ils installés à cet endroit si dépouillé, si haut perché ? Était-ce pour se protéger du froid, des curieux ou de visites éventuelles ?
Les plus vieux du pays assuraient qu’en des temps reculés, des huguenots étaient venus s’y cacher. Il était vrai que, dans ce coin perdu, personne n’aurait pu les remarquer ! Au pire, s’ils avaient vu l’ennemi approcher, ils auraient eu la possibilité de franchir les sommets pour rejoindre plus loin la Savoie ou la Suisse. Les
vieux racontaient que les huit familles qui s’y étaient réfugiées, ainsi que les autres lignées, avaient vécu de peu de chose. Jusqu’à ce que se calment les persécutions, que cesse dans le pays cette guerre de religion. Depuis, l’histoire restait enfermée dans quelques mémoires, après avoir été serinée de génération en génération. Chacun ayant adjoint sa phrase, sa description, son opinion, tout s’était éloigné de la réalité. La seule vérité qui restait aujourd’hui était qu’il y avait bien longtemps que les pauvres hères de Freïde-Moùnt n’étaient plus protestants. La plupart ne connaissaient plus les mots « vaudois » ou « huguenots ». Malgré tout, les étrangers n’étaient pas les bienvenus. Chacun continuant de se méfier des inconnus. Les nouveau-nés étaient baptisés, et les femmes descendaient à Saint-Claudet afin d’assister à la messe le dimanche. De son côté, l’abbé Baguelet y montait volontiers pour bénir les récoltes l’été, ou bien pour prier et assister un mourant, comme il l’aurait fait pour n’importe quel croyant d’un tout autre hameau haut perché.
Personne n’avait abandonné l’endroit, même si la misère s’enferrait dans les terres. Les habitants qui se les étaient appropriées les avaient domptées avec courage, avec ténacité. À présent, dès que les gars étaient appelés pour le service national, nombre d’entre eux ne revenaient pas au pays. Ils restaient dans les villes afin de
travailler dans les usines et ils en oubliaient parfois ceux qui, hier, leur étaient chers. Voilà pourquoi les fermes comptaient beaucoup de filles que les jeunes gens de
Saint-Claudet ou de plus loin refusaient d’épouser. Les logis de Freïde-Moùnt étaient toujours remplis, alors que les terres devenaient de plus en plus pénibles à entretenir.
Louis Grimaud, le troisième fils d’Anthime, était un jeune homme réservé, gentil, qui adorait sa mère qu’il voyait souvent attristée ou maltraitée par le père. Les mots étaient rares entre lui et ses sœurs, étant donné que celles-ci ne discouraient qu’en patois. Pour s’en défendre, elles expliquaient : « Inutile de parler français pour s’occuper des bêtes ou des lessives. » Cela était suffisant pour comprendre qu’elles n’avaient pas usé souvent les bancs de l’école. Seule, la sœur aînée, Constance, avait appris le français, grâce à l’aide de Louis. C’était la raison pour laquelle, à son tour, elle ambitionnait de quitter Freïde-Moùnt et d’aller à Marseille se placer. Nombre de filles l’avaient fait. La preuve, le dimanche, à la sortie de la messe, lorsque celles-ci venaient visiter leurs parents,
Constance les avait entendues parler souvent de leur travail, dévoiler avec fierté le montant de leurs gages. On se rendait compte tout de suite qu’elles ne mentaient pas, à admirer leur robe ou leur corsage. Pour faire patienter sa sœur, Louis, en cachette, lui avait avoué que bientôt il irait rejoindre Victor à Marseille. Il lui avait recommandé de ne surtout pas en parler, car, si le père l’apprenait, il ne le laisserait pas partir. La jeune fille avait juré en crachant par terre, et Louis lui avait promis que plus tard, à son tour, il la ferait venir. Si cet avenir ne les rassura pas pleinement, il
leur donna quelque espoir un moment.
Pour se réconforter, Louis alla visiter le vieux Mathieu. Certains assuraient que l’homme était prophète. D’autres se moquaient de lui, le traitant de pauvre illuminé. Beaucoup s’en méfiaient, vu que le brave vieillard lisait l’avenir dans les yeux de ceux qui le sollicitaient et non pas dans le creux de
leur main. Mathieu, qui n’avait pas de progéniture, aimait Louis comme un fils, ce garçon que lui avait refusé la nature. Leurs rapports en étaient plus que chaleureux, proches de l’affection. L’homme se plaisait à lui raconter sa vie, celle de ses arrière-grands-parents, les derniers protestants. Parfois, le mal étant toujours très douloureux, il avait besoin de parler de sa femme qui était décédée parce qu’il n’avait pas lu dans ses yeux une quelconque maladie ni encore moins la mort.
Depuis, il était tracassé. Selon son humeur, il refusait d’observer les yeux de quiconque. « Je n’ai plus le droit, s’obstinait-il à répondre. Je me suis trompé pour Élise… Comment savoir pour toi ? »
Ce soir, tandis que Louis lui demandait ce qu’il pensait de son envie de s’en aller, l’homme répliqua, les yeux perdus dans le ciel qui brillait de mille éclats :
— Tu te poses trop de questions, mon garçon. C’est la destinée toute seule qui décide de ce que tu feras. Tu descendras à Marseille de gré ou de force, ou tu resteras à Freïde-Moùnt de gré ou de force aussi. Ce n’est pas toi qui mèneras tes pas. Ce n’est pas toi qui choisis. Destinée, la belle, la puissante, lorsqu’elle a tiré sa flèche, impossible de l’arrêter. Dans ces conditions, ne cherche pas. Tu fais ce que tu dois, ce que tu
crois qu’il faut que tu fasses ; ce sera suffisant pour ne pas garder de regrets et pour ne plus te poser de
questions, quoi qu’il se passe.
Ces paroles n’aidèrent en rien Louis qui s’en alla, le front baissé. Il ne savait pas ce que sa destinée choisirait pour lui. Il en avait discuté avec Constance, mais, pour chacun, tout n’était que du rêve, et Louis pensa que ce n’était peut-être bien que du vent.
L’hiver approchait à pas de loup. Pâques était encore loin de pointer son nez de velours, alors que le printemps ne
faisait point claquer ses sabots, se contentant de cacher ses boutons de fleurs
dans son dos.
***
Un orage violent était en train de se former sur les sommets. Il promettait des extravagances qui
ne tarderaient pas à frapper toutes les faces escarpées. Dans Freïde-Moùnt régnait un drôle de silence, qui avait été précédé d’un vacarme du diable. Tout laissait croire que le malin ne se tenait pas très loin.
Louis se dépêchait tellement qu’il ne prit pas le temps de rentrer les vaches. Tant pis si son père le lui avait commandé d’un ton qui n’autorisait ni l’hésitation ni la désobéissance. Le garçon venait de découvrir un événement beaucoup plus urgent. Il lui fallait dévier au plus vite le torrent qui dévalait la colline au galop pour se jeter dans le creux de la ravine, la remplir,
puis déborder de toutes parts avec la puissance d’un troupeau de taureaux. Une voie d’eau prête à tout emporter, qui traverserait la ferme et qui ressortirait s’étaler dans la cour, de l’autre côté. Sans attendre, il avait entrepris de rouler des rochers, de soulever la terre,
de piocher au plus vite afin de creuser un fossé. Par là, il avait réussi à détourner l’eau du chemin qu’elle avait décidé de tracer. Il avait donné toutes ses forces, fourni toute sa volonté et son imagination, ce qui avait permis de sauver la maison. Épuisé, il s’était assis dans la boue, tête baissée, sale, trempé. Il regardait l’eau domptée, nourrie par la terre qu’elle transportait, descendre vers l’adret pour rejoindre le Couriouz sans s’arrêter. Elle ne représentait plus aucun danger. En revanche, dans le pré, du fait que personne ne s’en était occupé, les vaches avaient reçu la pluie, une véritable saucée. Son père, rouge de colère, était venu le chercher sans lui laisser une seule seconde pour s’expliquer, pour raconter tout ce qu’il avait fait. Il avait été si violent dans ses propos et dans ses gestes que, dès la nuit tombée, malgré la pluie qui n’avait point cessé, Louis avait préparé son paquet. Il avait dit deux mots à Constance de ce qu’il avait décidé, et il avait rejoint Saint-Claudet. Le lendemain matin, il montait dans le
train pour Marseille, loin de cette exploitation reculée où régnait en maître son père que tout un chacun détestait. Le mois de mars de cette nouvelle année venait de singulièrement commencer.
Là-haut, les vaches étaient prêtes à retourner au pré, ayant été toutes bouchonnées par les filles. Anthime, lui, de son côté, s’était levé, l’air renfrogné, parce que rien ne changeait.
Ce fut Albert qui lui annonça la nouvelle :
— Louis a décampé dans la nuit.
Le père tapa du poing sur la table.
— Il ne peut pas être parti ? Où veux-tu qu’il soit allé ?
Albert lui assura qu’il avait rejoint la gare de Tressin dans la soirée. Il l’avait entendu prévenir Constance, tandis qu’ils étaient tous deux cachés dans le grenier.
Anthime se leva d’un bond pour se diriger vers l’étable où la jeune fille était en train de donner le foin aux vaches qui allaient vêler. À peine entré, il se mit à hurler si fort qu’elle sursauta :
— Louis s’en est allé. Tu le savais, n’est-ce pas ? Pourquoi tu l’as gardé pour toi ? Tu n’avais pas le droit. Je suis ton père. C’est moi qui commande sous ce toit !
Constance le regarda, effarée. Elle haussa les épaules, dans l’impossibilité de riposter, si ce n’était de lui répondre en patois :
— Qué dijè, païre ? Comprénou pa. Parlou pa lou franchè, lou chabè !
Ce qui le fit crier !
— Ne fais pas celle qui ne comprend pas, parce que tu as deviné ce que j’ai dit. Tu causes patois quand ça t’arrange. Où est ton frère Louis ? Vous avez dû partager des confidences, et en français cette fois !
Soudain, il se tut. Il s’assit sur une botte de paille pour s’interroger. Peut-être que le garçon était parti rejoindre Victor ? Tous deux étaient sournois, ni l’un ni l’autre ne savaient obéir. Ils allaient voir comment cela se passerait pour eux, avec un patron ! Un patron qui n’aurait pas sa patience pour les garder comme lui l’avait fait, depuis leur naissance. Au cours de ce long silence, Constance
continua de donner le foin aux bêtes. Tout à coup, le père se leva et la montra du doigt :
— Si tu sais quoi que ce soit, tu as intérêt à ouvrir la bouche, ou je te fous dehors à ton tour !
Ce qui fit sourire Constance un court instant. Car, pour son arrogance, Anthime
lui donna un soufflet si violent qu’elle tomba dans l’allée. À la suite de quoi, sa robe ainsi que son tablier furent couverts de bouse et de
boue mélangées. Constance se releva, regarda son père avec assurance, puis planta la fourche qu’elle tenait à la main dans le tas de fumier qu’elle avait préparé, et s’apprêta à s’en aller. Ce fut sur le pas de la porte qu’elle se retourna pour s’exprimer dans un français parfait :
— Il n’est point nécessaire de me mettre dehors, père, c’est moi qui m’en vais.
Elle sortit de la remise, tête haute, et se dirigea droit vers la fontaine où elle nettoya ses vêtements. Elle se lava, malgré l’eau qui était des plus froides. Qu’importait ! Elle pleurait, tout en regardant le pic du Turbat pour se donner du courage.
Le courage d’effectuer ce qu’elle venait d’annoncer à son père, même si l’envie de renoncer la tenaillait tout bas. Son corps comme ses lèvres tremblaient sans s’arrêter.
La journée passée, Constance n’était point partie. Aussi, le patriarche se moqua sitôt qu’il la vit venir s’attabler.
— Je croyais que tu devais nous quitter ? Tu as changé d’idée ?
La jeune fille l’ignora. Elle préféra dire quelques mots en patois à ses sœurs, et regarder avec tristesse sa mère qui pleurait, car elle l’avait prévenue de son départ. Le baiser qu’elle lui avait donné ne l’avait pas consolée, ni l’affection ni la tendresse qu’elle lui avait démontrées en la serrant dans ses bras. La pauvre femme voyait ses enfants abandonner le
logis les uns après les autres, ne pouvant toutefois que cacher son poing dans sa poche et se
soumettre à la colère de son mari.
Le repas achevé, ses sœurs s’inquiétèrent de ce départ improvisé. Elles lui recommandèrent de se calmer, de réfléchir, tandis que Constance les rassurait :
— N’ayez pas de souci. J’ai l’adresse de Victor. Louis a déjà dû le rejoindre.
Elle ajouta qu’elle n’aurait aucun problème pour trouver un emploi, et que, dès qu’elle le pourrait, elle leur enverrait des nouvelles, bien qu’elle ne sache pas très bien écrire. Elles iraient voir Mathieu afin qu’il leur lise sa lettre. Lui ne se moquerait pas de sa gaucherie. Enfin, elle
prit un ton attristé :
— Occupez-vous de la mère, elle en a plus besoin que moi.
Ce qui tourmentait les trois jeunes femmes, c’était que Constance allait quitter Freïde-Moùnt dans la nuit. Elle gagnerait Saint-Claudet par la sente, afin de prendre le
premier train le lendemain matin. La jeune fille leur maintint d’un ton sérieux qu’elle avait confiance en la providence, qu’il ne serait pas utile pour elle de faire appel à Mathieu.
Ses sœurs, qui ne cessaient pas de pleurer, l’accompagnèrent à travers Freïde-Moùnt dès que la lune fut levée. Celle-ci versait son lait pour mieux les éclairer. Parvenues sur le sentier qui menait à la rivière, elles s’arrêtèrent, s’embrassèrent, et Constance s’éloigna d’une démarche fière. Elle se retourna plusieurs fois, agita la main. Guère plus loin, elle ne put plus distinguer leurs ombres avalées par la nuit. De ce côté, la lune lui tenait compagnie, éclairant son chemin qui descendait en pente rapide. Un chemin qu’elle connaissait bien, étant donné qu’elle l’empruntait tous les dimanches matin pour aller à la messe. Ce soir, néanmoins, elle n’était pas tranquille. Marcher seule, à cette heure, était angoissant, d’autant qu’elle ne savait pas du tout vers quoi elle se dirigeait. Pour se rasséréner, elle serra dans sa main la chaîne en argent qui pendait à son cou, celle de son baptême, à laquelle était accrochée une médaille de la Vierge Marie.
— Guidez-moi vers cette nouvelle vie que je ne peux imaginer, souffla-t-elle avec
ferveur. Je vous en prie de tout mon cœur…
Tout en marchant, elle récita une longue prière. Pour se rassurer, elle sortit le porte-monnaie qu’elle avait glissé dans la poche de sa veste. Elle regarda les quatre billets pliés qu’elle y avait glissés. Ces billets étaient ceux que leur mère leur offrait le jour de Noël, en cachette du père. Un pour chacune. De l’argent qu’elle avait économisé avec parcimonie tout au long de l’année. L’un des billets était le sien, les trois autres avaient été donnés par ses sœurs qui, elles, n’auraient plus rien. Elle leur avait assuré qu’elles ne regretteraient pas de l’avoir aidée. Sitôt qu’elle aurait un travail, elle leur adresserait un mandat pour les rembourser. Si
elle pouvait, elle leur en enverrait un chaque mois.
La descente se fit plus vite que ce qu’elle avait escompté. Le jour n’était pas levé quand elle atteignit Saint-Claudet. Le village était désert, silencieux. Seuls des chiens aboyaient. Elle but à la fontaine, se rafraîchit, puis elle s’engagea sur la piste qui conduisait à Tressin. Une fois arrivée, trouvant la gare fermée, elle attendit. Plus tard, quelqu’un vint ouvrir. Elle put alors savoir à quelle heure le train pour Marseille serait là. Il lui faudrait patienter jusqu’à dix heures, lui dit-on, ce qui lui sembla être une éternité. Pour se réchauffer, elle frotta ses membres qui étaient endoloris. Malgré le vent froid qui soufflait, elle sortit sur le quai, s’allongea sur un banc, glissa sous sa tête son maigre baluchon et s’endormit. Le bruit de la locomotive qui entrait en gare en lançant un long coup de sifflet la réveilla. Elle eut juste le temps d’acheter son billet, avant de monter dans le premier wagon qui se présentait. C’était le début d’une drôle d’aventure pour une fille de la montagne, qui ne connaissait pas Tressin et qui n’avait jamais vu un train !
Louis, qui la veille avait pris le même omnibus, était arrivé à Marseille. Il avait été surpris par la douceur de l’air, la mer qui roulait ses vagues au loin, la foule sur le port, le bruit, l’accent, les odeurs… S’étant renseigné sur le chemin qu’il lui fallait prendre, il n’eut aucune difficulté à rejoindre son frère, rue de Lodi. Comme il en avait été convenu, Victor avait parlé de lui à son patron. Celui-ci avait tout de suite donné son accord pour l’embaucher en tant que mitron, puisqu’il était très satisfait du travail de Victor. « On dirait que tu as pétri toute ta vie. Tu as le don de la farine et du levain. Ça, crois-moi, ce n’est pas donné à tout le monde. J’espère que ton frère sera aussi doué que toi. » Victor lui avait répondu qu’il ne le savait pas, mais que c’était un gentil garçon, sérieux, qui ne lui poserait pas de problème. Si par hasard ce n’était pas le cas, il le remettrait d’aplomb sans hésiter.
Lorsque Louis se présenta à la boutique, Victor fut furieux. On était à peine aux giboulées de mars que déjà il arrivait. Pâques était encore loin sur le calendrier. Les cloches n’avaient point carillonné pour l’annoncer. Par contre, voyant la mine réjouie du patron, il finit par taper sur l’épaule du garçon presque avec affection.
Quand ils furent dans leur chambrette sous les combles, Louis raconta ce qu’il s’était passé la veille à Freïde-Moùnt et qui avait provoqué sa venue.
— Le père est un fou, il n’a écouté que sa colère, une fois de plus…
Louis ne commenta pas la remarque de son frère. Il était fatigué et comprenait surtout qu’une nouvelle vie se présentait à lui. Pour s’encourager, il se dit : « Demain, tout va changer sitôt que j’enfoncerai le nez dans la farine. L’important sera de ne pas éternuer pour tout voir s’envoler, telle une neige fine ! » Il se tourna, gardant un sourire béat, et finit par s’endormir, innocent, sous son nouveau toit.
Le jeune homme s’appliquait de son mieux pour apprendre ce métier qu’il ne connaissait pas. Malgré tout, il était très maladroit. Parfois, il ne comprenait pas ce qu’on attendait de lui. L’apprentissage fut donc laborieux et difficile, alors que Victor avait réussi à trouver, sans chercher, les gestes utiles qu’il fallait. Il savait reconnaître si le levain était prêt, ou calculer combien il devait placer de bois dans le four pour que la fournée soit cuite sans qu’une bûche soit gaspillée. Louis ignorait comment, aujourd’hui, son frère connaissait tout cela. Quand il lui posa la question, celui-ci haussa les épaules :
— C’est venu tout seul. Pas de quoi t’inquiéter, tu t’en sors bien. Le patron ne te renverra pas, c’est certain.
Tous les deux étaient heureux de leur nouvelle complicité, de cette vie qui s’annonçait, loin de toute colère, de la violence journalière d’hier. Louis eut une pensée émue pour Constance qui allait devoir attendre un signe de sa part pour pouvoir
le rejoindre.
Sitôt dans le wagon, Constance se sentit perdue. Elle suivit le couloir, cherchant
une place, même si les sièges inoccupés ne manquaient pas. Elle atteignit le bout du train sans s’être arrêtée. Avec un sourire, une dame qui l’observait lui fit remarquer, d’un ton amusé, qu’elle ne pourrait pas aller plus loin, sinon elle risquait de se retrouver sur la
voie ! Elle lui conseilla plutôt de venir s’asseoir en face d’elle. La jeune fille hésitant, la dame continua :
— Voyez, nous aurons chacune un bout de fenêtre. Nous pourrons bavarder pour occuper nos heures, ce qui serait mieux que de
rester seule, chacune dans un compartiment !
Constance la remercia, tout en s’asseyant à la place indiquée. Elle posa son paquet dans le filet, pendant que la locomotive sifflait.
Aussitôt, le cœur de la jeune fille se serra, et, tête tournée, front collé à la vitre, elle pleura.
— Désormais, il est trop tard pour faire demi-tour…, murmura-t-elle.
— C’est la première fois que vous quittez votre famille, n’est-ce pas ? Vous êtes une Gavotte qui part travailler dans le Midi…
— Je vais rejoindre mes frères qui sont à Marseille. Ils m’accueilleront en attendant que je trouve un emploi.
— Je m’appelle Eugénie de Ruffrein. J’habite à Aix-en-Provence.
La dame lui révéla qu’elle était veuve, que ses enfants vivaient leur vie loin d’elle : sa fille habitait à Vizille, d’où elle revenait, tandis que son fils demeurait à Paris. Elle soupira :
— Depuis qu’ils sont partis, je me sens si seule dans ma grande maison…
À son tour, par la fenêtre, elle regarda le paysage défiler, les collines, les arbres, un étang, juste de quoi apaiser son émoi passager. Finalement, s’étant reprise, elle se tourna vers Constance :
— Je peux vous proposer de vous loger pour la nuit si vous voulez. Demain, nous
pourrions discuter, à tête reposée, de ce que vous envisagez de faire.
Elle ajouta qu’elle ne doutait pas qu’elle était une jeune fille raisonnable, parce que les gens de la montagne étaient très courageux.
— Acceptez de venir passer la nuit chez moi. Après quoi, vous choisirez de vous en aller ou pas.