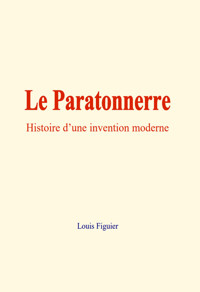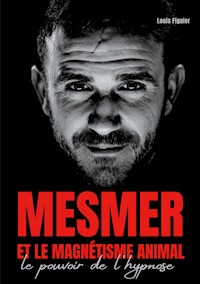Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Joseph Balsamo, dit comte de Cagliostro, né à Palerme (Sicile, Italie) le 2 juin 1743 et mort à San Léo le 26 août 1795, est un grand personnage énigmatique du xviiie siècle. Il a emprunté durant sa vie de nombreux pseudonymes, notamment des titres de noblesse illégitimes. Sa vie obscure, ses origines mystérieuses, ses agissements douteux d'aventurier ont laissé place à un mythe autour de sa vie, cultivé par de grands auteurs à travers leurs oeuvres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
CHAPITRE PREMIER
Influence que certains hommes peuvent exercer sur d’autres par leur seule volonté — Les miroirs magiques — Le Juif Léon — Cagliostro à Strasbourg
CHAPITRE II
Cagliostro à Bordeaux — Son arrivée à Paris — Prodiges qu’il y accomplit — Le banquet d’outre-tombe de la rue Saint-Claude — Miracles de Lorenza, la Grande maîtresse — Le souper des trente-six adeptes — La guérison miraculeuse du prince de Soubise par Cagliostro — Enthousiasme de la capitale pour le nouveau thaumaturge
CHAPITRE III
Le cénacle des treize
CHAPITRE IV
L’affaire du collier
CHAPITRE V
Aventures et exploits de Cagliostro avant son arrivée à Strasbourg
CHAPITRE VI
Dénouement de l’affaire du collier — Cagliostro devant ses juges — Cagliostro quitte la France — Sa mort
CHAPITRE VII
L’illuminisme en France après Cagliostro et Mesmer — Les prophéties politiques — Le P. Beauregard — La prophétie de M. de Lille, ou la prophétie turgotine — La prophétie de Cazotte
CHAPITRE PREMIER
INFLUENCE QUE CERTAINS HOMMES PEUVENT EXERCER SUR D’AUTRES PAR LEUR SEULE VOLONTÉ — LES MIROIRS MAGIQUES — LE JUIF LÉON — CAGLIOSTRO À STRASBOURG
Entre les diverses merveilles, que l’histoire rapporte à une même cause, magnétisme, selon les uns, un agent surnaturel, selon les autres, la plus étonnante, sans doute, et, il faut le dire aussi, la plus redoutable, si elle venait à être bien constatée, serait cette influence que certains hommes pourraient, par leur seule volonté, exercer sur leurs semblables, au point de produire sur eux toutes sortes de sensations illusoires, d’affections réelles même, et jusqu’à d’importantes modifications physiques.
Dans le Paris philosophique du dix-huitième siècle, cinq ou six ans avant que Mesmer y apportât le magnétisme animal, la croyance aux prodiges et au surnaturel marchait de front avec le scepticisme religieux et l’Encyclopédie. Il y avait alors dans plusieurs quartiers, et des mieux hantés, de la capitale, des assemblées mystérieuses où des hommes, sortis on ne sait d’où, venaient vendre très chèrement des miroirs prétendus magiques, dans lesquels ils se faisaient fort de montrer les images des personnes chéries dont on regrettait la mort ou l’absence. Et, chose singulière ! plus d’un chaland fasciné crut voir, en effet, et témoigna qu’il voyait l’image évoquée de cette façon.
Un juif, nommé Léon, se fit remettre ainsi, par de riches dupes, plus de quarante mille livres. Quant au stratagème qu’il employait, voici l’idée qu’en donne un auteur contemporain, d’après un témoin oculaire :
« En 1772, un de mes amis, connaissant le goût que j’avais pour les choses extraordinaires, me proposa de me faire connaître un homme qui possédait un miroir constellé, au moyen duquel je verrais les personnes que je voudrais, vivantes ou mortes. Je rejetai sa proposition comme une extravagance. Deux mois après, d’autres personnes me parlèrent de cette singularité, comme d’un fait certain. Je me déterminai à l’aller voir. Je fus conduit chez un juif allemand nommé Léon, qui logeait en chambre garnie, rue de la Harpe. Ce juif commença d’abord par m’entretenir de sciences abstraites, et finit par me dire qu’on avait trouvé, à la mort d’une personne, une boîte dans laquelle il y avait un petit miroir et des caractères en langue inconnue, qu’on n’avait jamais pu déchiffrer. Il ajouta qu’après avoir examiné cette boîte avec plusieurs savants rabbins, ils avaient découvert que ce miroir était constellé, et qu’on pouvait y voir ce qu’on désirait. La boîte était un carré long d’environ dix pouces de longueur sur quatre ou cinq pouces de diamètre, et ressemblait à celles dans lesquelles les carmes du Luxembourg envoient leurs bouteilles d’eau en province. Elle s’ouvrait à une des extrémités. Il y avait dans le fond un petit miroir concave, autour duquel étaient marquées différentes figures hiéroglyphiques et des caractères qui paraissaient hébraïques.
« Le juif me dit que les personnes qui étaient nées au mois d’avril pouvaient y voir. Étant de ce mois, je proposai d’en faire l’essai ; il me fit d’abord répéter quelques prières en me plaçant dans un coin de la chambre ; après quoi, il me montra comment je devais tenir la boîte, et me recommanda d’avoir un désir ardent de voir ce que je voudrais. Après une demi-heure de contention, ne voyant rien, je lui en demandai la cause. Il me dit des injures, et me traita d’incrédule, d’homme sans mœurs, ajoutant que ce miroir n’avait aucune vertu aux mains de pareilles gens. Avant de me retirer, je lui proposai une personne qui avait toutes les qualités requises pour voir, et lui promis de l’amener ; nous convînmes du jour. J’y conduisis la personne, qui était un curieux de bonne foi, et sur qui je pouvais compter comme sur moi-même. Après les préliminaires accoutumés, il le plaça dans un coin de la chambre, lui recommanda la foi en l’Esprit qui présidait au prodige qu’il allait voir. Après un quart d’heure de réflexion, il lui demanda quel objet il désirait fixer. Le curieux lui nomma une personne qui n’était connue d’aucun de ceux qui étaient présents. Au moment même, il me dit qu’il la voyait dans son habillement et avec sa coiffure ordinaire. Le juif lui demanda s’il voulait voir d’autres personnes ; et sur la réponse qu’il fit qu’il désirait voir une dame, telle qu’elle était dans le moment, le juif mit un petit intervalle pour la cérémonie, et dit de regarder dans le miroir. Mon ami vit cette dame dans son appartement, avec un enfant qu’elle avait alors, reconnut la chambre et tous les meubles. Étonnés du prodige, nous restâmes dans la plus grande admiration. Notre surprise était d’autant plus grande que nous avions examiné ensemble si, par l’optique ou la catoptrique, on pourrait, à l’aide de moyens quelconques, retracer au fond de la boîte des objets peints et éloignés, ce qui était impossible. La boîte était tenue verticalement, elle n’avait que cinq pouces d’ouverture sur quatre, et le visage de la personne couvrait l’orifice de la boîte, le dos tourné vers le mur. Nous avions pris des renseignements sur le local de la chambre et sur celle qui était contiguë. D’après ces précautions, mon ami, persuadé de la vérité du prodige, sans pouvoir l’expliquer, forma le projet d’acheter le miroir, à quelque prix que ce fût, si le juif voulait répéter l’expérience dans un appartement de son hôtel. Il y consentit. L’expérience fut faite. Elle réussit aussi bien que la première. Il lui demanda le prix de ce miroir, qui ne valait pas plus de trente sous intrinsèquement. Le juif fit beaucoup de difficultés, disant que c’était un trésor pour lui, qui pouvait lui produire beaucoup. Enfin, après bien des débats, on convint à six mille livres, qui furent données après qu’on y eut vu encore une fois une autre personne. Notre premier soin fut de chercher des enfants nés sous la constellation désignée. Après bien des recherches, nous en trouvâmes un qui fut soumis à l’expérience, et qui voyait certains objets dans des instants, et qui ne voyait rien dans d’autres.
« Nous apprîmes, quelque temps après, que le juif continuait à recevoir du monde chez lui, et qu’il avait un second miroir. Nous fîmes des recherches : le résultat de nos informations fut qu’il en avait procuré à plusieurs seigneurs à des prix plus ou moins hauts, suivant l’envie qu’ils avaient témoignée d’en avoir, et qu’il en avait déjà vendu pour quarante mille livres. Cette découverte me déconcerta et me fit soupçonner quelque supercherie. Je vis la plupart des personnes qui en étaient pourvues, qui assuraient avoir vu dans certains temps, et n’avoir rien vu dans d’autres. Elles étaient toutes de bonne foi. Ce juif en avait vendu à douze cents livres. Je fus le voir dans l’intention de lui faire des reproches sur ce qu’il nous avait assuré que ce miroir était unique. Il s’excusa en disant qu’à force de travail et d’expériences, il était parvenu à en faire de semblables, et qui produisaient le même effet. Je trouvai chez lui beaucoup de gens qui non seulement voyaient, disaient-ils, les personnes qu’ils avaient demandées, qu’elles fussent vivantes ou mortes, éloignées ou non ; mais qui entendaient les réponses aux demandes qu’ils leur faisaient, sans que personne se doutât de la conversation.
« Tous ces gens me parurent suspects. J’y fis connaissance avec une femme qui m’avoua enfin que tout ce manège n’était qu’artificiel, et qu’elle ne voyait et n’entendait rien. Cette découverte me convainquit que ce juif n’était qu’un fourbe. Mais je ne pouvais expliquer l’illusion de mon ami, dont la bonne foi et la franchise m’étaient connues. Voici de quelle manière je m’y pris pour découvrir la vérité : je fis faire un miroir parfaitement semblable au sien. Pour qu’ils fussent plus ressemblants, on l’exposa à la fumée pendant quelque temps. Ces deux pièces se ressemblaient si fort que je m’y trompais moi-même. Je fis faire l’essai avec le nouveau miroir par plusieurs personnes, qui virent de même que dans l’ancien. Mon ami en fut aussi la dupe. Convaincu par cette expérience que ce prétendu prodige n’était qu’une illusion, à laquelle un désir ardent de voir ce qu’on souhaitait donnait tout son effet, je fis part de ma découverte à mon ami, qui eut peine à revenir de son erreur. L’amour-propre blessé, le regret d’avoir donné son argent, et d’avoir perdu un bien qu’il croyait posséder seul, le tinrent longtemps en suspens. Enfin, il fut obligé de se rendre à la vérité. L’enthousiasme cessa, la tête se remit, et, avec la meilleure volonté, mon ami ne put plus rien voir ni dans l’un, ni dans l’autre miroir. Plusieurs personnes dans le même cas que lui, apprenant notre aventure, furent indignées, et leur illusion ayant cessé, elles ne virent plus rien dans leur miroir. Parmi celles-ci, il s’en trouva qui furent se plaindre à M. de Sartines, alors lieutenant de police, qui fit mettre les compères du juif à Bicêtre, et fit bannir celui-ci de France. »
Un peu de tolérance de la part de M. de Sartines, et tous ces miroirs allaient s’obscurcir d’eux-mêmes par respect pour un miroir plus éclatant, celui du fameux Cagliostro, déjà tout près de faire son entrée en France.
Comme ce personnage apparut sur la scène dans le temps même où elle était occupée par Mesmer, on a voulu faire de l’un le rival de l’autre, et l’on a prétendu que tous deux puisaient leurs prestiges à la même source. Cagliostro, moins restreint dans les applications qu’il savait faire de l’agent commun, plus encyclopédique que Mesmer, aurait, en quelque sorte, généralisé le magnétisme. Au fait, Cagliostro guérissait aussi bien que Mesmer, quoiqu’il fût sans titre et sans autre mission que celle qu’il s’était donnée ; mais il guérissait sans passes, sans baguettes de fer, sans manipulations, sans baquet, et tout simplement en touchant, ce qui le rapprochait plus de Gassner et de Greatrakes que de Mesmer. Autre différence : Cagliostro n’exploitait point ses malades, au contraire. Dans toutes les villes où il devait passer, de confortables cliniques étaient préparées par ses agents et à ses frais, et là, tous ceux qui venaient lui demander leur guérison, la recevaient de sa main, avec des secours pour leurs besoins et même pour ceux de leurs familles. Cagliostro était prodigue, et il le prouvait par les larges aumônes qu’il semait sur son passage. Du reste, profondément muet sur l’origine de sa fortune, il gardait le même silence sur la nature de son agent, et ne livrait rien à discuter aux savants, aux médecins ni aux académies. Il procédait avec audace, agissait d’autorité, et produisait partout un étonnement qui fit, sans aucun doute, une bonne part de son succès. Le roi Louis XVI, qui se moquait de Mesmer, déclarait coupable de lèse-majesté quiconque ferait injure à Cagliostro. Ce sublime charlatan n’eut donc pas, à ce titre, de démêlé avec M. de Sartines et ses successeurs.
Mais les cures médicales de Cagliostro n’étaient qu’un hors-d’œuvre dans sa carrière de magnétiseur universel, ou tout au plus un moyen calculé pour se mettre en crédit parmi la foule. Sa belle stature et sa haute mine, relevées par un costume de la plus bizarre magnificence, sa nombreuse suite et le grand train qu’il menait dans ses voyages, attiraient naturellement sur lui tous les yeux, et disposaient les esprits vulgaires à une admiration idolâtre. Sa plus grande force était dans la fascination puissante qu’il exerçait sur tout ce qui approchait de lui. On lui prêtait toutes sortes de sciences et de facultés merveilleuses. Voici sous quels traits le peignait un contemporain qui assurait l’avoir connu particulièrement :
« Docteur initié dans l’art cabalistique, dans cette partie de l’art qui fait commercer avec les peuples élémentaires, avec les morts et les absents ; il est Rose-Croix, il possède toutes les sciences humaines, il est expert dans la transmutation des métaux, et principalement du métal de l’or ; c’est un sylphe bienfaisant, qui traite les pauvres pour rien, vend pour quelque chose l’immortalité aux riches, renferme, par ses courses vagabondes, les espaces immenses des lieux dans le court espace des heures1. »
Si, à quelques-unes de ces qualités, les alchimistes de l’époque devaient reconnaître un successeur ou un adepte du sublime souffleur Lascaris, il en est d’autres auxquelles les médiums actuels de l’Amérique et de l’Europe pourraient reconnaître leur prédécesseur et même leur maître. Nous verrons, en effet, que Cagliostro a produit, sans l’emploi des tables, les plus étonnants miracles qui aient été admirés de nos jours dans les médiums et leur entourage.
Bordes, dans ses Lettres sur la Suisse, qualifie Cagliostro d’homme admirable. « Sa figure, dit-il, annonce l’esprit, décèle le génie ; ses yeux de feu lisent au fond des âmes. Il sait presque toutes les langues de l’Europe et de l’Asie ; son éloquence étonne, entraîne, même dans celles qu’il parle le moins bien. »
La Gazette de conté complétait la peinture de ce personnage par quelques traits plus vulgaires, mais plus caractéristiques :
« M. le comte de Cagliostro est possesseur, dit-on, des secrets merveilleux d’un fameux adepte qui a trouvé l’Élixir de vie… M. le comte est peint en habit oriental. Son portrait se voit toujours à Médine, chez le Grand Seigneur ; il ne se couche jamais que dans un fauteuil ; il ne fait qu’un repas avec des macaronis. Il apporte la véritable médecine et chimie égyptienne, et propose cinquante mille écus pour fonder un hôpital égyptien. Il ne communique point avec les gens de l’art ; mais, pour se distinguer d’eux, il guérit gratuitement. On nomme M. le chevalier de I… qui se dit ressuscité par lui. Son remède est, dit-on, le même qu’appliquait, il y a quelques années, un fameux opérateur qui avait des montres pour boutons, à l’instar de la femme d’un autre qui portait des montres à carillon dans des pendants d’oreilles. Obligé de quitter la Russie par la jalousie du premier médecin de l’impératrice, M. le comte de Cagliostro lui proposa un singulier duel ; c’était de composer, chacun de son côté, quatre pilules avec le poison le plus violent possible. « Je prendrai les vôtres, dit-il au docteur russe, j’avalerai par-dessus une goutte de mon élixir, et je me guérirai ; vous prendrez les miennes, et guérissez-vous si vous le pouvez… » Un cartel si raisonnable ne fut point accepté. »
Cagliostro venait, en effet, de Russie, lorsqu’il arriva en France. On raconte que, pendant son séjour à Saint-Pétersbourg, il souffrit, et même protégea les assiduités du ministre Potemkin auprès de sa femme Lorenza, ou Seraphina, car elle est connue sous ces deux noms. Potemkin avait donné une somme considérable pour acheter le silence de Cagliostro. Mais la tzarine Catherine II, ayant eu vent de cette intrigue, donna une somme plus forte, et obtint l’éloignement de sa rivale.
Par prudence ou par discrétion, Cagliostro ne se rendit pas d’abord à Paris, qui, à cette époque (1780), appartenait tout entier à Mesmer. Tout au plus, y vint-il une ou deux fois incognito pendant les quatre premières années de son séjour en France. Ce fut Strasbourg qu’il choisit pour sa résidence. Cette ville, principal théâtre de ses opérations, est la même où, deux ou trois ans plus tard, on verra se former, par les soins et les leçons du comte de Puységur, deux des plus grandes sociétés magnétiques qui aient existé en Europe. Cagliostro propageait, dit-on, la haute maçonnerie. Il avait reçu ou pris, en Angleterre, le nom de grand cophte, c’est-à-dire chef suprême de la franc-maçonnerie égyptienne, branche nouvelle qu’il voulait greffer sur l’ancienne franc-maçonnerie européenne. À Strasbourg, il ne s’occupa pas de former des adeptes dans la franc-maçonnerie ; mais sans y penser, il en préparait pour Mesmer son rival. Cette société de Strasbourg, qu’il étonna si longtemps, ces médecins, ces savants, ces grands seigneurs qui, d’après le témoignage d’un contemporain, « se faisaient gloire de manier sa spatule, » et qu’il laissa pleins de foi au merveilleux, n’étaient-ils pas, en effet, autant d’élèves dociles et tout préparés à recevoir l’enseignement magnétique des élèves de Mesmer ?
Ce fut le 19 septembre 1780, que Cagliostro fit son entrée dans la capitale de l’Alsace. Dès le matin, un nombre considérable de gens du peuple et de bourgeois étaient sortis de la ville, et debout sur le pont de Kehl, ou attablés dans les guinguettes voisines, ils devisaient sur le prodigieux personnage que l’on attendait. On lui donnait diverses origines. On racontait ses longs voyages en Asie, en Afrique et en Europe. On parlait des richesses immenses qu’il avait amassées en changeant en or les métaux vils. Pour les uns, c’était un saint, un inspiré, un prophète qui avait le don des miracles. Pour les autres, toutes les cures qu’on lui attribuait devaient s’expliquer naturellement comme le résultat de sa vaste science. Un troisième groupe, et ce n’était pas le moins nombreux, ne voyait en lui qu’un génie infernal, un diable expédié en mission sur la terre. Mais, çà et là, se rencontraient, dans cette classe même, des gens plus favorables à Cagliostro, et qui, considérant qu’après tout, il ne faisait que du bien aux hommes, en inféraient assez logiquement que ce devait être un bon génie. Ils admettaient donc et soutenaient intrépidement tout ce que cet étrange personnage disait ou faisait dire de lui-même. Or, il avait proclamé qu’il était venu et qu’il voyageait en Europe pour convertir les incrédules et relever le catholicisme. Il assurait que Dieu, pour le mettre à même de justifier sa mission, lui avait donné le pouvoir d’opérer des prodiges, et même avait daigné le gratifier de la vision béatifique. On disait, en effet, qu’il avait de fréquents entretiens avec les anges !…
« Des entretiens avec les anges, s’écria un vieillard qui, sans appartenir à aucun groupe, avait recueilli et médité silencieusement tout ce qui s’était dit jusque-là ; des entretiens avec les anges !… Mais quel est donc l’âge de cet homme ?
— L’âge de notre père Adam, ou celui de M. le comte de Saint-Germain, lui répondit un de ses voisins en le persiflant ; je vous trouve plaisant, bon homme, avec votre question. Est-ce qu’il y a un extrait de baptême pour de pareils personnages ? Sachez qu’ils n’ont aucun âge, ou qu’ils ont toujours celui qu’il leur plaît d’avoir. On dit que M. le comte de Cagliostro a plus de trois mille ans, mais qu’il n’en paraît guère que trente-six.
— Trente-six ans ! Ouais, se dit tout bas le vieillard, mon coquin aurait à peu près cet âge ; il faut absolument que je voie cet homme. »
Pendant ces colloques, l’homme si curieusement attendu, le grand cophte était arrivé au pont de Kehl, au milieu d’un nombreux cortège de laquais et de valets de chambre en livrées magnifiques. Il étalait le luxe d’un prince, et il savait d’ailleurs en prendre l’air et la dignité. À côté de lui, dans une voiture découverte, Seraphina Feliciani, sa femme, brillait de tous les charmes de la jeunesse et de la beauté. Unie à lui presque au sortir de l’enfance, elle partageait, depuis dix ans, sa vie d’aventures. L’entrée de Cagliostro dans Strasbourg fut un véritable triomphe. Elle fut à peine contrariée par un incident, qui n’eut d’autre suite que de faire éclater tout d’abord la puissance du grand cophte ou sa merveilleuse habileté dans l’emploi de la ventriloquie.
Au moment où le cortège était arrivé à la hauteur du pont de Kehl, un cri partit du milieu des groupes, et presque aussitôt, un vieillard en sortit ; il se précipita au-devant des chevaux, et, arrêtant la voiture, il s’écria :
« C’est Joseph Balsamo, c’est mon coquin. » Et l’apostrophant avec colère, il répétait ces mots : mes soixante onces d’or ! mes soixante onces d’or !
Le grand cophte parut calme ; à peine songea-t-il à jeter un coup d’œil sur cet agresseur téméraire ; mais au milieu du silence profond que cet incident avait produit dans la foule, on entendit distinctement ces paroles, qui semblaient tomber du haut des airs :
« Écartez du chemin cet insensé, que les esprits infernaux possèdent ! »
La plupart des assistants tombèrent à genoux, terrifiés par l’imposant aspect de ses traits. Ceux qui purent rester maîtres d’eux-mêmes, s’emparèrent du pauvre vieillard qui fut entraîné, et rien ne troubla plus l’entrée triomphale du grand cophte au milieu de la ville en fête.
Le cortège s’arrêta devant une grande salle où se trouvaient déjà tous les malades que les émissaires de Cagliostro avaient recrutés d’avance. On avait eu le soin d’écarter ceux qui étaient atteints d’affections graves, se réservant de les secourir à domicile. On assure que le fameux empirique guérit tous ceux qui étaient rassemblés dans cette salle, « les uns par le simple attouchement, les autres par des paroles, ceux-ci par le moyen d’un pourboire en argent, ceux-là par son remède universel. »
Mais ce remède, en quoi consistait-il ? Faut-il s’en rapporter sur ce point à ce qui est affirmé dans la Biographie de Michaud, par un auteur anonyme, qui prétend savoir que l’élixir de Cagliostro était uniquement composé d’or et d’aromates : « Nous avons eu l’occasion, dit cet écrivain, de goûter l’élixir vital de Cagliostro, ainsi que celui du fameux comte de Saint-Germain ; ils n’ont point d’autre base que l’or et les aromates. » Voilà qui est bientôt dit, perspicace anonyme !
Quoi qu’il en soit, lorsque Cagliostro sortit de la salle des malades, les acclamations et les bénédictions de la foule l’accompagnèrent jusqu’à l’hôtel splendide qui lui avait été préparé, et dans lequel il allait produire d’autres merveilles, tout à fait analogues à ces phénomènes de magnétisme transcendant que nous avons à passer en revue dans ce volume.
Pour ce genre de manifestations, Cagliostro ne pouvait opérer que par l’intermédiaire d’un jeune garçon ou d’une jeune fille, qu’il appelait ses colombes, et qui jouaient le rôle de nos médiums actuels. Les colombes, ou les pupilles de Cagliostro, devaient être de la plus pure innocence. Ces enfants, choisis par lui, recevaient d’abord de ses mains une sorte de consécration ; puis ils prononçaient, devant une carafe pleine d’eau, les paroles qui évoquent les anges. Bientôt les esprits célestes se montraient pour eux dans la carafe. Aux questions qui leur étaient faites, les anges répondaient quelquefois eux-mêmes, et d’une voix intelligible ; mais, le plus souvent, ces réponses arrivaient écrites dans la carafe, à fleur d’eau, et n’étaient visibles que pour les colombes qui devaient les lire au public.
Le soir même de son arrivée, Cagliostro reçut à une table somptueusement servie, l’élite de la société de Strasbourg, à laquelle il donna ensuite une séance de ses colombes. Voici comment, d’après le témoignage des contemporains, un anonyme raconte cette soirée.
« On amena dans le salon de Cagliostro, éclairé par des procédés où l’optique et la fantasmagorie jouaient un grand rôle, plusieurs petits garçons et plusieurs petites filles de sept à huit ans. Le grand cophte choisit dans chaque sexe la colombe qui lui parut montrer le plus d’intelligence ; il livra les deux enfants à sa femme, qui les emmena dans une salle voisine où elle les parfuma, les vêtit de robes blanches, leur fit boire un verre d’élixir et les représenta ensuite préparés à l’initiation.
« Cagliostro ne s’était absenté qu’un moment pour rentrer sous le costume de grand cophte. C’était une robe de soie noire, sur laquelle se déroulaient des légendes hiéroglyphiques brodées en rouge ; il avait une coiffure égyptienne avec des bandelettes plissées et pendantes après avoir encadré la tête ; ces bandelettes étaient de toile d’or. Un cercle de pierreries les retenait au front. Un cordon vert émeraude, parsemé de scarabées et de caractères de toutes couleurs en métaux ciselés, descendait en sautoir sur sa poitrine. À une ceinture de soie rouge pendait une large épée de chevalier avec la poignée en croix. Il avait une figure si formidablement imposante sous cet appareil, que toute l’assemblée fit silence dans une sorte de terreur. On avait placé sous une petite table ronde en ébène la carafe de cristal. Suivant le rite, on mit derrière les deux enfants, transformés en pupilles ou colombes, un paravent pour les abriter.