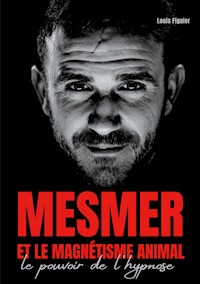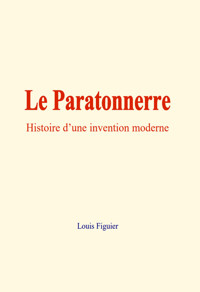
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre traite de l’histoire de la découverte du paratonnerre, l’une des grandes inventions des temps modernes. Nous exposerons d’abord l’opinion générale qui eut cours dans la science au sujet de la cause du tonnerre jusqu’à la découverte des phénomènes électriques ; avant de présenter l’histoire de la découverte du paratonnerre.
« L’imposant météore de la foudre a toujours fortement impressionné l’esprit des hommes. Les nuées qui s’entr’ouvrent, et font jaillir subitement une éblouissante clarté ; le tonnerre qui retentit en roulements prolongés, et dont les échos répercutent au loin et redoublent les grondements sinistres ; la foudre qui s’élance en traits de feu, et porte sur son passage la destruction et la mort ; tout cet ensemble d’un phénomène effrayant et majestueux, a, de tout temps, exercé sur l’imagination une influence profonde. Dans l’enfance des peuples, avec les préjugés qui obscurcissaient l’esprit des sociétés primitives, on ne put s’empêcher d’attribuer à ce phénomène une source divine, d’y voir la manifestation du courroux des dieux. Ces signes effrayants qui brillaient au sein des airs, reproduisaient avec tant de fidélité tout ce qu’avaient évoqué l’imagination des poètes ou les menaces des prêtres, qu’il était presque impossible que l’on n’y trouvât point un témoignage du ciel armé contre la terre, ou l’indice de la présence des dieux irrités. Les anciens législateurs et les premiers rois, ne manquèrent pas de profiter largement d’un fait naturel qui prêtait tant de poids à leur autorité, qui retenait par la crainte les peuples dans le devoir, et qui était si propre à les maintenir dans une erreur favorable à leurs desseins politiques.»
À PROPOS DE L'AUTEUR
Guillaume Louis Figuier (1819-1894) était un écrivain et vulgarisateur scientifique français prolifique du XIXe siècle. Après une carrière prometteuse en pharmacie, chimie et physique, il abandonne la recherche après un conflit avec Claude Bernard en 1854. Il se consacre alors à la vulgarisation scientifique à travers des articles et ouvrages populaires comme "Les Merveilles de la science". Il tente aussi, sans succès, de créer un théâtre scientifique. Son œuvre marque durablement la diffusion du savoir scientifique en France.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Paratonnerre
Le Paratonnerre
Histoire d’une invention moderne
Paratonnerre : barre ou verge de fer, terminée en pointe, qu’on place sur le point le plus élevé d’un édifice, pour le garantir de la foudre. À la base de cette barre, on attache un cordon composé de fils de fer ou de laiton tressés. Ce cordon, qui sert de conducteur, doit se prolonger jusque dans un puits, ou du moins dans un souterrain constamment humide.
CHAPITRE I
L’imposant météore de la foudre a toujours fortement impressionné l’esprit des hommes. Les nuées qui s’entr’ouvrent, et font jaillir subitement une éblouissante clarté ; le tonnerre qui retentit en roulements prolongés, et dont les échos répercutent au loin et redoublent les grondements sinistres ; la foudre qui s’élance en traits de feu, et porte sur son passage la destruction et la mort ; tout cet ensemble d’un phénomène effrayant et majestueux, a, de tout temps, exercé sur l’imagination une influence profonde{1}. Dans l’enfance des peuples, avec les préjugés qui obscurcissaient l’esprit des sociétés primitives, on ne put s’empêcher d’attribuer à ce phénomène une source divine, d’y voir la manifestation du courroux des dieux. Ces signes effrayants qui brillaient au sein des airs, reproduisaient avec tant de fidélité tout ce qu’avaient évoqué l’imagination des poètes ou les menaces des prêtres, qu’il était presque impossible que l’on n’y trouvât point un témoignage du ciel armé contre la terre, ou l’indice de la présence des dieux irrités. Les anciens législateurs et les premiers rois, ne manquèrent pas de profiter largement d’un fait naturel qui prêtait tant de poids à leur autorité, qui retenait par la crainte les peuples dans le devoir, et qui était si propre à les maintenir dans une erreur favorable à leurs desseins politiques. Aussi voit-on cette idée de l’origine divine du tonnerre apparaître dès les premiers temps de l’humanité, se montrer uniformément au berceau de chaque nation, et persévérer chez les anciens peuples avec une constance invincible.
Les premiers philosophes de la Grèce tentèrent, par leurs poétiques fictions, de modifier cette notion primitive et universelle dans un sens mieux en harmonie avec le caractère de la religion païenne. Pour les Grecs, le tonnerre et les éclairs provenaient des Cyclopes, occupés dans les cavernes de Lemnos à forger les foudres qui devaient servir aux vengeances de Jupiter. Mais le don de faire retentir le tonnerre était réservé à la plus puissante des divinités de l’Olympe, et c’est avec cet attribut symbolique, c’est-à-dire la foudre en main, que la religion païenne a toujours représenté le père des dieux.
Les Romains, aussi bien que tous les peuples de l’Asie, partagèrent cette croyance que le tonnerre était une manifestation spéciale et caractéristique de la Divinité. En vain Lucrèce avait-il essayé de réfuter, en vers admirables, cet antique préjugé : le sentiment d’un poète sceptique ne pouvait opposer qu’une barrière bien faible à une superstition populaire dérivée de la religion, et en apparence justifiée par les faits.
On continua donc, chez les Romains, à considérer la foudre et les orages comme une manifestation spéciale de la volonté des dieux. Cette opinion se transmit et se maintint après eux, chez presque tous les peuples de notre hémisphère.
On connaît l’impression que produisirent sur l’esprit des habitants du Nouveau-Monde les mousquets et les canons des Espagnols. Si tout fuyait à l’approche des soldats de Pizarre et de Cortès, c’est que ces hordes sauvages ne pouvaient que regarder comme des dieux vengeurs, des conquérants qui s’avançaient tenant dans leurs mains la foudre et les éclairs.
Lorsqu’au xvie siècle les saines lumières de la philosophie vinrent dissiper les épaisses ténèbres où les esprits s’égaraient depuis si longtemps, les hommes, moins crédules et un peu plus observateurs, osèrent envisager de plus près ce redoutable météore. Il est assez remarquable que ce soit Descartes, l’immortel rénovateur de la philosophie dans les temps modernes, qui ait essayé le premier de découvrir la cause du tonnerre. La théorie mise en avant par Descartes était erronée sans doute, mais elle avait du moins l’avantage de poser la question de manière à préparer pour l’avenir la solution du problème.
Descartes pensait que le tonnerre se manifeste lorsque des nuages placés plus haut dans l’atmosphère tombent sur d’autres situés plus bas. L’air contenu entre les deux nuages, étant comprimé par cette chute soudaine, produit, selon Descartes, un grand dégagement de chaleur, d’où résultent l’apparition de l’éclair et le bruit qui caractérisent le tonnerre.
Meilleur physicien que Descartes, l’illustre Boerhaave a émis, après ce philosophe, une théorie du tonnerre plus fortement raisonnée, sans être pour cela plus vraie. Pour expliquer la chaleur qui provoque l’apparition des éclairs, Boerhaave admettait que de petites masses d’eau congelées au sein des nuages ont la propriété de concentrer les rayons solaires. Ces petits amas de glace peuvent agir, selon Boerhaave, comme autant de lentilles convergentes, pour condenser en un point unique une quantité considérable de rayons solaires, et déterminer, en ce point, une élévation extrême de température.
Dans ses Notes sur le Cours de chimie de Lémery, le chimiste Baron expose en ces termes la théorie de Boerhaave, qu’il adopte sans réserve :
« Cet excellent physicien (Boerhaave), nous dit Baron, prouve d’une manière très-satisfaisante, dans ses Elementa chimica, que les particules d’eau que l’action du soleil avait élevées en l’air, venant à se réunir plusieurs ensemble sous la forme de nuées, composent des masses de glace qui réfléchissent la lumière du soleil par celle de leurs surfaces qui regarde cet astre, tandis que leur surface opposée éprouve un froid glacial. S’il arrive donc, comme cela se peut rencontrer souvent, que plusieurs nuées soient disposées les unes à l’égard des autres de façon qu’elles fassent l’effet de plusieurs miroirs concaves dont les foyers concourent dans un foyer commun, on comprend aisément que les rayons du soleil, ainsi réfléchis et rassemblés dans un même lieu, doivent produire une chaleur excessivement prodigieuse. Le premier effet de cette chaleur sera de dilater considérablement l’air environnant et de causer une espèce de vide dans l’espace renfermé entre les nuées ; mais bientôt après, ces mêmes nuées venant à changer de situation et les foyers se trouvant détruits, l’eau, la neige, la grêle et généralement tout ce qui environne le vide dont nous avons parlé, mais surtout les grandes masses de glace qui forment les nuées mêmes, fondent avec une impétuosité sans pareille les unes vers les autres pour remplir ce vide. L’énorme vitesse du mouvement par lequel toutes ces matières sont emportées occasionne un frottement si violent de toutes les parties les unes contre les autres, qu’il s’ensuit non-seulement un bruit éclatant et quelquefois horrible, mais encore l’inflammation de toutes les exhalaisons sulfureuses, grasses et huileuses qui se trouvent dans le voisinage, et dont l’air est toujours chargé abondamment pendant les grandes chaleurs. Ainsi il n’est pas étonnant que le tonnerre soit presque toujours accompagné d’éclairs… »
Fig. 259. — Boerhaave.
L’idée de Boerhaave sur la concentration des rayons solaires par de petites masses d’eau congelée flottant au sein des nues ne fut pas acceptée, car on ne pouvait admettre que les rayons du soleil traversassent, sans les fondre, ces corpuscules de glace. Mais la seconde idée présentée par l’illustre physicien hollandais, resta universellement adoptée, car elle répondait à une opinion fort en faveur depuis l’antiquité. On admit donc, avec Boerhaave, que le phénomène des éclairs et de la foudre provenait de l’inflammation de toutes les exhalaisons sulfureuses, grasses, huileuses et essentiellement combustibles, qui, émanées de la terre, viennent se réunir et s’accumuler dans les airs.
Cette explication physique du tonnerre, fort plausible pour cette époque, devint la théorie dominante, l’opinion classique jusqu’au milieu du xviiie siècle ; c’est contre ce système chimérique que dut lutter plus tard la théorie des électriciens.
Ainsi, dans l’opinion des physiciens de cette époque, on considérait la matière du tonnerre comme un mélange de toutes sortes d’exhalaisons terrestres, susceptibles de s’enflammer soit par l’effet d’une fermentation spéciale, soit par le choc et la pression des nuées, que les vents agitent et poussent violemment les unes contre les autres. Lorsqu’une portion considérable de ce mélange vient à prendre feu, disait-on, il se fait une explosion plus ou moins forte, suivant la quantité ou la nature des matières qui s’enflamment.
Comme cette théorie du tonnerre a joué un grand rôle dans l’histoire de la physique, nous croyons utile de la préciser exactement. Pour en donner une idée complète, nous citerons un passage de la Météorologie du père Cotte, dans lequel l’auteur développé et commente avec lucidité la théorie admise de son temps sur la cause du tonnerre :
« Si l’inflammation des exhalaisons terrestres se fait sur une médiocre quantité de matières, et au bord de la nuée, dit le père Cotte, cet effet se passe sans bruit, au moins à notre égard, il n’en résulte qu’un éclat de lumière, à peu près comme si nous apercevions de loin une certaine quantité de poudre qui s’enflammât librement et en plein air, sans être renfermée. Voilà l’éclair qui nous éblouit sans nous rien faire entendre, et qu’on appelle éclair de chaleur.
« Qu’une plus grande quantité de cette même matière vienne à fermenter dans le corps même de la nuée, aussitôt grande effervescence, bouillonnement, explosion ; et si cette première portion, éclatant ainsi, en rencontre une semblable qui n’ait point tout ce qu’il lui faut de mouvement pour éclater elle-même, elle l’anime de son action, et celle-ci une troisième ; de proche en proche il se fait une suite d’explosions d’autant plus violentes, que ces matières seront enveloppées de nuages plus épais. C’est ainsi, dit-on, que se font ces coups simples et redoublés qu’on entend quand il tonne, et dont les échos peuvent encore augmenter la durée. Voilà ce qu’on appelle tonnerre proprement dit.
« La nuée, entr’ouverte par les grandes explosions, laisse échapper une partie de ces feux qu’elle renferme ; autant de fois que cela arrive, c’est un éclair plus vif que les précédents, et qui annonce un coup, que nous n’entendons pourtant que quelques instants après, parce que le bruit ou le son ne se transmet pas avec autant de promptitude que la lumière. Suivant l’expérience de M…, de l’Académie des sciences, on doit compter cent soixante-treize toises pour chaque seconde de temps, ou chaque battement de pouls, qui s’écoule entre le moment où l’on voit l’éclair et celui où l’on entend le tonnerre. Si on ne l’entend par exemple, qu’après quatorze secondes, c’est une preuve que la nuée est éloignée d’une lieue commune de France, de deux mille quatre cent cinquante toises, au lieu que la lumière, n’employant que sept minutes à venir du soleil jusqu’à nous, parcourt en une seconde soixante dix-huit mille cent soixante-sept lieues, et en quatorze secondes un million quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-huit lieues ; il n’y a donc pas d’intervalle sensible entre le moment où l’éclair sort du nuage et celui où nous le voyons.
« Dans le moment où l’on entend le tonnerre, il sort une vapeur enflammée qu’on appelle la foudre, qui crève la nuée, tantôt par en haut, tantôt par en bas ou de côté, qui s’élance avec une vitesse proportionnée à son explosion, comme la poudre qui s’enflamme dans une bombe porte son action aux environs, quand elle a brisé le métal qui la retenait. La foudre part donc à chaque coup de tonnerre qui est précédé d’un éclair, mais elle ne frappe les objets terrestres que quand elle éclate dans une direction qui l’y conduise. »
Pour prêter de la force à cette théorie, les physiciens du dernier siècle invoquaient les observations et les découvertes de la chimie encore à sa naissance. On comparait à celui des chimistes le grand laboratoire de l’univers. La terre, disait-on, est une source continuelle de vapeurs et d’exhalaisons qui s’élèvent dans les airs. Les trois règnes de la nature sont soumis à cette loi. Les animaux perdent sans cesse, par la transpiration, une partie de leur substance ; de la surface extérieure des plantes, s’exhalent continuellement des matières vaporisées, qui sont quelquefois, grâce à leur odeur, appréciables à nos sens. Les diverses substances qui composent le règne minéral ne font pas exception à cette règle, et l’eau qui est répandue sur le globe en si grande abondance, se trouve aussi dans un état continuel d’évaporation. Ces vapeurs et ces exhalaisons différentes, qui sont composées, disait-on, de soufre, de bitume, de nitre ou de sel, en un mot de toutes les substances sulfureuses, grasses, inflammables et volatiles des animaux, végétaux et minéraux, s’élèvent dans l’atmosphère ; elles y flottent au gré des vents, et y subissent une infinité de combinaisons. On ajoutait que la chaleur du soleil, le mouvement dont tous les corps sont animés, les feux souterrains, etc., élèvent dans les airs des particules oléagineuses, salines, sulfurées et aqueuses. Mêlées et combinées par le souffle des vents, ces matières peuvent fermenter et s’enflammer. Cet effet se produit dans les moments d’orage. Les exhalaisons terrestres sont alors agitées et réunies ; leur mélange, leur choc et leur frottement les font fermenter toutes à la fois. Il résulte de cette fermentation générale, une inflammation de ces divers fluides, et une détonation qui constitue le tonnerre et la foudre.
Les vapeurs terrestres, disait-on, peuvent s’embraser dans l’air, comme le font, dans le laboratoire du chimiste, divers produits inflammables. On citait en exemple, la poudre à canon et les diverses compositions détonantes que l’on savait préparer à cette époque, telles que l’or et l’argent fulminant. Les nombreux pyrophores que les chimistes étudiaient alors avec tant de curiosité, le pyrophore de Homberg et celui de Geoffroy, le volcan de Lémery (sulfure de fer), le phosphore de Brandi et de Kunckel, c’est-à-dire notre phosphore actuel, n’étaient pas oubliés dans cette énumération des substances qui peuvent s’enflammer dans l’air, ou produire une détonation par le choc.
Nous ne nous arrêterons pas à combattre cette théorie, qui n’appartient plus qu’au domaine de l’histoire. Il nous a paru utile de l’exposer avec détails, afin de montrer qu’elle reposait sur des considérations très-spécieuses, et de faire comprendre les difficultés qu’elle opposa plus tard à la doctrine des électriciens.
Nous venons d’exposer l’opinion générale qui eut cours dans la science au sujet de la cause du tonnerre jusqu’à la découverte des phénomènes électriques. Avant de passer à l’histoire de la découverte du paratonnerre chez les modernes, il sera utile de rechercher si, avant cette époque, c’est-à-dire dans l’antiquité, on a connu les moyens de se garantir de la foudre. Nous espérons prouver que rien de semblable n’a existé dans l’antiquité, quoi qu’en aient dit une foule d’écrivains modernes, tels que Dutens{2}, Eusèbe Salverte{3}, La Boëssière{4}, et plus récemment M. Boullet{5} et J. Ampère{6}.
Servius parlant de l’art de conjurer la foudre nous transporte à l’époque la plus reculée de l’humanité. Cet écrivain latin, qui vivait sous Théodose le Jeune, est auteur de commentaires estimés sur les œuvres de Virgile. À propos du vers où ce poète dépeint Jupiter ratifiant, par le bruit du tonnerre, le pacte des nations troyenne et latine, Servius interprétant Hésiode et Eschyle, avec les idées superstitieuses de son temps, prétend que Prométhée découvrit et révéla aux hommes le moyen de faire descendre le feu du ciel : « Les premiers habitants de la terre, dit Servius, n’apportaient point de feu sur les autels ; mais, par leurs prières, ils y faisaient descendre (eliciebant) un feu divin. »
Selon le même auteur, c’est Prométhée qui leur avait révélé ce secret : « Prométhée, dit Servius, découvrit et révéla aux hommes l’art de faire descendre la foudre (eliciendorum fulminum)… Par le procédé qu’il avait enseigné, ils faisaient descendre le feu de la région supérieure [supernus ignis eliciebatur]. »
Mais, dit M. Th. H. Martin, « c’est là une conjecture ridicule de ce grammairien latin du Ve siècle de notre ère, à propos d’une antique fable grecque, dont il n’a pas pénétré le sens. Il n’est pas de peuple sauvage qui n’ait pour se procurer du feu, des moyens plus faciles et moins périlleux que celui qui est prêté si gratuitement par Servius à Prométhée{7}. »
Le mythe de Salmonée remonte au delà des temps historiques. Selon le récit des prêtres, Salmonée, roi d’Élide, eut l’audace de vouloir imiter la foudre. Pour cela, il lançait son char sur un pont d’airain, et il imitait ainsi le bruit et l’éclat du tonnerre. D’après les historiens, les dieux foudroyèrent Salmonée pour cette tentative audacieuse et impie.
Comment s’arrêter à cette opinion des anciens ? Comment le bruit d’un pont de bronze pouvait-il se faire entendre, comme le dit Virgile, « de tous les peuples de la Grèce »?
Eustathius, dans son commentaire sur l’Odyssée, met en avant des idées moins puériles. Il représente Salmonée comme un savant qui s’efforçait d’imiter le bruit et l’éclat du tonnerre et qui périt au milieu de ses dangereux essais.
Eusèbe Salverte qui, dans son ouvrage sur les Sciences occultes, a consacré un long chapitre à signaler les connaissances des anciens dans l’art de conjurer la foudre, n’est pas éloigné de croire que Salmonée possédait en effet quelque méthode qui permettait « de soutirer des nuages la matière électrique, et de l’amasser au point de déterminer bientôt une effrayante explosion ». Il fait remarquer à l’appui de ses conjectures, qu’en Élide, théâtre des succès de Salmonée et de la catastrophe qui y mit un terme, on voyait, près du grand autel du temple d’Olympie, un autel entouré d’une balustrade, et consacré à Jupiter Catabatès (qui descend) : « Or ce surnom fut donné à Jupiter pour marquer qu’il faisait sentir sa présence sur la terre par le bruit du tonnerre, par la foudre, par les éclairs, ou par de véritables apparitions. »
L’explication que donne Eustathius au xiie siècle de la fable de Salmonée, est toute gratuite, et ne repose sur aucun fondement. Quant à l’extension qu’Eusèbe Salverte a voulu donner à la même fable, en accordant à Salmonée toute la science des modernes, elle exagère encore, et sans plus de fondement historique, une explication de fantaisie.
Parmi les anciens peuples de l’Asie, on a signalé quelques traditions qui se rattachent, d’une manière plus ou moins claire, à l’art de conjurer la foudre. Elles se rapportent surtout à Zoroastre, le célèbre fondateur de la religion des Mages.
Khondémir rapporte que le démon apparaissait à Zoroastre au milieu du feu, et qu’il imprima sur son corps une marque lumineuse. Suivant Dion Chrysostome, lorsque Zoroastre quitta la montagne où il avait longtemps vécu dans la solitude, il parut tout brillant d’une flamme inextinguible, qu’il avait fait descendre du ciel. L’auteur des Récognitions, attribuées à saint Clément d’Alexandrie, et Grégoire de Tours, affirment que, sous le nom de Zoroastre, les Perses révéraient un fils de Cham, qui, par un prestige magique, faisait descendre le feu du ciel, ou persuadait aux hommes qu’il avait ce miraculeux pouvoir.
Une tradition, répétée par plusieurs auteurs anciens, rapporte que Zoroastre, roi de la Bactriane, périt brûlé par le démon, qu’il importunait trop souvent pour répéter son brillant prodige. Ces expressions semblent désigner un physicien qui, répétant plusieurs fois une expérience dangereuse, négligea un jour de prendre les précautions nécessaires et tomba victime de cet oubli.
Suidas, Cédrénus et la Chronique d’Alexandrie disent que Zoroastre, assiégé dans sa capitale par Ninus, demanda aux dieux d’être frappé de la foudre, et qu’il vit son vœu s’accomplir, après qu’il eut recommandé à ses disciples de garder ses cendres comme un gage de la durée de leur puissance. Suivant une autre tradition qui diffère peu de la précédente, Zoroastre, décidé à mourir pour ne point tomber au pouvoir du vainqueur, dirigea la foudre contre lui-même ; par un dernier miracle de son art, il se donna une mort extraordinaire, bien digne de l’envoyé du ciel et du pontife ou de l’instituteur du culte du feu.
De quelques textes confus qui se rapportent au fondateur de la religion des Mages et à celles de ses opérations cabalistiques où il est question de la foudre, on a cru pouvoir induire que Zoroastre avait des notions sur l’électricité ; qu’il avait trouvé le moyen de faire descendre la foudre des cieux, qu’il s’en servit pour opérer les premiers miracles destinés à prouver sa mission prophétique, et surtout pour allumer le feu sacré qu’il offrit à l’adoration de ses sectateurs. On a encore ajouté qu’entre les mains de Zoroastre et de ses disciples, le feu céleste devint un instrument destiné à éprouver le courage des initiés, à confirmer leur foi et à éblouir leurs yeux de cette splendeur immense, impossible à soutenir pour des regards mortels, qui est à la fois l’attribut et l’image de la Divinité.
Ces récits qui se contredisent, et qui ne se rapportent pas tous au vrai Zoroastre, c’est-à-dire au Mède Zarathustra, roi de la Bactriane, qui établit les principales doctrines de l’Avista, sont apocryphes, pour la plupart. Ce sont de pures traditions orientales qui prouvent seulement que, dans la religion des Mages, comme dans les autres religions, le feu du ciel était souvent invoqué.
En arrivant à des temps plus historiques, nous trouvons les faits, bien souvent cités, de Numa Pompilius, second roi de Rome, et de son successeur Tullus Hostilius.
Ovide nous a transmis dans ses Fastes, l’histoire légendaire de Numa, qu’il expose comme il suit.
À une époque où le tonnerre exerçait de continuels ravages en Italie, Numa chercha à apaiser la foudre (fulmen piari), c’est-à-dire, en quittant le style figuré, le moyen de rendre ce météore moins malfaisant. Dirigé par la nymphe Égérie, il obtint la révélation de ce secret, au moyen d’une surprise dont furent victimes Faunus et Martius Picus, dieux des forêts, ou prêtres des divinités étrusques. Trouvant sur leur route des coupes pleines de vin parfumé, que Numa y avait placées avec intention, ces dieux étourdis se laissent aller à fêter trop largement le délicieux breuvage. Quand ils sont privés de leurs sens par les fumées d’un vin généreux, Numa survient et les garrotte sans peine. Sortant de leur sommeil, Faunus et Picus essayent en vain de briser leurs chaînes. Alors le monarque romain se répand en compliments respectueux, il leur demande pardon de l’extrême liberté qu’il a prise, protestant qu’il ne veut leur faire aucun mal, et laissant entrevoir qu’il pourrait les délivrer à cette condition :
Quoque modo possint fulmen monstrare piari,
c’est-à-dire de lui apprendre la manière d’apaiser, de conjurer la foudre.
Cette demande hardie n’est pas absolument rejetée par Faunus, qui répond :
Dî sumus agrestes, et qui dominemur in altis Montibus : arbitrium est in sua tela Jovi.Nunc tu non poteris per te deducere cœlo ;At poteris nostrâ forsitan usus ope.
« Nous sommes des dieux champêtres et qui habitons le sommet des montagnes. Nous pouvons disposer des foudres de Jupiter. Tu ne pourrais maintenant les obtenir toi-même du ciel, mais peut-être pourrais-tu y réussir avec notre secours. »
Martius Picus reconnaît qu’il possède l’ars valida, et qu’il est disposé à le transmettre. Le marché se conclut, le secret est révélé, et l’on prend jour pour le mettre à l’épreuve. Au jour fixé, Numa et les siens se rassemblent solennellement.
Le soleil se levait radieux aux courbes lointaines de l’horizon, lorsque Numa, la tête voilée de blanc, élève ses mains au ciel, et demande que la promesse des dieux soit remplie.
Dum loquitur, totum jam sol emerserat orbem,Et gravis æthereo venit ab axe fragor. Ter tonuit sine nube Deus, tria fulgura misit.
« Tandis qu’il parle, le disque entier du soleil s’est montré ; un bruit éclatant retentit au plus haut des airs. Dans un ciel sans nuages, Jupiter a tonné trois fois, et trois éclairs ont resplendi. »
Alors la voûte d’azur s’ouvre dans les cieux, et le bouclier sacré tombe aux pieds du monarque.
C’est d’après ce récit mythologique d’Ovide que beaucoup de commentateurs ont cru pouvoir admettre que Numa apprit des prêtres étrusques le secret de conjurer la foudre et de la faire descendre, inoffensive, du sein des nuées.
S’il faut en croire les historiens de Rome, Numa Pompilius répéta plusieurs fois, avec succès, cette expérience religieuse. N’employant ce secret que pour le service des dieux, il put en user sans être puni. Mais il en fut autrement de son successeur Tullus Hostilius, qui, ayant voulu dénaturer l’emploi de l’arcane divin, fut frappé de mort.
Pline et Tite-Live ont raconté, sous la responsabilité de Lucius Pison et de ses Annales anciennes, comment le secret de Numa se transmit à Tullus Hostilius.
Pline nous dit que Tullus apprit dans les livres de Numa l’art d’attirer le tonnerre, mais que l’ayant pratiqué d’une façon inexacte (parum ritè) il fut foudroyé. Il répète à peu près les mêmes paroles dans une autre partie de son ouvrage. Mais là, derechef, et toujours sur la foi des Annales anciennes de Pison (gravis auctor, nous dit-il), il affirme que la foudre pouvait être forcée à descendre du ciel par certains rites sacrés, ou par les prières ; et il cite Porsenna, roi des Volsques, qui l’avait évoquée aussi de la même manière. Pline ajoute que l’on eut recours à ce moyen pour délivrer la ville de Volsinies, dans l’Étrurie, d’un monstre qui la ravageait.
Ce monstre, pour le dire en passant, avait reçu le nom de Volta, rencontre bien originale, il faut l’avouer, si l’on se rappelle le nom de Volta, le célèbre physicien de Pavie qui s’est tant illustré par ses découvertes sur l’électricité.
Tite-Live raconte avec un peu plus de développements les mêmes faits allégués par Pline :
« On rapporte, dit Tite-Live, que ce prince en feuilletant les Mémoires laissés par Numa, y trouva quelques renseignements sur les sacrifices secrets offerts à Jupiter Elicius. Il essaya de les répéter, mais dans les préparatifs ou dans la célébration il s’écarta du rite sacré… En butte au courroux de Jupiter évoqué par une cérémonie défectueuse (sollicitati prava religione), il fut frappé de la foudre et consumé ainsi que son palais{8}. »
Ces diverses citations ne prouvent nullement que Numa et Tullus Hostilius aient connu l’art de conjurer la foudre.
Dans l’ouvrage que nous avons déjà cité, La foudre, l’électricité et le magnétisme chez les anciens, M. Th. H. Martin a soumis à un examen approfondi ces allégations prétendues historiques, et qui ne sont que des fables ou de fausses interprétations. Il montre avec évidence qu’il faut entendre le mot évocation de la foudre, que les commentateurs ont mis en avant par une simple évocation de Jupiter.
Sans reproduire la discussion à laquelle se livre M. H. Martin sur ce point, nous rapporterons la conclusion qu’il en tire :
« Que faut-il conclure, dit M. H. Martin, de la comparaison de tous ces textes ? C’est que, suivant la tradition et les vieux annalistes de Rome, Numa avait évoqué non pas la foudre, mais Jupiter, et que par cette évocation prétendue il avait prêté une autorité divine aux cérémonies expiatoires que le Dieu était supposé lui avoir révélées ; c’est que, suivant les mêmes auteurs, la fin tragique de Tullus Hostilius, mort dans un incendie causé par la foudre, était la punition de la manière irrégulière dont il avait procédé dans une évocation de Jupiter, et non dans une expérience sur la foudre ; c’est que L. Pison avait respecté ici la tradition primitive, suivie aussi par Valérius d’Antium, par Ovide et par Plutarque, mais que Pline et Servius, empruntant aux stoïciens grecs et romains les excès de l’interprétation allégorique de la mythologie, excès aussi éloignés de la vérité que ceux de l’interprétation prétendue historique d’Évhémère, ont cru faire preuve de sagacité en substituant dans cette fable antique, le nom de la foudre à celui de Jupiter. Nous avons vu que cette interprétation, incompatible avec le récit détaillé de Valérius et d’Ovide, avait tenté aussi Tite-Live, mais qu’il l’avait abandonnée dans son récit de la mort de Tullus Hostilius.
« Appien, Valère Maxime (IX, 12) et Eutrope se bornent à dire que ce roi fut foudroyé et brûlé avec sa maison. Denys d’Halicarnasse dit d’abord que Tullus Hostilius périt dans un incendie avec sa famille ; puis il ajoute que suivant quelques auteurs cet incendie avait été allumé par la foudre, parce que Tullus avait irrité Jupiter en négligeant quelques sacrifices usités à Rome et en introduisant au contraire des cérémonies étrangères, mais que suivant la plupart des auteurs il mourut victime d’un attentat attribué à son successeur Ancus Martius.
« En résumé, le rôle de Numa offre beaucoup d’analogie avec le rôle religieux du thaumaturge Épiménide chez les Grecs, et il n’en offre aucune avec le rôle scientifique de Franklin ; quant à la fin tragique de Tullus Hostilius, que tant d’autres modernes, depuis Dutens jusqu’à M. J.-J. Ampère, ont comparée bien à tort à celle du physicien Richmann, elle y fut probablement analogue à celle de Romulus que les sénateurs, las de lui sur la terre, envoyèrent au ciel ; ces deux crimes furent dissimulés chacun sous une légende merveilleuse ; mais Tullus Hostilius n’eut pas d’apothéose comme Romulus. Voilà ce qu’on peut entrevoir de plus probable sur la mort de ce roi, au milieu des ténèbres qui couvrent ces premiers temps de Rome{9}. »
Suivant Ovide et Denys d’Halicarnasse, Romulus, onzième roi des Albains (Sylvius Alladas), aurait trouvé, même avant Numa et Tullus Hostilius, le moyen de contrefaire le tonnerre et les éclairs. Eusèbe prétend que ce moyen consistait en une simple manœuvre, par laquelle ses soldats frappaient tous à la fois leurs boucliers de leurs épées{10}, manière assez ridicule, il nous semble, d’imiter la foudre. Les dieux cependant prirent à cœur cette usurpation, ou pour mieux dire cette contrefaçon de leurs armes ordinaires, et le roi d’Albe tomba sous leur tonnerre vengeur.
Fulmineo periit imitator fulminis ictu{11}.
« En imitant la foudre il périt foudroyé. »
On trouve dans la Pharsale de Lucain un passage très-curieux, relatif au sujet qui nous occupe. Ce poëte prétend qu’un aruspice d’Étrurie, nommé Aruns, également versé dans la connaissance des mouvements du tonnerre et dans l’art divin d’interroger les entrailles des victimes et le vol des oiseaux,
Fulminis edoctus motus, venasque calentes Fibrarum et monitus errantis in aera pennæ,
savait rassembler les feux de la foudre épars dans le ciel et les enfouir dans la terre.
M. H. Martin, dans une très-savante dissertation sur la prétendue science des prêtres étrusques, a dévoilé le charlatanisme de ces prêtres, qui n’avaient d’autre but que d’en imposer à la multitude, aux personnages et aux chefs d’État qui faisaient appel à leurs prédictions ou à leurs prodiges.
« Il est vrai, dit M. H. Martin, que les Étrusques prétendaient enterrer la foudre ; mais il est constant que leur procédé consistait à enterrer avec certaines cérémonies, les débris des objets qu’elle avait frappés. Non-seulement aucun fait ne prouve qu’ils aient eu le pouvoir de la faire tomber ou de la diriger ; mais, comme nous l’avons vu, il n’est pas même certain que les anciens Étrusques en aient eu la prétention, et les textes d’où on a voulu le conclure ne parlent que de sacrifices et de cérémonies superstitieuses. Quant à des procédés efficaces employés par les Étrusques pour écarter la foudre, il n’y en a pas de traces. M. Ideler admet que leurs Livres rituels pouvaient contenir pour cela quelques recettes. C’est possible, mais rien ne le prouve. Ce qu’il y a de certain, c’est que le contenu des Livres rituels et des autres ouvrages étrusques était parfaitement connu des Romains, qui ne connaissaient contre la foudre que des préservatifs absurdes, et que, par conséquent, ceux des Étrusques, s’ils en avaient, et dans quelque ouvrage qu’ils les eussent consignés, n’étaient pas meilleurs{12}. »
Un érudit, membre de l’Académie du Gard, M. La Boëssière, a publié en 1822 un curieux mémoire qui traite des Connaissances des anciens dans l’art d’évoquer et d’absorber la foudre{13}. M. La Boëssière rappelle dans ce mémoire, l’existence de plusieurs médailles qui paraissent se rapporter à son sujet. L’une, décrite par Duchoul, représente le temple de Junon, déesse de l’air : la toiture qui recouvre cet édifice est armée de tiges pointues. L’autre médaille, décrite et gravée par Pellerin, porte pour légende : Jupiter Elicius ; le dieu y paraît la foudre en main ; en bas est un homme qui dirige un cerf-volant. Cette dernière médaille présenterait une coïncidence et un rapprochement fort singuliers avec le cerf-volant électrique de Franklin et de Romas. Mais hâtons-nous d’ajouter qu’elle a été reconnue non authentique.
Dans son ouvrage sur la Religion des Romains, Duchoul cite d’autres médailles qui présentent l’exergue : XV Viri sacris faciundis{14}. On y voit un poisson hérissé de pointes, placé sur un globe ou sur une coupe. M. La Boëssière pense qu’un poisson ou un globe, ainsi armé de pointes, fut le conducteur employé par Numa pour soutirer des nuages le feu électrique, et rapprochant la figure de ce globe de celle d’une tête couverte de cheveux hérissés, il donne une explication ingénieuse du singulier dialogue de Numa avec Jupiter, dialogue rapporté par Valérius Antias, et tourné en ridicule par Arnobe, sans que probablement ni l’un ni l’autre le comprît.
Les Hébreux ont-ils eu connaissance de l’électricité ?
Ben David avait avancé que Moïse possédait quelques notions de ces phénomènes. Un savant de Berlin, M. Hirt, a tenté d’appuyer cette conjecture d’arguments plausibles. Mais un autre érudit allemand, Michaëlis, est allé plus loin{15}.
Dans une correspondance de Lichtenberg, sur l’effet des flèches qui surmontaient le temple de Salomon, Michaëlis fait observer que durant un laps de temps de mille années, le temple de Jérusalem paraît n’avoir jamais été atteint par le feu du ciel. Ce dernier fait n’est pas susceptible de preuves directes. La remarque de Michaëlis acquiert pourtant un certain degré d’importance, si l’on considère, avec Arago, que les anciens auteurs mentionnaient avec un soin remarquable les accidents de cet ordre arrivés à leurs monuments publics. Une forêt de flèches dorées, ou à pointes d’or très-aiguës, couvrait le toit d’une partie du vaste temple de Jérusalem, et au moyen des conduits métalliques établis pour l’écoulement des eaux, ce toit communiquait avec les citernes et les cavités de la montagne sur laquelle le temple était bâti. Comme les toits, les murs et les poutres, les planchers et les portes de chaque appartement étaient dorés, il résultait de l’ensemble de ces dispositions, un système de conducteurs parfaits pour l’écoulement du fluide électrique.
L’historien Josèphe, en décrivant l’extérieur du temple de Jérusalem, nous dit qu’il était partout revêtu de pesantes plaques d’or, et que pour empêcher les oiseaux de souiller le toit de leurs excréments, on l’avait hérissé de baguettes pointues en or ou revêtues d’or. Plus loin, décrivant le combat des prêtres contre les Romains après l’incendie du temple, Josèphe nous apprend que les prêtres juifs arrachèrent les flèches dont le temple était surmonté, ainsi que les masses de plomb dans lesquelles ces flèches étaient enchâssées, et qu’ils s’en servirent comme de projectiles de guerre. Roland, dans ses annotations sur ce passage, déclare qu’il faut entendre par là les pointes de fer, obelos ferreos, qui étaient placées sur le toit du temple pour éloigner les oiseaux.
Le temple de Salomon était un vaste édifice fermé de murailles, en partie couvert de toiture, en partie découvert. Il avait deux parvis extérieurs. Venaient ensuite le parvis des femmes, celui des Israélites, et celui des sacrificateurs où s’élevait l’autel des holocaustes, avec ce que l’on nommait la mer d’airain, et qui était un immense vase de métal, porté sur douze figures de bœufs. Au delà de l’autel des holocaustes, commençait le temple proprement dit. Précédé d’un large portique ouvert, il était couvert d’une toiture plane et décoré de deux colonnes d’airain creuses. Une galerie à trois étages régnait le long du temple.
Fig. 260. — Le temple de Salomon à Jérusalem, restauré d’après les travaux modernes.
La planche que l’on voit représente le Temple de Salomon restauré d’après les beaux travaux de M. de Rougé. Elle reproduit l’un des dessins qui ont été exécutés pour la belle publication de messieurs Noblet et Baudry ayant pour titre le Temple de Jérusalem.
Il est vraiment curieux que pendant l’espace d’environ mille ans, le temple de Salomon n’ait jamais été frappé de la foudre, ni depuis sa fondation sous Salomon jusqu’à sa ruine sous Nabuchodonosor, ni après la captivité des Hébreux, jusqu’à Hérode, qui fit réparer le temple, jusqu’à sa ruine définitive par les Romains sous l’empereur Titus.
Il est manifeste que les masses d’or, de bronze, de métal doré, qui couvraient le temple, et les flèches qui s’élevaient sur une partie de la toiture, fonctionnaient comme de véritables paratonnerres, et en écartaient la foudre. Mais rien ne prouve qu’aucune intention scientifique eût présidé à l’érection de ces verges métalliques. L’historien Josèphe nous fait connaître leur destination, quand il dit qu’elles avaient pour objet d’empêcher les oiseaux de souiller le toit de leurs excréments. Nous ne voyons pas pourquoi on irait chercher en dehors de ce texte, une explication qui oblige à prêter aux Hébreux des connaissances scientifiques qu’on ne leur a jamais accordées.
La première indication positive d’une méthode destinée, chez les anciens, à protéger les maisons contre le feu du ciel, se trouve dans l’ouvrage de Columelle. Cet écrivain établit, en termes exprès, que Tarchon, disciple du magicien Tagès, et fondateur de la théurgie étrusque, abritait son habitation en l’entourant de vignes blanches.
Utque Jovis magni prohiberet fulmina TarchonSæpè suas sedes percinxit vitibus albis{16}.
On sait que le temple d’Apollon fut, dans le même but, environné de lauriers{17}.
Une croyance semblable se retrouvait parmi les habitants de l’Hindoustan, qui employaient autrefois comme préservatifs contre la foudre, des plantes grasses dont ils entouraient leurs demeures.
Un tel moyen d’écarter la foudre n’avait rien que d’absurde. Aussi voyons-nous dans Pline lui-même, que presque toutes les tours élevées devant Terracine et le temple de Féronia, ayant été détruits par le feu du ciel, les habitants renoncèrent à ce singulier genre de retranchements.
Pline prétend encore que la foudre ne descend jamais dans le sol à plus de cinq pieds de profondeur, et que les personnes craintives couvrent leurs maisons de peaux de phoques, les seuls animaux marins que le feu du ciel n’atteigne jamais.
On voit que les anciens avaient des idées fort étranges sur l’art d’écarter la foudre, et que les moyens qu’ils préconisaient dans ce but n’étaient pas marqués au coin de la raison.
Ctésias de Cnide, un des compagnons de Xénophon, raconte, dans un passage qui nous a été conservé par Photius, qu’il avait reçu deux épées, l’une des mains de Parisatis, mère d’Artaxercès, l’autre des mains du roi lui-même. Il ajoute :
« Si on les plante dans la terre, la pointe en haut, elles écartent les nuées, la grêle et les orages. Le roi en fit l’expérience devant moi à ses risques et périls. »
Ce qu’on peut objecter contre le moyen dont parle Ctésias, c’est son insuffisance pour écarter les orages, attendu qu’une simple tige pointue de quelques pieds de hauteur, comme une épée plantée dans le sol, n’a jamais joui d’un tel pouvoir. Comment d’ailleurs accorder le moindre crédit à l’assertion de cet historien, quand on voit Ctésias affirmer, dans le même chapitre, qu’il a connaissance d’une fontaine de seize coudées de circonférence, sur une orgye de profondeur, qui, tous les ans, se remplissait d’un or liquide, dont on pouvait charger cent cruches !
Le moyen dont parle Ctésias, par son inefficacité absolue, doit donc être placé sur la même ligne que celui signalé par Hérodote, qui prétend que les anciens Thraces désarmaient les nuages orageux en lançant leurs flèches contre le ciel.
Les alchimistes du Moyen âge ont cité avec complaisance un procédé pour faire de l’or au moyen de la foudre mise en bouteille. Ce procédé est rapporté par un vieux cabaliste nommé Holfergen, comme ayant été découvert par Abraham de Gotha, adepte de l’art hermétique.
Abraham de Gotha, qui avait eu cette belle idée se serait fait sans doute un nom célèbre dans l’histoire de l’alchimie, sans une circonstance fâcheuse. Il fut pendu à l’âge de trente-six ans, pour cause de sortilège.
Pour faire de l’or, le disciple d’Hermès conseillait de recueillir la foudre dans une fiole pleine d’eau. Après avoir fait évaporer lentement le liquide, en récitant certaines oraisons, cet heureux adepte retrouvait toujours au fond de sa cornue, une masse d’or d’un poids égal à celui de l’éclair qu’il avait su liquéfier.
Notre cabaliste ne paraît nullement douter du fait. Il prétend même que cette recette fut pratiquée bien avant Abraham de Gotha, par les Gaulois, du temps de César :
« Ces morceaux d’or, retrouvés dans les lacs des Gaules, nous dit-il, n’étaient que de la foudre concrétée. En temps d’orage, les Éduens et les Tolosains se couchaient près des fontaines, après avoir allumé une torche et planté à côté d’eux leur épée nue la pointe en haut. Il advenait que la foudre tombait souvent sur la pointe de l’épée, sans faire de mal au guerrier, et s’écoulait innocemment dans l’eau où, après s’être liquéfiée, elle finissait par se solidifier dans les temps de grande chaleur. »
S’il faut s’en rapporter aux Lettres de Gerbert