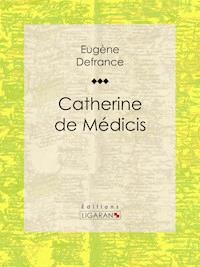
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Après la marche triomphale de Florence à Livourne, après le versement effectué par Philippe Strozzi des 1 200 livres d'or qui constituaient la dote de Catherine, après le cadeau de noces du Pape Clément VII, cadeau de 100 000 ducats en bijoux et pierres précieuses, (...), le mariage du futur Henri II, second fils de François 1er Henri duc d'Orléans, avec Catherine de Médicis, fut célébré à Marseille le 28 octobre de l'année 1533."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335042863
©Ligaran 2015
À Monsieur Léon Marlet
Bibliothécaire du Sénat.
Si j’écris votre nom en tête de cet ouvrage, mon cher Ami, c’est parce que vous en avez été le guide savant et sûr. C’est parce que depuis de longues années vous avez consacré toute votre érudition de distingué chartiste à l’étude du seizième siècle et des caractères si variés, parfois même si complexes, qui en ont marqué tour à tour et la grandeur de pensée, et les tragiques phases. C’est enfin parce que vous avez été l’amical soutien, l’encourageant réconfort dans l’âpre élaboration de cet ardu travail, au cours duquel la fatigue et l’abattement moral sont bien souvent venus arrêter ma plume.
Je vous dois donc infiniment de reconnaissance pour tout cela, mon cher Ami. Et voilà pourquoi je tenais à vous dédier une œuvre qui contient non seulement beaucoup de votre science, mais aussi beaucoup de notre mutuelle affection.
E.D.
3 Avril 1911.
Nous savons deviner l’avenir dans les astres du ciel, dans les plis de la main, et le passé dans les cendres sépulcrales. Aux livres à l’écrit intraduisible pour les profanes, aux textes ténébreux des coptes, nous connaissons les signes qui tuent et les incantations qui font revivre les morts.
THOMASSI BORONELLO.
Pour notre histoire nationale, aussi bien que pour l’histoire européenne, la seconde moitié du seizième siècle et le premier quart du dix-septième, constituent une période effroyablement malheureuse. Certes, ce n’est plus la nuit des siècles qui ont suivi la mort de Théodose ; mais l’intellectualité humaine et les organisations sociales des peuples sont, à cette époque, si lentes dans leurs métamorphoses, qu’il semble que l’aurore de la Renaissance se prolonge en une imprécision lamentable. Un grand vent de raison a cependant secoué le monde, puissamment aidé par la sublime invention de Gutenberg. À la voix des Calvin, Luther, Michel Servet, Rabelais, Dolet, Théodore de Bèze et Sébastien Castellion, le trône de Rome se sent violemment ébranlé. Pour ce que c’est assez vescu en ténèbres, s’écrie l’imprimeur lyonnais qui devait payer cette phrase sur le bûcher de la place Maubert.
Mais toute action émancipatrice ne s’exerce jamais sans réaction. Des profondeurs de l’Allemagne, surgit soudain une multitude de sectes d’où sort une nouvelle barbarie, érigeant en dogmes les plus singulières aberrations mentales. En même temps que dans les troubles politiques s’entretuent papistes et huguenots, en même temps que des intelligences discutent véhémentement sur l’utilité ou l’absurdité de la messe, sur l’incarnation ou l’absence de Jésus dans la sainte hostie, d’autres cerveaux font un brusque retour dans les doctrines du paganisme germanique et Scandinave, auxquelles ils joignent les pratiques étranges des rites magiques du Moyen Âge.
Évidemment on croit toujours en Dieu. Mais puisque ceux qui prononcent respectueusement son nom ne savent être d’accord sur la manière de l’honorer, c’est donc que le Diable se mêle de troubler les esprits ? Et l’on croit alors plus que jamais à l’influence du Prince des ténèbres.
Cependant c’est bien pour la gloire du Dieu de miséricorde que s’élèvent les bûchers, que grincent les roues de tortures, que saint Barthélemy martyr voit sa fête célébrée dans du sang, que s’assassinent les grands et que gémissent les humbles. Mais le clergé proteste tout bas, disant que ce n’est pas de par la volonté du céleste Père que s’accomplissent ces horribles choses, et que c’est uniquement l’œuvre du suppôt des enfers, perturbateur des consciences et des cœurs devenus inhumains. Et de cet aveu, des raisonneurs concluent que l’ange déchu est désormais plus fort que son maître.
D’ailleurs qui le nierait ? Depuis des siècles, les psaumes, les humiliations, les prières et les jeunes n’ont rien produit pour l’amoindrissement des misères humaines. Le Rédempteur divin, seul dispensateur du bon, du bien et du juste, a été impuissant devant l’envahissement de la foi mondiale par les stryges infernales. Donc il faut s’attacher à Satan, obtenir sa protection, ses faveurs, en lui dressant des autels, en lui organisant des messes spéciales, en lui dédiant des victimes par le poison et par le fer, par l’envoûtement et l’inceste, par le viol et la sodomie. Au plain-chant des cathédrales, on substituera le sifflement aigu des flûtes en tibias ; et l’encens subtil et vaporeux enveloppant les saints au sourire béat sera remplacé par l’assa-fœtida aux âcres émanations, brûlant aux pieds de Jodhévauhé, monstre ricanant dans son cercle d’airain.
Avec de tels honneurs rendus aux démons et au Macroprosope couronné, les adeptes sataniques sont bien sûrs d’obtenir promptement une puissance devant laquelle tout cédera, tout pliera. Confirmant cette force de l’ombre, les docteurs es sciences maudites ne déclarent-ils pas que les fidèles du noir Seigneur sont seuls possesseurs du Secret des Secrets ? Apologistes autorisés des théories du mal, ils assurent que tout fervent doctrinaire luciférien peut commander aux génies nocturnes, aux élémentales, aux lémures et larves, aux incubes et succubes, aux spectres et goules, aux farfadets et lamies. Ils détiennent en outre le moyen de découvrir les sources et les trésors, de faire gémir la mandragore, et de transformer les plus vils métaux en un or pur et ductile. Ils savent aussi faire naître de troublants désirs dans les cœurs les plus réfractaires à l’amour, et chacun reconnaît que la complexe goétie n’est pour eux qu’un ensemble de banales opérations et formules évocatoires. Mieux encore, Paracelse et Stirgane, biogénistes convaincus, ne donnent-ils pas l’immanquable moyen d’obtenir l’hommunculus, homme ou femme artificiels que l’hermétiste peut à son gré créer en son laboratoire, par la concentration dans un alambic scellé, d’une quantité déterminée de semence humaine ?. Quel triomphe que d’avoir en mains ces moyens prestigieux ! Quelle jouissance que de parvenir à ce vaste idéal, à cette influence supérieure et sans rivale !
Bien rares furent les esprits suffisamment forts pour échapper à cet âpre désir de domination, de vengeance, de haine calculatrice ou d’amour lubrique. Jamais on ne vit les souverains de la vieille Europe aussi avides de merveilleux, qu’ils le furent au seizième siècle. Encouragés par ces hautes protections, les Ruggieri le vieux, Corneille Agrippa, Jérôme Cardan, Michel Nostradamus et autres maîtres dans l’enseignement des grands arts, font de nombreux élèves qui trouvent aisément de lucratifs emplois auprès des princes régnants. Mais nul monarque, nulle reine, ne réservèrent à ces personnages, le bon accueil et le soutien que leur accorda Catherine de Médicis à la cour de France.
Aussi vit-on bientôt trente mille sorciers, alchimistes, devins et astrologues, vivre du produit de la superstition parisienne. Tout ce que la ville et la cour comptent de notabilités, croit plus ou moins à l’autorité diabolique des magiciens, à l’attraction du mauvais œil, aux dangers mortels de l’envoûtement. Des cerveaux comme ceux de Pasquier, de Thou, Ambroise Paré, n’échappèrent pas à cette fièvre démoniaque. L’Église même, qui lançait sans arrêt ses plus terribles anathèmes contre les sorciers, ne les condamnait pas comme des imposteurs ou des fous, mais bien comme des impies et relaps dont la malignité pouvait, à l’aide du démon, opérer des faits extraordinaires susceptibles de nuire au christianisme. Chacun traîne alors son existence dans une crainte, une méfiance continuelles, voyant des empoisonneurs et des assassins partout, des sortilèges en toutes choses, et des menaces divines dans les moindres phénomènes atmosphériques.
Possédée par une ambition incommensurable. Catherine de Médicis n’aura d’autre but que celui de conserver le gouvernement ; et pour satisfaire cet amour du pouvoir, elle emploiera tous les systèmes bons ou mauvais. Très autoritaire, mais fataliste comme la plupart des intelligences supérieures de son temps, ce n’est ni le catholicisme, ni le protestantisme qui sauront guider sa conscience. Contrairement à ce que prétendent divers historiens redresseurs de torts, c’est bien à un idéal plus ténébreux que Catherine voua son âme, toute son âme de Florentine altière. C’est seulement devant l’astrolabe, les miroirs magiques et les cercles goétiques, qu’elle inclinera sa fierté souveraine. Par les sciences occultes, elle sera épouse, mère et dictatrice, tour à tour bonne ou cruelle, fourbe ou sincère, mais toujours adroitement énigmatique et mystérieuse.
Ceci n’empêchera pas cette femme étrange de posséder les plus hautes qualités d’un administrateur d’État, sans avoir aucune des faiblesses morales ou physiques particulières à son sexe. Prise entre le républicanisme des huguenots et la trahison catholique, elle saura garder le trône aux Valois par des combinaisons dont l’habileté fait encore envie à nos plus éclairés diplomates. Elle sera une autorité forte, inflexible et clairvoyante, prompte en ses décisions, ne redoutant ni les injures, ni les embûches, ni les terribles moyens. Tant plus de morts, tant moins d’ennemis, écrira-t-elle à de Gordes. Et cette phrase résumera tout ce caractère de femme infrangible, qui met sa dignité de Reine-Mère au-dessus des sentiments féminins ordinaires.
Elle est d’une coquetterie modérée, et en dehors de son mari : pas d’amour. En dehors de ses enfants : pas d’affection. Encore n’accorde-t-elle à ces derniers ses élans maternels, qu’autant qu’ils sont incapables d’enrayer son autorité, leur retirant toute tendresse dès qu’ils ont atteint l’âge de gouverner. Pourtant, elle faiblira devant Henri III qui ne lui rendra son attachement que par une profonde ingratitude. Donc, elle n’a qu’un idéal : c’est la couronne de France qu’elle porte par fierté et par devoir.
Pour Catherine, le sceptre réunit toutes les joies, toutes les satisfactions, en dépit des combats de chaque jour, des perpétuelles duplicités à créer ou à détruire. Que lui importe la lutte ! N’est-elle pas née par elle et pour elle ? Les Médicis n’étaient-ils pas d’ardents remueurs politiques ? Et pourquoi exigerait-on qu’elle fût douce et sensible, conciliante et bonne ? N’a-t-elle pas été formée au contact de la tourbe révolutionnaire ? Son enfance ne s’est-elle pas lamentablement écoulée au milieu des haines soulevées par le despotisme de son père ? Les hommes n’ont-ils pas toujours été des barbares pour elle, lorsque, âgée de neuf ans, prisonnière en un couvent, Baptiste Ceï proposa de l’attacher nue, sur les murs de Florence, entre deux créneaux, exposée aux canonnades des assiégeants. Et quand Bernard Castiglione, jugeant cette proposition insuffisamment outrageante, émettait l’avis de terminer la discussion en la livrant aux soudards étrangers pour la déshonorer par le viol, pouvait-elle vraiment concevoir que la bonté, la générosité et la pitié humaines constituent le beau d’une existence ?…
Mariée, elle ne fut pas plus heureuse. Henri II ne la considéra jamais autrement que comme un être propre à la perpétuation de sa race. Tout ce que le cœur d’un roi pouvait contenir de vibration amoureuse, d’admiration dévouée, de soumission d’âme vis-à-vis d’un être aimé, Henri II le donna entièrement à Diane de Poitiers. Catherine ne fut que l’accessoire obligé, imposé par les exigences et les intérêts politiques d’un trône.
Devant tant d’adversion ou d’indifférence, la cruauté et le machiavélisme de Catherine sont, certes, excusables en partie. Mais la réhabilitation de cette femme supérieure n’est pas le but de ce livre. D’autres historiens se sont déjà imposé cette tâche et je n’y reviendrai pas. Si l’unanimité s’est enfin prononcée en faveur des qualités gouvernementales de Catherine, il ne faudrait pourtant pas exagérer l’admiration qui peut lui être due, en refusant systématiquement de croire aux défauts qui caractérisèrent cette nature d’élite. Ceci m’amène nécessairement à une digression.
Depuis quelques années, des médecins-historiens se plaisent à établir des diagnostics rétrospectifs, dont quelques-uns tentent à réhabiliter Catherine de Médicis d’une part des crimes que lui imputèrent ses contemporains. À quatre siècles de distance, sans hésitation, ces praticiens nécrophores appliquent en pensée leur oreille sur la poitrine de la reine de Navarre et déclarent sentencieusement qu’elle n’est pas morte d’une action toxique, mais tout simplement d’une pleurésie d’origine tuberculeuse. Quant au cardinal de Châtillon, ils nous le montrent, avec une assurance audacieuse, mourant d’un ulcère de l’estomac.
Loin de moi la pensée d’encourager la multiplication des erreurs historiques, ou de blâmer ceux de mes confrères qui essayent de les détruire. Il y a tant d’historiens dont le but est uniquement de flatter l’opinion préconçue du populaire, ou de faire l’œuvre d’un parti quelconque, qu’il faut au contraire féliciter ceux qui ont le courage d’enrayer la propagation de ces turpitudes intéressées. Mais entre l’impartiale mise au point d’un fait, basée sur des sources authentiques d’archives, et une fantaisiste version médicale établie d’après l’interprétation conventionnelle d’un texte, il y a un écart considérable, marqué par une sorte de forfanterie dont les chercheurs sérieux ne seront jamais dupes.
Nier la criminalité et la superstition de Catherine de Médicis, c’est absolument nier l’esprit de l’époque dont elle devait inéluctablement subir l’ambiance. D’ailleurs une telle négation ne rehausse en rien la valeur de cette reine qui ne fut ni plus superstitieuse, ni moins criminelle que les autres grandes figures de son temps. Mais plus que d’autres, elle eut l’occasion de mettre en pratique ces deux forces ordinairement sournoises : le fer et le poison.
Que l’on ait exagéré les conséquences de ses actes mystérieux, cela n’est pas douteux. Il y avait là un terrain excellemment propice aux colères huguenotes, terrain que surent cultiver des pamphlétaires violents comme Henri Estienne. Cependant, il faut reconnaître que dans tout pamphlet, comme dans toute légende, il y a un fond de vérité évidemment difficile à démêler de la fiction. Car, les pamphlétaires, chroniqueurs et mémoristes qui nous ont transmis les défaillances intimes et les bizarreries morales de certains personnages célèbres, n’ont jamais écrit sans partialité. Soit en admiration, soit en haine, la vérité est presque toujours altérée, et Catherine de Médicis ne devait pas échapper à cette loi des préventions humaines.
Pour l’historien consciencieux et de bonne foi, il est donc indispensable de vérifier attentivement les textes imprimés traitant d’un même sujet, de les comparer entre eux et de recourir toujours aux pièces manuscrites des archives diplomatiques, seules sources vraiment authentiques de l’histoire.
Comme dans mes ouvrages antérieurs, telle est la méthode que je me suis efforcé d’appliquer à l’élaboration du présent livre, en y apportant tout l’inédit possible, toute la minutie, toute la tolérance et la sincérité nécessaires à la solidité d’une œuvre documentaire, et à la mise en lumière d’une physionomie aussi mystérieusement personnelle que cette mère de trois rois, qui fut certes bien italienne par naissance, mais surtout bien française par orgueil et par autocratique principe.
EUGÈNE DEFRANCE.
Après la marche triomphale de Florence à Livourne, après le versement effectué par Philippe Strozzi des 1 200 livres d’or qui constituaient la dote de Catherine, après le cadeau de noces du Pape Clément VII, cadeau de 100 000 ducats en bijoux et pierres précieuses, après l’apport des comtés d’Auvergne et de Lauraguais, le mariage du futur Henri II, second fils de François 1er, Henri duc d’Orléans, avec Catherine de Médicis, fut célébré à Marseille le 28 octobre de l’année 1533.
Henri, âgé de quatorze ans, n’avait que vingt jours de plus que sa femme. En dépit du jeune âge des deux époux, François Ier tenait à être assuré de la consommation du mariage de son fils ; et le pape Clément VII, oncle de Catherine, ne voulait pas quitter Marseille sans avoir la même certitude.
Donc, le 28 octobre au soir, « le festin terminé, dit un témoin oculaire, le pape s’est retiré. Le roi s’est aussi retiré en habit de masque. La reine, avec toutes les demoiselles d’honneur, a accompagné la sérénissime duchesse en sa chambre, où était préparé un lit si riche, qu’il est estimé soixante mille écus ; la chambre où était le lit était toute tapissée de brocart… C’est ainsi qu’ils ont dormi ensemble la nuit dernière, et qu’a été consommé le mariage. Le matin, Sa Sainteté est allée les visiter au lit de bonne heure, et les a trouvés tous deux très dispos. Notre seigneur [le pape] est aussi joyeux que je l’ai jamais vu, ainsi que le roi et toute la cour ».
Dès le temps même, d’aucuns prétendirent que François Ier aurait poussé la curiosité plus loin encore que Clément VII : « Quand on eut fini de danser et que chacun fut retourné dans ses appartements, dit l’ambassadeur de Milan, le roi voulut lui-même mettre au lit les époux, et quelques-uns disent qu’il les voulut voir joûter, et que chacun d’eux fût vaillant à la joûte. »
Balzac nous dit que des faiseurs d’anecdotes, contemporains de cette union, assurent que Clément VII attendit patiemment jusqu’au 12 novembre les preuves physiologiques de la fécondité de sa nièce. Mais son attente ayant été vaine, au moment de quitter Marseille pour se rendre à Civita-Vecchia, Clément dit à Catherine en manière de consolation : A figlia d’ingannonon manca mai la figlinolanza, c’est-à-dire qu’à fille d’esprit, jamais la postérité ne manque.
Le souhait formulé par Clément VII n’était certes pas près de sa réalisation. Dix années devaient s’écouler avant que Catherine, devenue dauphine, put donner un successeur à la couronne qu’allait porter son époux. Les difficultés de sa situation se compliquèrent bientôt de cette stérilité, dit Dandolo, et la maîtresse en titre de son mari, Diane de Poitiers, pensa un moment à la faire répudier. L’ambassadeur vénitien Contarini confirme ce bruit de cour et le complète par certains détails dignes d’intérêt :
« À la mort du dauphin (1536), dit-il, comme on doutait que Catherine de Médicis pût jamais avoir d’enfants, le bruit se répandit que François Ier désirait un divorce, espérant peut-être tirer parti d’une autre alliance. Catherine para ce coup avec son habileté habituelle. Allant trouver le roi, elle lui dit qu’elle avait appris qu’il avait l’intention de donner une autre femme à son fils, et puisque Dieu ne lui avait pas fait la grâce d’avoir des enfants, du moment qu’il ne plaisait pas à Sa Majesté d’attendre davantage, il était bien convenable de pourvoir à la succession d’un si grand royaume ; quant à elle, se rappelant ce qu’elle devait au roi pour l’avoir choisie, elle était prête à subir la grande douleur qui lui en viendrait, plutôt que de contrarier sa volonté, toute disposée à entrer en un monastère, ou à rester au service de celle qui aurait la fortune d’être la femme de son mari ; tout cela entrecoupé de larmes et de sanglots. François Ier, d’humeur généreuse et facile, en fut si touché, qu’il lui dit avec émotion : « Ma fille, puisque Dieu a voulu que vous soyez ma bru et la femme du dauphin, je ne veux pas qu’il en soit autrement, et peut-être Dieu voudra-t-il bien se rendre à vos désirs et aux nôtres. »
Henri Estienne, écrivant quatorze ans plus tard, en 1574, se fait aussi l’écho de cette répudiation projetée : « Comme estant sur le point d’estre répudiée et renvoyée en Italie, tant à cause que la nature l’avoit condamnée à ne porter jamais enfants, que pour apparence de son mauvais naturel, elle gaigna la grande sénéchale, depuis duchesse de Valentinois (Diane de Poitiers) afin qu’icelle l’entretinst en grâce avec Monsieur le dauphin son mary, et n’eût honte d’estre ainsi come maquerelle pour parvenir à son intention. »
Il est certain que Catherine finit un jour par vivre en parfait accord avec la maîtresse de son mari ; mais il n’en avait pas toujours été ainsi, et une lettre d’un ancien serviteur de Marguerite d’Angoulème, sœur de François Ier, nous renseigne plus amplement sur les machinations de Diane de Poitiers au sujet de la répudiation de Catherine. Voici en quels termes, Villemadon rappelait la chose à la reine en août de l’année 1559 :
« Je commencerai par vous dire que régnant, le feu roi François et étant le feu roi luy dauphin revenu du Piémont où il s’oublia tant que de commettre un ord et sal adultère par le Conseil et conduite de certains mignons méchants et infidèles serviteurs, et par lesquels d’abondant la misérable grande sénéchale, Diane de Poitiers, public et commun réceptacle de tant d’hommes paillards et effrénés qui sont morts, ou qui vivent encore, lui fut introduite comme une bague dont il apprendroit beaucoup de vertu ; et depuis que les nouvelles furent venues que la bâtarde était née du susdit adultère, vous fûtes mise sur les rangs par les susdits moqueurs et la vieille mérétrice qui vous déclarèrent entre eux incapable de telle grandeur et honneur d’être femme d’un dauphin de France, parce que vous n’auriez jamais d’enfants, puisque vous mettiez tant de temps à en porter, vue qu’il ne tenait pas à votre mari de n’en pas avoir. »
Catherine de Médicis ressentait une telle haine à l’adresse de Diane de Poitiers, qu’un jour elle manifesta le désir de la faire vitrioler par Jacques de Savoie, duc de Nemours. C’est l’Aubespine, l’un des quatre secrétaires d’État, qui nous conte le fait au sujet d’une lettre que ce dernier, convaincu de menées pour enlever le pouvoir à la reine, lui adressa afin d’obtenir son pardon :
« La reyne a bien ri. dit l’Aubespine à son frère, évêque de Limoges, quand elle a vu dessus la lettre de M. de Nemours ces lignes marquées, se souvenant qu’elle le vouloit employer lorsque Mme de Valentinois la fâchoit tant à luy faire jeter par luy d’une eau forte distillée, comme par manière de jeu, sur le visage, de quoy elle fût toute sa vie demeurée défigurée, et ainsi pensait de en retirer le feu roy son mari ; ce qui ne fut pas fait, car elle y pensa depuis. Bruslez ceste lettre après l’avoir lue, s’il vous plaist. »
Si la répudiation a été évitée, si Catherine a su établir son autorité de dauphine, si aux sarcasmes de l’entourage royal elle a su répondre par une habileté plus efficace que des actions de haine, cette stérilité est quand même pour son orgueil et pour son amour un tourment obsesseur. D’abord elle se livre aux médecins ordinaires de la cour, et leur ignorance la jette bientôt dans le domaine des grands mystères auxquels, par atavisme de famille et de race, elle est étroitement attachée. Elle consulte les devins, elle se fait préparer des philtres, elle évite de voyager à dos de mulet, parce que cet animal, réputé infécond, communique sa stérilité aux femmes qui le montent. Aux consultations des tarots, se joignent les breuvages magiques et les potions médicinales de tous genres :
« La sérénissime dauphine, dit l’ambassadeur vénitien Matteo Dandolo, est d’une bonne complexion, sauf en ce qui regarde les qualités physiques propres à en faire une femme à enfants, « donna di fîgluoli » ; non seulement elle n’en a point encore, mais je doute qu’elle en doive jamais avoir, bien qu’elle ne manque point d’avaler toutes les médecines capables d’aider la génération, d’où je conclus qu’elle court de grands risques d’augmenter son infirmité plutôt que d’y porter remède. Elle est aimée et chérie du dauphin ; d’après les plus grands indices, Sa Majesté l’affectionne aussi et de même la cour et le peuple, à ce point d’ailleurs que j’estime qu’il n’y a personne qui ne voudrait se laisser se tirer du sang pour lui faire avoir un fils et . »
C’est ici qu’entre en scène un infatigable et savant médecin, Jean Fernel, qui sacrifia à la science médicale et aux mathématiques sa fortune, ses plaisirs et sa santé, avec une conviction et un désintéressement exemplaires. Les malades affluaient chez lui en si grand nombre, que souvent il était obligé de dîner debout, écoutant tous ses consultants, riches ou pauvres, avec patience et politesse. La renommée qui s’était bientôt établie autour de son nom parvint jusqu’au dauphin de France dont la maîtresse, Diane de Poitiers, était alors gravement malade. Fernel triompha par l’heureuse guérison de Diane, et ce fut le début de l’estime que Henri II lui accorda toute sa vie.
L’ardeur que Jean Fernel apportait au travail l’obligea à refuser la place de premier médecin du dauphin dont ce prince voulait l’honorer, ce qui l’aurait naturellement retiré de ses travaux et séparé de ses élèves. Henri consentit difficilement à laisser l’indépendance à l’illustre praticien, et pour lui témoigner l’étendue de sa considération, il exigea que Fernel touchât, quand même, les honoraires de la place refusée.
Après plusieurs autres tentatives également inutiles de la part de Henri, Fernel n’accepta cette situation qu’à la mort de son confrère, Louis de Bourges, qui avait été le premier médecin de François Ier. Mais ce fut bien avant cette époque que Jean Fernel fut consulté par Henri II sur la stérilité de Catherine de Médicis. Si l’on en croit Isaac Bullart, le dauphin avait, d’une singulière façon, demandé à Fernel d’examiner la dauphine : « Monsieur le Médecin, aurait-il dit, feriez-vous bien des enfants à ma femme ? »… ce à quoi Jean Fernel aurait sagement répondu : « C’est à Dieu, Sire, à vous donner des enfants par sa bénédiction ; c’est à vous à les faire et à moi à y apporter ce qui est de la médecine ordonnée de Dieu pour le remède des infirmités humaines. »
À l’appui de Bullart, Varillas rapporte le remède que Jean Fernel aurait soi-disant prescrit à Henri II pour sa femme : « Le peuple étoit persuadé, dit-il, que la reine-mère, après dix ans de stérilité, n’avoit conçu le roi (François II) que parce que le premier médecin Fernel avoit conseillé à Henri second de coucher avec elle durant ses ordinaires, et que les personnes engendrées de la sorte étoient sujettes à cette honteuse maladie (la lèpre). » Et Mézeray constate qu’en effet « François II avoit été, dès sa naissance, de complexion malsaine, étant le premier enfant d’une mère qui avoit eu ses purgations bien tard. »
Le savant médecin calviniste Antoine Menjot est aussi de l’avis de Varillas. De plus, dans une dissertation physiologique un peu naïve, il nous explique pourquoi et comment Catherine de Médicis n’était susceptible d’engendrer qu’à certaines époques déterminées : « Catherine de Médicis, dit-il, n’étoit stérile que par une trop grande sécheresse de l’utérus, ou que pour être trop serrée dans cette partie. Au premier cas, la semence rencontrant une terre trop aride, ne pouvoit fructifier. Au second cas, elle ne parvenoit point où elle devoit. Or, comme pendant le cours des ordinaires





























