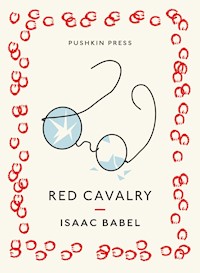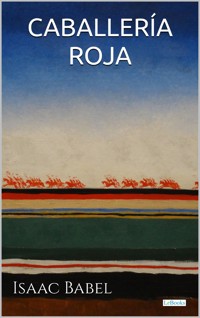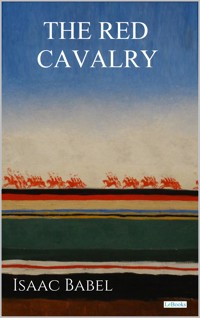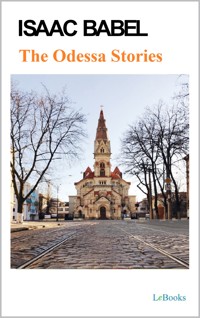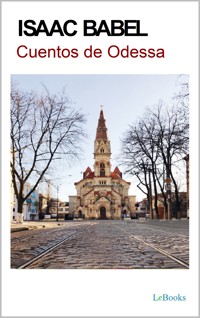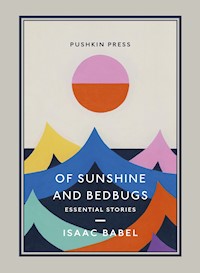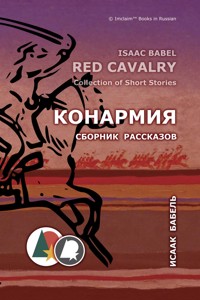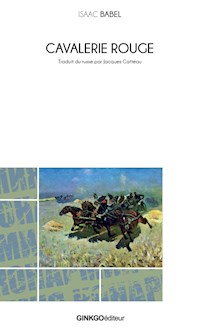
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Traduction intégrale avec notes et étude, et avec les Récits du cycle de Cavalerie rouge, des fragments du Journal de 1920, les Plans et esquisses, par Jacques Catteau.
Entré en 1920 dans l'Armée rouge, Isaac Babel participa avec la 1ère Armée de Cavalerie soviétique de Boudienny à la guerre contre les Blancs aux frontières de la Pologne. Il retraça cette épopée tragique et violente à travers une série de courts récits, publiés en revue et réunis en 1926. Un des chefs-d’œuvre de la littérature de guerre.
« On ne saurait trouver nulle part une évocation plus cruelle, plus sauvagement belle, d'une époque extraordinaire où les pires horreurs prennent un aspect presque quotidien. Grâce à l'art de Babel, les atrocités et les scènes les plus répugnantes revêtent une grandeur épique. » (André Pierre)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petite Bibliothèque slave
— Collection dirigée par Xavier Mottez —
Isaac BabelБабель Исаак Эммануилович1894-1940
CAVALERIE ROUGEКонармия
suivi des Récits du cycle de « Cavalerie rouge »des fragments du Journal de 1920des Plans et esquisses
TRADUCTION DU RUSSENOTES ET ÉTUDEDE JACQUES CATTEAU
GINKGOéditeur
Couverture : Mitrophan GREKOV, Tatchanka (1925)
© Ginkgo Editeur, 2023
© Jacques Catteau, 1972, 1983, 1986, 2023
Avertissement du traducteur
La présente traduction suit l’édition princeps de Cavalerie Rouge, celle de 1926. Dès 1929, la Censure s’armait de ses ciseaux et émondait le texte original. Même les éditions postérieures à la réhabilitation d’Isaac Babel (1954), celle de 1957 préfacée par Ilya Ehrenbourg et la dernière, celle de 1966, ont maintenu ces coupures. Trois préoccupations ont apparemment guidé les censeurs : la politique, toute allusion à Trotski est biffée, la puritaine, tous les passages un tant soit peu érotiques sont voilés, enfin la nationaliste, les rares observations acides de l’écrivain sur le peuple russe sont gommées. En revanche, les quelques variantes de mots isolés semblent le fait de l’auteur lui-même ou le résultat d’une mauvaise lecture du texte primitif. Les passages incriminés encore aujourd’hui sont entre crochets [ ]. Qu’on ne voie là que probité envers le beau texte et désir de proposer au lecteur slaviste qui dispose seulement d’une édition récente en russe, un ouvrage précis et entier.
Les notes explicatives, nullement indispensables à la compréhension immédiate, détruisent souvent le plaisir de lire : elles ont été volontairement rejetées à la fin de l’ouvrage où le lecteur curieux pourra les consulter.
Cavalerie rouge (1)
LA TRAVERSÉE DU ZBROUTCH (2)
Le commandant de la 6me division (3) a fait rapport de la prise aujourd’hui, à l’aube, de Novograd-Volynsk (4). L’état-major a quitté Krapivno et notre train des équipages, criarde arrière-garde, s’est étiré le long de [l’inflétrissable]voie qui va de Brest à Varsovie (5), ossuaire des moujiks qui la construisirent sous Nicolas Ier.
Des champs pourpres de pavots fleurissent autour de nous, le vent de midi joue dans le seigle jaunissant, le sarrazin virginal s’élève à l’horizon comme la muraille d’un lointain monastère. La douce Volhynie se tord, la Volhynie nous échappe dans la brume emperlée des boulaies, escalade en rampant des collines diaprées de fleurs et enchevêtre ses bras exsangues dans les tortils des houblonnières. Un soleil orange roule dans le ciel comme une tête coupée, une clarté douce flamboie dans les crevasses des nuages noirs et les étendards du couchant flottent sur nos têtes. L’odeur du sang d’hier et des chevaux tués goutte dans la fraîcheur du soir. Le Zbroutch qui a viré au noir, bruit et tord les nœuds écumants de ses rapides. Les ponts sont détruits et chevaux et attelages traversent à gué. Une lune majestueuse s’étale sur les flots. Les chevaux s’enfoncent jusqu’à la croupe dans l’eau, des déluges sonores s’épanchent entre les centaines de jambes. Quelqu’un se noie et agonit de jurons retentissants la mère de Dieu. Le fleuve est parsemé des carrés noirs des télègues, le fleuve s’emplit de rumeur, de sifflets et de chansons qui grondent au-dessus des serpents de lune et des fosses de lumière.
Dans la nuit avancée, nous arrivons à Novograd. Je trouve dans l’appartement qu’on m’a assigné une femme enceinte et deux Juifs roux, aux cous minces ; un troisième dort, la tête enfouie sous une couverture, blotti contre le mur. Je trouve dans la chambre qu’on m’a assignée des armoires défoncées, des lambeaux de pelisses de femme sur le plancher, des excréments humains et des tessons de la vaisselle précieuse que les Juifs utilisent une fois l’an, pour la Pâque(6).
— Enlevez-moi ça –, dis-je à la femme –, vous vous plaisez dans la crasse, bonnes gens...
Les deux Juifs quittent leur place. Ils bondissent sur leurs semelles de feutre et ramassent les débris, ils bondissent en silence, simiesques comme les Japonais au cirque ; leurs cous gonflent et pivotent. Ils m’installent sur le sol une couette éventrée et je me couche, tourné vers la cloison, près du troisième juif qui dort. La misère craintive se referme [aussitôt]au-dessus de ma couche.
Tout est englouti dans le silence, seule la lune enserrant de ses mains bleues sa tête ronde, brillante et insouciante, rôde sous la fenêtre.
Je dégourdis mes jambes enflées, allongé sur ma couette éventrée, je m’endors. Je rêve du commandant de la 6me division. Il pourchasse sur un étalon pesant le commandant de brigade et lui loge deux balles dans les yeux. Les balles lui traversent la tête et les deux yeux tombent à terre. « Pourquoi as-tu fait tourner bride à la brigade ? » crie Savitski, le commandant de la 6me division, au blessé... C’est alors que je me réveille : la femme enceinte palpe mon visage dans l’obscurité.
— Pane, (7) me dit-elle, vous criez en rêvant et vous vous agitez. Je vais faire votre lit dans un autre coin car vous bousculez mon papa...
Elle lève au-dessus du plancher ses jambes maigres et son ventre rond. Elle ôte la couverture : un mort, un vieillard gît à la renverse. La gorge est béante, le visage fendu par le milieu, du sang bleu s’est figé dans la barbe, comme un morceau de plomb.
— Pane, dit la juive, toute en secouant la couette, les Polonais étaient à l’égorger et lui, il les suppliait : tuez-moi dans la cour de derrière pour que ma fille ne me voie pas mourir ! Mais ils ont fait comme ça les arrangeait. Il est mort dans cette chambre en pensant à moi. Et maintenant, je veux savoir, dit soudain la femme avec une force terrible, je veux savoir où vous trouveriez par toute la terre un père tel que le mien...
[Novograd-Volynsk, juillet 1920]
L’ÉGLISE DE NOVOGRAD (8)
Hier j’étais allé faire mon rapport au commissaire politique aux armées qui s’était installé dans la maison d’un prêtre catholique en fuite. Dame Élise, la gouvernante du jésuite, m’avait accueilli dans la cuisine. Elle m’avait donné du thé ambré et des biscuits. Ses biscuits sentaient le crucifix. Une sève maligne les imprégnait, la fureur odoriférante du Vatican aussi.
À côté du presbytère, dans l’église mugissaient les cloches sonnées par un carillonneur pris de démence. C’était un soir plein d’étoiles de juillet. Dame Élise, secouant ses mèches attentives et grises, me gavait de gâteaux secs et je savourais la provende des jésuites.
La vieille Polonaise m’appelait pane, sur le seuil, des vieillards gris aux oreilles ossifiées se tenaient au garde-à-vous et là-bas, dans une pénombre reptile ondulait la soutane d’un moine. Le curé s’était enfui mais il avait laissé son vicaire, Romuald.
Castrat nasillard au corps de géant, Romuald nous donnait du « Camarades ». Il promenait son doigt jaune sur la carte et cernait les zones dévastées de Pologne. Pris d’un enthousiasme éraillé, il énumérait les blessures de sa patrie. Qu’un humble oubli engloutisse la mémoire de Romuald qui nous trahit implacablement et qui fut fusillé au passage ! Mais ce soir-là sa soutane étriquée s’agitait aux plis des portières, balayait furieusement tous les couloirs et souriait silencieusement à tous ceux qui voulaient boire de la vodka. Ce soir-là, l’ombre furtive du moine ne me lâchait pas. Il aurait fait un évêque, Romuald, s’il n’avait été un espion.
Je buvais du rhum avec lui, le souffle d’un mode de vie mystérieux palpitait et vacillait sous les ruines du presbytère et ses séductions doucereuses me laissèrent sans force. Ô crucifix, minuscules comme des talismans de prostituées, parchemins des bulles papales et satin des lettres de femmes, qui se décomposaient dans la soie bleue des gilets !...
Je te vois d’ici, moine infidèle en soutane violette, je vois la bouffissure de tes mains, et ton âme tendre et implacable comme celle d’un chat, je vois les plaies de ton dieu d’où sanguinole la semence, poison parfumé qui grise les vierges.
Nous buvions du rhum en attendant le commissaire mais il n’était toujours pas revenu de l’état-major. Romuald s’affala dans un coin et s’endormit. Il dort et tressaille tandis que, par la fenêtre, dans le jardin, l’allée chatoie sous la passion noire des cieux. Des éclairs verts fulgurent sur les coupoles. Un cadavre dévêtu traîne au bas du talus. Et l’éclat de la lune ruisselle le long de ses jambes mortes et déjetées.
Voici la Pologne, voici l’altière affliction de la Rzeczpospolita (9) ! Étranger amené par la violence, je jette à terre un matelas pouilleux dans le temple abandonné par son serviteur, je glisse sous ma tête des in-folio où l’on peut lire des hosannas adressés à sa Très Haute et Lumineuse Seigneurie, Joseph Pilsudski.
Ô Pologne, des hordes de gueux déferlent sur tes vieilles cités, l’hymne d’union de tous les serfs gronde au-dessus d’elles. Malheur à toi, Rzeczpospolita ! Malheur à toi, prince Radziwill (10) et à toi, Prince Sapieha (11), les insurgés d’un instant !...
Mon commissaire politique n’est toujours pas là. Je le cherche à l’état-major, dans le jardin, dans l’église. Ses portes sont ouvertes, j’entre, et là devant moi, deux crânes d’argent flamboient sur le couvercle d’un tombeau brisé. Saisi d’effroi, je me jette dans la crypte. De là un escalier de chêne mène à l’autel. Et je vois de nombreuses lumières qui courent dans les hauteurs juste sous la coupole. Je vois le commissaire politique, le chef de la Section Spéciale (12) et les cosaques... cierges en main. Ils font écho à mon faible cri et me conduisent hors de la crypte.
Les crânes qui n’étaient que sculptures de catafalque ne me font plus fuir et tous ensemble nous poursuivons la perquisition, car c’en était une, entreprise à la suite de la découverte de monceaux d’équipements militaires dans le logement du prêtre.
Rutilant des gueules de chevaux cousues sur nos soutaches, échangeant des chuchotements et tintant des éperons, nous tournons dans l’édifice sonore et la cire coule sur nos mains. Les Vierges, aux parures de pierres précieuses, suivent notre chemin de leurs prunelles roses comme celles des souris, la flamme palpite dans nos doigts refermés et des ombres angulaires se tordent convulsivement sur les statues de saint Pierre, de saint François et de saint Vincent, sut leurs petites joues vermeilles et leurs barbes frisotées, enluminées de carmin.
Nous tournons et nous cherchons. Des boutons d’os sautent sous nos doigts, s’écartent des icônes fendues par le milieu, découvrant des souterrains menant à des antres où fleurit la moisissure. L’église est ancienne et pleine de secrets. Elle dissimule dans ses murs luisants des passages cachés, des niches et des vantaux qui silencieusement s’entrouvrent,
Ô prêtre stupide qui a suspendu aux clous du Sauveur les soutien-gorge de ses paroissiennes ! Franchi l’iconostase, nous avons trouvé une valise remplie de pièces d’or, un sac en maroquin plein de billets de banque et des écrins de joailliers parisiens renfermant des bagues aux chatons sertis d’émeraude.
Et puis nous avons compté l’argent dans la chambre du commissaire politique. Piles de pièces d’or, tapis de billets, rafales de vent soufflant sur les flammes des bougies, démence de corneille dans les yeux de Dame Élise, rire tonitruant de Romuald et l’incessant mugissement des cloches sonnées par pane Robatski, le carillonneur pris de folie...
— Fuis, me dis-je, fuis ces madones qui lancent des œillades, ces madones déjouées par des soldats...
LA LETTRE (13)
Voici la lettre au pays que me dicta un gamin de notre expédition, Kourdioukov. Elle mérite d’être sauvée de l’oubli. Je l’ai recopiée sans l’orner et je la cite mot pour mot, telle qu’elle est en vérité.
« Maman bien-aimée, Eudoxie Fiodorovna. Dans les premières lignes de cette lettre (14), je m’empresse de vous faire savoir que, grâce au Seigneur, je suis en vie et en bonne santé, j’espère que vous me direz de même pour vous. Et qu’aussi je vous salue bien bas, de mon visage clair jusqu’à la Terre Humide (15)... (suit l’énumération des parents, parrain, marraine, compère et commère. Passons et voyons le deuxième alinéa.)
« Maman bien-aimée, Eudoxie Fiodorovna Kourdioukova. Je m’empresse de vous écrire que je me trouve dans la Cavalerie Rouge du Camarade Boudionny et que se trouve aussi ici votre compère Nikon Vassilitch qui est présentement héros de l’Armée Rouge. Il m’a pris avec lui dans l’expédition de la Section Politique où nous livrons aux avant-postes la littérature et les journaux : les Izvestia du C.C.E. (16)de Moscou, la Pravda de Moscou et notre cher et inexorable journal Le Cavalier Rouge que tout combattant aux avant-postes souhaite lire et, puis après, plein d’un courage héroïque, il sabre les infâmes nobliaux polonais et puis que je mène une vie très magnifique près de Nikon Vassilitch.
« Maman bien-aimée, Eudoxie Fiodorovna. Envoyez-moi ce que vous pouvez, ce qui est en votre force et possibilité. Je vous prions d’égorger le goret tacheté et de me faire un colis à la Section Politique du Camarade Boudionny, adressé à Basile Kourdioukov. Chaque jour qui passe, je me couche à l’heure de repos sans avoir mangé et sans rien pour me couvrir, si bien qu’on a sacrément froid. Écrivez-moi une lettre rapport à Stepa (17), s’il est en vie ou pas, je vous prions de le passer à la revue et écrivez-moi pour lui s’il continue à s’entretailler ou si c’est fini, et aussi rapport à la gale dans les jambes de devant, si on l’a ferré ou pas. Je vous prions, maman bien-aimée, Eudoxie Fiodorovna, de lui laver sans faute les jambes de devant avec le savon que j’ai laissé derrière les icônes et si papa a liquidé le savon, alors achetez-en à Krasnodar et que Dieu vous garde. Je peux vous décrire aussi que le pays de par ici est tout à fait pauvre, que les paysans avec leurs chevaux s’enterrent dans les forêts pour fuir nos Aigles Rouges, qu’à ce qu’on voit, il y a peu de blé, que le grain en est terriblement menu, même que ça nous fait rire. Les gens du coin sèment du seigle et pareillement de l’avoine. Le houblon pousse par ici sur des rames, de sorte que ça fait bien régulier. Et le houblon on le bouille.
« Dans les lignes suivantes de cette lettre je m’empresse de vous décrire que papa, il a sabré mon frère Fiodor Timoféitch(18)Kourdioukov, il y a environ un an de ça. Notre brigade rouge du camarade Pavlitchenko marchait sur la ville de Rostov quand dans nos rangs une trahison eut lieu. Et papa à c’t’époque-là était chez Dénikine comme commandant de compagnie. Les ceusses qui l’avaient vu racontaient qu’il portait des médailles comme sous l’ancien régime. Et à la suite de cette trahison, on nous a tous fait prisonniers et mon frère Fiodor Timoféitch est tombé dans le regard à papa. Et papa s’est mis à tabasser Fédia en disant : roulure, chien de Rouge, fils de chienne et du même genre et il l’a tabassé jusqu’au soir, tant que mon frère Fiodor Timoféitch n’a pas été mort. J’ai alors écrit une lettre pour vous dire que votre Fédia reposait sans croix. Mais papa m’a chopé avec la lettre et a dit – vous êtes des enfants de pute, de ses graines, à elle, vous êtes une engeance de traînée, j’ai engrossé votre mère et je l’engrosserai encore, ma vie est fichue, j’anéantirai au nom de la vérité ma semence et autre chose encore. J’ai accepté les souffrances qui me venaient de lui comme Jésus-Christ notre Sauveur. Seulement j’ai filé au plus vite et j’ai fait ma jonction avec mon détachement du Camarade Pavlitchenko. Et notre brigade a reçu l’ordre de se rendre à la ville de Voronej pour être recomplétée et là nous avons eu le complément et aussi des chevaux, des musettes, des revolvers Naguan (19) et tout ce qu’il fallait pour nous. Rapport à Voronej je peux vous décrire, maman bien-aimée, Eudoxie Fiodorovna, que cette ville est très magnifique, peut-être plus grande que Krasnodar. Les gens y sont très beaux, la rivière est apte pour la baignade. On nous a donné du pain, deux livres par jour, une demi-livre de viande et du sucre, pas mal, si bien qu’après le lever, on buvait son thé sucré, et pareillement à la veillée, et on oubliait qu’on avait eu faim, et pour le repas, j’allais chercher des crêpes et de l’oie chez mon frère Siméon Timoféitch, et puis après je me couchais à l’heure du repos. À c’t’époque-là tout le régiment voulait avoir Siméon Timoféitch comme commandant à cause de sa témérité et même que l’ordre est venu du camarade Boudlonny, et il a touché deux chevaux, une tenue tout ce qu’il y a de bien, une télègue pour mettre son fourbi à lui tout seul, et l’ordre du Drapeau Rouge et moi j’étais rattaché à lui, comme frère. À c’t’heure, si un voisin se met à vous faire des avanies, Siméon Timoféitch peut fort bien lui couper le cou. Après nous avons commencé à poursuivre le Général Dénikine, on les a sabrés par mille et on les a rejetés dans la Mer Noire, mais seulement on ne voyait papa nulle part et Siméon Timoféitch le recherchait à tous les postes de combat parce qu’il s’ennuyait beaucoup de son frère Fédia. Mais seulement, maman bien-aimée, tout comme vous connaissez papa et son caractère têtu, tout comme il a fait : il avait insolemment teinté sa barbe rousse avec un noir jais et il se trouvait dans la ville de Maïkop, avec des frusques de péquin, si bien que personne parmi les habitants ne savait qu’il était justement Garde rural, tout ce qu’il y a de plus Garde rural sous l’ancien régime. Mais seulement, la vérité, elle finit toujours par se montrer, votre compère Nikon Vassilitch l’a aperçu par hasard dans la bourrine (20)d’un habitant et a écrit une lettre pour Siméon Timoféitch. Nous montîmes à cheval et parcourîmes deux cents verstes, moi, mon frère Senka et les cosaques du village qui en avaient envie.
« Et qu’est-ce que nous avons vu dans la ville de Maïkop ? Nous avons vu que l’arrière ne sympathise pas du tout avec le front et que partout c’est la trahison, que c’est rempli de youpins comme sous l’ancien régime. Et Siméon Timoféitch dans la ville de Maïkop a rudement querellé les youpins qui ne voulaient pas relâcher papa et l’avait mis en prison, sous clef, en disant : « On a reçu l’ordre [du camarade Trotski] de ne pas massacrer les prisonniers, nous le jugerons nous-mêmes, ne vous fâchez point, il recevra son dû. »Mais seulement, Siméon Timoféitch, il a pris son dû et il a prouvé qu’il était commandant de régiment et qu’il avait reçu des mains du Camarade Boudionny tous les ordres du Drapeau Rouge et il menaça de sabrer tous ceux qui le querelleraient rapport à la personne de papa et qui ne la donneraient pas, et puis les cosaques de notre village ont menacé aussi. Mais seulement Siméon Timoféitch a obtenu papa et il s’est mis à lui filer des coups de fouet et il a rangé tous les combattants dans la cour, comme c’est stipoulé au règlement militaire. Et alors Senka (21)a flanqué à papa un seau d’eau sur la barbe et la teinture s’est mise à couler. Et Senka a demandé à Timothée Rodionytch :
— Vous êtes bien entre mes mains, papa ?
— Non, dit papa, je suis mal.
Alors Senka a demandé :
— Et Fédia, quand vous l’avez tabassé, il était bien entre vos mains ?
— Non, dit papa, Fédia était mal.
Alors Senka a demandé :
— Et vous avez pensé, papa, que vous aussi, vous serez mal un jour ?
— Non, dit papa, je n’ai pas pensé que je serai mal un jour.
Alors Senka s’est tourné vers le peuple et a dit :
— Et moi, je pense également que si je tombe aux mains des vôtres, papa, ils ne m’épargneront pas. Et maintenant, papa, on va vous finir... »
« Et Timothée Rodionytch s’est mis insolemment à agonir Senka d’injures où revenaient « Mère » et « La Vierge » et à taper Senka sur la gueule, et Siméon Timoféitch m’a renvoyé de la cour, si bien que je ne peux pas, maman bien-aimée Eudoxie Fiodorovna, vous décrire rapport à la manière qu’on a fini papa, vu que j’étais renvoyé de la cour.
Et puis nous avons pris notre cantonnement dans la ville de Novorossiisk. Pour cette ville on peut raconter qu’après elle il n’y a plus aucune terre sèche mais que de l’eau, la Mer Noire, et nous sommes restés là jusqu’en mai quand nous sommes partis pour le front polonais où nous flanquons une tannée aux nobliaux du coin que c’est pas de la frime...
Je demeure votre fils bien aimé, Basile Timoféitch Kourdioukov. Bonne maman, jetez un œil à mon Stepa, et que Dieu vous garde. »
Voici la lettre de Kourdioukov. Pas un mot n’a été changé. Quand je l’eus terminée, il prit le feuillet couvert d’écriture et le cacha contre sa poitrine, à même la peau.
— Kourdioukov, demandai-je au gamin, ton père avait sale caractère ?
— Mon père était un dogue, répondit-il d’un ton maussade.
— Et ta mère, elle était mieux ?
— Ma mère, ça pouvait coller. Tiens, si tu veux, voici notre famille...
Il me tendit une photographie cassée. On y voyait Timothée Kourdioukov, garde rural aux larges épaules, en casquette d’uniforme, barbe bien peignée, pommettes saillantes, immobile, regard étincelant des yeux pâles et vides. À côté, dans un pauvre fauteuil de bambou, était assise une paysanne toute petite, au corsage avachi, aux traits flétris, lumineux et humbles. Et sur le mur, sur le fond pitoyable de cette photographie de province, à fleurs et à pigeons, se dressaient deux gaillards, monstrueusement énormes, obtus, à la face épaisse, aux gros yeux, figés comme à l’exercice, les deux frères Kourdioukov, Fiodor et Siméon.
LE CHEF DE LA REMONTE (22)
Plane une plainte au-dessus du village. La cavalerie fourrage le blé et troque ses chevaux. En échange de leurs carnes fourbues, les cavaliers raflent les bêtes de trait. Qui les en blâmera ? Il n’y a pas d’armée sans chevaux.
Mais ça ne soulage guère les paysans de le savoir. La meute des paysans harcèle l’état-major.
Ils traînent au bout de longes, des rosses qui renâclent et glissent de faiblesse. Privés de leurs compagnons nourriciers, les moujiks sentant monter en eux le flux d’une bravoure amère, d’une bravoure qu’ils savent éphémère, se hâtent sans espoir aucun de déblatérer contre le commandement, contre Dieu et contre leur pitoyable sort.
Le chef de l’état-major J... est en uniforme, sur le perron. Protégeant ses paupières enflammées, il écoute, visiblement attentif, les réclamations des moujiks. Mais l’attention chez lui n’est autre qu’une attitude polie. Comme tout responsable discipliné et surmené, il sait aux instants creux de l’existence, arrêter complètement son activité cérébrale. Durant ces rares minutes de vacuité bénie et [bovine]pour l’esprit, le chef de l’état-major secoue la vieille machine usée.
Et aujourd’hui il en va de même avec les moujiks.
Sous l’accompagnement balsamique d’une rumeur décousue et folle de désespoir, J... observe, comme étranger, la naissance dans son cerveau d’un tohu-bohu amorti qui annonce la pensée pure et énergique. Survenu l’indispensable déclic, il attrape au vol un dernier pleur de moujik, pousse un coup de gueule autoritaire et retourne travailler à l’état-major.
Cette fois-ci, il n’a même pas eu à montrer les dents. Sur son destrier anglo-arabe à la robe de feu, a galopé jusqu’au perron Diakov, l’ancien écuyer de cirque promu aujourd’hui chef de la remonte, Diakov à la trogne rutilante, aux moustaches blanchies, à l’ample cape noire et aux soutaches d’argent courant le long des rouges chalvars.
— La bénédiction du saint homme aux honorables charognes, s’écria-t-il et brisant net son galop, il accula son coursier, et au même instant, juste sous son étrier, vint s’affaler une haridelle pelée, une de ces carnes troquées par les cosaques.
— Vois, camarade chef, se mit à brailler un moujik en se battant les cuisses... Tiens voilà ce que vous, les militaires, vous nous laissez à nous autres... T’as vu c’que c’est qu’on nous donne ? Essaie un peu de trimer avec ça...
— Mais pour ce cheval, commença alors Diakov, incisif et grave, pour ce cheval, respectable ami, tu es parfaitement en droit de toucher quinze mille roubles à la remonte, et si le cheval se montrait un peu plus enjoué, dans c’cas tu toucherais, cher vieux, vingt mille roubles à la remonte. Seulement que le cheval soit tombé, c’est pas un argument. Si le cheval qui est tombé se relève, c’est un cheval, si, à l’inverse, il ne se relève pas, alors c’est pas un cheval. Mais, soit dit en passant, cette brave petite jument avec moi va se relever...
— Ô Seigneur, ma Bonne Mère, toi qui es toute miséricorde ! s’exclama le moujik en levant les bras au ciel... Comment qu’elle se relèverait, la seulette... Elle va crever, la pauvrette...
— Tu fais offense au cheval, compère, répondit Diakov avec une profonde conviction. Compère, tu blasphèmes purement et simplement. Et avec prestance, il enleva de la selle son corps d’athlète bien bâti. Etirant des jambes splendides, prises aux genoux dans le cuir, souple et somptueux comme à la scène il s’avança vers la bête expirante. Languissamment, elle fixa Diakov de son œil profond, à fleur de tête, lécha dans sa paume enluminée comme un ordre caché et aussitôt, le cheval recru sentit qu’une vertu experte émanait de ce Roméo déjà blanchi, florissant et vert. Balançant sa tête et glissant sur ses jambes fléchissantes, sentant le chatouillement impérieux et impatient de la cravache sous le ventre, la haridelle lentement, attentivement se mettait debout. Et alors nous avons tous vu le poignet fin dans un envol de manche tapoter la crinière souillée et la cravache se coller dans un gémissement aux flancs sanguinolents. Tremblant de tout son corps, la rosse se tenait sur ses quatre jambes et ne quittait plus Diakov de ses yeux craintifs et amoureux, de ses yeux de chien.
— La preuve que c’est un cheval, dit Diakov au moujik et il ajouta radouci : et toi, cher vieux, tu rouspétais encore...
Et abandonnant les rênes de son coursier à son ordonnance, le chef de la remonte gravit d’un seul élan les quatre marches du perron et, dans une envolée de sa cape d’opéra, disparut dans les locaux de l’état-major.
[Beliov, juillet 1920]
APOLEK (23)
La merveilleuse et sage vie de pane Apolek m’a tourné la tête comme un vin vieux. À Novograd-Volynsk, dans la ville en un tournemain écrasée, parmi les ruines crochues, le destin a jeté sous mes pas un Évangile jusque-là celé du monde. Baigné de l’éclat ingénu des nimbes, j’ai fait alors le serment de suivre l’exemple de pane Apolek. Suavité d’une haine rêvée, mépris amer pour les chiens et les porcs de l’humanité, feu d’une grisante et muette vengeance, j’ai tout immolé à mon nouveau serment.
Dans la maison du curé de Novograd en fuite, une icône, haut placée sur le mur, portait l’inscription : « La mort de Jean le Baptiste ». Sans une hésitation, j’ai reconnu en ce saint Jean le portrait d’un homme que j’avais vu autrefois.
Je me souviens : entre les murs droits et clairs jouait l’arachnéenne quiétude d’un matin d’été. Au pied du tableau, par le soleil posé tombait un rayon rectiligne. Étincelait l’essaim de la poussière. Droit sur moi, des profondeurs bleues de la niche descendait la longue silhouette de saint Jean. Un noir manteau pendait solennellement sur ce corps inflexible et d’une maigreur repoussante. Des gouttes de sang brillaient sur les agrafes rondes de son manteau. La tête de Jean avait été tranchée à l’oblique du cou déchiré. Elle était posée sur un plat d’argile, solidement tenu par les gros doigts jaunes d’un guerrier. Le visage du mort m’évoquait quelqu’un. Le pressentiment d’un mystère m’effleura. Sur le plat d’argile reposait une tête morte peinte et copiée d’après celle de Romuald, le vicaire du curé en fuite. Du rictus figé pendait, scintillante diaprure d’écailles, le tronc minuscule d’un serpent dont la tête petite, d’un rose tendre et pleine de vie soulignait puissamment le fond sombre du manteau.
L’art du peintre et sa lugubre trouvaille me frappèrent d’admiration. D’autant plus étonnante me parut, le lendemain, la Vierge aux joues vermeilles que Dame Élise, la gouvernante du vieux curé, avait accrochée au-dessus du lit conjugal. Les deux toiles étaient signées du même pinceau. Le visage bien en chair de la Vierge, c’était le portrait de Dame Élise. Alors l’énigme des icônes de Novograd me parut presque résolue et elle me mena tout droit à la cuisine de Dame Élise où, par les soirs qui embaumaient, se réunissaient les ombres de la vieille Pologne serve, avec en tête un peintre fol-en-christ. Mais l’était-il fol, cet Apolek qui avait peuplé d’anges les villages d’alentour et canonisé le boiteux Ianek, un juif converti ?
Il était arrivé ici, en compagnie d’un aveugle, Gottfried, voilà trente ans, par un jour d’été comme les autres. Les deux amis, Apolek et Gottfried, approchaient de l’auberge de Schmerel, sise sur la grand’route de Rovno, à deux verstes de l’enceinte de la ville. De la main droite Apolek portait une boîte de couleurs, de la gauche, il guidait l’accordéoniste aveugle. Le pas chantant de leurs souliers allemands, ferrés et cloutés, résonnait de tranquillité et d’espérance. Du cou grêle d’Apolek pendait une écharpe jaune canari et trois plumettes chocolat se balançaient sur le chapeau tyrolien de l’aveugle.
Dans l’auberge les étrangers disposèrent sur le rebord de la fenêtre leurs couleurs et leur accordéon. Le peintre déroula son écharpe, interminable comme le ruban d’un escamoteur de foire. Puis il sortit dans la cour, se mit tout nu et inonda d’eau glacée son corps rose, étriqué et malingre. La femme de Schmerel apporta à ses hôtes de la vodka aux raisins de Corinthe et des croquettes de viande farcies de gruau et de sarrazin. Rassasié, Gottfried posa son accordéon sur ses genoux pointus. Il soupira, rejeta la tête en arrière et ses doigts maigres entrèrent en mouvement. Et les murs [enfumés]de l’estaminet juif répercutèrent des airs de Heidelberg. Apolek accompagnait l’aveugle d’une voix chevrotante. On eût dit qu’on avait apporté chez Schmerel les orgues de Sainte Indelghilde et que sur l’orgue s’étaient installées, côte à côte, des muses en écharpes ouatinées et bigarrées, et en souliers allemands, ferrés et cloutés.
Les hôtes chantèrent jusqu’au coucher du soleil, puis rangèrent dans des housses de toile l’accordéon et les couleurs, et Apolek, en s’inclinant profondément, remit à Braïna, la femme de l’aubergiste, une feuille de papier.
— Chère Madame Braïna, dit-il, acceptez d’un artiste vagabond, baptisé du nom chrétien d’Apollinaire, ce portrait de vous en signe de notre gratitude la plus humble et en témoignage de votre généreuse hospitalité. Si le Seigneur prolonge mes jours et affermit mon art, je reviendrai pour repeindre en couleur ce portrait. Les perles iront bien à vos cheveux et sur votre gorge nous ajouterons un collier d’émeraudes...
Sur la modeste feuille de papier, exécuté à la sanguine, à la sanguine rouge et tendre comme l’argile, était représenté le visage rieur de Dame Braïna, nimbé de boucles cuivrées.
— Mes sous ! s’écria Schmerel en voyant le portrait de sa femme. Il s’arma d’un gourdin et se lança aux trousses de ses clients. Mais chemin faisant Schmerel se rappela le corps rose d’Apolek, ruisselant d’eau, et le soleil aussi dans la petite cour et les doux sons de l’accordéon. L’aubergiste se troubla et, rejetant son gourdin, rentra.
Le lendemain matin, Apolek présentait au curé de Novograd un diplôme de fin d’études de l’Académie de Munich et disposait devant lui douze tableaux inspirés des Saintes Écritures. C’était des huiles sur de minces planchettes de cyprès. Le Père vit sur sa table la pourpre embrasée des mantelets, l’éclat des campagnes smaragdines et la mousseline diaprée jetée sur les plaines de Palestine.
Les saints d’Apolek, tout cet assortiment de vieillards vénérables, bons et simples, remplis d’allégresse, aux barbes chenues et aux visages rubiconds, s’inséraient dans des torrents de soie et de crépuscules puissants.
Le même jour, pane Apolek reçut commande d’orner de fresques la nouvelle église. Et au moment de boire la bénédictine, le Père dit à l’artiste :
— Sancta Maria, disait-il, mon bon Apolek, de quelles contrées merveilleuses une aussi joyeuse grâce que vous nous est-elle envoyée ?
Apolek travaillait avec zèle et un mois plus tard, la nouvelle église était déjà pleine de bêlements de troupeaux, de l’or poudreux des couchants et de vaches aux pis jaune paille. Des buffles au cuir râpé tiraient sous le joug, des chiens aux gueules roses couraient au-devant des brebis et dans des barcelonnettes suspendues aux troncs droits des palmiers se balançaient de petits enfants dodus. Les haillons bruns des franciscains entouraient un berceau. La foule des rois-mages était sillonnée de calvities miroitantes et de rides sanglantes comme des blessures. Dans la foule des mages luisait, traversé d’un rire muet de renard, le visage chafouin de petite vieille de Léon XIII et le curé de Novograd lui-même, une main occupée à égrener son chapelet de facture chinoise, bénissait de l’autre le petit Jésus.
Cinq mois d’affilée, Apolek rampa, prisonnier dans sa chaise de bois, le long des murs, le long de la coupole et du triforium.
— Vous avez un net penchant pour les gens que vous connaissez, mon bon Apolek, dit un jour le curé qui s’était retrouvé parmi les mages et avait aussi reconnu Romuald dans la tête tranchée de Jean le Baptiste. Il eut un sourire, le vieux Père, et fit porter au peintre qui œuvrait sous la coupole, un verre de cognac.
Puis Apolek acheva la Cène et la lapidation de Marie de Magdala. Et un dimanche il dévoila les fresques. Les notabilités, par le prêtre invitées, reconnurent en l’apôtre Paul le boiteux converti Ianek et en Marie-Madeleine, la juive Elka, née de parents inconnus et mère d’une ribambelle de petits champis. Les notables ordonnèrent de recouvrir ces images sacrilèges. Le curé fit pleuvoir des menaces sur le blasphémateur. Mais Apolek ne recouvrit par ses fresques.
Ainsi commença une guerre inouïe entre le corps tout-puissant de l’Église catholique d’une part et de l’autre, l’insouciant peinturlureur de scènes religieuses. Elle dura trente ans et [fut sans merci comme une passion de jésuite.] L’humble dévergondé faillit même être promu au rang d’hérésiarque. C’eût été là le plus madré et le plus farceur des combattants qu’ait eu à connaître l’Église romaine au cours de son orageuse et équivoque histoire, un combattant à l’ivresse bénie qui courait le monde avec deux souris blanches cachées contre sa poitrine et un assortiment de pinceaux les plus fins dans sa poche.
— Quinze zlotys (24) la Vierge Marie, vingt-cinq zlotys pour la Sainte Famille et cinquante zlotys pour la Cène avec représentation de toute la famille du commanditaire. L’ennemi du client peut être peint en Judas Iscariote et ceci moyennant un supplément de dix zlotys, voici ce que déclara Apolek aux paysans des alentours après qu’on l’eut chassé de l’église en construction.
Les commandes ne manquaient pas. Et quand une année plus tard, une commission appelée à grands coups d’épîtres frénétiques par le curé de Novograd et dépêchée par l’évêque de Jitomir, arriva, elle trouva dans les bourrines les plus déshéritées et les plus nauséabondes de monstrueux tableaux de familles, sacrilèges, naïfs et pittoresques [comme la jungle tropicale (25)]. Des Josephs aux cheveux grisons séparés par une raie de milieu, des Jésus gominés, des Maries campagnardes aux flancs alourdis par les maternités et aux genoux écartés ; ces icônes étaient accrochées dans le coin d’honneur et encadrées de couronnes tressées de fleurs en papier.
— Il vous a canonisés de votre vivant ! s’exclama le vicaire général de Doubno et de Novoconstantinovo en réponse à la foule qui défendait Apolek. Il vous a entourés des ineffables attributs de la sainteté, vous qui, par trois fois, avez succombé au péché de désobéissance, vous les bouilleurs de cru clandestins, les usuriers inexorables, les falsificateurs de poids, vous qui avez vendu l’innocence de vos propres filles !
— Votre Sainteté, dit alors au vicaire général Witold le bancal, receleur et gardien de cimetière, qui peut dire à l’obscur peuple ce qu’est la vérité pour Dieu, notre seigneur à tous, dont la miséricorde est infinie ? N’y a-t-il pas plus de vérité dans les tableaux d’Apolek qui comble notre fierté que dans vos paroles pleines d’invectives et de hargne seigneuriale ?
Les huées de la foule firent fuir le vicaire. L’état des esprits dans les faubourgs constituait une menace pour les serviteurs de l’Église. L’artiste invité à la place d’Apolek n’osait recouvrir de peinture Elka et Ianek le boiteux. Aujourd’hui encore on peut les voir dans un des collatéraux de l’église de Novograd. Ianek en apôtre Paul, boiteux craintif à la barbe noire effilochée, apostat campagnard, et elle, la pécheresse de Magdala, malingre et éperdue, au corps dansant et aux joues hâves.
La lutte contre le curé dura trois décennies. Puis une vague de cosaques chassa le vieux moine de son nid de pierres parfumé et, ô retour du destin, Apolek élut demeure dans la cuisine de Dame Élise. Et me voici, hôte de passage, buvant par les soirs le vin de ses paroles.
De quoi conversons-nous ? Des temps romantiques de la noblesse polonaise, du fanatisme rageur des bonnes femmes, du sculpteur Luca della Robbia et de la famille du charpentier de Bethléem.
— Je voudrais dire au pane secrétaire... me glisse mystérieusement avant le souper...
— Oui, répondis-je, oui, Apolek, je vous écoute...
Mais le sacristain, pane Robatski, sévère et gris, tout en os et en oreilles qu’il a grandes, est assis trop près de nous. Il étale entre nous les toiles défraîchies du silence et de l’hostilité.
— Je voudrais dire au pane, chuchote Apolek en m’attirant à l’écart, que Jésus, fils de Marie, a été marié à Déborah, fille de Jérusalem de modeste naissance...
— Oh, cet homme (26), crie pane Robatski, plein de désespoir, cet homme ne mourra pas dans son lit !... cet homme sera tué ! (27)
— Après le souper, murmure Apolek d’une voix baissée et bruissante. Après le souper, si le pane secrétaire le désire...
Je le désire. Enflammé par le début de l’histoire, j’arpente la cuisine et attends l’heure élue. Dehors, c’est la nuit, dressée comme une colonne noire. Dehors s’est engourdi le jardin vivant et ténébreux. Torrent lactescent et étincelant sous la lune, le chemin coule vers l’église. La terre est dallée de clartés obscures, des colliers de fruits luisants pendent aux buissons. L’odeur des lis est pure et âpre comme un alcool. Et le frais poison s’insinue dans l’haleine grasse et turbulente du fourneau et assassine la touffeur résineuse du sapin épandu dans la cuisine.
Apolek en nœud de cravate rose et pantalon rose élimé, fourrage dans un coin tel un gracieux et doux animal. Sa table est barbouillée de couleur et de colle. Le bon vieux travaille à gestes courts et rapides, le tambourinement d’une grêle mélodie monte de l’angle de la pièce. Le vieux Gottfried bat la mesure de ses doigts tremblotants. L’aveugle est assis, immobile dans l’éclat jaune et huileux de la lampe. Inclinant son front dégarni, il écoute la musique sans fin de sa cécité et le marmonnement d’Apolek, l’ami de toujours.
— ... Et tout ce que disent au pane les popes et l’Évangéliste Marc et l’Évangéliste Matthieu, ce n’est pas la vérité... Mais la vérité, je peux la dévoiler au pane secrétaire de qui, moyennant cinquante marks, je suis prêt à faire le portrait sous l’aspect du bienheureux François, sur un fond de verdure et de ciel. C’est qu’il était un saint tout à fait simple, ce François. Et si le pane secrétaire a une fiancée en Russie... Les femmes aiment le bienheureux François, bien que pas toutes, pane...
Ainsi commença dans le coin embaumant le sapin, l’histoire des noces de Jésus et de Déborah. Cette jeune fille, selon Apolek, avait un fiancé. Son fiancé était un jeune Israélite qui faisait le négoce des défenses d’éléphants. Mais la nuit de noces de Déborah se termina dans la gêne et les larmes. La femme fut saisie d’effroi quand elle vit son mari s’approcher de sa couche. Un hoquet [irrépressible]lui gonfla la gorge. Elle éructa tout ce qu’elle avait mangé lors du banquet nuptial. L’opprobre tomba sur Déborah, sur son père, sa mère et tout son sang. Le fiancé la laissa en la raillant et convia tous ses hôtes. Alors Jésus, voyant la langueur [singulière]d’une femme qui avait soif de mari et craignait son approche, se vêtit des habits du jeune marié et, plein de compassion, connut Déborah, couchée dans ses vomissures. Puis elle alla vers les convives, triomphant bruyamment et [détournant ses regardsrusés] comme une femme fière de sa chute. Jésus, lui, s’était retiré à l’écart. Une sueur mortelle couvrit son corps et l’abeille de l’affliction le piqua au cœur. Sans que personne le remarquât, il sortit de la salle où l’on festoyait et s’enfonça dans le pays désertique, à l’orient de la Judée, où l’attendait Jean. Et Déborah enfanta son premier-né...
— Où est-il donc ? m’écriai-je.
— Les popes l’ont caché aux regards, énonça gravement Apolek et il approcha son doigt léger et frileux de son nez d’ivrogne.
— L’artiste, s’écria soudain Robatski, émergeant de l’ombre, et ses oreilles grises s’avancèrent. Que dites-vous (28) ? Cela est impensable...
— Oui, oui, Apolek se replia sur lui-même et agrippa Gottfried, oui, oui, pane...
Il entraîna l’aveugle vers la sortie mais sur le seuil ralentit et me fit signe d’approcher, de son doigt...
— Le bienheureux François, chuchota-t-il en clignant des yeux, avec un oiseau sur la manche, une colombe ou un chardonneret comme le pane secrétaire le désirera...
Et il disparut avec l’aveugle, l’ami de toujours.
— Ô imbécillité ! proféra alors le sacristain Robatski. Cet homme ne mourra pas dans son lit...
Robatski ouvrit une large bouche et bâilla comme un chat. Je lui dis adieu et partis me coucher dans ma maison juive pillée.
Sur la ville flânait une lune orpheline. Et je marchais en sa compagnie, réchauffant en moi des rêves chimériques et des chants discordants.
LE SOLEIL DE L’ITALIE (29)
J’étais à nouveau hier dans l’office de Dame Élise, sous la tiède couronne des vertes branches de sapin. J’étais assis près du poêle chaud et vivant. qui grondait, et puis je m’en étais retourné. En contrebas le Zbroutch (30) silencieux roulait son flot de verre noir. [Mon âme gonflée par l’ivresse languissante du rêve souriait à je ne sais qui et mon imagination, bonne femme aveugle et béate, faisait tourbillonner devant moi ses brumes de juillet.]