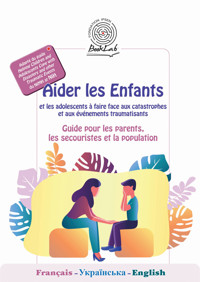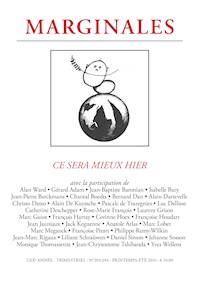
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales
Il est des moments où l’histoire fait le dos rond. Tout va si mal, les enjeux sont si opaques, les perspectives semblent sans issue. Un sentiment diffus nous envahit peu à peu, une nostalgie si prégnante que l’on aimerait autant que le temps s’arrête, et même qu’il reparte en arrière. Une nostalgie s’impose, dispose comme d’un pouvoir aimanté, nous attire vers le passé, parce que vu dans le rétroviseur, il semble comblé de tous les dons. Étrange sensation, à rebours des règles même du devenir, qui suppose qu’on s’y abandonne, puisqu’il n’est pas de marche arrière possible.
Ce sentiment, on peut gager qu’il est vieux comme le monde. Dans la conscience que toute existence a son terme, que le vecteur ne peut nous entraîner que vers un point ultime dont aucun voyageur ne revient, comme dit Hamlet, le désir s’accroît que cette loi puisse être vaincue, qu’il y ait une issue qui épargne de l’irrémédiable fin. Le comble du désir serait alors de remettre ses pas dans ceux déjà franchis, et même d’aller plus loin, en deçà du vécu, avant même le prélude, peut-être, tant qu’à faire, vers le vide initial…
Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique de la nostalgie avec des écrivains comme Chantal Boedts, Marc Lobet ou encore Yves Wellens.
À PROPOS DE LA REVUE
Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment
Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que
Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.
Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.
Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.
LES AUTEURS
Jacques De Decker, Alan Ward, Gérard Adam, Jean-Baptiste Baronian, Isabelle Bary, Jean-Pierre Berckmans, Chantal Boedts, Bernard Dan, Alain Dartevelle, Christo Datso, Alain De Kuyssche, Pascale de Trazegnies, Luc Dellisse, Catherine Deschepper, Rose-Marie François, Laurent Grison, Marc Guiot, François Harray, Corinne Hoex, Françoise Houdart, Jean Jauniaux, Jack Keguenne, Jean-Louis Lippert, Marc Lobet, Marc Meganck, Françoise Pirart, Jean-Marc Rigaux, Liliane Schraûwen, Daniel Simon, Jehanne Sosson, Monique Thomassettie, Jean-Chrysostome Tshibanda, Yves Wellens, Philippe Remy-Wilkin, Étienne Verhasselt et Jean-Pol Baras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Éditorial
Jacques De Decker
Il est des moments où l’histoire fait le dos rond. Tout va si mal, les enjeux sont si opaques, les perspectives semblent sans issue. Un sentiment diffus nous envahit peu à peu, une nostalgie si prégnante que l’on aimerait autant que le temps s’arrête, et même qu’il reparte en arrière. Une nostalgie s’impose, dispose comme d’un pouvoir aimanté, nous attire vers le passé, parce que vu dans le rétroviseur, il semble comblé de tous les dons. Étrange sensation, à rebours des règles même du devenir, qui suppose qu’on s’y abandonne, puisqu’il n’est pas de marche arrière possible.
Ce sentiment, on peut gager qu’il est vieux comme le monde. Dans la conscience que toute existence a son terme, que le vecteur ne peut nous entraîner que vers un point ultime dont aucun voyageur ne revient, comme dit Hamlet, le désir s’accroît que cette loi puisse être vaincue, qu’il y ait une issue qui épargne de l’irrémédiable fin. Le comble du désir serait alors de remettre ses pas dans ceux déjà franchis, et même d’aller plus loin, en deçà du vécu, avant même le prélude, peut-être, tant qu’à faire, vers le vide initial…
Ce sentiment-là n’est pas neuf. Il pourrait bien être permanent. Mais il a pu exceptionnellement s’interrompre. Et nous sommes les élus qui avons eu le privilège de connaître une de ces trêves. Elle est précisément situable dans l’espace et dans le temps. Spatialement, elle se circonscrit dans l’hémisphère nord, de part et d’autre de l’Atlantique. Chronologiquement, elle se repère dans l’extrême terme du deuxième millénaire, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le lugubre 11 septembre. Là, tout ne semblait qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
De fait, le monde s’organisait, il tentait d’édifier un ordre politique, économique et social. Il avait connu l’horreur absolue, sans modèle dans le passé. Il avait industrialisé le pire. La persécution, que d’autres époques avaient subie, il l’avait marquée au signe des temps modernes, ceux que Chaplin avait dénoncés au moyen d’un langage flambant neuf auquel il avait donné ses signes de noblesse, qu’il avait transmué, de front avec quelques autres, en langage artistique à part entière.
Par ailleurs, une arme de destruction massive avait été « expérimentée » au prix du massacre de dizaines de milliers de vies humaines qui n’avaient pas la peau aussi blanche que ceux qui, d’un coup de manette, avaient transformé une ville palpitante de vie en un charnier gigantesque.
On comprend que, au terme de ces deux crimes colossaux, qui ne furent condamnés que dans un cas, l’autre étant commis par des combattants qui étaient, comme on dit dans leur langue, « too big to fail », on ait voulu se prémunir contre leur répétition. Et cela a mis en branle un gigantesque phénomène de restauration qui, après avoir été réalisé dans les faits, a envahi les esprits. Entre les deux premières guerres mondiales s’étaient glissées les années folles, comme si l’on s’imposait de ne pas penser à l’imminence d’une répétition du pire, qui ne se fit d’ailleurs pas attendre.
Après 45, on a cessé de faire fi des menaces de répétition du désastre. Une vaste concertation s’est mise en place, mais partagée en deux camps, ce qui représenta un temps une garantie contre l’échec. Ce fut la guerre froide, cette simulation à l’échelle mondiale d’un conflit dans lequel personne ne voulait s’engager, trop conscient des dégâts démesurés que pouvaient provoquer les déchaînements de violence. C’était une paix armée, parce qu’armée comme jamais. Non que le déchaînement de la violence ne fût pas pensable, mais il était inconcevable pour cause de gigantisme. On ne saura peut-être jamais à quel prix cette illusion d’apaisement fut conquise, et même orchestrée. Non que des conflits ne se poursuivissent pas durant cette période, qui eurent la Corée ou le Vietnam pour théâtre. Mais ils se déroulaient dans de lointaines contrées, avec lesquelles nous n’étions pas, comme aujourd’hui, étroitement connectées…
Nous n’avions pas le loisir de suivre les événements, comme on disait, en « temps réel ». La mondialisation n’avait pas encore tissé sa toile. Nous demeurions donc tranquillement réfugiés dans notre petit cocon. À ceci près que la puissance qui nous avait délivrés du cataclysme envoyait, elle, toujours ses « guys » au front, ce que l’opinion finit par trouver saumâtre. La guerre, du coup, devint de ce bord-là, professionnelle, dépourvue d’engagement réel, face à des combattants qui, eux, étaient prêts à se battre jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au sacrifice ultime. Un nouveau contraste se fit jour, instaurant un décalage énorme entre des soldats stipendiés et d’autres, prêts à y laisser leur vie. Cette opposition-là jouerait par la suite un rôle décisif.
Quant à la version restreinte de la guerre froide, celle qui se déroulait sur le sol européen, par le jeu de la propagande et du conditionnement idéologique, elle allait mourir de sa belle mort lorsque l’Est rendit les armes face à la puissance économique de l’Ouest. Et l’on vécut à ce moment, lors de la chute du Mur, une sorte d’apnée de la pacification. Il s’en trouva même à s’exclamer que l’Histoire était terminée, que le tour était joué. C’est de ce moment que date, dans nos consciences, voire dans nos inconscients, le sentiment que le bonheur était accessible, et qu’il nous était dévolu. Grande, non, gigantesque illusion !
Elle dura un peu plus d’une décennie. Nous avons cessé de planer au moment où deux avions ont renversé deux tours dans la métropole symbolique de l’Occident. On a cru à une séquence d’actualité ; ce fut une rupture, un retour aveuglant à la loi de l’affrontement continu. Avec, face à face, des adversaires parfaitement dissymétriques. Tellement dissemblables qu’on évoqua aussitôt une nouvelle barbarie. Sans prendre garde au fait que le plus puissant des belligérants avait, par sa surenchère, engendré l’autre.
Il faut en déduire que, non, l’ascension vers la paix et le bonheur n’est pas un mouvement uniformément accéléré. C’est l’état de paix qui est l’exception. Et donc nous souvenir que celui que nous avons connu a été payé par tous ceux qui y ont laissé leur vie par millions, et dont certains contemporains sont encore les nôtres. C’est pourquoi la nostalgie n’a aucune raison d’être. Il faut être à la hauteur de ce qui nous arrive, il faut se souvenir du courage, de la lucidité et de la fermeté de ceux qui nous ont précédés, de l’intelligence et de la générosité qui ont guidé leurs pas. Peut-être parce qu’ils savaient mieux que nous qu’ils avaient leur destin en main. Et qu’ils n’en étaient pas seulement les spectateurs, par écrans de tous formats interposés.
Demain est notre seul horizon. La nostalgie n’a pas de raison d’être, parce qu’elle ne renvoie jamais qu’à un passé édulcoré, où pourtant le bruit et la fureur n’ont cessé de régner. Et ce ne sont pas les illusions d’optique dont nous sommes abreuvés qui doivent nous faire oublier que notre destin nous appartient.
Happy Hour
Alan Ward
Traduit par Stéphanie Follebouckt
Mercredi 11 novembre 2015
On est la onzième heure du onzième jour du onzième mois.
En fait, pas exactement. Plutôt neuf heures et demie après la onzième heure du onzième jour du onzième mois. Mais on est tout près (c’est pas comme si c’était Noël).
Steven Hardcastle est assis à la fenêtre, à l’une des tables centrales du côté gauche de la pièce, et dispose d’un large angle de vue sur les évènements et les clients. L’observateur. Il a l’habitude d’appeler la partie avant du bar « L’Arène ». À l’arrière se trouve un espace composé de boxes, plus obscur (au sens propre et figuré), qu’il faut franchir pour atteindre les toilettes. Une forêt digne des frères Grimm, tout en bois sombre, tables sombres, fausses poutres (peinture utilisée : « Bois foncé »), chaises en velours rouge usées, reproductions surannées de portraits déformés et bric-à-brac lugubre. Il a toujours soupçonné que des deals de toutes sortes y avaient cours. S’il lui arrive de jeter un œil sur les occupants lors de son passage, il récolte des regards qui lui coupent l’envie potentielle de demander l’heure ou le temps qu’il fera le lendemain, encore moins le prix du jour pour cent grammes de coke. Sans grande imagination, il appelle cette partie du bar « La Forêt ».
Le Shakespeare, car tel est le nom de cet établissement, est une brasserie-pub hybride, le genre de bar que les Français considèrent comme un pub anglo-irlando-américain, mais qui est simplement une vieille (bonne) brasserie dotée de meubles en bois de (mauvaise) imitation pub, de signaux lumineux Guinness, d’une musique disco assourdissante (du disco, de nos jours ?) et d’un gigantesque écran suspendu diffusant du foot ou des clips MTV. La Happy Hour (Boissons à moitié prix – 19 h 30 à 21 h 30 !) bat son plein, la clique habituelle de clients bigarrés a pratiquement envahi L’Arène à présent. C’est précisément cette diversité que Steven apprécie. Chaque soir, ils sont différents : gens, styles, classes sociales, tempéraments, ethnies, dragues, disputes et bagarres éventuelles.
Il est bien installé, occupé à observer, réfléchir, décompresser, en attendant que la serveuse vienne prendre sa commande d’un deuxième cocktail. Il a terminé sa première Macbeth Margarita et a décidé de prendre le Hamburger Hamlet (frites et salade incluses), avec une carafe de Rosé Roméo (de Provence heureusement, pas de Vérone comme on aurait presque pu l’imaginer). La ringardise totalement inconsciente et décomplexée qui caractérise les idées des propriétaires est pour lui une autre raison d’aimer l’endroit.
— C’est pour quoi ces drapeaux ? demande Mo. Deux chapelets de petits drapeaux tricolores avec têtes de mort surimprimées s’étendent de chaque coin du bar pour se rejoindre au centre.
— Ils ont dû les trouver dans une foire pour pas cher. Le symbole pirate ne devrait pas y être. Quoique…, dit Fred.
— Ils sont pour quoi alors ?
Fred et Mo arrivent habituellement au début de la Happy Hour, cela rend leurs soirées économiquement plus viables, sans compter qu’il y a autant de femmes que d’hommes à ce moment-là, mais ce soir ils étaient au cinéma pour voir le film Avengers donc ils sont arrivés plus tard. Ils sont assis à l’une des tables hautes avec tabourets de bar qui occupent une grande partie de L’Arène. Les tables faites pour draguer. Le reste de l’espace est occupé sur les côtés par d’autres tables où s’installent les clients pour manger leurs hamburgers, steaks ou fish & chips (oui parfaitement, de nombreux vacanciers britanniques des bateaux de croisière s’arrêtent ici pour leur repas du soir avant d’être ramenés sur leur colosse et son trajet de nuit vers la prochaine étape méditerranéenne).
Les croisiéristes contemporains.
— La fin de la Première Guerre mondiale. 1918.
— Mais ça fait presque un siècle, putain. À quoi ça sert ?
— Ça sert à ce qu’on n’oublie pas. Cette guerre a duré cinq ans, a été menée dans les pires conditions imaginables, seize millions de personnes en sont mortes. Elle s’est terminée par un traité, signé à onze heures le 11 novembre 1918 (tu piges, Mo ?). Un vrai foutoir, une erreur monumentale, qui a rendu furax les vaincus allemands. Donc vingt ans après les Allemands furax ont déclenché la Seconde Guerre mondiale, qui a duré six ans et a fait soixante millions de morts, y compris les onze millions de l’Holocauste et le demi-million de civils allemands qui ont fondu comme des figurines en cire sous les bombes incendiaires dont les Britanniques les pilonnaient.
— Beurk ! T’as fini ?
— Sans oublier les quatre millions qui sont morts pendant la guerre du Vietnam et (alors que tu étais déjà né, enfoiré) le demi-million de personnes tuées en Irak depuis 2003. Et ça continue… Ça s’appelle l’Histoire et on peut en tirer beaucoup d’enseignements. Si tu m’écoutais de temps en temps, même toi tu pourrais apprendre des choses.
Steven a observé les drapeaux lui aussi. Depuis son départ en préretraite des institutions européennes à Bruxelles, il dispose de plus de temps pour étudier ce qu’il considère à présent comme une obsession, la Première Guerre mondiale, afin d’y trouver du sens. C’est difficile à supporter. La banalité de la mort, le massacre incompréhensible, l’absurdité et l’horreur hantent ses périodes les plus sombres. Dans ces moments-là, c’est souvent la lecture de ses poètes préférés, en particulier Wilfred Owen, qui lui procure du réconfort.
Il est aussi pratiquement certain que cela l’affecte davantage maintenant à cause de ce qui se passe en Europe. La montée de l’extrême droite, du populisme, du racisme, du nationalisme. Jusqu’à ce risible référendum en Grande-Bretagne : quitter ou rester dans l’Union européenne. Quels que soient ses bons et mauvais côtés (et il ne les connaît que trop bien pour y avoir travaillé pendant trente ans), elle a évité des guerres en Europe pendant soixante-dix ans et a vu trois dictatures fascistes se transformer en démocraties. Elle a amené les pays à discuter, se disputer et négocier plutôt qu’à s’entre-tuer. Pour cette seule raison, cela valait le coup d’y rester. Et si la Grande-Bretagne la quittait, qui serait le prochain ?
Une rupture ranimerait les vers de la guerre. Ils s’insinueraient dans les failles. Ils parviendraient en grignotant au cœur des débris. Et ils pondraient leurs œufs.
Steven tend la main vers son verre de whisky et voit qu’elle tremble.
— Hé Fred, regarde !
Mo pointe discrètement en direction d’une table presque cachée derrière le bar, dans La Forêt. Sur les chaises en velours les plus proches sont assises deux jeunes femmes, et l’une d’elles vient de regarder Mo et de lui sourire (du moins c’est ce qu’il croit). Elles semblent britanniques, mais n’ont pas l’air de touristes en croisière, plutôt en séjour promo d’une semaine. Et dire qu’on n’est que mercredi !
Fred leur jette un œil, regarde Mo et tambourine des doigts sur la table.
Ils se dirigent nonchalamment vers les jeunes femmes et leur demandent s’ils peuvent se joindre à elles. En français. Regards interrogatifs. Fred essaie à nouveau, plus lentement, avec des gestes. Elles se regardent, mi-agacées mi-amusées, et répondent « Ouais, pourquoi pas ».
Steven a évidemment observé les deux garçons, d’abord à leur table haute puis leur approche décontractée des deux filles dans La Forêt (« garçons », « filles » ? À son âge il appelle « fille » ou « garçon » n’importe quel jeune de moins de trente ans). Il devine que ces quatre-là doivent avoir plus ou moins dix-huit ans et sont probablement étudiants.
Alors qu’il passe à côté d’eux en route vers les toilettes, il les entend chercher un mot en anglais. Ils souffrent manifestement tous d’une déficience linguistique. Les filles sont britanniques.
— Vous savez comme dans les Avengers, « vengeance », dit le plus grand des garçons en français. Puis il essaie avec un accent anglais. « Vengeance », vous devez savoir ce que c’est. Regards vides, les filles ne savent pas.
— Ouais, bon, on peut dire vengeance mais…
— Excusez-moi, je peux peut-être vous aider, dit Steven. Je crois qu’il veut dire « revanche ».
— Ouais, revanche, dit l’autre fille. C’est ça, la revanche.
Soupir de soulagement général et remerciements fusant de toutes parts, dans divers accents anglais et français.
Steven poursuit son chemin dans La Forêt.
Et c’est ainsi qu’après environ une heure de maladresses interculturelles, d’apprentissages linguistiques divertissants, de rires bêtes et de drague collective, les filles s’en vont non sans avoir promis aux garçons de les retrouver là vendredi pendant la Happy Hour.
En passant devant lui, elles lui sourient et le remercient pour son aide.
— Il n’y a pas de quoi.
Pause… Osera-t-il ?
— Puis-je vous poser une petite question ?
— Ouais, du moment que ce n’est pas trop perso ! (Gloussements).
— Vous êtes jeunes, l’avenir vous appartient, une page blanche. Que pensez-vous du départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne ? Vous savez, le référendum. Brexit ?
Sans hésiter, l’une d’elle répond :
— Ouais, carrément. Mon père dit qu’on peut se débrouiller bien mieux sans toutes ces règles et tout, qui nous disent quoi faire. Comme avant. Choisir avec qui on veut commercer. Après tout, qui a gagné la guerre ? (Steven ne croit pas ce qu’il entend). C’est nous. On a battu les Allemands, d’après mon grand-père, et maintenant ce sont eux qui veulent nous dire quoi faire. (Son niveau d’incrédulité a grimpé radicalement et se trouve à présent en zone rouge.) Et mon père dit que l’Europe tombe en ruine de toute façon, donc à quoi ça sert d’y rester. On est mieux dehors. Par nous-mêmes. Comme avant. Comme au bon vieux temps, d’après mon grand-père.
Il sait qu’il est impossible de contrer, voire de discuter cela. Ces gosses veulent de nouvelles manières de vivre, des vieilles manières de vivre, et récolteront probablement de nouvelles guerres. Elles n’ont pas compris cette partie-là. La partie concernant les vers.
— Au revoir, à plus.
Et elles s’en vont joyeusement sur leurs hauts talons et leurs grands espoirs.
— Vous draguez nos gonzesses, vieux pervers ? Dit sur le ton de l’ironie, avec le sourire. Le plus grand des deux. Les garçons s’en vont eux aussi.
— Laissez-moi vous offrir un verre avant que vous ne partiez.
— T’as vu, Mo, maintenant c’est nous qu’il essaie de draguer ! Il doit être bi ou transgenre. Ils se marrent tous les deux puis lui tapent amicalement l’épaule.
— On rigole, mon pote. Vous êtes pas mal… pour un vieux. Regain d’hilarité. La consommation prolongée de bières a fait son effet.
— Je suis Steven Hardcastle. Et vous êtes… ?
— Fred.
— Mo.
Ils s’asseyent. Il commande. Ils choisissent une bière plus chère puisque c’est lui qui paie. Ils parlent. Ils sont tous deux issus de familles modestes et ont grandi ensemble dans un des nombreux HLM des alentours de Nice. Ils sont amis depuis toujours, mêmes écoles, mêmes loisirs. Ils se sont serré les coudes contre la violence et les gangs. Ils aiment sortir le soir à Cannes parce que la ville est plus calme, moins à cran, moins agressive et distante seulement de vingt minutes et quatre euros en train. Tous deux ont été de bons élèves, à fort potentiel mais, alors que la famille de Fred l’a encouragé à étudier, au point d’être admis à l’université de Nice en histoire contemporaine (actuellement en seconde année), la famille algérienne de Mo s’est montrée fidèle aux clichés. Seul garçon, il a été pourri gâté par sa mère, a évité les corvées et la discipline, a traîné dans la rue avec ses pairs algériens (mâles) au lieu de faire ses devoirs, alors que ses deux sœurs devaient aider pour le nettoyage, la cuisine, les courses et autres tâches ménagères, après quoi elles étaient priées d’aller dans leurs chambres pour étudier. N’importe qui aurait deviné le résultat. Mo a quitté l’école avec un diplôme assez nul et ses sœurs ont réussi. L’une s’apprête à entrer à l’université, l’autre a été embauchée dans une banque. Toutes deux ont des futurs radieux, font preuve d’un sain mélange de respect pour leurs parents et leur religion ainsi que d’un besoin d’être modernes et contemporaines, sans négliger le fait qu’elles ont de l’ambition.
— Pourquoi as-tu choisi l’Histoire, Fred ? C’est l’un de mes sujets préférés.
— Oh non, pas cette foutue Histoire encore ! dit Mo.
— En fait ce qui me fascine c’est l’histoire de la guerre. Je pense que sa signification a beaucoup changé. Il y a de nouveaux paradigmes, dictés par Internet, les médias sociaux, les avancées en technologie numérique, et il nous faut les comprendre pour survivre. Je voudrais faire ma dissertation là-dessus. Puis j’espère continuer avec un master.
— Excellent choix, Fred. L’un de mes sujets de prédilection. On doit en reparler davantage une autre fois, quand nous serons tous un peu moins saouls. C’est tout à fait exaltant !
— Cool, M. Hardcastle. Je n’arrête pas de le dire à Monsieur le Débile ici présent. Il ne veut jamais m’écouter, ni apprendre quoi que ce soit.
— Il n’arrête pas de me dire de commencer par l’Algérie, dit Mo.
— Évidemment. Tu ne sais rien du passé de ta famille ou de la colonisation française, ou de la guerre d’Algérie, ou même du merdier qui y règne maintenant. Dites-lui, M. Hardcastle, dites-lui l’importance de l’Histoire.
— Mais s’il ne veut pas apprendre ?
— Il est juste buté. Il n’est pas con. En fait il est même plutôt futé. Il ne veut simplement pas le montrer. Tu n’as pas besoin d’être à l’université pour apprendre et étudier, crétin. Parfois, discuter avec des gens comme M. Hardcastle est aussi bien, même mieux.
— Cause toujours, dit Mo.
Jeudi 12 novembre 2015
Le fait de collectionner les voitures anciennes (bon, soyons honnêtes, juste vieilles) dépend, pour la plupart des enthousiastes, d’un peu d’argent, de beaucoup d’optimisme et d’un prisme rose qui permet au propriétaire de croire que sa voiture est presque parfaite, dénuée de ces attributs rouillés, ternis, bruyants et fumants qui, pour être ignorés, nécessitent une défaillance volontaire de lucidité de la taille d’une Rolls-Royce.
Il y a de nombreuses vieilles voitures parfaites, bien entendu, restaurées jusqu’à la dernière poignée en chrome, mais il a fallu à leur propriétaire des années de patience et d’efforts pour leur redonner leur apparence d’antan, ou des tas de billets pour que des garages et ateliers le fassent pour lui. Dans les deux cas, elles coûtent de l’argent.
La Morris Minor 1954 décapotable de Steven Hardcastle, convoyée spécialement en France lorsqu’il a pris sa retraite, est l’une de ces défaillances de lucidité. Bien qu’elle démarre et roule correctement, le moteur est fatigué, la boîte de vitesses et l’embrayage se disputent constamment, la carrosserie marque son âge comme les taches sur une coccinelle et il faut éprouver la suspension grinçante pour y croire.
Il a pris la décision de limiter ses pertes et de la revendre, dans l’espoir d’acheter une autre voiture populaire des années cinquante avec ce qu’il en tirera. Une Coccinelle Volkswagen peut-être, ou pourquoi pas une Citroën 2 CV ? Il ne serait pas cher de la réparer, de l’entretenir et de remplacer des pièces en France.
M. Garnier arrive un peu en retard à dix heures, jette un œil à la Morris et émet un son entre le soupir et le grognement. C’est loin d’être un début prometteur. Il est accompagné par un jeune homme, resté dans la voiture, que Steven a l’impression de reconnaître malgré la distance. Après une assez courte inspection et tout aussi courte vérification du moteur, M. Garnier débite son discours.
— Vous savez M. euh…
— Hardcastle.
— Harcastle, c’est ça, vous savez M. Harcastle, de nos jours les gens veulent des voitures anciennes immaculées. Ils ne veulent pas payer pour acheter une voiture et payer encore pour la rendre… respectable. Comprenez-vous ce que je dis ?
Steven comprend très bien.
— Mais c’est une jolie petite chose, et je suis sûr de trouver quelqu’un qui serait d’accord de mettre un peu plus pour la rendre parfaite.
Steven comprend encore mieux.
Le garçon – jeune homme – sort de la voiture et se dirige vers eux. C’est Mo.
— Hé M. Hardcastle, je vous ai reconnu ! Il nous a aidés avec des tas de mots anglais hier soir dans un café, M. Garnier. Quelle coïncidence.
— La synchronicité (Mo, va voir sur Google). Content de te voir.
Garnier semble s’en moquer éperdument, occupé à lire un texto qui vient de sonner. Mo se tourne vers Steven et murmure :
— Et les filles, M. H ! Merci beaucoup. On les revoit demain soir. Happy Hour. On va forcément y arriver une fois qu’elles seront un peu bourrées. Il lui fait un clin d’œil salace.
Garnier est à présent plongé dans la rédaction d’un message.
— Bon, pourquoi vous achetez et conduisez ces vieilles bagnoles, M. H ? Elles sont lentes, dépassées, polluantes, n’ont ni direction assistée ni GPS ni ABS ni correcteur d’assiette automatique…
— Merci Mo, je crois que j’ai compris.
Mais Mo, manifestement de nature curieuse (et Steven a toujours placé la curiosité très haut sur l’échelle de l’intelligence), le fixe avec le plus charmant des sourires.
— Alors, c’est quoi que vous aimez tant dans cette vieille voiture ?
Steven prend une lente inspiration, ouvre la portière passager, invite le jeune homme à s’asseoir et s’installe sur le siège conducteur.
— Tu te souviens de ce que Fred t’a raconté hier soir ? À propos des guerres. Des millions de morts. Depuis des lustres et jusqu’à aujourd’hui.
— Ouais, bien sûr.
— Tu n’étais pas trop bourré ? dit Steven en souriant.
— Moi ? Ça va pas ! Je tiens l’alcool.
— OK, alors écoute.
Et Steven parle à Mo de la guerre sous ses nombreuses formes, aspects et tailles. Des choses semblables à ce que Fred lui a dit la veille, mais assorties de causes, d’explications, de théories, de détails supplémentaires, de dates, du nombre de tués et de blessés (forces armées et populations civiles). Cela dure un certain temps, mais l’intérêt de Mo ne faiblit pas.
Steven s’interrompt, enfin.
— M. H, ça va ? Vous tremblez.
— Oh vraiment ? Désolé. Je me suis emporté. Un peu perdu. Ce sujet, en particulier la Première Guerre mondiale, me fascine depuis des années mais il commence à me faire un drôle d’effet. Comme s’il prenait le dessus. Et il me semble que ça empire.
Il se redresse sur son siège, se tourne vers Mo et esquisse un sourire.
— Mais je vais bien maintenant.
— Comment vous connaissez tout ça au fait ?
— Lectures, recherches, prises de notes. Tu serais étonné comme peu de gens savent tout cela.
— Je ne savais pas. Mais maintenant bien. C’est… difficile à encaisser.
Le visage de Mo s’anime et s’épanouit. Steven le regarde et pourrait lui dire que ce qu’il éprouve est une mini-fulguration (Mo, va voir sur Google) mais il garde le silence. Il attend jusqu’à ce que Mo soit prêt à mettre des mots sur ses pensées.
— M. H ?
— Oui, Mo.
— Je peux vous dire quelque chose que je n’ai jamais dit à personne avant ?
— Je t’en prie.
— Mon grand-père m’a un jour parlé de trucs à Paris dans les années soixante, où des Algériens manifestaient pacifiquement mais ont été arrêtés, torturés, tués dans un stade sportif, d’autres ont été battus et jetés dans la Seine pour y être noyés. Il dit que près de deux cents personnes sont mortes. Je le soupçonne d’avoir été là mais il ne me l’a pas dit. Et il y avait encore des choses mais il n’a pas voulu me les raconter. J’avais seulement quatorze ans. Mais bon, c’est le passé, pas vrai ? Je suis français maintenant. À quoi ça sert ? Qu’est-ce que ça m’apporte maintenant ?
Steven demeure silencieux pendant un moment, les yeux rivés sur le pare-brise. Le soleil commence à briller sur les mimosas et les eucalyptus.
— Mais ça t’a déjà apporté quelque chose. Le fait de m’avoir raconté cette histoire était un acte courageux de ta part et le début de quelque chose, je ne sais pas quoi, ça dépend de toi. Apprends seulement ceci, pour l’avenir. Ça a beau être un cliché (Mo, va voir sur Google) : la connaissance est un pouvoir.
S’ensuit une longue pause. Steven a l’air épuisé. Tous deux regardent par-delà le pare-brise. M. Garnier semble les avoir oubliés, constamment sur l’un ou l’autre de ses téléphones portables. Il faut avoir un certain tempérament pour être vendeur de voitures d’occasion.
C’est Mo qui finit par rompre le silence.
— La voiture, M. H.
— Ah oui ! Il sourit. Ça, c’est la partie agréable, après cette accumulation de mort et de destruction. Le bon vieux temps. Tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de l’Europe était décimée, ce qui veut dire qu’il n’en restait pas grand-chose, même dans les pays victorieux. Tout le monde était pauvre et ne désirait que trouver du boulot, gagner un peu d’argent, acheter de jolies choses et être normal pour un temps. Au cours des années cinquante, les constructeurs automobiles partout en Europe se sont mis à fabriquer ce que j’appelle les « voitures du peuple », petites et pas chères, idéales pour aller voir la famille, les amis, la mer… La Morris Minor, Fiat et Seat 500, Coccinelle Volkswagen, BMW Isetta, Citroën 2 CV, Renault 4, et bien d’autres. En fait, tu vois, avant la guerre les gens n’avaient pas de voiture, ils avaient seulement un vélo et la plupart des gens allaient au travail à vélo. Certains avaient des side-cars mais la majorité prenait le bus, ou le train pour des trajets plus longs. C’était donc une révolution. En même temps, les gens ont commencé à reconstruire leurs vies et les rendre plus faciles, plus confortables. Ils ont acheté des frigos, des cuisinières, des machines à laver. Il s’agissait de réels besoins, surtout après de telles privations. C’était une sorte d’âge d’or après-guerre, un Temps de l’innocence.
— J’ai un peu décroché à la fin mais jusque-là je crois que je vous suivais.
— Puis sont arrivés les téléviseurs. Jusqu’à environ 1952 il n’y avait que des radios. Ce fut le début de la fin du Temps de l’innocence.
Il s’interrompt, sa respiration s’accélère. La colère commence à l’envahir.
— Et puis on s’est mis à tout foirer, on est allé trop loin, on a construit une société basée seulement sur ce que l’on achetait, sur ce que la pub nous disait d’acheter, sur ce qui nous rendait plus beaux que nos voisins, tout ça nous a donné trop de choix. La société de consommation était née. Le monde de la matérialité.
— Hé, comme Madonna, la Material Girl. Je l’aimais bien mais elle est devenue vachement vieille. Elle est naze. Alors que Lady Gaga, ça, c’est quelque chose.
Mais Steven était lancé, de plus en plus furieux, Madonna et Lady Gaga loin derrière lui.
— Et les valeurs que nous avions – aider, donner, écouter, travailler ensemble pour des vies meilleures – ont été remplacées uniquement par des objets et de l’argent. Nous avons perdu notre être intérieur, notre être spirituel (désolé si ça paraît ringard) et nous avons vendu notre boussole morale pour des voitures plus spacieuses, des maisons plus sophistiquées, des cartes de crédit… et nous nous sommes perdus.
Il s’interrompt, fixant au-delà du pare-brise les mimosas et les eucalyptus, à présent tachetés de toutes les nuances de vert par le soleil du matin.
— Et nous sommes devenus décadents (Mo, va voir sur Google). À présent, nombreux sont ceux, essentiellement parmi les jeunes, qui rejettent cette décadence, chacun à sa manière. Certains vivent de façon alternative, New Age, fermes bio, etc., mais d’autres, surtout dans la région du monde dont tes parents sont originaires, voudraient détruire notre société décadente et sans dieu, et nous avec, pour la remplacer par la leur. Bien sûr ils ne peuvent pas. Ils n’ont pas assez d’adeptes, de pouvoir et de soldats pour y parvenir, mais ils essaient. Tu te souviens de Charlie Hebdo ? Treize morts. Ça aussi c’était la guerre, Mo.
Il cesse de parler, prend une grande inspiration, se tourne vers le gamin et sourit.
— Voilà la raison pour laquelle j’aime collectionner et conduire des voitures populaires des années cinquante. Leur simplicité, pour qui et pour quoi elles étaient conçues, tout ça représente pour moi un âge innocent, de valeurs simples, réelles. Peut-être vais-je trop loin, par nostalgie, mais j’y trouve beaucoup de vrai. J’espère que tu comprends ce que je veux dire…
Il regarde sa montre.
— Merde, j’ai parlé trop longtemps. Désolé. M. Garnier doit penser que nous fomentons une révolution ensemble.
— Non, M. H, franchement, c’était super intéressant. Comme de se réveiller. Des choses que je ne connaissais pas, donc auxquelles je ne pouvais pas penser. J’ai pas tout pigé évidemment, mais j’ai de quoi tenir. Vous savez comme Fred essaie de m’apprendre des choses, comment penser aux choses. Mais c’est peut-être parce que c’est lui, mon vieux pote, mon partenaire de picole, mon associé en drague, que je n’écoute pas, que je ne veux pas écouter. De la jalousie peut-être. Fred le petit malin, qui est allé à l’université et moi pas. C’est de ma faute en fait, je suis un crétin d’avoir glandé au lieu d’étudier.
Il s’interrompt, pensif, un peu perdu.
— Mais après tout ce que vous avez dit, je vais mieux l’écouter maintenant. Apprendre des choses. Et en parler. Et faire des choses si je peux. Et peut-être que vous, moi et lui, nous pourrons en reparler de temps en temps au Shakespeare ? OK ?
Steven obtient 4 000 euros pour sa voiture, considérablement moins qu’il n’eût voulu mais assez, s’il rajoute un peu, pour acheter une Coccinelle ou même une vieille Renault 4 CV. Il décide de ne pas sortir au Shakespeare ce soir-là (c’est devenu un peu trop régulier, trop obsessionnel et il est convaincu que les margaritas sont en train de faire grimper son indice glycémique au niveau d’un diabète de type deux). Il est temps de se calmer un peu, surfer sur internet à la recherche de voitures à vendre et pourquoi pas faire des lectures sur la guerre d’Algérie ?
Mais demain, vendredi, il ira. TGIF, Thank God It’s Friday, ainsi commence le week-end. Difficile de se débarrasser des vieilles habitudes acquises durant la jeunesse. En plus il pourra observer comment les garçons se débrouillent avec les deux filles.
Vendredi 13 novembre 2015
Steven Hardcastle pénètre dans Le Shakespeare et se dirige vers une de ses tables favorites, à gauche à côté des fenêtres, d’où il peut boire, manger et observer. Fred et Mo sont déjà installés à une des tables hautes et ont gardé deux places pour leurs rencards. Il commande une margarita (les meilleurs cocktails de ce côté-ci de New York, comme il dit souvent) puis se dirige vers les garçons.
— Salut M. H, dit Mo.
— Sympa de vous revoir, dit Fred.
— Vous avez eu votre train avec… ?
— Vous rigolez ! Ils étaient en foutue grève, les enfoirés. On a dû prendre un putain de bus. Ça nous a pris une heure. On ne sait pas si on arrivera à rentrer ce soir. Et Mo a dû quitter le boulot plus tôt. Garnier n’a pas apprécié. Il va probablement le déduire de sa paie, le sale radin.
Il est inhabituel pour Fred de se mettre dans un état pareil. C’est en général lui le plus calme et réfléchi. Il est probablement nerveux à cause des filles. Il regarde (un peu trop) souvent vers la porte.
— Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai quand vos deux beautés arrivent. Je ne voudrais pas qu’elles passent trop de temps avec moi. Elles pourraient se rendre compte à quel point un homme de cinquante-sept ans est plus séduisant et intéressant que deux hommes de dix-neuf ans… Et plus riche.
— Allez-vous faire foutre M. H, si vous me permettez.
Ils éclatent tous de rire, lèvent leur verre et les garçons se détendent un peu. C’est exactement ce que Steven espérait : relâcher la tension avant qu’ils ne retrouvent les deux Anglaises, aussi jolies que joliment stupides.
— Et si vous avez besoin d’aide en traduction, appelez-moi. Mon vocabulaire est très étendu, très approfondi et très moderne !
— J’avais dit que c’était un vieux pervers, pas vrai Mo ?
Nouvelles taquineries, puis il retourne à sa table alors que les deux filles font leur entrée.
— Salut Monsieur…
— Steven.
— Steven. Comment allez-vous ? Vous êtes tout beau, habillé classe pour un vendredi soir !
— Et vous alors ! Fred et Mo vont devoir faire reculer les hordes mongoles ce soir.
— Merci, vous êtes gentil. C’est vendredi soir pour nous aussi. TGIF. Dans le monde la moitié des gens qui ont notre âge, et certains du vôtre aussi (elles se regardent et gloussent, mais gentiment), sort le vendredi, boit, s’amuse, oublie le boulot et le monde. Et c’est notre dernier soir donc c’est sûr qu’on va en profiter. À plus.
Tout en minijupes, tops moulants et talons hauts, elles se dirigent vers la table de Fred et Mo, où Steven l’observateur assiste à nombre de bises et de sourires.
Les filles commandent du vin blanc. S’ensuivent davantage de cliquetis de verres, tchin-tchin, santé, quiproquos linguistiques amusants et supercompliments concernant les tenues « sensationnelles » des filles.
— Vous savez, dit l’une d’elles, la blonde (l’autre est brune), nous ne connaissons même pas nos prénoms. Je suis Penny, mais tous mes amis m’appellent Pens. Et voici Chloë, mais tout le monde l’appelle Clo. Nous, c’est Pens et Clo. C’est un plaisir de vous rencontrer, chers Messieurs !
— Et nous sommes Fred et Mo, dit Fred.
— C’est de la triche, ça doit être vos diminutifs. Quels sont vos vrais prénoms ?
— Eh bien moi c’est Frédéric et lui, c’est Mohammed.
Les garçons sourient.
Les filles pas.
Pause.
Clo : Donc tu es quoi, musulman ?
Mo : Oui mais je ne pratique pas beaucoup, juste les bases, certaines prières du vendredi avec mon père, et le ramadan. Ça c’est pénible, surtout en été lorsque nous étions petits.
Pens : Et tu viens d’où ?
Mo : Mon père est algérien et ma mère est moitié française, moitié algérienne.
Clo : Ah donc ta mère n’est pas musulmane alors ?
Mo : Si, elle s’est convertie après avoir épousé mon père.
Pens : J’imagine que c’est pour ça que tu n’as pas l’air tellement…
Mo : D’un Arabe ?
La Happy Hour est une des composantes américaines les plus brillantes de la société de consommation : vendre le maximum de produits et toujours plus que ce dont vos clients ont besoin. Il y a longtemps aux États-Unis, entre dix-sept et dix-huit heures, toutes les boissons étaient à moitié prix. Juste après le boulot. Les gens en profitaient, buvant plus que de raison (moitié prix !) et à la fin de l’heure, ils continuaient à boire. Ils ne pouvaient plus s’arrêter. Et ils mangeaient. Des hamburgers, des frites, des côtes de bœuf, des steaks. Ils s’en allaient à une heure du matin ivres morts et allégés de quelques centaines de dollars.
Depuis lors c’est devenu une institution mondialisée (comme nous avons bien appris la leçon) au point que les bars de l’Alaska jusqu’à l’Australie proposent des Happy Hours, qui débutent et finissent à l’heure que leur propriétaire choisit.
Le Shakespeare est bondé. Heureusement c’est une soirée douce pour un mois de novembre et le trop-plein de clients se répand sur le trottoir (où ils peuvent aussi fumer…).
La Happy Hour (Boissons à moitié prix – 19 h 30 à 21 h 30 !) est terminée mais elle a eu l’effet escompté. À l’intérieur comme dehors, la soirée est lancée, faite de bruits, rires, gros mots, cris, comme tout bon vendredi soir qui se respecte. La télévision dans le bar est une de ces méga Samsung que l’on peut voir à près de cinquante mètres, tournée vers L’Arène et l’entrée. Elle est perpétuellement allumée, diffusant du football (la semaine) ou MTV (le week-end), et les clips musicaux sont à fond, en Full HD, mégapixels, Double-Dolby Surround Sound. Si le 3D Live existait, les propriétaires l’auraient aussi.
Légèrement comprimé à sa table et incapable de voir « ses » garçons et filles, Steven est occupé à boire sa dernière margarita et à prendre des notes. Mais le niveau sonore est devenu trop élevé pour lui et il glisse progressivement dans l’un de ses « états ». Il le sent. Ses connaissances micro-détaillées et obsessionnelles de la Première Guerre mondiale vont commencer à remplir son esprit d’images insoutenables, de chiffres incalculables, d’horreurs, prenant le dessus jusqu’à ce qu’il retrouve son calme. Il se met à paniquer, piégé comme il l’est par tous ces gens, tout ce bruit. Il se lève pour s’en aller mais est incapable de bouger, écrasé par ces gens de plus en plus oppressants, leurs rires et leurs cris de plus en plus tonitruants. Il faut qu’il sorte. Maintenant.
Soudain MTV s’arrête. La musique s’arrête. Les images s’arrêtent. Une grande banderole « FLASH INFO » apparaît. Rouge vif.
Puis il entend des tirs, tourne la tête et voit deux jeunes hommes en noir avec des fusils d’assaut se frayer calmement un chemin parmi la foule et tirer sur tous et n’importe qui. Les rires et les cris se transforment en hurlements de panique, de douleur, d’hystérie, à mesure que les gens tombent, tentent de se cacher, s’enfuient, se retrouvent coincés par la foule, se font piétiner. Il voit deux serveuses touchées à la tête et à la poitrine, le sang explosant sur leurs uniformes noirs alors qu’elles s’effondrent dans la foule. Il voit Mo et Pens pulvérisés de leurs sièges par un tir automatique nourri, le sang giclant de leurs poitrines sur Fred et Clo au cours de leur chute. Puis c’est au tour de Fred et Clo de tomber quand l’assaillant mitraille dans l’autre sens. L’homme lance une grenade derrière le bar. Des bouteilles éclatées, des verres, des bras et autres membres non identifiés encore vêtus de leurs oripeaux sanglants volent dans l’air comme des feux d’artifice multicolores. Les tirs, les hurlements et les gémissements sont insupportables. Sa tête va exploser.
Jusqu’à présent il a eu de la chance parce que les tireurs ont commencé à droite et au milieu de L’Arène, or il est à gauche. Mais les tirs se dirigent maintenant de son côté. Deux jeunes femmes tombent sur sa table, leur sang coule le long du bord, il est absorbé par des serviettes jusqu’à ce qu’elles en soient pleines et dégorgent leur contenu sur le sol. L’une des deux femmes est tombée sur son verre de vin brisé et de son cou lacéré coule un ruisseau de sang qui goutte le long de la table et va rejoindre la rivière en crue. Il est pétrifié par cette vision de la nature au sein de la mort.
Puis il entend d’autres tirs, beaucoup plus près, et il dégringole sous la table, glisse dans le sang, se roule en boule. À travers un interstice entre bras ballants, pieds de table et cascade de perles sanglantes, il voit les deux tireurs se retourner et partir, mitraillant dans la rue. À ce moment, la plupart de ceux qui se trouvaient dehors ont détalé, en panique. Il entend des sirènes. Il parvient tout juste à voir les hommes monter dans une voiture noire et s’en aller, même pas vite, juste comme s’il s’agissait d’une journée de boulot ordinaire.
La télévision est allumée. Le bar est silencieux. Il ouvre les yeux, il est assis sur sa chaise, à sa table. Il regarde autour de lui, tremblant. Il n’y a pas de sang, pas de morts, pas de blessés, pas de chaos. Juste un bar plein de gens en train de regarder la télévision en silence.
Des images de rues parisiennes, de bars, de sang, de gens pris en charge par les ambulanciers, de voitures de police, de camions pompiers, de hurlements, de sanglots, tout ça en Full HD, mégapixels, Double-Dolby Surround Sound.
— Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a eu une attaque terroriste coordonnée dans plusieurs endroits de Paris. Une tentative d’attentat a eu lieu au Stade de France, où le Président de la République se trouvait pour un match amical contre l’Allemagne, mais les trois auteurs de l’attaque-suicide n’ont pu pénétrer dans l’enceinte et ont déclenché leurs ceintures d’explosifs à l’extérieur, provoquant leur mort et celle d’un passant. Au centre de Paris, des cafés et restaurants des dixième et onzième arrondissements ont été la cible d’attentats. Les attaques semblent avoir été bien préparées et coordonnées. Les terroristes ont quitté les lieux mais nous avons reçu des informations concernant une attaque majeure au Bataclan, où a lieu un concert de rock. Nous ne disposons pas de chiffres précis concernant le nombre de morts et de blessés, mais les premières estimations font état de plusieurs centaines. Nous vous tiendrons informés des…
Steven fixe le sang et les victimes en Full HD et mégapixels. Toutes les images qu’il a vues et collectionnées de la Première Guerre mondiale sont des photos en noir et blanc ou en sépia, instants de douleur, d’agonie, de mort récente, d’épreuves extrêmes et de désespoir. Il contemple à présent du sang réel en temps réel, du sang carmin foncé qui s’écoule des gens sur leurs visages, leurs vêtements, la rue, les ambulanciers. C’est un choc terrible. Comme tous ceux de sa génération, il n’a jamais dû faire l’armée, aller à la guerre et la voir de première main. Car ceci est la guerre, comme toutes les autres avant elle, petites ou grandes. Cela ne change rien qu’elle ne soit pas menée soldats contre soldats. Des civils ont été la cible d’agressions militaires et idéologiques des milliers de fois depuis des milliers d’années.
Le bar commence à s’agiter. Les gens étaient sous le choc mais se mettent à parler. Et ils parlent de deux choses.
Personne n’aurait pu imaginer que des attaques d’un tel sang-froid seraient menées contre des civils innocents lors d’une soirée sympa dans les bars de Paris. C’est trop près de chez eux. C’est chez eux.
Selon les premiers témoignages, les assaillants, dont aucun ne portait de masque, étaient « d’origine nord-africaine ». Ce qui signifie marocaine, algérienne ou tunisienne. Une poudrière d’opinion publique et de politique nationale est sur le point d’être allumée, qui sait ce qu’elle emportera avec elle lorsqu’elle explosera ?
Un silence embarrassé règne du côté de la table de Fred, Mo, Pens et Clo. Ils ont tous été instantanément calmés par les infos. La routine du vendredi soir, alcool et rituel d’accouplement, a été dévastée. Cela n’aurait pas été pire si leur serveuse était tombée raide morte en leur apportant leurs boissons.
C’est Pens qui ose le dire.