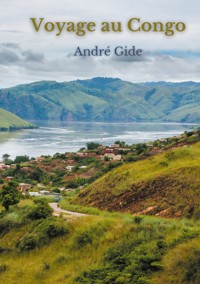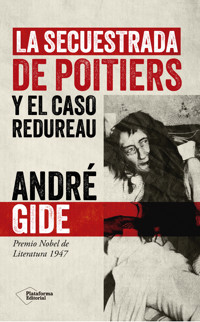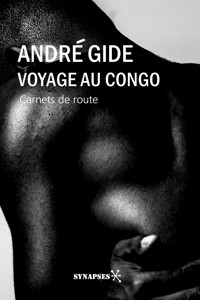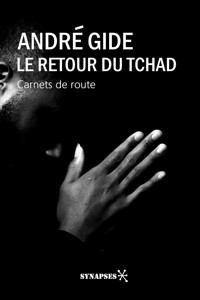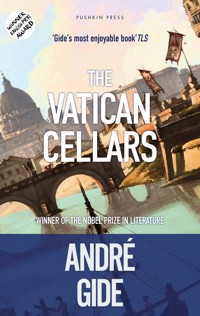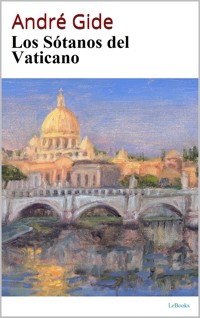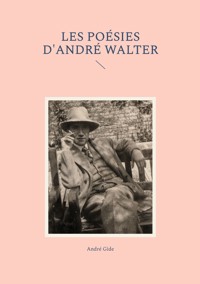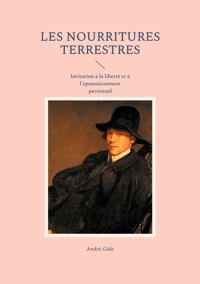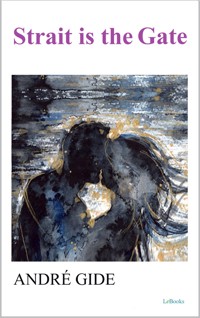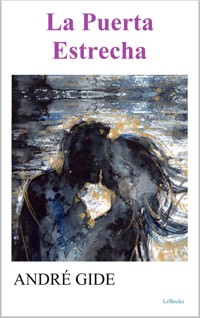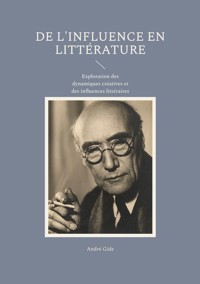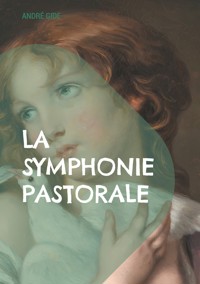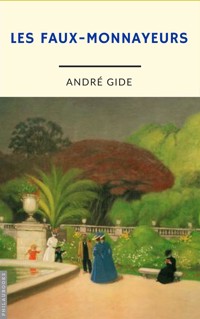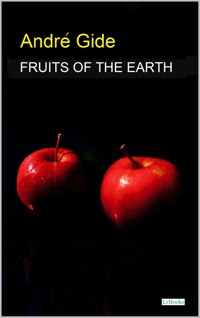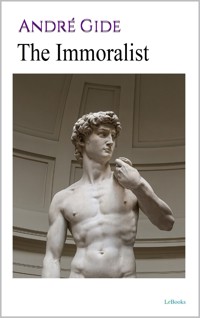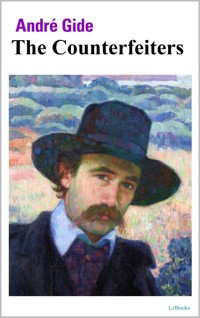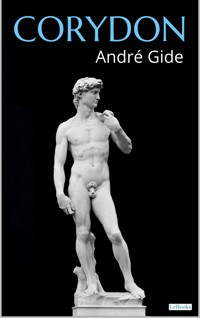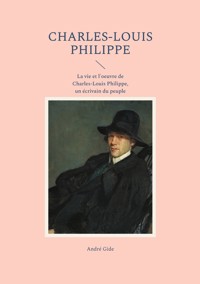
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
"Charles-Louis Philippe" d'André Gide est une biographie pénétrante qui rend hommage à l'un des écrivains les plus authentiques et touchants de la littérature française du début du XXe siècle. André Gide, écrivain et critique littéraire de renom, dresse un portrait intime et respectueux de Charles-Louis Philippe, dont les oeuvres se distinguent par leur simplicité et leur humanité profonde. Charles-Louis Philippe, issu d'un milieu modeste, parvient à se faire un nom dans le monde littéraire grâce à ses récits poignants et réalistes qui mettent en lumière les vies des gens ordinaires. Ses oeuvres, comme "Le Père Perdrix" et "Marie Donadieu", sont connues pour leur style dépouillé et leur empathie sincère envers les personnages marginaux de la société. Gide explore la vie de Philippe, depuis son enfance difficile à Cérilly, marquée par la pauvreté et la maladie, jusqu'à sa carrière littéraire à Paris. Il décrit comment Philippe, malgré des circonstances adverses, développe une voix unique qui résonne par sa vérité et son humanité. Gide analyse également les thèmes récurrents dans les oeuvres de Philippe, tels que la lutte contre l'injustice sociale, la compassion pour les démunis, et la quête d'une vie authentique. Ce livre est plus qu'une simple biographie ; c'est aussi une réflexion sur l'importance de l'honnêteté artistique et de la sensibilité sociale. Gide, en admirateur sincère, révèle comment Philippe, par sa vie et son écriture, a touché le coeur de ses lecteurs et a laissé une marque indélébile dans la littérature française.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 36
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MESDAMES, MESSIEURS,
Par suite d’un malentendu, on ne m’a demandé de tenir cette conférence qu’avec beaucoup de retard ; comme je ne suis rien moins qu’un improvisateur, je n’aurais pas pu accepter de la faire s’il ne s’était agi de Charles-Louis Philippe, et si je n’avais pensé que, pour parler de lui devant vous, un grand amour était plus utile qu’une longue et savante préparation. Je ne chercherai point, du reste, à vous apporter ici des idées originales sur la personne et l’œuvre de Charles-Louis Philippe. N’attendez pas non plus des souvenirs personnels, des anecdotes pittoresques : je ne pense point que Philippe en laisse beaucoup à raconter, pour cette raison que c’était le plus simple des êtres, qu’il ne composait point son personnage et ne prétendait jamais à paraître, parce qu’il se sentait être profondément.
Je vais à mon tour essayer de vous peindre très simplement sa figure authentique, de dégager à travers sa vie les quelques traits les plus significatifs, qui, sans doute, aideront à mieux comprendre son œuvre. Une abondante suite de lettres à un ami de jeunesse va m’y aider ; correspondance dont la Nouvelle Revue française ne fait que commencer la publication ; l’amabilité du directeur de cette revue m’a permis de prendre connaissance des lettres encore inédites et d’y puiser abondamment.
« J'appartiens à une génération qui n'a pas encore passé par les livres », dit-il, en 1903, dans une lettre à Barrés déjà publiée, « Ma grand'mère était mendiante ; mon père, qui était un enfant plein d'orgueil, a mendié lorsqu'il était trop jeune pour gagner son pain. » C’est cette grand’mère qu’a peinte Philippe sous les traits de Solange Blanchard, dans cet admirable Charles Blanchard inachevé, auquel Philippe travaillait lorsque la mort l’a surpris, en décembre dernier. Son père s’établit sabotier dans le village de Cérilly. C’est là que le petit Louis passe son enfance ; malingre, sensitif à l’excès, blotti frileusement avec sa sœur jumelle, auprès de ses parents. Ceux-ci ne sont pourtant plus dans la misère, et, comme le petit Louis est, lui aussi, « un enfant plein d’orgueil », et qu’au besoin l’orgueil de ses parents suffirait, on songe à lui donner l’instruction qu’il mérite.
« Mon père est un brave homme qui a travaillé son métier toute sa vie, plein de courage, et enthousiaste aussi. Il a su amasser quelque toute petite aisance qui lui permet de vivre en notre province et de travailler seulement pour se distraire. »
L’enfant a, du reste, un furieux appétit d’instruction. Tout petit, il joue à « aller à l’école », et un beau jour, de son chef, il se décide à y aller pour de bon. On le renvoie parce qu’il est trop petit. Il s’obstine. De cette obstination pathétique — pathétique parce que toujours contrariée, contrecarrée — il ne se départira jamais.
Il est petit, timide, gauche ; il n’a aucun des avantages physiques qui pourraient suppléer les avantages de la fortune pour lui permettre de réussir. Et, comme sa nature est extraordinairement tendre et affectueuse, on peut dire vraiment qu’il est miraculeusement doué pour souffrir. « Moi aussi, dit-il à son ami Henri Vandeputte dès la première lettre, je suis bien ardent et j'ai des flammes au cœur pour tout ce que je pense et pour tout ce que je fais. » Et certainement l’enracinement à Cérilly près des siens lui épargnerait beaucoup de souffrances ; mais il faut qu’il vienne à Paris pour devenir Charles-Louis Philippe.
Il prépare l’examen de Polytechnique, y échoue, se retourne vers les ponts et chaussées.
Après avoir espéré misérablement une situation en province, promené, balancé, berné par de soi-disant protecteurs, il entre enfin, à vingt-deux ans, en 96, au service de la Ville de Paris.
En 95, déjà voici ce qu’il écrivait dans un petit journal intime :
Un essai d'analyse du dégoût et de la débâcle intime d'un jeune homme : il est assis dans une grande prostration, une fatigue en son être moral, et un avachissement en son être physique.
Son âme a perdu l’habitude de l’espoir. Des chocs et des élans vers des avenirs ont épuisé sa force vitale, Les faits sans succès de son passé lui ont fait prendre un grand pli de doute à tout, un regard morne qui scrute et ne voit bien que le sombre. Il a la sensation de l’impuissance de son milieu, et même de l’impuissance de lui dans ce milieu. À quoi user