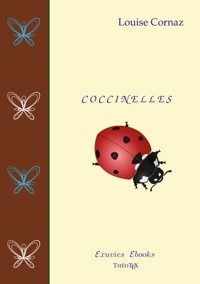
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Louise Cornaz a écrit la quasi-totalité des ses livres sous le pseudonyme masculin de Joseph Autier. Ce nom évoquera peut-être pour quelques uns l'auteur de la traduction française de deux best-sellers chrétiens : Ben-Hur, de Lew Wallace, et Que Ferait Jésus, de Charles Sheldon. Le titre de Coccinelles trouve son explication dans la très spirituelle dédicace que l'auteur adresse au peintre et littérateur Frédéric Berthoud. Elle s'y demande jusqu'où s'envoleront les petites bêtes à bon Dieu à qui elle a donné le jour : Jusqu'au siècle d'internet, ce qui n'est déjà pas mal, pourrions-nous lui répondre aujourd'hui.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322471065
Auteur Louise Cornaz. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Le nom de Louise Cornaz est pratiquement inconnu du public évangélique français, parce que cette femme de lettres a écrit la quasi-totalité des ses livres sous le pseudonyme masculin de Joseph Autier. A peine pour quelques uns ce nom évoquera peut-être l'auteur de la traduction française de deux best-sellers chrétiens : Ben-Hur, de Lew Wallace, et Que Ferait Jésus ?, de Charles Sheldon.
En Suisse par contre, où elle naquit en 1850, à Montet dans le canton de Vaud, on se souvient d'elle comme la première rédactrice du Bulletin Féminin, et comme une militante active dans la lutte anti-alcoolique et anti-tuberculeuse.
Cadette d'une fratrie de six frères et de six sœurs, d'une famille aisée, Louise perdit son père à dix ans, et à quatorze fut placée dans un internat de Wurtenberg. Elle y développa une passion pour le chant, et pour l'écriture ; elle publiera plus tard son premier roman à l'insu de sa famille. La somme de sa production représente environ une trentaine de petits volumes, romans, nouvelles, traductions d'œuvres américaines…
Chrétienne engagée sa vie durant dans l'Eglise Libre, Louise Cornaz s'est beaucoup intéressé à l'éducation religieuse des enfants, ce qui explique son choix de traductions pour la jeunesse (les œuvres de Ralph Connor notamment).
De tempérament probablement très affirmé, puisqu'on la surnommait Calamité à l'internat, Louise ne s'est jamais mariée. Sans doute il ne lui a pas été donné de rencontrer l'homme de sa vie, car on remarquera que sur les quatre nouvelles qui composent ce recueil, trois concernent le sujet du mariage. Chez ces âmes féminines qu'une triste insensibilité populaire charge volontiers de l'injuste stigmate de vieilles filles, il n'est pas rare de rencontrer un fort besoin de rédemption inversée : la femme rachète l'homme. C'est le cas présenté par chacune de ces trois aventuresa, dont la plus piquante reste certainement Le Portrait de Greuze, où l'on verra l'anti-héros saisir enfin la réalité après avoir couru après l'ombre.
Le titre de Coccinelles trouve son explication dans la très spirituelle dédicace que l'auteur adresse au peintre et littérateur Frédéric Berthoud. Elle s'y demande jusqu'où s'envoleront les petites bêtes à bon Dieu à qui elle a donné le jour : Jusqu'au siècle d'internet, ce qui n'est déjà pas mal, pourrions-nous lui répondre aujourd'hui. Louise pour sa part a rejoint son Sauveur, et céleste Époux, le 11 mars 1914.
Coccinelles, genre d'insectes coléoptères, vulgairement appelés bêtes à bon Dieu », — ainsi porte le dictionnaire de Littré. Il aurait pu ajouter que ce sont bestioles sans prétentions, nullement malfaisantes, mais sans utilité bien définie.
Elles sont de peu de poids aussi, — un brin d'herbe que le moindre souffle du vent ferait onduler, peut en porter plusieurs sans ployer.
Elles ne sont point importunes comme les mouches, elles ne font pas de bruit, — de bien innocentes créatures, somme toute !
Ne vous est-il jamais arrivé, mon oncle, de voir une de ces petites bêtes, au corselet rouge, noir ou jaune, pointillé de blanc ou de brun, s'enhardir jusqu'à venir courir sur votre main ?
Vous ne la rejetiez pas brusquement à terre, vous ne l'écrasiez pas sous vos pieds, — non, vous la laissiez arriver jusqu'au bout de vos doigts, et puis, vous lui donniez une secousse bienveillante, pour l'aider à s'envoler.
Elle s'envolait alors, mais ses ailes un peu lourdes ne la portaient pas loin. Bientôt elle retombait… N'importe, elle était heureuse d'avoir pu se soutenir un instant dans l'espace et son cœur de bestiole demeurait rempli de reconnaissance pour l'appui trouvé auprès de vous.
Bien simples aussi, sans prétentions et sans malice, sont les nouvelles contenues dans ce volume. Comme les petits insectes, que l'été voit naître et mourir, elles sont venues à vous et au lieu de les anéantir par vos critiques, vous avez étendu la main pour leur laisser prendre leur vol.
Jusqu'où les portera-t-il ? On ne le sait.
Quoi qu'il en soit elles osent réclamer encore la continuation de votre bienveillance et mettre leur existence sous l'égide de votre nom vénéré.
Louise Cornaz.
Depuis huit jours que son dernier roman avait paru, Jacques Trachel se tenait éloigné de Paris, au lieu de se mettre en évidence, comme volontiers il le faisait à chaque mise en vente d'un volume nouveau.
S'il se cachait ainsi — car il se cachait positivement — c'est que sa renommée, jusqu'alors bruyante, voire tapageuse, lui paraissait courir un réel danger.
Il prévoyait, de la part de ses lecteurs habituels, des critiques, des railleries, des protestations même et prudemment s'y dérobait, préférant infiniment ignorer ce que l'on dirait de la fraîche et pure idylle qu'il venait de signer, lui, un des écrivains les plus en vue de l'école naturaliste, un des plus fervents disciples de Schopenhauer et de M. de Hartmann. A cette heure, lui-même ne comprenait plus comment il avait pu renier ainsi les tendances littéraires, qu'il appelait de bonne foi ses convictions, bien qu'elles fussent nées uniquement d'un grand besoin de succès bruyants.
Comme on ne saurait peindre impunément des choses d'un réalisme outré, ni déclamer en vain contre la vie, Trachel en était arrivé à ne plus voir que les laideurs de l'existence, mais, sans qu'il s'en doutât, son œuvre nouvelle témoignait d'une inspiration toute personnelle, qui faisait défaut à ses romans précédents.
Il l'avait écrite sans nul souci de la mode, ou des modèles à suivre, tout simplement sous l'empire d'une impression très vive, rapportée de Savoie, peu de mois auparavant.
Trachel faisait à cette époque une cure à Evian, car on a beau maudire la vie et la proclamer un mal, on y tient quand même, ne fût-ce que par habitude, et le pessimisme du jeune homme ne l'empêchait point de prendre soin de sa santé.
Un jour, surpris par un orage, pendant une promenade, il se vit forcé de chercher un abri dans une petite maison de paysans, à demi cachée sous de grands châtaigniers.
Au premier abord elle lui parut déserte. La cuisine, dans laquelle on pénétrait par quatre marches de molasse effritée, était vide ; on n'y entendait d'autres bruits que ceux du dehors. Satisfait d'avoir un toit sur sa tête, au moment où la tempête se déchaînait dans toute sa violence, le jeune homme repoussa la porte derrière lui et se mit à considérer, d'un air distrait, des assiettes de faïence grossière, ornées de dessins bizarres, alignées sur un dressoir noirci par la fumée.
— Est-ce toi, Claudine ? cria tout à coup une voix qui semblait venir du fond de la cuisine.
Trachel se dirigea de ce côté-là. Une porte qu'il n'avait pas encore remarquée se trouvait devant lui ; il l'ouvrit toute grande sans hésiter.
Elle donnait accès dans une chambre basse, éclairée par deux fenêtres, très rapprochées l'une de l'autre, au travers desquelles la pluie entrait à flots, tandis que le vent, s'engouffrant dans les rideaux blancs, les gonflait comme des voiles.
Une femme était couchée sur une chaise longue, placée en face des fenêtres. Elle paraissait transie et de grosses gouttes de pluie tombaient, à chaque instant, jusque sur ses mains et son visage, blancs comme de la cire.
Elle poussa une exclamation de surprise, en voyant paraître sur le seuil, non pas la robuste Savoisienne dont elle attendait le retour, mais un étranger ; et lui-même demeurait interdit devant cette figure immobile, qui se laissait ainsi inonder, comme à plaisir.
Enfin, retrouvant son sang-froid, il lui expliqua comment il se faisait qu'il fût là, tandis qu'elle le priait de fermer les fenêtres, ajoutant, sans amertume ni regret dans la voix, qu'elle était infirme et ne pouvait marcher.
Il y avait tant de pathétique simplicité dans la manière dont elle disait cela, que Trachel s'inclina respectueusement devant elle, sans prononcer les paroles de banale sympathie qu'il avait eues, au premier moment, sur les lèvres.
Elle lui indiqua d'un geste une chaise, placée non loin d'elle ; il s'y assit et peu à peu ils se mirent à causer, laissant le vent secouer la maison et la pluie battre les vitres avec fureur. Les éclairs se succédaient presque sans interruption. Par moments le bruit du tonnerre couvrait celui de leurs voix ; ils se taisaient alors, elle regardant au dehors, lui la considérant avec un intérêt mêlé de pitié.
Trompé, au premier abord, par l'expression de souffrance que la maladie imprimait à ses traits, il s'apercevait maintenant que cette pauvre paralytique solitaire était, en réalité, une toute jeune fille.
Bien portante, elle aurait eu plus d'éclat, sans doute, mais non pas, peut-être, ce charme doux et pénétrant que répand autour d'elle une âme pure, joyeuse et résignée dans l'épreuve.
Confiante comme on l'est à son âge, elle eut bien vite mis l'étranger au courant de tout ce qui la concernait.
Atteinte d'un mal qu'aucun remède n'avait pu vaincre, son père, médecin à Bourges, avait voulu essayer d'un changement d'air et il l'avait envoyée là, tout près d'Evian, au pied des Alpes, chez sa nourrice, une brave paysanne.
Celle-ci la soignait de son mieux, aidée de sa propre fille, et se désolait, certainement, à cette heure de la sentir seule à la maison pendant l'orage.
Cet abandon, très accidentel et très rare, n'affectait point la jeune malade. Elle savait que la bonne et vigilante Claudine allait rentrer, aussi sans inquiétude et sans impatience et avec la franchise naïve d'une enfant, heureuse d'ouvrir son cœur en toute occasion, elle parlait à ce visiteur inconnu de sa famille et d'elle-même, comme à un vieil ami.
Elle lui disait comment de jeunes frères et de jeunes sœurs, aussi bien que les devoirs d'une maîtresse de maison, retenaient sa mère loin d'elle et lui confiait ses espérances de guérison, confirmées déjà par les promesses du docteur d'Evian qui la visitait.
Et pendant qu'elle parlait l'orage se calmait. Les coups de tonnerre devenaient plus sourds en s'éloignant, mais l'averse ne paraissait pas prête à cesser, elle tombait maintenant avec la tranquille régularité des pluies qui durent longtemps.
Trachel, comprenant bien qu'il ne gagnait plus rien à attendre, se levait pour prendre congé, quand une grande fille dont les vêtements étaient mouillés de part en part et dont les souliers faisaient entendre à chaque pas un léger bruit d'eau, se précipita dans la chambre en s'écriant :
— Oh ! Mamzelle Stasie, combien j'ai été inquiète de vous pendant cet orage. Je vous savais près de la fenêtre ouverte ! — Elle s'arrêta tout à coup ; elle venait d'apercevoir Trachel, qu'elle toisa de la tête aux pieds d'un regard étonné, puis elle ajouta : « Heureusement quelqu'un l'a fermée, sans cela vous auriez été à moitié noyée. »
La jeune fille se mit à rire doucement à cette idée, disant qu'il eût été terrible vraiment de devoir mourir de cette manière, tandis que Trachel assurait de son côté qu'il se félicitait d'avoir pu se rendre utile, en échappant lui-même à la tempête.
Tout en parlant il avait relevé son chapeau, posé à terre, près de sa chaise. Le voyant ainsi prêt à partir, la jeune malade et la paysanne insistèrent pour lui faire prendre un parapluie, sans lequel il ne retirerait aucun profit de sa halte forcée.
Il accepta, sans se faire trop prier, le grand riflard en coton verdâtre, que Claudine avait tiré des profondeurs d'une armoire, et qu'elle lui présentait en se disant, à part elle, qu'il contrastait d'une façon un peu étrange avec son élégant costume, irréprochable chef-d'œuvre d'un coupeur de Paris.
— Me permettrez-vous, mademoiselle, de le rapporter moi-même en venant prendre de vos nouvelles ? demanda-t-il en s'inclinant devant la frêle petite créature, étendue sur la chaise longue.
— Vous me ferez plaisir, répondit-elle avec simplicité, j'aime les visites et j'en ai bien peu. En même temps elle lui tendait sa main blanche et mince, qu'il serra dans la sienne, avec un sentiment de respect, tout à fait nouveau chez lui.
Au moment de quitter la chambre, il sembla se rappeler qu'il avait oublié quelque chose et revint en arrière en souriant.
— Il est juste que je vous donne mon adresse, pour le cas où j'oublierais de vous restituer votre parapluie, mademoiselle. Je demeure au Grand-Hôtel des Bains et je m'appelle Jacques Trachel.
— Oh ! s'écria Claudine, ce n'était pas nécessaire de le dire, rien qu'à vous voir on comprend que vous êtes un honnête monsieur.
Il la remercia du compliment et s'éloigna, non sans avoir constaté, avec une secrète mortification, que ni l'une ni l'autre de ses deux auditrices n'avaient eu l'air de se douter que son nom ne fût pas celui du premier venu. Evidemment il ne s'attendait pas à trouver en elles des lectrices de ses romans, mais bourgeoises ou paysannes, grandes ou petites mondaines, toute femme devait savoir que parler à Jacques Trachel constituait un événement dont l'on pouvait, à bon droit, être fière. Pour se consoler, il se rappela qu'il avait eu à faire à deux enfants ignorantes, puis il oublia tout à coup la légère éraflure faite à son amour-propre d'auteur et sa pensée se reporta avec sympathie sur la position triste et dépendante de cette jeune fille, qui paraissait accepter la souffrance comme une chose toute naturelle, et ne songeait pas à s'en plaindre. Il éprouvait pour elle une compassion sincère et sans phrases, et l'idée ne lui vint pas de joindre le récit de sa rencontre avec elle à la liste des faits qu'il cataloguait pour les mettre plus tard en volumes.
Ce n'était pas l'écrivain qui dominait en lui en ce moment, c'était l'homme et ce fut encore ce dernier, infiniment meilleur que le premier, qui reprit le lendemain le chemin par lequel on se rendait à la maison, sur laquelle les châtaigniers étendaient leurs grandes branches. Ce fut lui, toujours, qui prit l'habitude de suivre, souvent, cette même route.
Il apportait à la petite malade des fleurs, des bonbons, des romans traduits de l'anglais, à l'usage des pensionnats de demoiselles. Parfois il lui arrivait même de lui en lire quelques chapitres de sa voix mâle et bien timbrée, qu'il savait moduler avec un art exquis. Quand il trouvait son livre par trop fade, il le fermait et se mettait à lui raconter des histoires qu'il inventait au fur et à mesure, pour le seul plaisir de la voir sourire, et dans lesquelles on ne retrouvait pas trace de sa tendance morbide à ne peindre jamais que des choses très laides ou très tristes.
Il aimait aussi à l'entendre causer, à lui faire raconter ses simples souvenirs d'enfance, ou à la questionner sur ses frères et sœurs. Elle s'animait alors, et les éloges, les exclamations d'enthousiasme, les anecdotes ne tarissaient pas. Elle déroulait pour lui tout le chapelet des bons mots de Raoul, des espiègleries de Nini, des prodiges d'intelligence de Toto. Elle lui avait confié aussi un gros chagrin à elle, qui consistait à avoir été affublée, par la volonté d'une vieille marraine, du nom d'Anastasie.
— N'est-ce pas affreux ? lui avait-elle dit d'un ton absolument lamentable, et sans attendre sa réponse elle avait continué : — Mais tous ceux qui m'aiment m'appellent Stasie, vous ferez comme eux, n'est-ce pas ?
Charmé de cette confiance enfantine, il promit de ne se servir jamais, en s'adressant à elle, du nom détesté. Il déclara même que l'abréviation faisait le plus joli petit nom du monde, mais que lui aussi voulait à l'avenir être appelé par elle Jacques tout court.
Il ne la trouvait pas toujours dans la chambre basse, où il l'avait vue pour la première fois. Dès que le temps le permettait, on la transportait au grand air et l'on installait sa chaise longue au-dessus de la maison, sous les châtaigniers.
De là elle pouvait apercevoir, au travers des branches, les grands escarpements rocailleux de la Dent d'Oche. Ses yeux en suivaient les lignes fuyantes, presque perpendiculaires, près du sommet, plus penchées à mesure qu'elles se rapprochaient du lac, au bord duquel la base verdoyante de la fière montagne venait mourir. Les fortes chaleurs de l'été avaient fait disparaître toute trace de neige des flancs du colosse, mais le soleil, en poursuivant sa course journalière, le colorait de teintes qui changeaient avec les heures, bleuâtres et froides comme l'acier à celles du matin, toutes rouges au contraire, chaudes et brillantes comme du métal en fusion, à celles du soir.
Au bord de la petite pelouse, où se trouvait Stasie, l'horizon s'élargissait démesurément.
Au premier plan la jeune fille voyait serpenter la route par laquelle on se rendait à Evian. Neuvecelle, en dessinant sur le miroir du lac les contours arrêtés de ses grands toits et de son clocher, l'empêchait de voir la petite ville elle-même, mais le son de ses cloches montait, le soir, jusqu'à elle.
Oh ! ces sonneries qui formaient, à l'heure des vêpres, de si beaux concerts, comme elle les aimait !
Elle savait distinguer, au milieu de cet immense carillon, les sons clairs des cloches de Maxilly de ceux plus profonds, plus sourds et plus solennels qui descendaient, par dessus les bois, du village de Saint-Paul. Il lui semblait entendre des voix mystérieuses et, joignant les mains, elle se laissait emporter par elles vers les régions, lointaines et radieuses, où la souffrance n'est plus, où les dissonances de la terre se fondent en un accord merveilleux. Mais les cloches ne sonnaient que par intervalles, pourtant Stasie trouvait toujours autour d'elle tant de choses à voir que, même seule, elle ne s'ennuyait jamais, et son petit visage blême s'éclairait, dès qu'on la ramenait sous les châtaigniers. Au delà des prairies et des vergers, qui étalaient devant elle leur verdure et leurs arbres, elle voyait miroiter la grande étendue bleue du lac, sur laquelle elle ne se lassait point de voir passer les ombres des nuages, les fumées des bateaux à vapeur et les barques, dont les hautes voiles triangulaires ressemblaient, déployées, à de gigantesques ailes d'oiseaux.
De l'autre côté du lac la rive suisse déroulait son panorama varié. A droite le Moléson dressait vers le ciel son front superbe, tandis qu'à gauche, dans un lointain vaporeux, le Jura ne semblait plus qu'une ligne bleuâtre entre le double azur du ciel et du Léman.
En face de Stasie le Jorat baignait dans les flots le pied de ses coteaux couverts de vignes, au milieu desquels s'élevaient des villes ou des villages dont les fenêtres et les toits garnis de zinc étincelaient aux derniers feux du jour, comme autant de petites flammes.
La jeune fille s'était prise d'une admiration passionnée pour cette nature à la fois imposante et gracieuse, riante et grandiose, et cette admiration, elle s'efforçait de la faire partager à son ami Jacques, comme elle aimait à appeler Trachel.





























