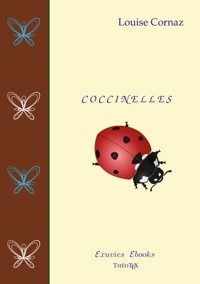0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
C’est à Lyon, où son père possédait une étude de notaire, qu’était née, le 4 décembre 1777, Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard.
Nommé, en 1784, receveur des finances, Jean Bernard quittait Lyon pour s’établir à Paris, avec sa femme, dans un hôtel de la rue des Saints-Pères. Leur fille Juliette ne les y rejoignit qu’après avoir passé quelques années au couvent de la Déserte où une de ses tantes était religieuse. « Je quittai à regret une époque si calme et si pure », écrivait-elle plus tard à propos de sa sortie du couvent, « elle me revient quelque fois comme dans un vague et doux rêve, avec ses nuages d’encens, ses cérémonies infinies, ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs. »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Louise Cornaz MADAME RÉCAMIER
1900
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383836711
IPREMIERS SUCCÈSET PREMIERS REVERS
C’est à Lyon, où son père possédait une étude de notaire, qu’était née, le 4 décembre 1777, Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard.
Nommé, en 1784, receveur des finances, Jean Bernard quittait Lyon pour s’établir à Paris, avec sa femme, dans un hôtel de la rue des Saints-Pères. Leur fille Juliette ne les y rejoignit qu’après avoir passé quelques années au couvent de la Déserte où une de ses tantes était religieuse. « Je quittai à regret une époque si calme et si pure », écrivait-elle plus tard à propos de sa sortie du couvent, « elle me revient quelque fois comme dans un vague et doux rêve, avec ses nuages d’encens, ses cérémonies infinies, ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs. »
Jamais assurément la jeune pensionnaire ne devait retrouver des jours « si calmes et si purs ». Elle allait au-devant d’une existence exceptionnellement brillante, pleine de triomphes et de succès dont bien peu de femmes ont connu l’équivalent ; des admirations, des adorations sans bornes allaient s’offrir à elle ; pourtant ce qu’elle quittait est resté certainement ce qui a le plus ressemblé au bonheur dans la longue carrière à la fin de laquelle elle disait parfois : « La vie que j’ai menée n’est pas enviable. »
Juliette Bernard était déjà, quand elle arriva chez ses parents, très jolie, aimable et gaie. Elle n’avait pas encore l’incomparable beauté qui devait la faire tant remarquer plus tard, mais déjà elle ne passait point inaperçue. Sa mère, une femme élégante, aimant le faste et le bruit, se plaisait à la parer comme une idole et à la produire dans le monde, ce que la fillette trouvait infiniment plus ennuyeux qu’amusant. Cela n’empêchait cependant point Mme Bernard de veiller à ce qu’elle reçût une éducation soignée. Juliette fut bientôt bonne musicienne, – elle chantait, jouait de la harpe et surtout du piano, qui resta, jusqu’à la fin de sa vie, son instrument préféré. Elle dansait avec une grâce extrême et pendant les premières années de sa jeunesse elle aima la danse avec passion, mais elle l’abandonna de bonne heure. Les arts d’agrément ne formaient point d’ailleurs sa seule étude, car Mme Bernard tenait à ce que son intelligence ne fût pas moins développée que ses talents.
On recevait une société nombreuse et cultivée chez M. et Mme Bernard. Ils menaient un grand train de vie ; leur hospitalité très large et leur amabilité attiraient chez eux beaucoup de gens d’esprit. Ils avaient une loge aux Français ; ils donnaient des fêtes fréquentes. Juliette prit ainsi, de bonne heure, une si grande habitude du monde que jamais, dans la suite, elle n’éprouva le moindre embarras à se trouver en contact avec la société la plus haute et la plus distinguée non seulement de Paris, mais de l’Europe entière.
Elle avait quinze ans quand elle épousa, de son plein gré, un banquier, Lyonnais d’origine, mais fixé à Paris, M. Jacques Récamier, de vingt-sept ans plus âgé qu’elle. Elle voyait en lui un ami de sa famille, un homme bon et enjoué qui lui témoignait une affection paternelle ; elle n’en demanda pas davantage. Cette affection, qui ne changea point de nature, et ne fut que celle d’un protecteur et d’un ami, lui suffit-elle toujours ? Ne regretta-t-elle jamais d’avoir lié sa vie si tôt et si imprudemment ? Il est probable, il est même certain que oui, mais elle n’en refusa pas moins, chaque fois qu’elle en fut sollicitée, de rompre un lien qui n’avait de réel que les apparences.
Le mariage de Juliette eut lieu le 24 avril 1793. On était en pleine Terreur ; la vie de Paris semblait être comme suspendue, tous les salons étaient fermés ; l’unique préoccupation était de se faire oublier ; aussi pendant quatre ans M. et Mme Récamier vécurent-ils dans l’ombre, ne voyant et ne recevant presque personne.
« Durant les temps qui succédèrent immédiatement à la Terreur, tout le monde craignait d’avoir l’air de posséder un foyer. On se rencontrait dans les lieux publics », dit Chateaubriand. Ce ne fut donc point dans les salons, – il n’y en avait plus, – que la jeune femme, dont la beauté s’était merveilleusement épanouie, remporta ses premiers triomphes, mais à la promenade de Longchamp où, un matin du printemps de 1801, elle fut l’objet d’une véritable ovation, et à l’église de Saint-Roch, où, un jour qu’elle quêtait pour une bonne œuvre, la foule qui envahissait la nef se pressa pour la voir, au point qu’elle faillit être écrasée. La quête produisit vingt mille francs, et la réputation de la belle Juliette se répandit jusque dans les rues où, comme elle le disait elle-même plus tard, « les petits Savoyards se retournaient pour la regarder ».
Benjamin Constant raconte que les premières années du mariage de Mme Récamier se passèrent entre des occupations poétiques, des jeux enfantins dans la retraite et de courtes et brillantes apparitions dans le monde. Le monde, à cette époque, c’était la société du Directoire ; M. et Mme Récamier ne la fréquentèrent point et ne franchirent qu’en deux occasions le seuil du Palais du Luxembourg, où se donnaient les fêtes officielles. La première fois que Mme Récamier y parut, on célébrait le retour d’Italie du général Bonaparte. Elle ne l’avait jamais rencontré jusqu’alors, et, pour le mieux voir, elle se leva, pendant une harangue que lui adressait Barras. Elle était si rayonnante, dans sa robe blanche, que tous les yeux se tournèrent de son côté et qu’un long murmure d’admiration remplit la salle. Furieux de voir l’attention se détourner de lui un instant, Napoléon la foudroya du regard et, toute confuse, elle se hâta de se rasseoir.
La position de M. Récamier, ses hautes relations d’affaires, la beauté et la grâce de sa femme groupèrent bientôt autour d’eux, dans l’hôtel de la rue du Mont-Blanc, – maintenant rue de la Chaussée d’Antin, – qu’ils venaient d’acquérir de M. Necker, et dans le château de Clichy, où ils passaient une grande partie de l’année, une société formée de tout ce que Paris comptait de plus distingué, soit comme rang, soit comme intelligence. L’ancien et le nouveau régime s’y coudoyaient ; les membres de la famille Bonaparte, les partisans du Consulat s’y mêlaient à ceux de l’ancien régime et aux représentants des meilleures familles de France. Leur salon fut le premier qui rouvrit ses portes et fut, pendant assez longtemps, l’unique centre de ralliement de ce monde encore si troublé et si désorganisé.
On n’y faisait pas de politique ; les maîtres de la maison n’avaient aucune raison de se montrer hostiles à l’homme dont la puissance grandissait chaque jour et qui déjà régnait en despote et ne supportait aucune rivalité autour de lui. Mais bientôt l’arrestation de M. Bernard, qui, accusé de complicité avec les chouans, ne dut son élargissement qu’à l’intervention de Bernadotte, le bannissement de Moreau, l’exécution du duc d’Enghien et surtout l’exil de Mme de Staël froissèrent les sentiments d’admiration et la sympathie que Mme Récamier avait, jusqu’alors, éprouvés pour Napoléon. Les démarches que Fouché fit à la même époque, pour attirer et fixer à la cour la jeune femme, à laquelle il ne cacha pas le rôle qu’il espérait lui voir jouer bientôt auprès de son maître, achevèrent de la détacher de l’Empire naissant.
Mme Récamier ne tarda pas à subir les conséquences d’un refus tout à son honneur. Au cours de l’automne de 1806, la maison de banque de son mari se trouva dans un embarras momentané, dont la Banque de France aurait pu aisément l’aider à sortir, si le gouvernement n’avait pas refusé son autorisation à l’appui sollicité. Du jour au lendemain, la ruine atteignait un des plus puissants établissements financiers de la capitale. M. Récamier fit à ses créanciers l’abandon de tout ce qu’il possédait ; sa femme vendit jusqu’à son dernier bijou. Ils sortirent de cette crise, l’honneur sauf et la tête haute, grandis dans l’estime de tous ceux qui les connaissaient, mais réduits à une situation de fortune qui, comparée à leur opulence passée, était presque de la pauvreté.
Mme Récamier fut comme idéalisée par ce premier revers, auquel s’ajouta bientôt la mort de sa mère. L’épreuve entourait sa beauté d’une auréole ; l’amertume de voir autour d’elle des défections et des froideurs lui fut épargnée. « Ses amis lui restèrent, et cette fois la fortune s’éloigna seule », écrivait un jour le plus dévoué de tous ceux qui l’ont aimée, le philosophe Ballanche. Son salon, pour être devenu plus simple et s’être rapetissé, n’en fut pas moins fréquenté ; un cercle d’hommes d’élite, d’esprits éminents, d’artistes, de littérateurs continua à s’y presser, – seulement la politique peu à peu s’y glissait et, de plus en plus, les habitués s’en recrutaient dans tous les rangs de l’opposition.