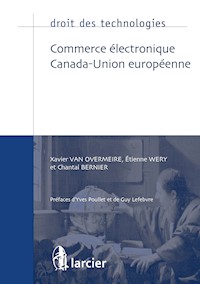
94,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Éditions Larcier
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Droit des technologies
- Sprache: Französisch
Le développement fulgurant des nouvelles technologies a grandement favorisé le développement du commerce électronique dans le monde. Il convient donc de s’intéresser encore davantage à la capacité d’adaptation de nos lois à la publicité sur Internet, au contrat électronique, à la protection de la vie privée ou encore à la responsabilité des prestataires de services Internet.
Même si ce nouveau monde virtuel est par essence un monde sans frontières, les règles régissant le commerce électronique diffèrent d’une zone territoriale à une autre. Ces différences tenues et marquées à la fois entre l’UE et le Canada ne sont pas sans conséquence lorsqu’on interagit sur le Web avec des prestataires de services établis sur les deux continents. Avoir conscience de ces différences et parfois de ces ressemblances permettra aux utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou consommateurs, d’interagir avec confiance et en toute connaissance sur la toile.
Une analyse plus approfondie des lois et directives applicables, ainsi que des précédents judiciaires, permet non seulement d’obtenir une vision plus claire des protections accordées aux utilisateurs d’Internet de part et d’autre de l’Atlantique tout en permettant d’identifier les principaux enjeux qui découlent des spécificités techniques et territoriales entre le Canada et l’Union européenne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Diffusion en Belgique et autres pays : ELS Belgium s.a. Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles & 0800/39 067 • +32 (0)2 548 07 13 • 6 0800/39 068 • +32 (0)2 548 07 14 [email protected] • [email protected] en France : UP Diffusion • [email protected]él. : 01 41 23 67 18 • Fax : 01 41 23 67 3011 rue Paul Bert • F-92247 Malakoff • www.updiffusion.fr
Les opinions développées dans ce livre n’engagent que son auteur et non l’Institution à laquelle il appartient.
© ELS Belgium s.a., 2018
Éditions Larcier
Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN : 9782807911475
Collection Droit des technologies
Sous la direction de Étienne Wéry et Jérôme Huet
La collection rassemble des ouvrages traitant des aspects juridiques, régulatoires, voire éthiques des nouvelles technologies au sens le plus large. Ils s’adressent aux juristes mais aussi aux professionnels et utilisateurs de ces nouvelles technologies.
Chaque sujet est traité de façon complète mais concise, le plus souvent en droits européen, français et belge
Déjà parus :
Thibault VERBIEST, Commerce électronique : le nouveau cadre juridique. Publicité - Contrats - Contentieux, 2004
Étienne WÉRY, Sexe en ligne : aspects juridiques et protection des mineurs, 2004
Thibault VERBIEST, Le nouveau droit du commerce électronique. La loi pour la confiance dans l’économie numérique et la protection du cyberconsommateur, 2005
Valérie SEBAG, Droit et bioéthique, 2007
Étienne WÉRY, Paiements et monnaie électroniques. Droits européen, français et belge, 2007
Étienne WÉRY, Facturer électroniquement. Droits européen, français et belge, 2007
Franklin DEHOUSSE, Thibault VERBIEST et Tania ZGAJEWSKI, Introduction au droit de la société de l’information. Synthèse en droits belge et européen. Convergence télécoms - Audiovisuel - Internet, 2007
Philippe ACHILLEAS (dir.), Droit de l’espace. Télécommunication – Observation – Navigation – Défense – Exploration, 2009
Stéphanie LACOUR (dir.), Des nanotechnologies aux technologies émergentes, 2013
Pierre-François DOCQUIR et Muriel HANOT (dir.), Nouveaux écrans, nouvelles régulations ?, 2013
Céline BLOUD-REY et Jean-Jacques MENURET (dir.), Le droit de la régulation audiovisuelle et le numérique, 2016
Préfaces
L’ambition poursuivie par ces auteurs dont les noms sont bien connus et appréciés dans les cercles du droit du numérique des deux côtés de l’Atlantique s’exprime modestement : « amener la confiance », et ce, par une meilleure connaissance des environnements réglementaires d’un commerce qui n’a plus de frontières et singulièrement pas entre les continents nord-américain et européen. À l’heure des dernières discussions à propos des accords AECG (Accords économiques et commerciaux généraux) entre le Canada et l’Europe, on sait, en particulier en Wallonie, combien cette confiance est nécessaire et pourra contribuer à un développement des échanges commerciaux, spécialement par voie électronique, entre les deux partenaires. On s’étonne que le contexte de ces accords ne soit mentionné qu’en conclusion de l’ouvrage, qui reprend les extraits significatifs de l’Accord en ce qui concerne précisément les actions à développer pour mieux harmoniser les réglementations(1).
D’emblée, les auteurs précisent l’ambition de l’ouvrage : il ne s’agit pas d’un traité analysant chaque thématique juridique liée au commerce électronique. Seuls les thèmes essentiels sont abordés : la publicité en ligne, le contrat électronique (formation, preuve et questions particulières liées aux contrats B to C), la protection des données à caractère personnel et la responsabilité des intermédiaires, laissant de côté des questions comme les droits de propriété intellectuelle, la liberté d’expression et la criminalité informatique ou des questions plus spécifiques comme les aspects juridiques du cloud ou des blockchains.
En un nombre de pages limitées – on mesure l’exploit – les auteurs nous permettent de saisir, de manière claire, simple, mais toujours précise, les approches développées des deux côtés de l’Atlantique, au Canada principalement, avec de temps en temps un débordement vers la situation réglementaire aux États-Unis. Il s’agit, à cette occasion, d’en montrer les ressemblances et parfois les différences, et d’illustrer leurs propos par quelques sommaires de jurisprudence sur les thèmes traités. Une première annexe reprend les textes réglementaires commentés ; une seconde renvoie à une bibliographie législative, doctrinale et jurisprudentielle. Que ce soit celui qui souhaite simplement être introduit au droit du commerce électronique ou celui qui souhaite prolonger cette introduction, chacun trouvera dans l’ouvrage les éléments nécessaires à son bonheur.
L’ouvrage débute par un court rappel des éléments essentiels du droit « constitutionnel » canadien et européen. Pour le lecteur européen, on soulignera les réflexions sur les particularités du fédéralisme canadien, à la fois de common law et de droit civil, et construit sur une répartition des compétences entre l’État fédéral et les provinces, difficile à comprendre.
Chacune des parties et sous-parties poursuit son propre plan. Certaines développent de manière résumée les aspects techniques sous-jacents aux problèmes juridiques (cf. en particulier la partie sur la publicité qui évoque les médias utilisés, les évolutions par l’utilisation des technologies et les techniques susceptibles d’être mises en place pour éviter les conflits de juridictions) ; toutes distinguent, en points séparés, les approches réglementaires européennes et canadiennes. On peut regretter que les auteurs ne procèdent pas systématiquement ensuite à une analyse comparative de ces approches, même si elle ressort souvent clairement de leurs exposés (exemple parmi bien d’autres : « À la différence du droit européen, la LPC n’impose pas au commerçant d’indiquer dans ses informations précontractuelles, le rappel de l’existence d’une garantie légale, de services après-vente ou de code de conduite le cas échéant »). Le lecteur sera donc attentif à ces divergences qui, sans être d’importance égale, méritent d’être analysées par les opérateurs économiques et leurs clientèles lors des flux transfrontières outre-Atlantique.
Ainsi, je souligne quelques exemples non exhaustifs notés à la suite des auteurs. En matière de publicité, le Canada développe, outre la loi générale sur la concurrence, un système d’autorégulation à travers le « Code canadien des normes de la publicité » (www.adstandards.com/fr/Standards/canCodeOfAdStandards.aspx), là où l’Europe poursuit une approche législative à travers les directives bien connues sur le commerce électronique et celles sur les pratiques commerciales déloyales ; la notion de consommateur est définie de manière plus étendue en Europe qu’au Canada. Toujours en matière de publicité, là où le critère suivi en Europe pour apprécier le caractère trompeur d’une publicité est le « consommateur moyen », les tribunaux canadiens préfèrent celui d’« impression générale » donnée par la publicité sans référence à la qualité du consommateur. On note également des approches différentes sur des questions particulières, comme la publicité pour enfants : alors que le Canada proscrit toute publicité pour enfants, en Europe ce n’est qu’avec le règlement de protection des données à caractère personnel qui soumet la publicité pour enfants à l’autorisation parentale. En matière de spamming, ou de pourriels comme aiment à dire les Québécois, l’Europe aurait peut-être intérêt à suivre l’exemple canadien offert par la loi de 2014. Enfin, en matière d’insertion via un méta tag du nom d’un concurrent, les auteurs soulignent les résultats discordants des jurisprudences européenne et canadienne : la première admet de telles utilisations, alors que la seconde y voit une forme de parasitisme.
En matière cette fois de contrat électronique, on relève que les deux ordres juridiques classent le contrat électronique suivant les mêmes caractéristiques (contrat à distance et contrat d’adhésion), ce qui n’empêche pas des divergences à propos de certaines questions spécifiques. Ainsi, en ce qui concerne la notion de « clauses abusives », les auteurs soulignent que la common law canadienne ne donne pas de définitions de cette notion. Autre exemple : à propos de l’opposabilité des clauses contractuelles, les clauses dites externes, c’est-à-dire nécessitant l’activation d’un hyperlien, ne sont pas valables en Europe, mais peuvent l’être au Canada (voy. l’arrêt Dell cité à titre d’illustration), sauf si le Code civil québécois prévoyant l’inopposabilité d’une clause non portée à la connaissance du consommateur s’applique. On ajoute que ce dernier droit ne connaît pas le droit de rétractation du consommateur, même si certains moyens juridiques sont possibles pour arriver à un résultat proche de celui lié chez nous à ce droit, en particulier au Québec, avec le droit à la rétrofacturation institué par la loi sur la protection du consommateur. Enfin, dernier exemple, la reconnaissance de la validité de la signature et du document électroniques semble plus aisée au Canada avec la loi PIPEDA (à l’exception du Québec, avec sa loi de 2001 concernant le cadre juridique des technologies de l’information) que sous le règlement 910/2014 « electronic IDentification, Authentication and trust Services » (eIDAS).
À propos de la protection des données à caractère personnel, les auteurs consacrent une part importante de leurs réflexions aux dispositions du nouveau règlement européen en vigueur le 25 mai 2018 et leur analyse est solide. Sans doute, dans le contexte de l’examen des régimes juridiques applicables aux flux électroniques entre nos deux continents, y aurait-il eu intérêt à consacrer quelques mots, d’une part, à la portée territoriale du règlement qui s’étend désormais à tout traitement, même situé en dehors du territoire de l’Europe, qui constitue une offre de biens ou services à destination de personnes résidentes en Europe ou un suivi du comportement de ces derniers, et, d’autre part, au renforcement des exigences en matière de protection adéquate offerte par les pays tiers à l’Europe, ce qui, selon l’auteur de ces lignes, ne devrait pas soulever de difficultés en ce qui concerne le Canada.
Dernière remarque, à propos du dernier point couvert par l’ouvrage, en matière de responsabilité des intermédiaires, les auteurs soulignent l’approche québécoise qui fonde la responsabilité des intermédiaires sur l’analyse de l’activité proposée par ce dernier et non sur une qualification a priori des métiers, comme c’est le cas en Europe avec la directive dite : « Commerce électronique ».
Au terme de ces quelques considérations, qu’il me soit permis de remercier les auteurs de l’ouvrage d’avoir contribué, sur un sujet technique et bien souvent présenté de manière hermétique, à nous expliquer que même si les divergences existent entre les deux ordres juridiques étudiés (ou trois, le droit québécois apparaissant par ses multiples particularités comme une sorte d’intermédiaire entre les deux autres), les mêmes soucis de protection des consommateurs et de protection des libertés des citoyens aboutissent à des solutions souvent identiques obtenues certes par des voies originales. Prenant conscience de ces soucis communs, il s’agit d’aider – et nous reprenons le mot des auteurs – à créer la confiance des citoyens en surmontant les apparentes divergences d’approches juridiques, et ce, au-delà des barrières géographiques, langagières et culturelles. Il s’agit ainsi de promouvoir le commerce électronique et l’adoption par chacun de ses bénéfices.
Yves Poullet
Recteur honoraire de l’Université de Namur
Professeur honoraire à la faculté de droit
Professeur associé à l’Université catholique de Lille
Membre de l’Académie royale de Belgique
***
Si le commerce mondial continue à croître de façon importante depuis la crise financière de 2008, les données concernant le commerce électronique sont difficiles à colliger. Un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), daté d’octobre 2017(2), estime toutefois que les ventes mondiales effectuées au moyen du commerce électronique représentaient un montant de 25 300 milliards USD en 2015, dont 90 % se faisaient entre entreprises (B to B). Donc, seulement 10 % de ces ventes étaient effectuées avec des consommateurs (B to C). Les transactions issues du commerce électronique correspondaient, par ailleurs, à 6 % du PIB mondial, ce qui est relativement modeste. Ce type de transactions, on le sait, est toutefois en forte croissance.
Le commerce électronique est, cela dit, confronté à de multiples enjeux de nature juridique, dont plusieurs diffèrent des transactions effectuées par des modes plus traditionnels. On pense ici aux enjeux liés à la formation du contrat, à la preuve électronique, à la protection du consommateur et à la publicité en ligne, à la protection des données personnelles, à la responsabilité des tiers fournisseurs de services, aux modalités de paiement, à la propriété intellectuelle, à la fraude et aux cybercrimes, etc.
Qu’apporte l’ouvrage présenté par Xavier Van Overmeire, Étienne Wéry et Chantal Bernier dans ce contexte ? Dans leur introduction, les auteurs indiquent qu’il a pour ambition de mettre en lumière certains éléments inhérents au développement du commerce électronique et qu’il s’articule autour des thématiques de la publicité sur Internet, du contrat électronique et de la vie privée. Les auteurs ont donc fait un choix, celui de présenter un nombre limité de sujets, tout en faisant une synthèse de ceux-ci. L’ouvrage vise, selon ses auteurs, à « permettre aux non-professionnels du droit d’appréhender le droit du commerce électronique en le vulgarisant ». Il prend pour terrain d’analyse le droit de l’Union européenne et du Canada, tout en survolant le droit américain.
Mon collègue Yves Poullet s’étant principalement attardé au contenu de l’ouvrage, je me limiterai, pour ma part, à faire quelques remarques sur son utilité et à certaines constatations résultant de ma lecture de celui-ci.
Soulignons que l’une des utilités principales de l’ouvrage résulte de la grande qualité de la synthèse juridique. Le droit étant une matière qui peut apparaître fort difficile à cerner pour le non-initié, on peut certainement dire que les auteurs ont réalisé leur ambition. La lecture est particulièrement aisée et le découpage de la matière favorise bien sa compréhension. Nous estimons qu’il est très utile pour les non-juristes à qui il s’adresse. Il peut être également le point de départ d’une recherche plus approfondie pour le juriste non spécialiste dans ce secteur du droit, ou bien à celui qui vise à connaître rapidement les règles applicables. En ce sens, la synthèse de la jurisprudence européenne, apparaissant à la fin de l’ouvrage, est très efficace.
Sur le plan des constatations, je me permets de citer mon collègue Vincent Gautrais, spécialiste du commerce électronique, qui mentionne à juste titre, selon moi, « que le commerce électronique est encore adolescent ; les faits entourant son développement évoluent très rapidement sans que l’on ne mesure encore tout à fait l’ampleur de la révolution communicationnelle que nous sommes en train de vivre. Quant au droit, il tente, avec un succès assez mitigé, fort de ses lois, de ses jurisprudences, de ses normes de plus en plus nombreuses, d’encadrer le tout ; plus exactement, il essaye de donner une certaine impression d’encadrement »(3). La tendance des législateurs, tant européens que canadiens, vise à assurer aux utilisateurs du commerce électronique davantage de confiance sans toutefois réussir à accomplir pleinement leur rôle. Ainsi, le droit, avec ses sources usuelles (conventions, usages, lois, jurisprudence), tente avec un succès assez limité d’encadrer adéquatement ce secteur, qui prend de plus plus de en place. Sachant que le commerce électronique évolue dans un monde virtuel sans frontière, on assiste, ici comme ailleurs, à une incapacité réelle des autorités gouvernementales et des commerçants d’arriver à un encadrement juridique efficace face aux nombreux défis qui sont posés par ce type de transactions. Il y a bien quelques initiatives d’uniformisation du droit dans ce secteur, mais elles sont nettement insuffisantes. Il y a donc lieu de se demander si nos institutions sont réellement efficaces et si elles ne devraient peut-être pas se remettre en cause.
D’une façon plus spécifique, mentionnons que la réglementation européenne sur la protection des données nous apparaît particulièrement novatrice et pourrait certainement influencer les législateurs canadiens et québécois à travailler sur des projets de loi plus contraignants, compte tenu de la valeur commerciale et de l’importance de l’exploitation des données personnelles « collectées » sur la toile informatique.
En terminant, nous souhaitons qu’à l’avenir les auteurs envisagent une couverture plus large des sujets visés par le commerce électronique, ce qui permettrait à cet ouvrage d’être encore plus utile… Le défi est donc lancé aux auteurs de se lancer dans l’écriture d’une seconde édition !
Guy Lefebvre
Membre distingué de l’Ordre d’excellence en éducation du Québec
Avocat émérite au barreau du Québec (Ad. E.)
Professeur titulaire, faculté de droit, Université de Montréal
Vice-recteur aux affaires internationales et à la francophonie
(1) « Au niveau du commerce électronique, l’Accord prévoit que les parties s’engagent à respecter la vie privée des utilisateurs ; à favoriser le développement de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique. Il prévoit en outre qu’un dialogue entre les parties devra être tenu en ce qui concerne entre autres la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public ; la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations ; sur le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées (les spams, vus en partie I du présent ouvrage) et la protection des renseignements personnels et la protection des consommateurs et des entreprises contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans le domaine du commerce électronique ».
(2) unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf, p. XIII.
(3) V. Gautrais, « Préface », in A. Elloumi, Le formalisme électronique, Tunis, Centre de publication universitaire, 2011.
Préambule
Cet ouvrage est destiné à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension des enjeux liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, personne ne peut ignorer l’importance considérable du monde virtuel dans notre quotidien. Néanmoins, peu d’utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou consommateurs, ont une vision claire des enjeux et des défis légaux que les législateurs européens et canadiens s’évertuent à saisir pour un meilleur contrôle et une meilleure protection des utilisateurs. Ceci doit permettre d’instaurer un climat de confiance renforcé dans l’esprit de ces derniers.
Afin d’aider le lecteur à comprendre les principes inhérents au commerce électronique au sein de l’Union européenne et du Canada, il nous paraît indispensable d’expliciter au préalable le fonctionnement des deux systèmes juridiques.
1. L’Union européenne
A. Historique
L’Union européenne fut instituée par le Traité de Paris et le Traité de Rome dans les années 1950. Ces traités instituèrent les « communautés européennes » ayant pour principal objectif de créer un marché intérieur(1). Les aspects cardinaux du marché intérieur sont l’élimination des droits de douane entre les pays adhérents, la suppression des obstacles à la libre circulation des personnes, des services, et des capitaux(2). Le marché intérieur a par ailleurs favorisé l’essor de législations relatives notamment au droit du travail, au droit de la concurrence ainsi qu’à la libéralisation de secteurs émergents tels que les télécommunications. Le droit de l’Union européenne a également contribué au développement du droit de la protection du consommateur.
B. Institutions
L’Union est composée d’une multitude d’institutions reposant sur trois organes. Premièrement, la Commission européenne, chargée de veiller au respect des Traités de l’Union, est la voix de l’intérêt général européen(3). Son droit d’initiative lui permet de proposer des directives et des règlements et est à cet égard le véritable moteur de l’Union. Deuxièmement,le Parlement européen, dont la fonction principale est d’adopter les textes législatifs proposés par la Commission. Troisièmement, le Conseil de l’Union qui représente le gouvernement de chaque État membre.
Outre ces trois organes, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est l’une des plus fondamentales en ce qu’elle contrôle l’application et le respect des textes de l’Union tels que les directives et les règlements. La Cour statue principalement sur les recours en annulation, les recours en manquement, les recours en carence et les questions préjudicielles(4). « […] la Cour a été amenée non seulement à préciser le droit, mais également à en combler les lacunes par une jurisprudence créatrice, prétorienne, et même à pourvoir à son développement »(5). Sa jurisprudence lie tous les États membres.
C. Primauté du droit européen
Les rapports entre l’Union européenne et les États membres sont fondés sur un monisme juridique(6). À cet égard, l’arrêt Costa c. Enel a entériné dès 1964 la primauté du droit européen sur les ordres juridiques nationaux(7). Le droit de l’Union européenne prime dès lors sur les lois des pays membres, ceux-ci devant s’assurer de la compatibilité de leurs lois avec le droit européen.
D. Les règlements et directives : effet direct et/ou applicabilité immédiate
Les textes de lois adoptés par le Parlement européen (également appelé « droit dérivé »)(8) qui feront l’objet d’une attention particulière tout au long de cet ouvrage sont les règlements et les directives.
Les règlements sont des textes législatifs immédiatement applicables au sein des ordres juridiques nationaux(9). Ils lient les États membres dès leur publication, sans nécessiter de loi de transposition au sein des ordres nationaux. Ils sont également pourvus d’effet direct, c’est-à-dire « […] le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires »(10). Les règlements peuvent donc être invoqués en justice directement par les citoyens européens contre un État membre, mais également contre un particulier (effet direct complet)(11).
Les directives quant à elles, nécessitent une loi de transposition au sein des États membres. Les directives énoncent des lignes directrices que les États membres se doivent de respecter en ayant toutefois une marge de manœuvre quant aux moyens mis en œuvre pour les mettre en application. Les directives sont également dotées d’un effet direct, restreint toutefois, en ce que les particuliers ne peuvent invoquer une directive qu’à l’encontre d’un État membre et non pas contre un particulier(12).
2. Le Canada
A. Le fédéralisme
Le Canada est une monarchie constitutionnelle parlementaire basée sur le fédéralisme(13). Ancienne colonie britannique, le Canada dispose d’une constitution « reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni »(14). Pour cette raison, la principale source du droit canadien est la common law(15). Toutefois, il existe une exception à l’égard de la province du Québec qui, pour des raisons d’ordre historique, est à la fois régie par la common law britannique et le droit civil français(16).
Le Canada est constitué de dix provinces et de trois territoires. Il convient de distinguer d’une part l’État fédéral, compétent pour légiférer sur des matières de droit public, et d’autre part les provinces, compétentes en principe à l’égard du droit privé(17). Chaque province est considérée comme souveraine, autrement dit, elles sont indépendantes les unes des autres et vis-à-vis de l’État fédéral. Elles sont seules compétentes pour légiférer sur leur territoire à l’égard des matières qui leur ont été exclusivement attribuées par la Constitution.
B. Organisation judiciaire
Les cours et tribunaux du Canada sont chacun compétents dans la limite des compétences qui leur ont été attribuées. La jurisprudence d’un tribunal ne liera que ce même tribunal, et ce, au sein de la province en question. Dès lors, une décision de la Cour d’appel de l’Ontario n’aura pas d’impact sur la Cour d’appel du Québec. Seule la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (CSC) a préséance sur l’entièreté des tribunaux du pays. À cet égard, une décision rendue par la CSC portant sur l’interprétation d’un article du Code criminel devra être suivie par l’ensemble des cours du Canada.
C. La common law
La common law étant la principale source de droit au Canada, les décisions des tribunaux sont essentielles, car elles ont non seulement l’autorité de chose jugée (les parties sont liées par la décision sous réserve d’un appel ou d’une révision), mais également l’autorité du précédent qui consiste à reconnaître l’autorité d’une décision pour d’autres affaires analogues(18). Hormis dans la province du Québec, les décisions ont également l’autorité du judge-made-law, équivalente à la portée d’une loi en cas d’absence ou d’insuffisance de la législation. Il convient de souligner que le poids du précédent sera proportionnel au degré hiérarchique du tribunal ayant statué. Le Québec ne reconnaît l’autorité du judge-made-law qu’en matière de droit public fédéral.
D. L’exception du Québec : la tradition civiliste
Le droit privé au Québec provient de la tradition civiliste, basée essentiellement sur le droit écrit(19). Le Québec dispose d’ailleurs de son propre Code civil, dont les principes réfèrent au Code napoléonien.
E. En cas de litige, quelle est la loi applicable ?
Il n’est pas rare que tant le Parlement fédéral que les parlements provinciaux légifèrent sur une même matière. La loi fédérale sera applicable lorsque le litige en question vise une compétence exclusivement fédérale, une entreprise fédérale, ou lorsque le litige est de nature interprovinciale (p. ex., lorsque les parties proviennent de deux provinces distinctes). La loi provinciale s’appliquera lorsque le litige porte sur une compétence exclusivement provinciale, une entreprise provinciale ou en cas de litige dont les intérêts se situent exclusivement sur le territoire d’une province déterminée (intra-provincial).
À titre d’exemple, et en vue d’introduire le présent ouvrage, en matière de responsabilité des intermédiaires techniques d’Internet, « même si c’est la LPRPDE [Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques] (loi fédérale) qui régit de façon générale les fournisseurs de services Internet, la loi québécoise pourrait régir certains autres prestataires techniques sur Internet, par exemple, un hébergeur, dans l’éventualité où ce dernier est une entité québécoise ou qu’il héberge des sites à partir d’un serveur situé au Québec »(20).
(1) C. Degryse, Dictionnaire de l’Union européenne, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 1050.
(2) Ibid., p. 580.
(3) Ibid., p. 204.
(4) Ibid., p. 257.
(5) S. Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, p. 454.
(6) Ibid., p. 463.
(7) CJUE,1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64.
(8) Versions consolidées du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JOCE, C 115/171 de 2008, art. 288.
(9) S. Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 473.
(10) R. Lecourt, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 248.
(11) CJUE, 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise, aff. 26-62.
(12) S. Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 477.
(13) H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008, p. 358.
(14) Loi constitutionnelle de 1867(R.-U.), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, n° 5.
(15) H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 4e éd, Cowansville, Yvon Blais, 2002, p. 10.
(16) Ibid., p. 9.
(17) Ibid., p. 17. À cet égard, les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1987 distinguent les matières octroyées exclusivement au Parlement fédéral telles que le droit criminel, les banques, la navigation, la pêche, le mariage et le divorce ou encore l’assurance chômage, des matières octroyées exclusivement aux Parlements provinciaux comme notamment la propriété et les droits civils, les hôpitaux, l’éducation et de manière générale les matières de nature purement provinciale. Exceptionnellement, certaines compétences peuvent être exercées de façon partagée tel que le transport exemple.
(18) H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, op. cit., p. 17.
(19) L.S. Lustgarten, M.W. Wilson et N. Papatheodorakos, Essentials of Québec Business Law, 2e éd., Alexandria (Ont.), Bensar Commerce corp., 2003, p. 9.
(20) É. Gratton, « La responsabilité des prestataires techniques d’Internet au Québec », Lex electronica, vol. 10, n° 1, hiver 2005, p. 10.
Introduction(1)
Ces dix dernières années ont été le théâtre d’un développement fulgurant des nouvelles technologies favorisant le développement du commerce électronique à travers le globe. Les outils de communication en ligne sont de plus en plus sollicités et leur demande augmente de manière exponentielle. Le jour de sa sortie en juin 2010, pas moins de 600 000 iPhone 4 ont été vendus à travers la Grande-Bretagne. Les serveurs américains et anglais d’Apple store ont été submergés par les demandes jusqu’à en causer leur mise hors service(2). Les fabricants eux-mêmes ont été pris par surprise et ont dû allonger les délais de livraison pour pouvoir faire face à cette crise. En 2014, une étude menée par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) établissait que près de 49,4 % de la population au Québec avait procédé à un achat en ligne(3).
La vente de produits en ligne connaît également une grande croissance. ComScore annonçait qu’entre janvier et mars 2012, « les abonnements et contenus numériques, les logiciels, l’électronique, l’horlogerie-bijouterie et les spectacles ont enregistré une croissance d’au moins 17 % de leurs ventes en ligne sur un an. Près de la moitié (48,8 %) des transactions bénéficiaient de livraisons gratuites »(4).
Par ailleurs, les sites de vente en ligne viennent progressivement remplacer les succursales. En automne 2010, la marque Le Château ferma trois succursales américaines et créa un site de commerce en ligne. Cette stratégie s’explique notamment par une volonté d’atteindre un plus grand nombre de consommateurs en Amérique du Nord.
Le monde virtuel tend également à se faire reconnaître une place au sein du monde politique. En avril 2009, le Parti pirate du Canada (PPdC) a été reconnu comme parti politique à part entière. Son principal cheval de bataille est une réforme du droit de la propriété intellectuelle. Son programme inclut également une réforme du droit des brevets ainsi que des mesures en faveur de la protection de la vie privée sur le Net, et de la neutralité du Net. Le mouvement est également présent au sein du Parlement européen depuis 2014.
Au Canada, les consommateurs peuvent profiter du service d’Amazon Primedepuis 2013. Ce service « permet d’obtenir la livraison gratuite en deux jours à l’achat de la plupart des produits offerts sur Amazon.ca », et ce, en payant 79 $ par année. En 2016, Amazon dépasse son concurrent Walmart et devient un acteur incontournable dans la vente de détail en ligne(5).
À l’heure actuelle, le droit des contrats s’avère dépassé par le phénomène des transactions sur Internet. Les règles applicables au contrat ne sont plus adéquates, et il convient de se focaliser sur un droit en plein essor qui tente de s’adapter à ce nouveau paradigme.
Parmi les différents phénomènes qui se sont développés grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC), le commerce électronique fera l’objet d’une attention particulière. Cet ouvrage a pour ambition de mettre en lumière certains éléments inhérents au développement du commerce électronique et s’articulera autour de quatre grandes thématiques. Ces thématiques seront mises en exergue au travers du droit européen et du droit canadien. Sans prétention d’en faire une analyse détaillée, le droit américain fera également l’objet d’un bref survol.
1. La publicité sur Internet
Internet est aujourd’hui extrêmement sollicité pour y diffuser des campagnes publicitaires. Les annonceurs ont pour objectif de créer un « buzz », c’est-à-dire de produire un taux élevé de popularité concernant une marque, un slogan ou une œuvre. Le « buzz » a la particularité de circuler à une très grande vitesse sur la toile, sans égard aux frontières. Grâce aux réseaux sociaux, les « buzz » se partagent de manière exponentielle et atteignent très vite des millions de vues.
À l’inverse, certains acteurs n’hésitent pas à diffuser des publicités sexistes en invoquant l’humour afin de créer l’indignation chez le spectateur. Cette « anti publicité » communément appelée « bad buzz » tend à devenir une véritable stratégie de marketing en raison de l’objectif visé : faire parler du produit. Toutefois, une utilisation abusive de la publicité, telle que l’envoi de messages commerciaux non sollicités, sera sévèrement sanctionnée.
Des nouvelles formes de publicité ont vu le jour et il convient d’en adapter les législations les concernant. Internet suscite l’imagination et la création de la part de ses utilisateurs. Les innovations commerciales sont sans limites et se heurtent manifestement à certains domaines du droit tels que la propriété intellectuelle ou encore la protection de la vie privée.
Exemples
• Les noms de domaine qui créent la confusion chez le consommateur ou qui empiètent sur une marque préexistante
• L’envoi d’emails non sollicités qui perturbent la tranquillité des internautes
• Le choix des balises méta ou « méta tags » lors du référencement de certains sites
2. Le contrat électronique
L’avènement de l’ère numérique a profondément influencé le droit applicable aux contrats, ceux-ci étant dorénavant susceptibles d’être conclus par le biais d’Internet. Le droit des contrats ne peut cependant s’appliquer tel quel aux contrats électroniques. En effet, lorsqu’un contrat est conclu à distance, il devient difficile de déterminer le lieu et le moment de sa conclusion. Ces nouvelles formes d’activité créent de nouvelles exigences pour protéger le consommateur.
3. La vie privée
Les questions inhérentes à la protection de la vie privée sont sans conteste fondamentales lorsqu’il est question de l’émergence des nouvelles technologies. Elles ont d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre et la législation relative à la protection de la vie privée est largement sollicitée. Les nouvelles technologies évoluant constamment, il faut appliquer la loi selon cette évolution.
Parmi les enjeux liés au commerce électronique, la protection des données personnelles est celui qui anime le plus les débats. Les données personnelles des utilisateurs sont aisément accessibles en ligne. Facebook et Google sont régulièrement pointés du doigt en ce qui concerne la confidentialité des données hébergées sur leurs serveurs. Récemment, le droit à l’oubli a été adapté à l’ère numérique avec l’arrêt Google(6). Cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2014 ancre dans le droit à l’exactitude des données le droit à l’effacement de données affichées sur Internet lorsque, par le passage du temps, elles sont devenues périmées, donc inexactes. Cette décision marque un pas dans l’évolution jurisprudentielle en matière de droit au respect de la vie privée en élargissant de façon significative les obligations des prestataires de services en ligne.
4. La responsabilité des acteurs sur Internet
Les nouvelles technologies entraînent un questionnement particulier en ce qui concerne la responsabilité des acteurs sur Internet. Par exemple, les hébergeurs de contenu ne sont pas tenus aux mêmes obligations que les éditeurs de contenu ou encore les fournisseurs de réseau de communication.
(1) Les auteurs souhaitent remercier et souligner la contribution de Me Sixtine Balot dans la rédaction de cet ouvrage, ainsi que Me Marianne Bastille-Parent.
(2) M. Perez, « iPhone preorder madness – Apple, AT&T stores crushed by iPhone 4 pre-orders », Into Mobile, 15 juin 2010, en ligne : www.intomobile.com/2010/06/15/iphone-preorder-madness-apple-att-stores-crushed-by-iphone-4-pre-orders/.
(3) CEFRIO, « Indice du commerce électronique au Québec (ICEQ) – 2014-2015 – Synthèse des résultats », en ligne : www.cefrio.qc.ca/media/uploader/CEFRIO_ICEQ2014-2015-10mois-Synthsedesrsultats.pdf.
(4) ComScore, ir.comscore.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=672004.
(5) Radio Canada, 7 mars 2016, « Amazon, maître incontournable du commerce électronique », en ligne : ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/03/07/003-amazon-commerce-electronique-innover.shtml.
(6) CJUE,2014, Google Inc. c Agencia Española de Protección de Datos, aff. C-131/12.
partie ILa publicité en ligne
sommaire
1 Généralités
2 Le contrôle du contenu de la publicité
3 Évolutions
chapitre IGénéralités
Les entreprises qui se livrent à de la publicité en ligne s’exposent à un risque plus élevé d’entraver certaines lois encadrant la publicité : i) les consommateurs qui sont dans l’impossibilité physique d’examiner les marchandises vendues sont plus vulnérables aux publicités trompeuses ; l’obligation des publicitaires de fournir une information complète, précise et exacte se trouve dès lors renforcée ; ii) compte tenu de l’accessibilité universelle d’Internet, les publicités sont susceptibles d’atteindre des internautes à travers le monde ; la législation régissant les activités publicitaires ou encore les usages ou les politiques peuvent radicalement changer d’un pays à l’autre ; une publicité peut passer inaperçue dans un pays et être condamnée dans un autre ; iii) la publicité étant ciblée selon les données personnelles, elle met en jeu le droit à la vie privée.
Ce premier chapitre abordera les diverses formes de publicité sur Internet (Section 1), le champ d’application de la loi au sein de l’Union européenne et du Canada (Section 2), et les limites auxquelles la publicité en ligne est assujettie en vertu du droit à la vie privée (Section 3).
section 1Les formes de publicité sur Internet
La publicité sur Internet est omniprésente. Sans pour autant en faire l’objet d’une étude approfondie, celle-ci se décline généralement selon différents moyens, principalement au sein même des sites Web. Elle s’effectue également via la messagerie électronique, ou encore sur des plateformes telles que les forums de discussions ou les sites comparateurs de prix.
I. Les sites Web
La publicité sur le Web apparaît de façons variées. Les plus communes sont les bannières publicitaires qui apparaissent sur la page consultée. Ces publicités servent la plupart du temps à financer le site Web qui les héberge. L’annonceur paye l’hôte de la page afin de diffuser son annonce et la contrepartie sert à maintenir le site en ligne.
Un autre type de publicité vise les fenêtres intruses (ou pop-up). Ces publicités s’affichent par le biais de nouvelles fenêtres qui s’ouvrent lors de la navigation entre deux sites Internet. Elles apparaissent automatiquement au premier plan sans toutefois avoir été sollicitées par l’internaute.
Par ailleurs, le référencement sur les moteurs de recherche peut parfois constituer également une forme de publicité. Il convient de distinguer le référencement naturel du référencement payant. Le référencement payant consiste à payer un moteur de recherche afin de faire apparaître le site Web lors de la saisie de certains mots clés. Le site Web se trouve alors référencé en tête de liste lors de la recherche. Il est généralement encadré dans une couleur distincte. Le référencement naturel a également pour vocation d’augmenter la visibilité d’un site en procédant à diverses techniques informatiques. La pratique la plus commune est appelée SEO (Search Engine Optimization). Lorsqu’une recherche est effectuée, les robots d’indexation scrutent les mots saisis non seulement sur les pages Internet, mais également sur les liens URL ainsi que dans les éléments « meta » invisibles à la lecture du site. Parmi ces différentes techniques, celle du recours aux « meta tags » est assez fréquente. Certains sites utilisent des mots clés cachés dans les pages html qui ne sont pas visibles à première vue, mais qui font apparaître leur page lors de la saisie de ces mots clés.
Exemple
La page d’une marque de chaussure « X » qui cacherait dans ses balises meta le nom de la marque concurrente, « Y ». Lorsque la page Y est recherchée, la page de X est référencée automatiquement. En fonction du régime juridique, cette pratique peut être illégale ; on l’appelle alors spamdexing ou référencement abusif.
II. Le courrier électronique
La publicité par messagerie électronique est très fréquente. Elle est appelée « pollupostage » ou « pourriels » au Québec, ou encore spam en anglais. L’envoi de courriers à vocation publicitaire est strictement réglementé, mais il convient d’en apporter les nuances.
Le marketing direct, ou l’envoi de courriel aux consommateurs pour promouvoir un produit est soit soumis à l’option d’adhésion (opt-in) soit soumis à l’option de retrait (opt-out). Cette distinction sera abordée au chapitre III : Évolutions.
III. La publicité ciblée ou comportementale
Le Commissariat à la vie privée du Canada décrit la publicité comportementale comme celle fondée sur des algorithmes qui analysent les données des utilisateurs, établissant leur profil et ciblant la publicité selon ce profil. Le profil est développé à partir du comportement en ligne(1). De ce fait, elle tombe sous le coup des lois sur la protection des données personnelles.
IV. Autres types de publicité
Les forums de discussion et les blogs sont des espaces propices à l’échange d’informations et d’idées portant sur un sujet particulier. Le marketing viral est une forme de publicité visant à poster des commentaires valorisant des produits concernés afin de donner l’impression que les recommandations proviennent des consommateurs eux-mêmes.
Les sites comparateurs de prix – pratique très utilisée en Europe – visent à permettre à un consommateur de générer un tableau comparatif des prix pour un même produit. Un important groupe français a été condamné en France en 2006 parce qu’il avait mis en ligne un site comparateur biaisé afin de s’attribuer systématiquement le meilleur prix affiché(2).
section 2Les lois applicables
La publicité est appréhendée différemment selon les pays dans lesquels elle se manifeste. Vu l’absence de frontières sur Internet, celle-ci est accessible partout à travers le globe. Les auteurs diffusant des contenus publicitaires non sollicités courent le risque d’être sanctionnés par des mesures coercitives (abordées au chapitre II : Le contrôle du contenu de la publicité). Il importe donc de déterminer quels sont les critères de qualification de la publicité propres à chaque État. L’Union européenne fera l’objet d’une première analyse, suivie du Canada. La publicité aux États-Unis sera très brièvement abordée.
I. L’Union européenne
Diverses directives européennes traitent de la publicité. Une directive est un acte législatif destiné à tous les pays membres de l’Union européenne qui fixe des objectifs à atteindre(3). Les pays membres sont contraints de mettre en œuvre ces objectifs au sein de leur territoire tout en ayant une certaine marge de manœuvre quant aux mesures à adopter.
A. La directive 2000/31/EC sur le commerce électronique
La publicité dans le contexte de la société de l’information est également appelée « communication commerciale ». Ce terme est défini à l’article 2 (f) de la directive 2000/31/EC sur le commerce électronique(4).
Une « communication commerciale » est composée de trois éléments constitutifs : un moyen de communication, destiné à la promotion de biens et de services, ou destiné à la promotion de l’image d’une entreprise, d’un métier ou d’une profession.
La directive 2000/31/EC sur le commerce électronique vise la publicité de manière générale lorsqu’elle est le fait d’un service de la société de l’information c’est-à-dire « […] tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par les termes : à distance : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ; par voie électronique : un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ; à la demande individuelle d’un destinataire de services : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle »(5).
On constate que le « service de la société de l’information » n’est pas défini par rapport à son contenu, mais par rapport à la manière dont il est presté ; plus précisément, il doit être presté : (i) à distance, (ii) par voie électronique, et (iii) à la demande individuelle d’un destinataire de services.
B. La directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales
La directive 2005/29 quant à elle s’applique de manière plus spécifique aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre professionnels et consommateurs(6).
L’article 5 détermine les comportements interdits dans la conduite des affaires à l’attention d’un consommateur, à savoir : une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. Les articles 6 et 7 font état des pratiques commerciales trompeuses. Une action trompeuse est celle qui contient des informations fausses susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen. Une omission trompeuse est la non-communication d’une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Font également partie des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales agressives (art. 8 et 9) définies comme étant des pratiques utilisant le harcèlement, la contrainte ou une influence injustifiée qui sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement.
La directive 2005/29 fait mention en annexe d’une liste de comportements considérés de manière irréfragable comme des pratiques commerciales déloyales.
La directive utilise comme critère de référence celui du consommateur moyen(7), à savoir celui qui « est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques […] »(8). Ce critère est laissé à l’appréciation des cours et tribunaux des autorités nationales qui « devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné ».
C. La directive 2006/114 sur la publicité trompeuse et la publicité comparative
En ce qui concerne la publicité trompeuse et mensongère, la directive 2006/114 vise particulièrement ces deux hypothèses (voy. chapitre II : Contrôle du contenu de la publicité). Elle prévoit différents moyens d’action en cas de griefs causés par la publicité (trompeuse ou comparative) notamment une action en cessation(9) avec publication de la décision(10) ou encore une interdiction de diffusion si la publicité n’a pas encore été portée à la connaissance du public(11).
D. Le règlement général sur les données personnelles (RGPD)
Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ce règlement vient renforcer les droits individuels à l’égard de la vie privée face à la publicité en ligne : les usagers doivent être informés du profilage et ont le droit de s’opposer, par exemple, via une option de refus, opt-out(12). De plus, l’adoption de nouvelles technologies de publicité en ligne qui pourraient avoir une répercussion sur la collecte doit être soumise à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée afin d’en évaluer le caractère intrusif et de développer les mesures de protection pertinentes(13).
II. Le Canada
Au Canada, la publicité est régie par les dispositions du Code criminel(14), par la loi sur la concurrence(15) et, en ce qu’elle comporte la cueillette de données personnelles en ligne, par la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques(16) et diverses lois provinciales concernant la protection des consommateurs et les pratiques commerciales.
A. La loi sur la concurrence
La loi sur la concurrence est la principale loi fédérale s’appliquant à toutes les formes de publicité, peu importe le support utilisé. Sont donc notamment visés les sites Web commerciaux, les courriers électroniques, les espaces de discussions sur Internet et les groupes de nouvelles créés dans le but de promouvoir la fourniture ou l’utilisation d’un produit ou influencer le comportement des consommateurs. La loi ne fournit cependant pas de définition de la publicité.
Quiconque faisant des représentations en ligne à partir du Canada et qui sont accessibles en ligne au Canada est tenu de se conformer à la Loi sur la concurrence.
Le 16 octobre 2009, le Bureau de la concurrence du Canada a émis des lignes directrices permettant d’interpréter la loi sur la concurrence dans le contexte d’Internet(17). En vertu de ces lignes directrices, il devient plus aisé de déterminer le champ d’application de la loi, bien que ces lignes directrices n’aient pas force de loi.
1. Champ d’application
La loi sur la concurrence a pour objectif de faire bénéficier tous les Canadiens de prix concurrentiels pour des produits et services de qualité(18). En termes de publicité, les entreprises sont donc soumises à une obligation de transparence en fournissant des informations précises aux consommateurs.
La loi s’applique aux personnes effectuant de la représentation en ligne à partir du Canada vers des juridictions étrangères, d’une part, et aux personnes effectuant de la représentation en ligne à partir de l’étranger vers le Canada ou selon les accords conclus entre les organismes étrangers et le Canada, d’autre part.
Une indication ne peut, selon la loi, être fausse ou trompeuse sur un « point important » :
« [une] indication sera fausse ou trompeuse sur un point important si, dans le contexte où elle est faite, elle donnerait d’emblée au citoyen ordinaire une impression fausse ou trompeuse qui risquerait d’avoir une incidence sur la décision du citoyen ordinaire d’acheter ou non le produit ainsi offert »(19).
Le critère sera celui de « l’impression générale », à la différence du droit européen qui retient le critère du consommateur moyen(20) :
« […] l’entière mosaïque doit être considérée plutôt que chaque carreau séparément. Le public acheteur n’étudie pas avec soin ou ne pèse pas chaque mot dans une annonce. L’impression ultime sur l’esprit du lecteur se forme de la somme totale non seulement de ce qui est dit, mais aussi de tout ce qui peut être raisonnablement induit »(21).
Il faudra dès lors « […] se baser sur les mots utilisés dans l’annonce tels qu’ils sont compris du public en général et non le sens particulier que peuvent leur donner les habitués de l’industrie et du commerce »(22).
2. Recours civil ou criminel
La loi sur la concurrence prévoit deux types de recours, l’un civil et l’autre criminel. Le Bureau de la concurrence a émis des lignes directrices en ce qui concerne le choix de l’un ou de l’autre régime(23).
Le recours civil est prévu à l’article 74.1. Il permet d’enjoindre l’entreprise à cesser l’activité illicite et de publier l’avis de cessation. Le tribunal administratif peut condamner l’entreprise à payer une amende administrative. Le paragraphe 1, d), prévoit également une forme de remboursement aux consommateurs pour les produits achetés.
Le recours au régime criminel s’appliquera dans des cas plus graves. Selon les lignes directrices, celui-ci est conditionné par deux éléments. Primo, l’accusé a donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses. Le fait que l’accusé ne cesse pas la conduite reprochée après avoir reçu des plaintes de la part des consommateurs constitue une preuve claire et convaincante. Secundo, il serait dans l’intérêt public d’intenter une poursuite criminelle.
La loi prévoit également une responsabilité pénale dans le cadre du télémarketing (art. 52.1[3]) et dans le cadre des ventes pyramidales (art. 55 et 55.1). Les deux types de poursuites ne peuvent être intentées cumulativement(24).
B. Le Code canadien des normes de la publicité(25)
La publicité au Canada a la particularité de s’auto-réglementer. Le Code précité a été élaboré par les professionnels de la publicité et la majorité des acteurs de ce secteur ont accepté de s’y conformer. Le Code dispose de 14 articles qui ont pour objectif d’établir des critères déterminant ce qu’est une « publicité acceptable »(26).
La particularité du Code est qu’il prévoit un mécanisme de plainte : les consommateurs, les annonceurs concurrents ou les groupes d’intérêt particulier peuvent déposer une plainte auprès du NCP (Normes canadiennes de la publicité) lorsqu’ils estiment que le Code a été violé.
En parallèle, des lignes directrices sont prévues pour éclairer les acteurs concernés par le Code dans l’interprétation des 14 articles(27).
C. La responsabilité des acteurs
Les personnes à l’origine d’un contenu diffusé sur Internet sont multiples. Il peut s’agir du concepteur de la page Web, de son hébergeur, du fournisseur d’accès à Internet ou encore de l’entreprise pour le compte de laquelle le site est créé.
La règle générale est la responsabilité conjointe pour tous les acteurs impliqués dans la mise en ligne du contenu. Sont visées par cette règle la personne dont les produits sont annoncés ; les agences de publicité, ou, selon l’article 74.01 de la loi, la personne qui prend la décision de mettre l’information en ligne ; les sites hébergeant la publicité (la personne qui met en ligne et conserve sur son serveur une information manifestement mensongère peut voir sa responsabilité engagée dans certaines circonstances). L’article 74.07 prévoit un régime d’exonération de responsabilité des éditeurs et distributeurs de bonne foi, c’est-à-dire toute personne qui diffuse pour le compte d’une autre personne des informations mensongères ou trompeuses dans le cadre de son activité habituelle, en consignant le nom et les coordonnées du donneur d’ordre. L’article 74.03 (2) vise le cas particulier de l’acteur qui agit de l’étranger. Sera alors présumée responsable la personne qui importe le produit au Canada.
La responsabilité d’un acteur s’évalue selon la nature et le degré de contrôle qu’il exerce sur le contenu.
Globalement, les lignes directrices relatives à la loi sur la concurrence dans le contexte d’Internet encouragent les acteurs à rendre la publicité plus accessible aux consommateurs afin de ne pas les induire en erreur. Ils peuvent s’y conformer en communiquant adéquatement les avertissements sur le bien ou le service. Par ailleurs, il leur est suggéré de présenter de manière manifeste et évidente les informations importantes. L’efficacité d’une clause de non-responsabilité sera déterminée par l’emplacement de cette clause sur le site, la probabilité qu’elle soit lue et sa répétition. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées, telles que les hyperliens (quoique non recommandés, car l’utilisateur du site ne va pas nécessairement cliquer sur le lien), l’utilisation de caractères gras, le recours aux outils tape-à-l’œil (images, sons), etc. Il est également conseillé de donner des indications sur l’annonceur.
Afin d’anticiper d’éventuels conflits de juridiction, il est conseillé de préciser quelles sont les personnes visées par l’annonce, notamment en termes géographiques.
D. La loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques (LPRPDE)
Deux rapports d’enquête du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada clarifient les balises relatives à la publicité en ligne : les enquêtes sur Facebook en 2009(28) et sur Bell Canada en 2015(29). Il ressort de ces rapports d’enquête que la publicité en ligne peut faire l’objet d’un usage raisonnable de données personnelles soumis à certaines conditions.
Ces conditions varient (1) selon que la publicité appuie un service gratuit (Facebook) ou ajoute une source de revenu à un service payant (Bell Canada), et (2) selon la sensibilité des renseignements personnels. Lorsque le service est gratuit, le consentement à recevoir de la publicité est implicite ; lorsque le service est payant, la cueillette de données personnelles pour cibler la publicité est sujette au consentement exprès.
Finalement, les renseignements de nature sensible (un profil détaillé ou des données médicales, p. ex.) ne peuvent être recueillis que par consentement exprès.
III. Le Québec
Outre la loi fédérale sur la concurrence qui s’applique au Québec, la loi provinciale sur la protection du consommateur donne des garanties additionnelles(30). Elle vise à protéger le consommateur contre les représentations fausses ou trompeuses qui l’empêcherait d’agir en connaissance de cause(31).
La loi sur la protection du consommateur (LPC) s’avère plus précise en ce qu’elle définit davantage de termes et énumère un nombre plus important d’infractions. Là où la loi sur la concurrence vise une situation générale, la loi sur la protection du consommateur vise des cas particuliers.
L’article 253 prévoit une présomption en faveur du consommateur. Celui-ci est présumé avoir contracté parce qu’il n’a pas eu connaissance de la pratique interdite, et que s’il l’avait été, il n’aurait jamais contracté. Les articles 271 et suivants prévoient un recours civil, tandis que les articles 277 et suivants prévoient des sanctions pénales.
Tout comme la loi sur la concurrence, la LPC se base sur le critère de l’impression générale(32). Outre la loi sur la protection du consommateur, le Québec dispose de la Charte de la langue française qui impose l’usage du français dans les annonces publicitaires(33).
La loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est également pertinente à la publicité en ligne. Dans une fiche d’information sur le profilage et la publicité ciblée(34), la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) articule ainsi les obligations des entreprises à cet égard :
• elles ne peuvent recueillir plus de renseignements que nécessaire selon les objectifs énoncés ;
• elles doivent informer les usagers, dès la collecte, de l’utilisation des renseignements.
(1) « Lignes directrices sur la protection de la vie privée et la publicité en ligne », décembre 2011, en ligne : www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/publicite-et-marketing/publicite-comportementale-et-publicite-ciblee/gl_ba_1112/.
(2) Tribunal de commerce, « Ordonnance de référé, 7 juin 2006 », septembre 2006, en ligne : www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1732.
(3) En ligne : europa.eu/european-union/law_en.
(4) CE, dir. 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JOCE, L 178/2 de 2000, art. 1 (f).
(5) Dir. 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
(6) CE, dir. 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la dir. 84/450/CEE du Conseil et les dir. 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et duConseil et le règl. (CE) 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), JOUE, L 149/22 de 2005.
(7) Dir. sur les pratiques commerciales déloyales, supra,note 35, art. 5 (2) b).
(8) Ibid., consid. 18.
(9) CE, dir. 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JOUE, L 376/21 de 2006, art. 5 (3) a).
(10) Ibid., art. 5 (4) a).
(11) Ibid., art. 5 (3) b).
(12) Ibid., art. 21.2.
(13) Ibid., art. 35.
(14) C. crim., LRC 1985, c C-46.
(15) Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.
(16) Loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, LC 2000, c 5.
(17) Bureau de la concurrence, « Application de la loi sur la concurrence aux indications dans Internet », en ligne : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03134.html.
(18) Ibid., p. 6.
(19) R. c. Kenitex Can. Ltd. et al., 1980, 51 C.P.R. (2d) 103.
(20) Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, art. 52 (4).
(21) R. c. Imperial Tabacco Products Ltd, 1971, 5 W.W.R. 409, p. 426.
(22) R. c. Tremco Manufacturing Co.(Canada) Ltd., 1974, 15 C.P.R. (2d) 232 (C.C. Ont.).
(23) Lignes directrices du Bureau de la concurrence, « Indications et pratiques commerciales trompeuses : choix entre le régime criminel ou civil de la loi sur la concurrence »,22 septembre 1999,en ligne : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01223.html.
(24) Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, art. 52 (7) et 74 (16).
(25) Code canadien des normes de la publicité,en ligne : www.adstandards.com/fr/Standards/canCodeOfAdStandards.aspx.
(26) Ibid.
(27) « Interprétation du Code »,en ligne : www.adstandards.com/fr/Standards/interpretingTheCode.aspx.
(28) C. McKay,« La protection de la vie privée et Facebook », 27 août 2007, en ligne : blog.priv.gc.ca/index.php/2009/08/27/la-protection-de-la-vie-privee-et-facebook/?lang=fr.
(29) « Le programme publicitaire de Bell soulève des préoccupations relatives à la protection de la vie privée », 7 avril 2015, en ligne : www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2015/nr-c_150407/.
(30) Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
(31) Ibid., art. 219.
(32) Ibid., art. 218.
(33) Charte de la langue française, CQLR, Chap. C-11.
(34) Fiche d’information : « Le profilage et la publicité ciblée », 31 octobre 2013, en ligne : www.cai.gouv.qc.ca/fiche-dinformation-le-profilage-et-la-publicite-ciblee-2/.
chapitre IILe contrôle du contenu de la publicité
Toute diffusion de contenu à caractère publicitaire fait l’objet d’un certain nombre de restrictions. L’annonceur doit prendre en compte divers facteurs avant de diffuser son annonce : la publicité ne peut en aucun cas être mensongère ou trompeuse (Section I). En ce qui concerne la publicité comparative, elle est autorisée moyennant le respect de conditions strictes (Section II). Par ailleurs, certains types de publicité font l’objet de réglementations sectorielles notamment la publicité sur l’alcool, la publicité sur le tabac ou encore la publicité visant les enfants (Section III).
section 1Représentations mensongères et trompeuses
La publicité mensongère et trompeuse est proscrite pour tout type de publicité, quelle que soit sa forme. La protection du consommateur étant à l’origine de cette interdiction, les annonceurs s’exposent tant à des sanctions civiles que pénales. L’énumération non exhaustive qui suit contient des exemples de pratiques publicitaires considérées comme mensongères et trompeuses : les coordonnées fallacieuses du vendeur, un prix mensonger, de fausses comparaisons de prix, l’omission d’indiquer une information essentielle ou encore des fausses représentations concernant la qualité supérieure d’un produit.
À l’instar de l’annonceur, les agences de publicité et les sites les hébergeant exposent également leur responsabilité.
I. Dans l’Union européenne
La directive 2006/114/CE relative à la publicité trompeuse et la publicité comparative définit en son article 2, b), la publicité trompeuse comme toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.
L’article 3 apporte des précisions intéressantes pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant :
a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services ;
b) le prix ou son mode d’établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services ;
c) la nature, les qualités et les droits de l’annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu’il a reçus ou ses distinctions.
II. Au Canada
L’article 52(1) de la loi sur la concurrence donne une définition d’indications fausses ou trompeuses :





























