1
Condoléances et doléances
Jeanne agrippa les mains de Théo et d’Antoine. Elle tentait de résister au vertige qui l’envahissait devant ce trou béant. Surtout, elle ne devait pas tomber, mais continuer à se tenir droite, malgré la douleur, malgré l’angoisse… Des centaines de regards étaient dardés sur son dos, elle les sentait comme autant de poignards.
Elle frissonna. Les fossoyeurs faisaient glisser les cordes, les deux cercueils descendaient ensemble, ils reposaient maintenant tout au fond, à même la glaise humide. Cette terre, si froide… Un sanglot monta en elle, qu’elle réprima à grand’peine. Elle sentit la main d’Antoine frémir entre ses doigts, et elle devina qu’il risquait lui aussi d’être submergé par le chagrin. Mais ils devaient résister, ils ne pouvaient se permettre de faillir, pas maintenant… Plus jamais. Jeanne serra la main d’Antoine, et aussi celle de Théo. Elle s’assurait de leur présence, elle était heureuse qu’ils soient ensemble, tous les trois, unis malgré tout.
Elle savait ce qu’il fallait faire maintenant. Elle se baissa et ramassa une poignée de terre humide, qu’elle jeta dans la tombe. Lentement, Théo dégagea sa main et se pencha à son tour. La terre fit un petit bruit en tombant sur le bois des cercueils posés l’un contre l’autre, comme de la pluie. Antoine envoya une troisième motte en poussant un gémissement. Les fossoyeurs s’approchèrent et, à larges pelletées, ils ensevelirent peu à peu les cercueils que bientôt on ne vit plus.
Il ne restait que la dalle de pierre, posée à côté de la fosse. Le marbre portait, en caractères dorés, les deux noms avec leurs dates : « Pascal Maurin, 1964-2007 ; Édith Maurin née Souran, 1965-2007 ». Pour la première fois, Jeanne remarqua qu’un symbole avait été gravé en dessous de cette inscription : un triangle enfermé à l’intérieur d’un cercle, étrangement barré. Un instant, elle se demanda ce qu’il signifiait.
Mais Théo lui tirait la manche : « Jeanne ! Que fait-on maintenant ? » Elle revint à la réalité : ils venaient de rendre un dernier hommage à leurs parents, il fallait à présent affronter la foule. « Je crois… » Sa voix se brisa, puis se raffermit : « Je crois que nous devons nous écarter. »
Maladroitement, ils reculèrent de quelques pas : ils percevaient toujours les regards posés sur eux, prêts à les juger. Jeanne s’éloigna, et ce fut un déchirement. Pour la première fois depuis l’annonce de leur décès accidentel, elle saisit à quel point elle aimait ses parents, à quel point elle comptait sur eux. Leur perte agissait comme une révélation : elle était seule désormais, seule dans la vie, avec ses frères.
Ils se tombèrent dans les bras, tous les trois : ils étaient triplés, liés depuis toujours. Aujourd’hui, avec la disparition de leurs parents, ils se soutenaient dans l’épreuve. Ils étaient différents, pourtant une affection inaltérable les unissait. Antoine était déjà assez grand pour ses seize ans ; de ses larges épaules se dégageait une impression de force, que confirmaient d’ailleurs ses sourcils vite froncés. Ses cheveux bouclés, noirs, retombaient sur son front mat, sans cacher ses yeux d’un bleu profond. Pour le moment, il avait la bouche crispée par le chagrin, mais ordinairement il avait le sourire facile. À côté de lui, Théo semblait beaucoup plus jeune : cette apparence juvénile cachait cependant une extraordinaire intelligence, une sagacité hors du commun. Il était grand, bien plus grand que son frère ; il avait poussé tout en longueur. Son horreur pour le sport et pour toute activité de plein air lui avait donné un teint blafard, des membres grêles. Ses cheveux châtains, coupés courts, mettaient en valeur son large front ; ses yeux noirs étaient cachés par des lunettes épaisses. Malgré l’apparence sévère que lui donnait son menton volontaire, Théo avait un cœur d’or et se montrait prêt à tout pour aider ses amis.
Jeanne considérait d’un œil attendri ses deux frères, sa seule famille désormais. Elle était l’unique fille des triplés : peut-être était-ce pour cette raison qu’elle était si féminine. Son corps menu paraissait plus léger encore qu’à l’ordinaire, à cause des vêtements de deuil qu’elle portait. Son visage fin émergeait de sa veste noire, pâli par sa douleur ; la brise soulevait ses cheveux blonds qui ruisselaient dans le soleil. Elle gardait les lèvres serrées pour ne pas éclater en sanglots. Ses yeux, très grands, étaient verts : un jour, sa mère lui avait expliqué qu’ainsi, elle portait un peu de chacun de ses parents, parce qu’Edith avait les yeux bruns et Pascal les yeux bleus. Jeanne tressaillit à ce souvenir.
« C’est curieux, tout-de-même, ces inconnus… » Théo avait relevé la tête et il considérait la foule des gens qui s’approchaient d’eux à petits pas convenus. Jeanne suivit son regard : la première personne de la longue file qui s’était formée venait de se recueillir un instant devant la tombe, et maintenant, elle se dirigeait vers eux pour les saluer. Jeanne n’eut pas le temps de relever la remarque de Théo, parce qu’elle serrait la main de l’inconnu qui s’inclina, murmura une formule de condoléances, prit la main d’Antoine, puis s’éloigna d’un air contrit, avant d’être relayé par une autre personne, également inconnue, puis encore une autre…
Elle aussi trouvait étrange la présence de tant de monde à l’enterrement de ses parents. Bien sûr, elle avait aperçu des connaissances, là-bas, patientant en arrière de la file : ses oncles et tantes, ses cousins, des amis de ses parents. Mais pourquoi tous ces étrangers ? Du reste, ils paraissaient profondément attristés de cette double disparition : leurs visages portaient les cernes du deuil, et aussi la marque d’une certaine anxiété.
De l’anxiété ! Pourquoi seraient-ils angoissés ? se reprit Jeanne. C’était bien plutôt à eux, les enfants d’Édith et Pascal, d’être troublés ! Qu’allaient-ils devenir désormais ? Leur oncle Éric, leur préféré, leur avait fait comprendre qu’il ne pouvait les accueillir sous son toit. Mais alors, qui s’occuperait d’eux ? Ils pourraient peut-être vivre seuls, après tout, ils seraient majeurs dans moins de deux ans…
Les yeux des inconnus croisaient les siens, et elle apercevait le reflet de sa propre peur dans leur regard. « Avec toutes mes condoléances… Nous sommes désolés… Vraiment, une mort si tragique… C’est terrible, terrible… » Les paroles creuses se répétaient, s’enchaînaient, elles avivaient le trouble de Jeanne, son sentiment d’abandon. Les tenues endeuillées, les foulards noirs rappelaient à chaque instant l’horreur tragique de la situation. Le cortège n’en finissait plus d’endeuiller cette cette belle journée de printemps.
Enfin des visages connus apparurent, des amis de leurs parents, quelques collègues de leur père, des voisins, et même plusieurs camarades de lycée. Ils les embrassaient, entouraient leurs épaules, leur murmuraient quelques mots de réconfort. Mais rien ne pouvait plus atteindre les triplés Maurin, réfugiés dans leur armure d’impassibilité pour ne pas avoir à trop souffrir. Derrière chaque parole, chaque main serrée, ils percevaient le rappel douloureux de la mort qui venait de frapper.
Puis vint la famille : leurs oncles d’abord, les frères de leur mère. Bertrand Souran était accompagné de sa femme Michelle et de sa fille Magalie. Raide et compassé même dans les situations les plus cocasses, il constituait d’ordinaire un grand sujet de moquerie pour les triplés. Pourtant, aujourd’hui, Jeanne sentit un élan d’affection pour lui. Magalie était son aînée de deux ans et elle avait toujours aimé partager ses jeux et ses discussions. Sa cousine la serra contre elle en sanglotant, lui souhaita du courage, et repartit.
Ensuite venait Éric, le plus jeune des frères Souran. Il adorait les triplés, et la réciproque était vraie : avec lui, que de rires partagés, que de bons moments ! Il fondit sur eux et les serra dans ses bras, tous les trois en même temps, à les étouffer. Il n’avait visiblement pas réussi à quitter son habituelle veste de cuir, son jean délavé et sa chemise à carreaux ; mais c’est ainsi qu’il était apprécié, avec son air bienveillant et son sourire franc.
Éric leur expliqua entre deux sanglots : « Il ne faut pas m’en vouloir… Vraiment, nous aurions préféré… Mais c’est impossible… » Puis il s’enfuit, comme s’il allait céder à son propre désir d’inviter les triplés à partager désormais leur foyer.
Sa femme, Laure, s’approcha à son tour et affirma : « C’est vrai, nous aurions aimé pouvoir vous emmener avec nous. » Elle rougit, sans doute parce que cette déclaration avait demandé beaucoup d’efforts à son extrême timidité. Elle les embrassa, chacun leur tour, tandis que ses deux enfants se pressaient contre elle, les larmes débordant des paupières. Claire n’avait que deux ans, et Mathias cinq. Jeanne pressa sa joue contre les visages humides des enfants, et elle se sentit réconfortée par leur affection.
Enfin ils se retrouvèrent seuls. Jeanne pensait à ses grands-parents, Georgette et Paul-Emile, les parents de leur mère. Ils auraient dû être là, s’ils n’étaient pas morts deux ans auparavant dans un accident de voiture. Mais quelle fatalité subissait donc sa famille, pour qu’elle soit ainsi décimée en quelques années ? Jeanne baissa le front. Un instant, elle s’absorba dans l’observation de l’herbe à ses pieds, piétinée par tant de passages, afin d’échapper aux pensées de deuil qui l’assaillaient.
Antoine poussa soudain un gémissement : « Oh non… » Jeanne releva la tête : bonne-maman Philippine marchait à pas lents dans leur direction, soutenue par son mari, Pierre Maurin. Quel désastre ! Elle les avait oubliés, ceux-là, tant son désarroi était complet ! Ils n’avaient pourtant pas besoin de faire des politesses à leurs grands-parents paternels, qu’ils appréciaient peu, d’autant moins que ces derniers étaient en froid avec leurs parents. Instinctivement, les triplés se serrèrent, pour faire front commun.
Bonne-maman Philippine se planta devant eux et les dévisagea avec raideur. Puis elle commenta : « Hé bien, mes enfants ! » de sa petite voix revêche, avant de les embrasser, l’un après l’autre, d’un coup de bec pointu. Bonne-maman Philippine n’était pas vraiment méchante, loin de là ; simplement, elle conservait en toutes circonstances la dureté d’une statue de granit, et dans ce genre d’occasion particulièrement, Jeanne n’avait aucune envie de voir ses traits tendus, ses lèvres pincées, ses petites lunettes perchées à l’extrémité de son nez fin, et surtout, d’entendre ses paroles autoritaires et ses ordres péremptoires. À côté d’elle, comme d’habitude, leur grand-père se tenait coi, mais il tournait vers eux des regards compatissants. Il aurait eu l’air bonhomme, s’il n’avait éprouvé continuellement de la crainte à vivre en compagnie de sa femme, à laquelle il était pourtant indispensable, puisqu’il l’aidait à se déplacer malgré ses rhumatismes. Pierre Maurin était aussi large et petit que sa femme était longue et mince : à eux deux, ils formaient un couple assez comique.
Mais Jeanne, Antoine et Théo n’avaient aucune envie de rire, encore moins lorsque bonne-maman Philippine annonça de sa petite voix fluette, mais qui n’attendait pas de réplique :
« Venez, maintenant.
— Venir ? Mais… Pour aller où ? demanda Antoine assez étourdiment.
— Tu croyais peut-être que j’allais vous laisser tout seuls ? » interrogea bonne-maman en fronçant les sourcils.
Puis elle secoua la tête de droite et de gauche, comme si elle était particulièrement ulcérée par la remarque de son petit-fils. Elle expliqua pourtant : « Nous sommes vos grands-parents, nous devons donc nous charger de votre éducation, après ce malheur. »
Ce n’était pas une suggestion, mais une affirmation. Impossible de s’y soustraire.
Jeanne échangea avec ses frères un regard désespéré. Le cimetière était vide à présent ; le silence était rompu, les oiseaux s’étaient remis à chanter. Les feuilles toutes neuves frémissaient doucement sur les arbres, le soleil faisait briller les tombes de marbre poli. Derrière eux, les fossoyeurs terminaient le travail : ils mettaient en place la pierre tombale par-dessus la fosse comblée. Jeanne sentit une profonde détresse l’envahir : il n’y avait pas d’échappatoire. Elle croisa les yeux de son grand-père, qui lui sourit timidement.
Bonne-maman Philippine leur avait tourné le dos. Elle se dirigeait à pas lents, précautionneux, vers la sortie du cimetière de Saint-Hammer. Elle n’avait pas jeté un regard en arrière, sur la tombe de son fils et de sa belle-fille.
L’âme en peine, les triplés partirent en procession derrière elle.
Dans la voiture, bonne-maman Philippine leur exposa son plan de guerre : il fallait régler la succession très rapidement, ils entreraient dans leurs biens à leur majorité, c’est-à-dire dans deux ans, d’ici là, ils resteraient chez leurs grands-parents. Ils allaient passer par leur maison, où ils feraient leurs valises ; puis ils iraient directement dans l’appartement parisien. Jeanne tenta sa chance et suggéra : « N’y aurait-il pas un moyen de garder la maison ? » Cette maison, elle l’aimait, elle y vivait depuis toujours en compagnie de ses frères et de ses parents, des moments heureux y étaient attachés, tous les souvenirs de ses parents, tout ce qui lui restait d’eux.
Devant le visage emporté de sa grand-mère, elle s’empressa de faire quelques concessions :
« On pourrait au moins emporter des meubles, des souvenirs…
— Hors de question. Tout sera vendu. Vous récupérerez l’argent. »
À son ton sec, Jeanne sentit que la discussion était close. Ils devaient se plier à la volonté de leur grand-mère. Ses yeux s’emplirent de larmes : de l’argent ! Mais peu importait l’argent, ce qu’elle voulait, c’était garder un souvenir de ses parents ! Théo lui entoura les épaules de son bras, pour la réconforter ; mais ses lèvres tremblaient.
Ils arrivèrent en fin d’après-midi à l’appartement de leurs grands-parents. Les triplés furent soulagés d’émerger enfin de la petite Twingo : ils avaient voyagé avec des sacs sur les genoux, le coffre étant déjà plein. Bonne-maman Philippine s’était montrée intransigeante : ils ne pouvaient emporter aucun meuble, seulement le contenu de leurs bagages. Alors ils s’étaient hâtés d’empiler l’essentiel : leurs vêtements, des photos, quelques livres, et surtout, des souvenirs de famille.
Bonne-maman Philippine était sortie de la maison et avait définitivement fermé la porte à clef. La propriété serait prochainement mise en vente par le notaire qui s’occupait de leurs affaires, ce qui leur permettrait, avait-elle expliqué, de devenir riches. « Mais nous aurions préféré garder la maison… » tenta une dernière fois Théo, en désespoir de cause. Le visage de bonne-maman Philippine s’affaissa : une lueur de pitié transparaissait dans ses yeux quand elle les regarda, et ce fut d’un ton adouci qu’elle expliqua : « Vraiment, je suis désolée. Il n’est pas possible de faire autrement. Vous devrez sortir le moins possible, et vous resterez la plupart du temps dans notre appartement. C’est mieux ainsi. »
Elle les avait poussés dans la voiture, sur la banquette arrière. Leur grand-père les avait dévisagés d’un air inquiet, puis il avait démarré le moteur. La voiture s’était éloignée en direction de Paris. Jeanne, Antoine et Théo n’avaient pas quitté des yeux leur ancienne maison – mentalement, ils lui disaient adieu, une dernière fois, avant qu’elle ne disparaisse au bout du chemin. Ils commençaient le deuil de leurs souvenirs heureux, de leur tranquille adolescence, après avoir entamé celui de leurs parents. Désormais rien ne serait plus comme avant, et cette brusque prise de conscience les faisait frémir d’angoisse. Ils s’étaient cramponnés à leurs valises – tout ce qui leur restait de ce naufrage – et avaient senti avec soulagement la présence des deux autres. Ils étaient tous les trois embarqués pour un même destin.
Ils étaient plongés dans de si tristes pensées qu’ils n’avaient pas relevé la phrase inquiétante de bonne-maman Philippine. Mal leur en prit. Car ils étaient bel et bien prisonniers, comme dans un piège qui se referme sur des proies inconscientes.
Bon-papa Pierre avait garé la voiture dans le sous-sol de l’immeuble, un beau bâtiment bourgeois situé dans un quartier tranquille, au cœur du xviearrondissement parisien. À eux cinq, ils avaient réussi à traîner tous les bagages jusqu’à l’ascenseur ; ils s’étaient entassés à l’intérieur, puis avaient débouché sur un palier bien éclairé, au cinquième et dernier étage. Les triplés n’avaient gardé qu’une idée floue de cet appartement ; ils n’y étaient pas retournés depuis environ cinq ans, et cette dernière visite ne leur avait pas laissé un bon souvenir. Leur grand-père avait donc entrepris de leur montrer les lieux, pendant que leur grand-mère s’affairait dans la cuisine.
À côté d’une salle à manger austère, le salon était vaste ; une partie de la pièce magnifiquement éclairée par une baie vitrée était aménagée en bibliothèque, et Théo s’extasia devant tous ces livres. Bon-papa Pierre bougonna un mot d’assentiment quand son petit-fils lui demanda la permission de regarder le contenu des rayonnages et d’emprunter quelques ouvrages. Mais Jeanne n’appréciait ni l’aménagement sévère ni les papiers peints aux teintes foncées. Cet appartement ne respirait pas normalement, il y régnait une atmosphère pesante. D’ailleurs, la vie même en était absente ; les seuls objets personnels se réduisaient à quelques images vieillies, en noir et blanc, strictement encadrées. Jeanne remarqua une photo où souriaient une jeune fille et un jeune homme, qui se tenaient par les épaules ; elle reconnut avec émotion son père. La jeune fille, qui lui était inconnue, avait un air d’étrange familiarité.
« Qui est-ce, sur la photo ? »
Bonne-maman Philippine n’entendit pas. Deviendrait-elle dure d’oreille ? se demanda Jeanne.
« Bonne-maman, réessaya Jeanne en haussant d’un ton, qui est cette femme, à côté de papa ? »
Bonne-maman Philippine fut prise d’un accès de fureur que jamais Jeanne n’aurait pu prévoir. « Qu’importent ces vieilles photos ! Que des vieilleries ! »
Le silence retomba.
« Nous n’avons plus d’enfant, maintenant ; nous les avons tous donnés. » murmura cette fois Philippine, comme pour elle-même.
Jeanne crut percevoir une tristesse soudaine dans sa voix ; et les yeux de sa grand-mère s’étaient plissés, comme sous le poids d’un ancien chagrin… Jeanne se rappela alors que son père avait déjà évoqué l’existence de ses frère et sœur, plus âgés que lui. Elle ne les avait jamais vus. Son père n’aimait pas en parler. Elle ne savait pas ce qu’ils étaient devenus. D’après les propos tenus par bonne-maman Philippine, ils devaient être morts.
Jeanne plongea son regard dans le visage souriant de son père, quand il avait une vingtaine d’années, sans doute peu de temps avant qu’il ne rencontre sa mère. Les paupières soudain lourdes de larmes, elle détourna la tête.
Bon-papa Pierre conduisit les deux garçons devant une chambre tapissée d’un bleu clair assez tendre ; une chaîne hi-fi, deux lits et un bureau occupaient l’espace de la pièce, ouverte sur les toits voisins. Un grand pan de ciel emplissait la fenêtre. « C’était la chambre de votre père. » expliqua bon-papa Pierre.
La seconde chambre, destinée à Jeanne, était toute blanche : des rideaux nacrés filtraient la lumière du dehors et la laissaient rebondir sur le mobilier immaculé, sur les étoffes pâles brodées de fines fleurs roses. Immédiatement, la pièce lui plut : malgré l’absence de tout tableau ou tout souvenir personnel, elle avait une âme.
« Et cette chambre, à qui appartenait-elle ?
— À personne ! » trancha bon-papa Pierre d’un ton brusque, qui ne donnait aucune envie de poursuivre la conversation. Jeanne soupira et elle se laissa aller sur le lit qui rebondit mollement sous son poids. Comme elle aurait voulu dormir, dormir des nuits et des nuits, pour oublier toute cette douleur accumulée, ces séparations, ces déchirements, ces peurs. Elle ferma les yeux…
Tout en sentant ses membres fatigués se détendre délicieusement, elle se demanda à qui pouvait bien avoir appartenu cette chambre ; elle aurait bien aimé connaître celle qui l’avait meublée avec tant de goût – car il s’agissait d’une femme, c’était évident. Leur père, Pascal Maurin, leur avait bien parlé d’une sœur aînée, bien plus âgée que lui, avec qui il avait coupé les liens ces dernières années. Peut-être s’agissait-il d’elle ? Jeanne ne se souvenait plus de son prénom : Aude, ou Anne, quelque chose de ce genre… Elle se rappelait avoir rencontré sa tante une fois, dans sa petite enfance, mais elle ne gardait aucun souvenir de son apparence. Elle se promit d’en parler un jour à sa grand-mère, tandis qu’elle se blottissait contre l’oreiller.
L’appel de bonne-maman Philippine la tira brusquement du repos au moment où elle s’y abandonnait enfin. « À table ! »
Ils se retrouvèrent tous les trois dans la chambre des garçons, après un repas où ils n’avaient rien pu avaler. Un silence insupportable avait pesé sur les convives. Jeanne s’était demandé si elle était la seule à ressentir ce mur d’isolement qui s’épaississait de minute en minute. Ils avaient été soulagés de voir arriver le dessert et s’étaient empressés de répondre par l’affirmative quand bonne-maman Philippine avait suggéré qu’ils étaient peut-être fatigués.
Maintenant, le silence régnait toujours ; mais c’était un silence partagé. Ils n’avaient pas besoin d’exprimer leur détresse : ils se connaissaient suffisamment pour savoir avec exactitude ce que chacun ressentait.
Antoine parla enfin : « Quand même, elle exagère. Pourquoi ne pouvait-elle pas suivre notre avis, pour la maison ? »
Théo haussa les épaules : « Il n’y a rien à dire, nous sommes mineurs. »
Cette fois, Antoine s’emporta – mais comme toujours avec lui, Jeanne savait que sa colère ne faisait que cacher sa déception : « Alors, maintenant, il n’y a plus rien à dire ? C’est à elle de tout décider ? » Théo haussa de nouveau les épaules en signe de résignation, ce qui ne fit qu’augmenter l’exaspération d’Antoine.
« Et puis, qu’est-ce qu’elle a à se mêler de nos affaires ? Pourquoi sommes-nous chez eux, maintenant ? »
Jeanne exprima ce qu’Antoine n’osait pas dire, de peur de raviver sa souffrance : « Je me demande pourquoi nous ne sommes pas chez Éric, ou chez Bertrand… Nous aurions été mieux chez eux… »
Le silence s’abattit de nouveau. C’est vrai, ils s’entendaient à merveille avec Éric. S’ils se moquaient toujours un peu de Bertrand, au fond ils l’aimaient bien ; de plus, sa fille Magalie avait quasiment le même âge qu’eux.
Mais voilà, leurs deux oncles avaient explicitement refusé de devenir leurs tuteurs ; ils avaient avancé l’explication qu’ils seraient mieux avec leurs grands-parents, qui étaient plus proches d’eux.
« Plus proches de nous ! Tu parles ! maugréa Antoine. Comme si nous étions proches, nous ne les avons pas vus depuis cinq ans !
— Voilà justement le plus étonnant, commenta Théo. Éric et Bertrand savaient que nos parents s’étaient disputés avec eux. Je me demande pourquoi ils ont tout de même préféré nous placer chez eux…
— Surtout en disant que c’était pour notre bien ! » ajouta Jeanne.
Ils avaient beau chercher, ils ne trouvaient pas d’explication. Ils n’osaient pas mettre en défaut l’affection de leurs oncles ; c’était pourtant la seule cause possible… Jeanne l’écartait, parce qu’elle avait besoin de croire en leur soutien.
La chambre sombra peu à peu dans la pénombre : le ciel s’était empourpré, puis obscurci. Dans le cadre de la fenêtre, des étoiles brillaient. L’appartement était devenu parfaitement silencieux ; les grands-parents avaient dû se mettre au lit. Les triplés n’avaient plus envie de dormir, maintenus en éveil par leur besoin de comprendre.
« Vous vous rappelez, il y a cinq ans ? souffla Jeanne à voix basse, de peur qu’on l’entende dans le couloir.
— Oui. Je n’ai jamais vu papa autant en colère.
— Il disait que ses parents étaient irresponsables… Qu’à cause d’eux, il arriverait un malheur… Et que comme d’habitude, ce serait lui, Pascal Maurin, qui en ferait les frais… »
Dans les ténèbres, la même idée traversa soudain leurs trois consciences. « Et si… si c’était cela, le malheur ? » Immédiatement, Jeanne essaya de se débattre contre cette hypothèse, paniquée par les conséquences qu’elle pourrait avoir.
« Tu es fou, Antoine ! Tu voudrais dire que nos grands-parents seraient responsables de la mort de leur fils et de leur belle-fille ? C’est impossible, voyons !
— Pas forcément responsables, dit Théo de sa voix docte. Disons qu’ils pourraient avoir fait quelque chose, il y a longtemps, qui ait conduit à leur mort.
— Mais ils sont morts par accident ! Par accident, entends-tu ! s’insurgea Jeanne
— Par accident ! Décidément, tu es bête, comme fille, jugea Antoine. Tu as déjà vu des gens se baigner au mois d’avril dans un lac de montagne, tout habillés de surcroît ! Moi, ça m’a toujours semblé bizarre, ce que nous a raconté Éric sur les circonstances de leur mort… »
Et voilà. Éric revenait dans la conversation. Ils avaient cru pouvoir compter sur lui, et maintenant qu’ils auraient eu besoin de son appui, il leur faisait défaut.
« De toutes les façons, je ne vois pas pourquoi quelqu’un aurait pu désirer les tuer. Ils n’avaient pas d’ennemi, que je sache ! Au contraire, ils avaient plein d’amis ! Et puis papa était très reconnu dans son travail… Maman aidait plein de gens… Je ne les ai jamais vus se disputer avec personne.
— Si, justement, reprit Théo. Avec bonne-maman Philippine. »
Jeanne se rappelait la scène comme si c’était hier. Les triplés étaient occupés à goûter dans la cuisine, parce que les adultes avaient réclamé un moment de calme. Ils n’entendaient pas la conversation dans le salon proche, mais ils avaient fini par constater que le ton montait de plus en plus. Un peu effrayés, ils étaient sortis de la cuisine, pour voir leur père dressé furieusement contre sa mère, tandis qu’Édith tentait de le calmer ; comme à l’accoutumée, bon-papa Pierre assistait sans rien dire à la scène, en retrait, l’air craintif. Pascal Maurin avait effectivement crié que la conduite de ses parents était inconsidérée, qu’ils prenaient de gros risques et qu’ils en faisaient aussi courir à leurs enfants et petits-enfants. Pascal Maurin avait fini par réunir précipitamment sa femme et ses enfants : ils étaient tous sortis en trombe de l’appartement, où ils n’étaient plus jamais retournés. Les cris de bonne-maman Philippine les avaient poursuivis dans la cage d’escalier :
« Pascal ! Reviens ! Il faut que je t’explique. »
Sur le moment, les triplés avaient beaucoup ri de cette scène. Ils n’aimaient pas beaucoup bonne-maman Philippine et bon-papa Pierre, qui étaient si ennuyeux : ils leur préféraient Papoune et Mamoune, ceux qui étaient morts voici deux ans dans un accident de voiture. Jeanne se souvenait que ses parents avaient beaucoup parlé de cette affaire ; simplement, leurs conciliabules cessaient dès qu’approchaient leurs enfants.
« Et s’ils s’étaient disputés pour une question d’héritage ? lança Jeanne.
— Oui… Peut-être, réfléchit Théo, ça expliquerait que bonne-maman Philippine insiste tant pour nous constituer un petit pactole.
— Ouais », grogna Antoine, visiblement pas convaincu.
Du reste, cette interprétation n’expliquait pas pourquoi ils n’avaient pas le droit de sortir de l’appartement. Le lendemain, après une nuit agitée de cauchemars, Antoine avait voulu aller se promener. Il s’était vu opposer un refus catégorique de bonne-maman.
« Mais bonne-maman, il fait très beau dehors !
— Le quartier est dangereux pour vous, je ne veux pas que vous sortiez. »
Bonne-maman Philippine, en bonne ménagère, avait disparu derrière son plumeau et s’était absorbée dans son exercice de dépoussiérage quotidien pour indiquer ostensiblement qu’il était inutile de poursuivre la conversation. Les trois jeunes avaient donc battu en retraite dans la chambre bleue et ils avaient longuement discuté de cette décision.
« Dangereux, le quartier ? Non mais, elle est folle ou quoi ! On est dans le coin le plus tranquille de Paris ! »
L’âme en peine, ils étaient retournés à leurs occupations favorites : Théo avait sorti un livre, Jeanne s’était mise à dessiner, et Antoine avait ouvert son sac à la recherche de son téléphone portable.
Au bout d’une demi-heure, il avait retourné tous ses sacs, fouillé toutes les armoires, vidé toutes ses poches.
« Dites, vous ne m’auriez pas pris mon portable, par hasard ?
— Non », grogna Jeanne, absorbée dans la réalisation d’un portrait de ses parents au crayon. Théo ne daigna même pas répondre : il lisait un livre qu’il avait déniché dans la bibliothèque de bon-papa Pierre.
« Alors il a disparu. » Pas de réaction.
« C’est bonne-maman Philippine qui me l’a pris, c’est sûr. »
Antoine avait réussi son effet. Les têtes de Jeanne et de Théo se relevèrent simultanément.
« Quoi ? Pourquoi te l’aurait-elle pris ?
— Je ne sais pas, moi ! Ce que je sais, c’est que mon téléphone a disparu ! Voilà !
— Tu as dû mal regarder. » suggéra Jeanne. Antoine haussa les épaules.
Il avait semé le doute dans l’esprit de ses frère et sœur. Jeanne et Théo se lancèrent immédiatement à la recherche de leur propre téléphone portable.
Sans succès. Ils eurent beau retourner toutes leurs affaires, pas de téléphone.
« C’est trop fort ! » soupira Théo, quand il fallut se rendre à l’évidence. « Nous n’avons pas le droit de sortir, et en plus, elle nous a pris nos téléphones ! Mais à quoi joue-t-elle ?
— Je vais voir. » lança Antoine. Et il sortit de la pièce, l’air décidé.
Jeanne et Théo laissèrent la porte ouverte, pour pouvoir entendre. Bonne-maman Philippine devait s’être installée dans son fauteuil favori du salon ; ils entendirent Antoine s’approcher d’elle et lui demander d’un ton dégagé : « Bonne-maman, j’aimerais téléphoner à un ami. Où se trouve le téléphone ? »
La réponse de bonne-maman Philippine ne se fit guère attendre, aussi sèche et raide qu’à l’ordinaire. « Le téléphone est là, posé sur le guéridon, mais je ne veux pas que tu l’utilises. »
Jeanne et Théo mesurèrent l’ampleur du choc que venait de recevoir leur frère à la densité du silence qui suivit. Il finit par bafouiller : « Mais… bonne-maman… c’est un vieux copain… Il va se demander ce que je deviens…
— Allez, il s’en remettra, ton vieux copain. Je ne veux pas que tu sois tenté d’aller traîner dehors. Tu es mieux ici. »
Antoine balbutia quelques phrases de révolte, mais bonne-maman Philippine se montrait intransigeante. Il finit par battre en retraite, dépité. Alors qu’il se faufilait par la porte entrouverte, Jeanne aperçut la silhouette de bon-papa Pierre dans le couloir. Il s’était arrêté et les regardait avec pitié, comme s’il avait conscience de mal agir.
«Je vous l’avais dit ! C’est bien elle !
— Mais… Pourquoi ? »
De nouveau les pourquoi, les comment… Pourquoi bonne-maman Philippine ne voulait-elle pas les laisser sortir, ni téléphoner ? C’était à croire qu’elle souhaitait qu’ils coupent tous les fils qui les reliaient encore à leur existence précédente: ils devaient rompre avec leurs amis, avec leurs habitudes… Et même avec leur liberté d’aller et de venir où bon leur semblait. « Si au moins nous avions pu emmener l’ordinateur… » soupira Antoine.
« Tu crois peut-être qu’elle t’aurait laissé te connecter à ta messagerie ? Tu n’y es pas, mon vieux ! Si elle ne veut pas que nous téléphonions, elle n’aurait pas voulu non plus d’Internet !
— De toutes les façons, il n’y a pas d’ordinateur dans l’appartement, souligna Jeanne. J’ai vérifié. »
Jeanne regarda Antoine : il prenait la nouvelle particulièrement au sérieux. Son frère accordait beaucoup d’importance à ses relations, notamment féminines, et il passait souvent un bon quart de sa journée à discuter au téléphone ou à envoyer des messages à ses amis. La moindre solitude lui apparaissait comme un échec. Son soudain désarroi prêtait à sourire, mais Jeanne n’en avait actuellement aucune envie.
« Tout de même, je me demande bien pourquoi… » Théo laissa son interrogation en suspens. Les trois adolescents pensaient à la même chose : que pouvait donc justifier cette étrange conduite de la part de leur grand-mère ?
Jeanne soupira. Elle regarda son dessin inachevé : à l’aide d’une ancienne photographie, elle avait entrepris de retracer les traits des deux visages tant aimés. Les silhouettes de ses parents apparaissaient sur la feuille, esquissées au crayon, et souriantes. Depuis l’annonce de leur mort, que de questions laissées en suspens ! Son optimisme avait peine à y faire face.
Elle se souvenait avec une infernale précision du moment où Éric était entré dans la maison familiale située dans la petite ville de Saint-Hammer, ce dimanche après-midi : à cet instant précis, tout avait basculé. Son existence avait tourné court, sortant de la voie sereine où elle cheminait tranquillement pour emprunter une nouvelle piste, noyée dans l’obscurité, pleine d’épreuves et de peurs. Depuis, les pourquoi se succédaient, sans qu’aucune réponse n’apparaisse jamais. Et les triplés restaient dans l’incertitude, à digérer leur deuil.
Leurs parents étaient partis le samedi matin pour un week-end « en amoureux », comme ils disaient joyeusement. De temps à autre, depuis que leurs enfants étaient en âge de rester seuls quelques jours, ils partaient ainsi tous les deux. Ils allaient faire du tourisme, ou de la marche à pied, ou quelques visites… Les triplés ne s’en inquiétaient pas trop. Ces excursions étaient rares, et ils appréciaient de savourer la liberté qui leur était ainsi octroyée : passer la journée toute entière chez des amis, pouvoir manger des chips et du saucisson en guise de dîner, se coucher très tard en regardant des DVD et se lever à midi le lendemain.
Ce samedi matin, leurs parents étaient partis un peu plus pressés que d’habitude : ils devaient se rendre loin. Leur père les avait embrassés d’un air soucieux, leur mère avait un peu plus insisté qu’à l’ordinaire sur les recommandations d’usage – Ne vous couchez pas trop tard, fermez derrière vous la porte d’entrée, n’oubliez pas de faire vos devoirs, etc. Puis ils s’étaient hâtés de monter en voiture ; les triplés avaient agité leur main en signe d’adieu, et le véhicule avait disparu au tournant de la route. Il était 8 h. Les trois adolescents avaient pris leurs sacs et s’étaient rendus au lycée.
La journée du samedi était passée, puis le dimanche ; il était 15 h, chacun des enfants Maurin s’était réfugié dans sa chambre pour vaquer à ses occupations : Jeanne et Théo faisaient leurs devoirs, Antoine dialoguait sur MSN. Ils n’attendaient pas leurs parents avant 20 h, quand le dîner serait prêt et la maison rangée.
Tout à coup quelqu’un avait frappé à la porte d’entrée. Antoine s’était précipité, certain qu’il s’agissait de la visite d’un ami ; Jeanne et Théo ne s’étaient pas dérangés, jusqu’à ce qu’ils entendent Antoine s’exclamer : « Éric ! Ça alors ! » Éric n’avait pas répondu : voilà ce qui avait, d’emblée, alerté Jeanne. Elle avait descendu les escaliers qui menaient dans le vestibule et avait aperçu son oncle. Son allure l’avait aussitôt confirmée dans son idée que quelque chose ne tournait pas rond : sa chemise baillait, ses cheveux étaient encore plus ébouriffés qu’à l’ordinaire, et surtout, il avait l’air parfaitement affolé. Il devait avoir reçu un choc, car il ne parvenait plus à parler : sa bouche dessinait un o parfait, mais aucun son n’en sortait. Il était entré fébrilement, avait repoussé la porte derrière lui et l’avait fermée à clef. Machinalement, il s’était affaissé dans le fauteuil du salon le plus proche.
Jeanne, Antoine et Théo s’étaient assis tous les trois dans le canapé qui lui faisait face, stupéfaits de l’attitude de leur oncle. Ils avaient attendu. Éric jetait des coups d’œil furtifs tout autour de lui ; il se passait la main dans les cheveux ; enfin il s’était calmé, et les avait regardés plus attentivement.
« Mes enfants… Oh, mes enfants… Je suis désolé, mais je dois vous apprendre une nouvelle très grave… Édith et Pascal… vos parents… » Éric avait fondu en larmes. Antoine et Théo s’étaient levés d’un seul bond, ils s’étaient précipités sur lui pour l’assaillir de questions, mais Jeanne était restée immobile, lovée dans un coin du canapé. Un froid insidieux s’était faufilé dans son corps quand Éric avait commencé à parler de ses parents, et maintenant, elle se sentait glacée de l’intérieur, frappée par un malheur dont elle ne pourrait jamais se remettre complètement. Elle savait, elle avait déjà tout compris. Ses parents étaient morts.
Éric, désespéré, leur avait expliqué que leurs parents étaient décédés par accident.
« Quel accident, exactement ? » avait interrogé Antoine, entre deux hoquets.
Éric avait eu l’air gêné, ou peut-être ne parvenait-il pas à dominer son chagrin. Il avait finalement répondu : « Ils se sont noyés. Ils se baignaient dans le lac de Windrille, en montagne. Ils ont dû mourir d’une hydrocution. » Sous le choc, personne n’avait relevé. D’ailleurs, les triplés savaient que leurs parents devaient se rendre dans les Alpes.
De ce sinistre moment jusqu’à la date de l’enterrement, trois jours plus tard, Jeanne conservait des souvenirs confus, où ne dominaient que les pointes aiguës de sa douleur. Éric ne voulait pas les laisser seuls dans la maison abandonnée ; il redoutait un quelconque danger, auquel Jeanne n’avait pas attaché d’importance, préoccupée uniquement de son deuil. Ils avaient donc ramassé quelques affaires, puis quitté la demeure familiale ; Éric et Laure les avaient hébergés dans leur petit appartement, où la joie de vivre des deux enfants les avait un peu réconfortés. Éric et son frère, Bertrand, s’étaient chargés de toutes les pénibles formalités administratives à accomplir dans ce genre de situation : Jeanne, Antoine et Théo leur en surent gré, car ils n’auraient pas supporté de se voir assaillis par des employés des pompes funèbres.
Puis il y avait eu ce jour d’enterrement, hier…
« Vous vous rappelez, Éric aussi craignait quelque chose. Quand nous sommes arrivés au cimetière, hier, il a regardé partout autour avant de nous laisser sortir de la voiture. »
Théo se retourna. Depuis tout à l’heure, il n’avait pas tourné une seule page de son livre. « J’ai remarqué, moi aussi. Tout le temps que nous avons passé dans son appartement, il était soucieux, il regardait par la fenêtre.
— Je ne vois pas pourquoi nous courrions un danger ! rétorqua Antoine.
— Je n’ai pas dit que nous étions en danger…
— Si, justement ! Tu as l’air de croire que bonne-maman Philippine et Éric cherchent à nous protéger ! Moi, je pense seulement qu’ils sont devenus fous, c’est tout ! Ils ont reçu un choc et ils ne peuvent pas admettre que nous sommes suffisamment grands pour nous débrouiller tout seuls ! »
Jeanne réfléchit. « Non, ce n’est pas si simple. Il y a réellement des choses étranges, dans cette affaire. Par exemple, cet… accident… »
Le silence retomba, bien plus épais qu’auparavant. Depuis hier, une entente tacite leur avait fait soigneusement éviter le sujet ; ils savaient combien de dangers il recelait, et ils craignaient de l’aborder trop vite, risquant de souiller ainsi la paix sereine où devaient reposer leurs parents. Cependant, il n’était pas possible d’ignorer plus longtemps cette vérité gênante : l’accident n’était qu’un alibi. Jeanne aussi en était persuadée, malgré ses réticences à l’admettre.
Théo trancha : « Ce n’est pas un accident. » Jeanne baissa la tête. Il était inutile de se voiler la face.
« Mais alors… Qui ? »
Il semblait à Jeanne que sa peine s’était encore alourdie : à la douleur de la mort s’ajoutait le malaise qu’infligeait l’incertitude d’un crime sans coupable. Le décès de ses parents aussi jeunes, aussi heureux de vivre, pleins de vitalité, était déjà une erreur de la nature, un horrible contre-sens ; mais elle parvenait à l’admettre comme quelque malheur particulièrement monstrueux. Là où la mort était inacceptable, c’était quand elle était provoquée sciemment – sans pour autant en connaître l’explication.
« Oui, qui aurait pu désirer la mort de nos parents ? » Sa question resta en suspens. Édith et Pascal vivaient entourés d’amis ; leur père était respecté dans son travail, car il accomplissait ses activités de chirurgien dans un grand hôpital parisien avec un talent qui lui avait permis de sauver de nombreuses vies ; depuis que les triplés étaient en âge de se rendre seuls au lycée, leur mère, femme au foyer, investissait beaucoup de son énergie dans des organisations bénévoles au service des plus démunis. Une famille sans histoire…
Pourtant, quelqu’un avait désiré leur nuire, au point de les tuer.
Antoine rompit brusquement le silence : Jeanne et Théo sursautèrent, tandis que leur frère enflait la voix, grandiloquen : « Si quelqu’un les a tués, je veux le savoir ! Je veux connaître la raison de leur meurtre ! Je n’accepterais pas de laisser impuni l’assassinat de mes parents ! »
Jeanne resta muette. Elle savait qu’il ne fallait jamais répondre aux brusques colères d’Antoine. Pourtant il avait raison : si le décès de leurs parents était criminel, la moindre chose qu’ils pouvaient faire en leur mémoire, c’était bien d’apprendre le mobile de l’assassin et de chercher à le remettre aux mains de la justice ! Mais comment faire ? Ils étaient coincés ici, sans permission de sortie… Théo, gêné, changea de sujet.
« Hier, vous avez remarqué ? Il y avait beaucoup de monde à l’enterrement.
— Oui, approuva Jeanne. Tous des inconnus. C’est bizarre, vous ne trouvez pas ? »
Antoine haussa les épaules : « Mais vous voyez le mal partout, maintenant ! C’était des gens que connaissaient les parents, et pas nous, voilà tout !
— Ils étaient des dizaines, Antoine, des centaines ! En admettant que quelques collègues ou connaissances se soient déplacés, ils ne pouvaient pas être aussi nombreux !
— Parfois, ils donnaient l’impression d’être très liés à nos parents. Ils pleuraient, comme s’ils étaient réellement affectés par leur mort. Ils ne pouvaient pas être de simples connaissances ! »
Antoine gardait l’air buté, pourtant il ne répliqua pas, à demi convaincu par l’argument de sa sœur. Mais il ne s’agissait là que d’une question parmi tant d’autres…



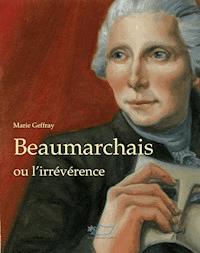
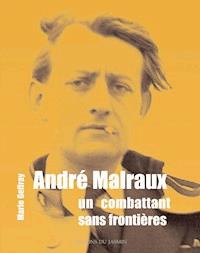













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











