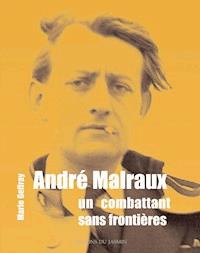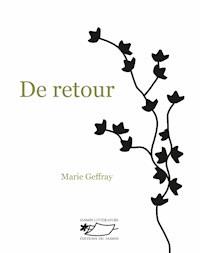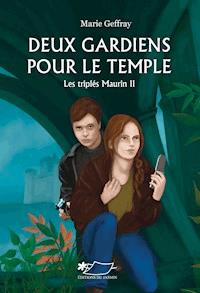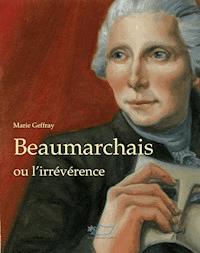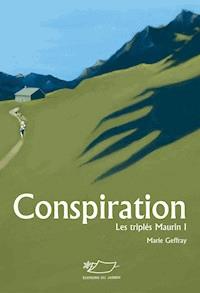Couverture
L’auteur
Marie Geffray a suivi des études de lettres : elle a rédigé une thèse de doctorat sur les écrits et les discours d’André Malraux et de Charles de Gaulle. Agrégée de lettres modernes, elle cherche à transmettre auprès des plus jeunes sa passion pour la littérature.
Du même auteur
Conspiration, Éditions du Jasmin, 2011
De Gaulle et Malraux, le discours et l’action, François-Xavier de Guibert, 2011
En direction du large, Pascal Galodé Éditeurs, 2008
Autres biographies
publiées dans la collection Signes de vie
1. Van Gogh, la course vers le soleil
José Féron Romano & Lise Martin
2. Jacob et Wilhelm Grimm, il était une fois…
François Mathieu
3. George Sand, le défi d’une femme
Séverine Forlani
4. Frida Kahlo, les ailes froissées
Pierre Clavilier
5. Simone de Beauvoir, une femme engagée
M. Stjepanovic-Pauly
6. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes et au delà
M. Stjepanovic-Pauly
7. Frédéric Chopin, l’âme du piano
Claude Clément
Copyright
Tous droits de reproduction, de traduction
et d’adaptation réservés pour tous pays
© 2011 Éditions du Jasmin
www.editions-du-jasmin.com
Dépôt légal septembre 2011
ISBN : 978-2-352844-55-6
Titre
Préface
Il m’est particulièrement agréable de préfacer ce livre de Marie Geffray consacré à Malraux. Je veux d’abord dire que cette jeune chercheuse fait partie du petit nombre des jeunes universitaires prometteurs pour la recherche littéraire des auteurs du XXesiècle et notamment sur Malraux. Marie Geffray est l’auteur d’une thèse remarquée sur l’art oratoire de de Gaulle et de Malraux et a participé au premier dictionnaire Malraux1.
Une nouvelle génération de chercheurs douée et audacieuse s’est levée, qui fut le plus souvent formée par la génération des pionniers dans le domaine des études malrauciennes en France. Je dis en France, car en saluant le travail de l’une des plus jeunes spécialistes, je ne veux oublier de saluer le travail de pionnier de Kiyoshi Komatsu au Japon dès les années trente, et de Walter Langlois outre-Atlantique. Quatre générations de chercheurs à travers le monde se sont succédé depuis l’époque deLa condition humaine et de la lutte antifasciste, mais Malraux avait déjà suscité un véritable intérêt au cours de la décennie précédente.
Ayant eu l’incroyable chance d’être l’un des plus jeunes malrauciens à avoir encore connu Malraux grâce à un « heureux sort » eût dit Jean de la Croix, j’admire les chercheurs, telle Marie Geffray, née il y a trente ans environ et qui furent saisis du souffle hanté et génial de Malraux, ce souffle posthume qui continue à être présent au début de ce XXIe siècle.
Marie Geffray nous offre donc aujourd’hui ceMalraux, un combattant sans frontières,qui apporte une sorte de fraîcheur au personnage d’une part, au sujet d’autre part. Sous ses doigts et sa plume le vaste sujet polyphonique depuis l’écrivain farfelu des années vingt, l’aventurier, le romancier, l’anti-colonialiste, le combattant d’Espagne, le compagnon de route des communistes, le cinéaste, le colonel Berger, puis le compagnon génial du général de Gaulle, le ministre d’État des affaires culturelles, enfin l’écrivain et métaphysicien de l’art et du destin, tous ces visages trouvent leur unité, leur convergence en un chœur aux accents tantôt romantiques, tantôt contemporains.
Les premières études importantes sur André Malraux sont nées en France au cours des années cinquante et aux États-Unis dans les années soixante-dix.
L’époque actuelle est fort riche car elle fait dialoguer les témoins de l’écrivain, dont l’âge oscille entre cinquante et cent ans, avec cette nouvelle génération de spécialistes ou de connaisseurs (terme que Claudel préférait au premier dans son acception de co-naissance) qui sont nés après sa mort.
Pour Marie Geffray, l’histoire du XXe siècle, celle que Malraux a traversée et dont il fut l’un des acteurs secondaires certes, mais un témoin de premier plan qui apporta de nouvelles lettres de noblesse au courage et à l’engagement des artistes, des écrivains, des intellectuels trempés, cette histoire donc, n’est pas pour elle dépassée. Nous vivons dans le domaine historique, politique, culturel, artistique, de ce qu’elle a fabriqué de toutes pièces dans le sublime comme dans l’atroce, l’inhumain, inséparables du complexe, du métaphysique.
De quelle épiphanie l’œuvre de Malraux est-elle porteuse qui puisse parler aux nouvelles générations ?
Il faut dire que contrairement à certains de ses plus célèbres biographes qui n’ont rien compris à l’art en général et moins encore à la portée de son discours sur la création artistique, Marie Geffray, elle, comprend la profondeur de la pensée sur l’art de Malraux pour écrire : « Parce qu’elles sont capables d’exprimer l’homme et sa vision du monde par-delà les époques, les œuvres permettent au créateur comme à l’esthète de s’affranchir du temps. » Puis elle traduit les hautes valeurs judéo-chrétiennes d’amour et de justice que Malraux admirait tant, par celles de fraternité et de justice sociale, qui furent l’un des fondements de son action et de son œuvre.
Dans ses deux derniers chapitres, où l’art oratoire prend une place importante, Marie Geffray s’arrête sur lesOraisons funèbres mais curieusement sans être frappée par cette coïncidence, qui n’en est pas une, qui fit que Malraux parmi les dix discours retenus dans l’édition définitive de 1976, conserva seulement trois grands discours en hommage à trois civilisations qui furent parmi les plus importantes pour l’Europe et partant pour l’Occident : l’Égypte, Israël, la Grèce. Toutefois, il a toujours rappelé que les deux parrains de l’Europe étaient Israël et la Grèce.
C’est en quelque sorte avec la question de la mythomanie de l’écrivain et homme d’action que la jeune universitaire achève son livre riche et limpide. Mythomanie et farfelu à la Clappique, ce personnage fondamental de l’œuvre de Malraux, sont deux éléments indissociables du destin de l’auteur desVoix du silenceet deLa Condition humaine.Marie Geffray a compris que la mythomanie permit à Malraux de dépasser « la négligence des constellations » et « l’ironie des nébuleuses ».
Je salue ici le deuxième livre d’une universitaire de grand talent qui aura beaucoup à apporter à l’évolution de la critique et de la théorie littéraires ainsi qu’à la poétique de l’art oratoire si prégnante chez André Malraux.
Michaël de Saint Cheron
1.Dictionnaire Malraux, Janine Mossuz-Lavau, Michaël de Saint-Cheron (dir.), CNRS éditions, 2011.
Exergue
La tragédie de la mort est en ceci
qu’elle transforme la vie en destin.
André Malraux.L’Espoir.œuvres complètes, t. 2.
1
Pour l’amour de Clara
Nous divorcerons six mois après…1
Dès qu’elle le voit, elle tombe amoureuse. Clara Goldschmidt est belle et érudite ; née dans une riche famille juive et cosmopolite, elle a reçu une solide éducation, à la fois variée et raffinée. Comment l’autodidacte André Malraux peut-il à ce point la fasciner ? Sa culture est réelle, mais manque de structure : le jeune homme n’a pas obtenu le baccalauréat. Sa connaissance du milieu des libraires et des éditeurs parisiens dissimule mal son manque d’expérience. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, son élocution et ses gestes sont déformés par les tics. Pire encore, il paraît bien jeune, il a à peine vingt ans, alors que Clara est de trois ans son aînée !
Pourtant, André séduit. Il soigne ses allures de dandy, laisse retomber sur ses épaules de lourds manteaux qui le drapent, se chausse chez les meilleurs fournisseurs parisiens, multiplie les accessoires : écharpes, gants et cannes. Cette prestance s’accompagne d’une faconde et d’une assurance qui font converger vers lui les regards. Lorsqu’il entre dans une pièce, son arrivée ne passe pas inaperçue : aussitôt, on lui fait place, on écoute avec amusement – et parfois irritation – ses fulgurances verbales, aux jugements souvent péremptoires.
Clara est envoûtée. La réciproque est vraie. André lui livre une cour effrénée.
Ils se sont rencontrés au printemps 1921, au cours d’une soirée réunissant différents collaborateurs de la revueAction, à laquelle les deux jeunes gens participent occasionnellement. Clara Goldschmidt et André Malraux s’éclipsent rapidement et gagnent une boîte de nuit. André danse mal, Clara ne lui en tient pas rigueur. Ils se revoient dès la semaine suivante. La jeune femme brune au menton décidé et aux yeux gris est d’autant plus captivante qu’elle assume sa liberté : fiancée à un médecin, elle a rompu cette liaison. Élevée dans une famille juive, orpheline de père, elle possède une culture humaniste très étendue et, en plus du français, maîtrise l’allemand, l’anglais, et un peu l’italien.
Malraux lui parle d’art. Elle évoque l’Italie, où elle ira l’été prochain. « Je vous accompagne », annonce André.
Clara ne refuse pas. Ils continuent à sortir ensemble à Paris, de musées en expositions. André tait ses origines modestes, préférant affirmer que son père est banquier, alors qu’il est tout au plus un vague agioteur agissant pour le compte des autres. Clara ne se formalise pas de ces mensonges. Elle comprend vite que son amant préfère embellir la réalité plutôt que de la subir.
Les deux jeunes gens souhaitent voyager en Italie tout en préservant les apparences de l’honorabilité. Officiellement, Clara part donc seule. Sur le quai de la gare de Lyon, elle embrasse sa mère et monte dans le train. Il s’ensuit un véritable vaudeville. André, prenant soin d’éviter la belle-mère, emprunte le même convoi, quelques wagons plus loin. Les amants se retrouvent vite dans un compartiment. Mais un ami de la famille Goldschmidt, consultant les registres du train, constate que Clara voyage avec un inconnu : comment une jeune fille de bonne famille ose-t-elle se compromettre ainsi ? Clara s’affole : si l’ami parle, son oncle, qui détient les cordons de la bourse, risque de lui couper les vivres.
Malraux prend les devants. Il entre dans le compartiment de l’indiscret et parle de duel. L’ami de la famille s’incline : il ne parlera pas. Les apparences sont sauves. Un mariage résoudrait sans doute le problème, suggère André. Clara acquiesce, mais rappelle que le mariage n’est qu’une institution vaine en regard de la liberté de l’individu : « Nous divorcerons six mois après », dit-elle légèrement. Mais voici l’Italie : le jeune Malraux découvre Florence avec émerveillement. Ses jugements picturaux, éblouissants, confondent Clara par leur justesse et leur profondeur. Ils se repaissent des œuvres tout autant que des discours qu’ils tiennent sur elles.
Après un bref séjour à Sienne, un télégramme les attend de retour à Florence : la mère de Clara a eu vent de l’aventure et l’enjoint de revenir immédiatement à Paris. En retour, le couple lui annonce ses fiançailles.
Le séjour italien se poursuit à Venise. L’argent vient à manquer, il faut retourner à Paris. Clara est accueillie par sa famille, oncle, tante et frère : tous souhaitent la dissuader de se marier avec cet homme de peu. Clara n’en a que faire. Quant à André, il parvient à extorquer l’autorisation de mariage à son père d’abord réticent : encore mineur, il a besoin de son accord pour passer devant le maire.
Le 21 octobre 1921, les deux jeunes gens s’épousent à la mairie du XVIearrondissement, en présence du père de Malraux, mais en l’absence de sa mère et de ses tantes. En échange d’un pot de vin, l’employé de l’état civil accepte de murmurer les dates de naissance respectives des époux, pour ne pas mettre en évidence leur différence d’âge. Les jeunes mariés s’installent au second étage de la villa des Goldschmidt. André ne tient pas trop à prendre une situation : « Je ne vais tout de même pas travailler », explique-t-il à Clara. Heureusement, celle-ci reçoit en dot de quoi assurer la subsistance du couple : trois cent mille francs-or, en plus d’actions.
André souhaite gérer le portefeuille pour faire fructifier cette petite fortune sans avoir à s’abaisser à un quelconque emploi. Sur les conseils de son père, il achète quantité d’actions dans les mines mexicaines qui, selon Fernand Malraux, vont continuer à grimper. Le jeune couple peut voyager tranquillement. Clara et André se rendent à Vienne où, grâce à la dévaluation du mark, ils vivent dans le luxe. Ils visitent aussi diverses provinces françaises et la Belgique, allant de musée en monument.
De temps à autre, André suit les cours de la Bourse. Il accompagne Clara en Allemagne, chez son grand-père, puis au printemps 1922, le couple part pour la Tunisie et la Sicile, plus tard pour la Grèce. Malraux écrit quelques textes, difficilement : il cherche sa voie. Pour le moment, tout en prenant officiellement ses distances avec les surréalistes, il peine à se détacher de leur influence dans des textes aux images irrationnelles et au style trop chargé. Les éditeurs rechignent devant ces écrits « farfelus » – pour utiliser le terme affectionné par le jeune Malraux.
À force de voyages et de réunions parisiennes avec les amis, André oublie de surveiller les actions mexicaines, qui ont cessé de monter. Elles commencent à chuter… Elles chutent… Elles ne valent plus rien.
Clara et André sont ruinés.
1. Clara Goldschmidt à André Malraux, avant leur mariage. Sur le témoignage de Clara, on peut lireNos vingt ans. Clara Malraux.- Nos vingt ans, Grasset, 1962.
2
Un enfant trop choyé
Presque tous les écrivains que je connais aiment leur enfance, je déteste la mienne.1
Sans argent, que faire ? André Malraux n’a pas appris à travailler. Trop protégé, il n’a jamais occupé d’emploi stable et n’a pas terminé sa scolarité. Saura-t-il, comme son père ou comme son grand-père, faire preuve de féconde inventivité pour se tailler une place dans la société ?
Le grand-père d’André, Alphonse Malraux, est né en 1832 à Dunkerque dans une famille de marins aventuriers. Après avoir tâté de différents métiers dans l’espoir de faire fortune, il est devenu armateur. Alors que ses ancêtres prenaient volontiers la mer, il se contente de faire voguer les dix navires de sa flotte ; il n’embarque qu’exceptionnellement, pour surveiller ses hommes. Notable de la ville, propriétaire de plusieurs maisons situées dans les beaux quartiers, sa fortune est faite : à trente-cinq ans, il épouse Isabelle Mathilde Antoine, avec laquelle il aura huit enfants – dont le père de Malraux, Fernand. La demeure est confortable, les meubles cossus, le linge bien entretenu. Pour autant, les fils d’Alphonse ne restent pas longtemps au foyer. Aussi rude avec ses enfants qu’avec ses employés, Alphonse fait régner sa loi sur la maison comme sur la ville, où il entretient une réputation de forte tête. En 1890, il est veuf.
André aimera ce grand-père, chez qui il est régulièrement envoyé en vacances. La maison de Dunkerque, sombre d’une splendeur passée, regorge de trésors, notamment des maquettes de bateaux qu’affectionne Alphonse. Le caractère bien trempé du vieil homme fascinera aussi l’enfant : par la force de sa volonté, Alphonse a construit sa vie et s’est considérablement enrichi. Pourquoi pas André, et avant lui, Fernand ? Les hommes de la famille sont des entrepreneurs.
Fernand abandonne rapidement ses études et, dès dix-huit ans, s’engage pour quatre ans dans l’armée, où il incorpore un régiment de dragons. Quand il est libéré comme sous-officier, il occupe de petits emplois dans des banques parisiennes. Malgré son défaut d’instruction secondaire, Fernand veut faire fortune, comme son père : la Bourse l’attire. Il se dit courtier, même s’il sert seulement d’entremetteur entre les agents de change et les particuliers qui souhaitent acquérir des actions. De temps à autre, il se passionne aussi pour des inventions : il rêve de déposer des brevets sans jamais y parvenir. Son bagout le sert autant que son amateurisme, il se proclame banquier ou ingénieur. Mais Fernand ne sait pas seulement bien parler : il est aussi bel homme. Avec sa moustache en croc et sa prestance soignée, il sait plaire aux femmes.
Il s’éprend de la jeune Berthe Lamy, d’origine modeste – son défunt père était boulanger, sa mère couturière. Le 24 mars 1900, les deux jeunes gens se marient à Paris, dans le XVIIIe arrondissement. C’est aussi là que logent désormais les jeunes époux.
Le 3 novembre 1901 naît Georges-André Malraux, le jour même de l’anniversaire de sa mère, ce qui préfigure peut-être le grand attachement que celle-ci portera à son fils. Le premier prénom, Georges, est vite abandonné. Le garçon est appelé André. Un petit frère, né le jour de Noël 1902 et prénommé Raymond-Fernand, ne vivra que trois mois.
Le couple Malraux se porte mal. Fernand multiplie les infidélités à sa femme, sans s’en cacher. Les parents d’André se disputent en sa présence. À quatre ans, le garçonnet menace d’appeler le garde-champêtre pour que les cris cessent enfin… Fernand part une première fois de l’appartement conjugal ; après un court retour, il le quitte définitivement.
À la suite de ces déboires conjugaux, Berthe Malraux emmène son jeune fils et trouve refuge auprès de sa mère, Adrienne. À Bondy, en périphérie parisienne, celle-ci gère une confiserie avec l’aide de sa fille Marie, restée célibataire. Berthe et André vont donc vivre dans ce bourg où se côtoient ouvriers, paysans et fonctionnaires – ni banlieue chic, ni banlieue industrielle.
André grandit à l’ombre des bocaux de bonbons, veillé par trois femmes attentives. Au 16 rue de la Gare, dans le quartier commerçant de Bondy, la petite confiserie côtoie des bistrots et des cafés, des épiceries et divers artisans. Elle offre ses douceurs parfumées aux passants : sucreries, friandises, chocolats, épices, thés et cafés. Alors que le sous-sol fait office de réserve, l’étage supérieur sert de logement. André y dispose de sa propre chambre. Choyé, on ne lui demande pas de participer aux travaux ménagers ou d’aider à servir au magasin. Il se rend à l’école, mais jamais sa mère, sa grand-mère ou sa tante ne le forcent à la réussite.
Cette protection excessive est peut-être la conséquence de la maladie du jeune garçon : atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui touche les émetteurs neurologiques qu’utilise le cerveau pour ordonner les mouvements et les comportements, il est affecté de nombreux tics : grimaces diverses, mouvements non maîtrisés, respiration saccadée… Les médecins de l’époque peinent à identifier ce mal. Aujourd’hui, on sait que ce syndrome rend la scolarité difficile et qu’il a certainement empêché André de poursuivre des études. Mais il explique peut-être aussi son attirance pour le farfelu !
Malgré ses tics et son hyperactivité, le jeune Malraux exerce un certain ascendant sur ses camarades. Il parle bien, et les trois femmes veillent à son apparence. Sa mise est toujours impeccable, il se tient très droit dans ses beaux habits soignés. Sérieux, il n’a pas le droit de traîner dans les rues après les cours. Il fréquente des institutions privées, donc payantes, plutôt que l’école communale : les dames veulent qu’il reçoive une bonne éducation. C’est à l’Institution Dugand qu’il rencontre son premier grand ami, Louis Chevasson, qui lui restera toujours fidèle.
Même s’il grandit dans un univers de femmes, deux figures paternelles veillent sur André. Fernand l’invite une fois par semaine : il raconte – en enjolivant – ses « coups » à la Bourse et ses réussites professionnelles. Pour le jeune garçon, ce père est une figure imposante, un exemple de conquête personnelle bâtie à partir de rien. Plus occasionnellement, André se rend aussi chez son grand-père de Dunkerque lors des vacances de Pâques et d’été. Non seulement il y découvre la mer, mais encore il est fasciné par la personnalité flamboyante d’Alphonse Malraux. Le petit André erre dans la grande maison encombrée de souvenirs jusqu’au décès d’Alphonse, en 1909.
En 1913, André obtient le certificat d’études. L’adolescent rêve d’aventures : il fait du scoutisme et, avec son ami Louis, dévore les journaux illustrés et les romans de cape et d’épée. Pourtant il finit par se lasser de ces livres faciles et trouve, à la bibliothèque populaire du quartier, des ouvrages plus roboratifs. C’est le début d’une éducation culturelle largement autodidacte, menée au hasard des lectures.
L’année suivante, la guerre éclate. De Bondy, on entend gronder les canons allemands, avant que la bataille de la Marne ne les repousse plus loin. Aux yeux de son fils, Fernand Malraux s’enveloppe d’une nouvelle gloire : il est promu adjudant en novembre 1914, puis sous-lieutenant l’année suivante. Il a belle prestance dans son uniforme, mais il s’arrange pour rester loin des combats. Il sort indemne de la guerre, sans la moindre blessure – et sans décoration. André n’en a cure. Il continue d’autant plus à admirer ce père qu’il se fait lointain. Déjà avant le début des hostilités, Fernand vivait en concubinage avec une jeune femme, Marie-Louise Godard, surnommée Lilette. Depuis 1912, André a un demi-frère, Roland – qu’il n’a encore jamais rencontré ; en 1920 naîtra un second demi-frère, Claude.
André suit des leçons particulières qui lui permettent, en 1915, de s’inscrire à l’école primaire supérieure de la rue Turbigo, à Paris. Louis Chevasson l’accompagne dans la capitale, où il suit d’autres cours. Pour les deux jeunes garçons commence une exploration méthodique de Paris, qui leur offre l’occasion de découvrir les bibliothèques, les musées, les théâtres, les cinémas et les cafés. André sort de l’enfance et accède à la liberté. Il confie à ses amis, Louis et un nouveau venu, Marcel Brandin, sa nouvelle vocation : il souhaite écrire.
André a-t-il réellement détesté son enfance ? Certainement pas. Il fut un enfant heureux, soigné, protégé. Alors, pourquoi avoir déclaré au début duMiroir des limbes, son œuvre d’inspiration autobiographique, que, contrairement aux autres écrivains, il n’appréciait pas cette période de son existence? Certainement y trouvait-il un caractère petit-bourgeois et sclérosé qui ne convenait pas à son goût des hauteurs et à son aspiration à façonner son propre personnage de héros…
Une fois scolarisé à Paris, André mène une vie de bohème intellectuelle, tout en continuant à habiter au-dessus de la confiserie de Bondy. Bon élève, sans être brillant, excepté en calcul où il a plus de difficulté, André ne sort pas des rangs. C’est en-dehors de l’école qu’il se forge une érudition hors-norme. Grappillant les connaissances partout où il passe, s’enthousiasmant pour des œuvres admirées dans une exposition ou pour un livre saisi au hasard, il amasse une culture surprenante.
Même s’il touche à tous les auteurs, ses goûts littéraires se dessinent déjà. André admire particulièrement Hugo, Dumas et Michelet. Avec ces trois écrivains apparaît sa fascination pour l’Histoire, dès lors qu’elle devient épopée : dans les révolutions, le héros emmène le peuple à sa suite et façonne les évènements, imposant au monde un ordre nouveau. Le style se déploie en périodes lyriques qui emportent l’imagination du jeune Malraux : lui-même conservera ce penchant pour un ton ample et passionné, ainsi que la volonté de transformer l’évènement historique brut en un mythe capable de susciter l’adhésion des foules.
André souhaite devenir écrivain, mais pour gagner sa vie, il comptera sur les livres que d’autres ont écrits. Même si, globalement, l’adolescent souffre peu de la guerre, l’inflation et la hausse des prix rendent la période plus difficile. En fouillant dans les caisses des bouquinistes des quais de Seine, André découvre un filon à exploiter : alors que les restrictions entraînent une pénurie de papier et que les livres parus sont de mauvaise qualité, il est encore possible de trouver, d’occasion, des éditions plus luxueuses et mieux reliées. Ces ouvrages sont recherchés par les amateurs, il est donc possible d’en tirer un bon prix…
Lorsqu’en 1918, André est refusé par le lycée Condorcet, il s’en souviendra. Puisqu’il ne poursuivra pas ses études, il vivra de livres dénichés, et surtout, de son énorme faim de culture.
Tout en renonçant au baccalauréat, Malraux n’abandonne pas son exploration méthodique de la littérature et des arts. Son syndrome de Gilles de la Tourette s’accommode bien de l’absence de cadre : André préfère rester autodidacte. Il peut ainsi employer son énergie à ce qui lui plaît ; surtout pas à un travail astreignant, à des horaires contraignants. Il a pourtant besoin d’argent. Même si les trois femmes continuent à veiller sur lui, de leur confiserie, la vie parisienne coûte cher. Fouinant chez les bouquinistes et les libraires d’occasion, André déniche de belles éditions, qu’il achète pour une somme dérisoire. Il se rend ensuite chez des connaisseurs, et les négocie au prix fort. Les livres rares n’ont plus de secrets pour lui : les libraires lui passent commande, et il part en quête des précieux ouvrages, s’associant parfois à son ami Louis Chevasson.
Au passage, Malraux s’instruit. Il lit, bien sûr, mais il découvre aussi le monde de l’édition. René-Louis Doyon, libraire-éditeur, l’envoie à la recherche de pièces rares ; mais il lui demande aussi son avis. André, pas tout à fait dix-huit ans, conseille des éditions de traductions, d’ouvrages épuisés. Toujours grâce à Doyon, il fait aussi ses premiers pas comme critique. Lorsque l’éditeur lance un mensuel,La Connaissance, Revue de lettres et d’idées, l’autodidacte s’y associe : en 1920 paraît son premier article,Des origines de la poésie cubiste