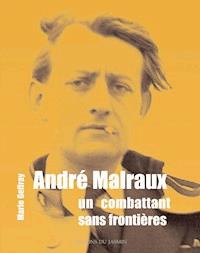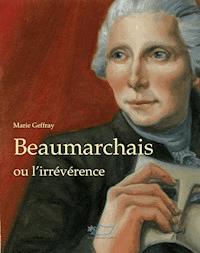
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Jasmin
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les facettes moins connues de la vie de Beaumarchais.
On ne connaît souvent de Beaumarchais que ses comédies. Homme de théâtre, il fut aussi horloger, maître de musique à la Cour, éditeur des œuvres complètes de Voltaire… Négociant, armateur, il mit ses activités au service de ses idéaux. En leur livrant des armes, il a notamment aidé les insurgés des jeunes États-Unis d’Amérique à se défaire du joug anglais. Aventurier, il a joué les agents secrets en Angleterre, en Hollande, ou encore en Autriche… Héritier de l’esprit des Lumières et libertin, il aura défendu au long d’une vie trépidante de nombreuses causes, réussissant toujours à concilier son ambition et son idéal de liberté.
Plongez dans la biographie de Beaumarchais, héritier de l’esprit des Lumières et libertin, qui aura défendu au long d’une vie trépidante de nombreuses causes, réussissant toujours à concilier son ambition et son idéal de liberté.
EXTRAIT
Ces privilèges exorbitants des comédiens sont difficiles à remettre en cause, parce que chaque auteur craint des représailles : si les comédiens ne sont pas satisfaits de lui, ils ne représenteront plus ses pièces ou les joueront mal à dessein. La situation est d’autant plus injuste que les acteurs vivent dans l’opulence, grâce à leur situation privilégiée (il n’existait pas de concurrent à la Comédie-Française, seule troupe autorisée par le roi). Les auteurs qui ne disposent pas d’une fortune familiale sont obligés, pour survivre, d’obtenir une pension royale, ce qui compromet fortement l’indépendance de leur création. Quand Beaumarchais cherche à assurer aux auteurs un revenu décent, il montre encore son attachement à la liberté de l’esprit et à son expression.
Avant lui, d’autres auteurs avaient tenté de s’élever contre les comédiens, stupéfaits du peu d’indemnités qu’ils recevaient au regard du succès de leur pièce : leurs protestations sont restées éphémères car solitaires. À l’inverse, Pierre-Augustin comprend que, pour obtenir gain de cause, il doit s’allier aux autres auteurs dramatiques pour créer un front commun. Il invite donc ses confrères à dîner chez lui, le 3 juillet 1777 : il s’agit de discuter de leurs intérêts et de voir comment les défendre. L’auteur du Barbier compte aussi sur un effet de publicité. En rendant l’affaire publique, il souhaite apitoyer le public sur la situation des auteurs, et compte ainsi obtenir son soutien.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Née en 1980,
Marie Geffray a suivi des études de lettres : elle a rédigé une thèse de doctorat sur les écrits et les discours d'André Malraux et Charles de Gaulle. Agrégée de lettres modernes, elle cherche à transmettre auprès des plus jeunes sa passion pour la littérature. C'est aussi cette volonté de faire aimer les livres qui la pousse à écrire pour les adolescents.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
L’auteur
L’auteur
Marie Geffray a suivi des études de lettres : elle a rédigé une thèse de doctorat sur les écrits et les discours d’André Malraux et de Charles de Gaulle. Professeur agrégée de lettres modernes, elle cherche à transmettre auprès des plus jeunes sa passion pour la littérature.
Du même auteur
Conspiration, Éditions du Jasmin, 2011
André Malraux, un combattant sans frontières, Éditions du Jasmin, 2011
De retour, Éditions du Jasmin, 2013
De Gaulle et Malraux, le discours et l’action, François-Xavier de Guibert, 2011
En direction du large, Pascal Galodé Éditeurs, 2008
Collection Signes de vie
1.
Van Gogh, la course vers le soleil
José Féron Romano & Lise Martin
2.
Jacob et Wilhelm Grimm, il était une fois…
François Mathieu
3.
George Sand, le défi d’une femme
Séverine Forlani
4.
Frida Kahlo, les ailes froissées
Pierre Clavilier
5.
Simone de Beauvoir, une femme engagée
M. Stjepanovic-Pauly
6.
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes et au-delà
M. Stjepanovic-Pauly
7.
Frédéric Chopin, l’âme du piano
Claude Clément
8.
André Malraux, un combattant sans frontières
Marie Geffray
9.
San Martín, à rebours des conquistadors
Denise Anne Clavilier
10.
Beaumarchais, ou l’irrévérence
Marie Geffray
11.
Jean Jaurès, l’éveilleur des consciences
Pierre Clavilier
Avec le soutien du
Copyright
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction réservés pour tous pays
Titre
1 Un horloger de talent
À l’instant qu’il naquit
Il montrait de l’esprit.
Vers de Marie-Julie pour célébrer son frère cadet
En ce jour de l’année 1754, Pierre-Augustin Caron reçoit un grand honneur : il est introduit à la cour du roi. Il s’avance sous le regard envieux des courtisans. Les boucles brunes de ses cheveux encadrent un visage aux traits décidés. Ses yeux brillent d’ambition. Ses mains sont fines et soignées : ce sont celles d’un artiste, bien plus que celles d’un artisan. Parmi les plus nobles de la cour, il est présenté à Louis XV. Pierre-Augustin est un simple fils d’horloger, âgé d’à peine vingt-deux ans. Que lui vaut une telle réussite ? Paradoxalement, c’est à une tentative d’usurpation qu’il la doit. Il a dû combattre pour obtenir la reconnaissance de son habileté et de son bon droit : dès le début, sa vie est ainsi placée sous le signe d’une lutte à mener pour s’élever dans la hiérarchie sociale, lutte qu’il remportera finalement grâce à son génie, contre ceux qui jouissent de privilèges de naissance.
Le succès de Pierre-Augustin Caron repose d’abord sur son talent d’horloger. Durant plus d’un an, il a travaillé sur un nouveau système d’échappement permettant de régler le ressort des montres afin de corriger un défaut dont souffrent alors tous les petits mécanismes d’horlogerie, quel que soit leur degré de sophistication : une légère avance, cumulée au cours d’une période de vingt-quatre heures. Pour remédier à ce problème, il existait déjà différents systèmes ; le jeune horloger les remanie, les synthétise, pour inventer finalement l’échappement à repos, qui permet l’exactitude de la montre sans pour autant compromettre sa miniaturisation. Cette trouvaille fera date, puisqu’elle est encore utilisée aujourd’hui pour les montres à ressort.
Naïf, Pierre-Augustin Caron s’était ouvert de l’avancement de ses travaux à un horloger de grand renom, Jean-André Lepaute. De douze ans son aîné, celui-ci a déjà fait un certain nombre de découvertes dans le domaine de l’horlogerie. Il conseille à son jeune collègue de déposer son invention à l’Académie des sciences, ce dont Beaumarchais s’acquitte à la fin de 1752. Le 23 juillet 1753, Pierre-Augustin est fou de joie : après des mois de minutieux travaux, il est enfin parvenu au bout de ses peines ! Son système d’échappement est terminé. Il en avertit Lepaute, qui prend la loupe pour examiner attentivement l’œuvre de son ami.
Quelques semaines plus tard, Pierre-Augustin est frappé par la foudre : Lepaute annonce dansLe Mercure de France, revue littéraire, artistique et scientifique, qu’il vient de créer pour les montres un nouveau système d’échappement… celui justement que Pierre-Augustin a inventé.
C’est mal connaître le jeune homme : il ne va tout de même pas se laisser voler son invention ! Il dépose promptement un mémoire à l’Académie des sciences pour protester de l’attitude de Lepaute et envoie auMercureune déclaration proclamant qu’il est bien l’inventeur du système dont se prévaut son ancien mentor. « Mon entreprise était sans doute téméraire : tant de grands hommes, que l’application de toute une vie ne me rendra peut-être jamais capable d’égaler, y ont travaillé sans être parvenus au point de perfection tant désiré, que je ne devrais point me flatter d’y réussir ; mais la jeunesse est présomptueuse, et ne serai-je pas excusable, Messieurs, si votre jugement couronne mon ouvrage ? » Cet énorme orgueil enrobé de modestie se flatte de séduire les académiciens.
L’article est d’une grande habileté : Pierre-Augustin a déjà compris que l’institution n’avait pas tous les pouvoirs, et que des pressions pouvaient s’exercer sur l’Académie. Grâce auMercure de France, il prend à témoin l’opinion publique, qu’il souhaite rallier à sa cause, ce qui vaut mieux que tous les appuis haut placés. Le 16 février 1754, Pierre-Augustin Caron triomphe : l’Académie des sciences rend ses conclusions sur l’affaire. Il y apparaît que le jeune horloger est bien l’inventeur légitime du système et que Lepaute a tenté de se l’approprier.
Pierre-Augustin est trop fin pour se contenter de ce premier succès. Il devine déjà que sa réputation doit être soigneusement entretenue, sous peine de s’effriter et de périr en peu de temps. Il répand donc son nom dans les cercles importants, fait paraître un nouvel article dansLe Mercure, soigne sa clientèle la plus raffinée. Il parvient ainsi à obtenir des commandes royales : durant l’été 1754, il crée une montre à gousset pour Louis XV. En tant que fournisseur du roi, il a désormais ses entrées à la cour et est fréquemment invité au lever du roi – cérémonie fort enviée par les courtisans – pour remonter la royale horlogerie.
En cette époque férue de sciences, les montres sont à la mode. Elles indiquent également un certain niveau social, en tout cas de richesse. Tous les grands veulent leur pièce d’horlogerie personnalisée afin d’indiquer leur rang. Pierre-Augustin fabrique pour Madame Victoire, l’une des filles du roi, une petite pendule raffinée, et pour Madame de Pompadour, la favorite, qui possède sur le souverain une grande influence et règne en quasi-reine sur la cour, un bijou d’une grande délicatesse : une montre minuscule, insérée dans le chaton d’une bague. Avec cette réalisation, qui a demandé une grande dextérité, Pierre-Augustin Caron souligne son excellente maîtrise de l’art horloger, mais également sa compréhension du monde courtisan. C’est elle qui va lui permettre de s’élever aussi haut que le pousse son ambition.
Le jeune parvenu à la cour du roi n’est qu’un simple fils d’artisan, originellement destiné à le rester. Né en 1732, il a grandi dans l’atelier parisien de son père, rue Saint-Denis, au cœur d’un quartier commerçant voisin des Halles. Avant de devenir cet ouvrier d’une grande adresse, le garçonnet déploie d’abord des talents de fripon avec les autres enfants de son âge. Il jouit d’une grande liberté et quitte souvent l’atelier où règne son père, horloger à Paris depuis 1722, pour rejoindre ses camarades et faire les cent coups en leur compagnie. Son enfance est heureuse, notamment grâce à la gaieté de ses sœurs. Ses parents ont dix enfants ; Pierre-Augustin est le septième, mais la mortalité infantile, très importante à l’époque, n’épargne pas la famille : ses trois frères meurent en bas âge. Il ne lui reste que cinq sœurs, Marie-Josèphe, dite dame Guibert, l’aînée, qui quitte tôt le domicile familial ; Marie-Louise, dite Lisette ; Madeleine-Françoise, dite Fanchon ; Marie-Julie, dite Bécasse, la préférée de Pierre-Augustin et sa cadette de trois ans ; enfin, Jeanne-Marguerite, dite Mademoiselle Tonton – les surnoms sont alors à la mode. Pierre-Augustin grandit en enfant chéri de ses sœurs, au milieu des rires et des chansons. Tous les enfants de la fratrie jouent de la musique et composent des mélodies : guitare, harpe, viole, flûte, clavecin, Pierre-Augustin sait plus ou moins jouer de tous ces instruments, même s’il conserve une prédilection pour la harpe.
Il gardera de cette période un grand amour de la musique et des lettres : au contact de ses sœurs, il apprend les belles manières, le sens de la repartie, et surtout le don de charmer. Dans toutes les compagnies qu’il fréquentera plus tard, il cherchera à reconstituer l’entente parfaite et la complicité intellectuelle qui règnent rue Saint-Denis.
À dix ans, il est envoyé dans une école à Alfort ; il y apprend des rudiments de latin et de mathématiques. Pour compléter son éducation religieuse, il se rend au couvent des Minimes de Vincennes : M. Caron a des origines protestantes, puisque ses parents se sont convertis au catholicisme, et, un demi-siècle après la révocation de l’édit de Nantes, il veut montrer sa fidélité à l’Église. Il tient donc à ce que son fils fasse sa première communion. Ce souci n’empêchera pas le jeune homme de montrer, plus tard, un certain anticléricalisme, mêlé d’une grande sollicitude à l’égard des protestants.
Sa scolarité dure peu de temps : dès l’âge de treize ans, Pierre-Augustin est mis en apprentissage chez son père. Il deviendra horloger, comme lui : seul fils de la famille, il doit lui succéder. Le jeune garçon n’est pas mécontent de retrouver l’atelier familial et, surtout, la compagnie de ses sœurs. Il passe avec elles de délicieux moments à écrire des vers, jouer de la musique et rêver d’amour. Il frémit d’émoi devant la moindre jupe et conte fleurette aux amies de ses sœurs ; il compose des poèmes à la gloire du sexe féminin, qu’il accompagne de sa harpe. Faire la cour aux jolies filles manque de lui coûter cher. Il déserte de plus en plus l’atelier paternel, préférant rêver à ses belles et sortir le soir, plutôt que de travailler assidûment à son établi. L’état de jeune libertin impose un certain train de vie : Pierre-Augustin a besoin d’argent. Il en trouve en détournant des montres de l’atelier pour les vendre à son profit ! Le digne père Caron ne peut supporter une telle attitude. Il met tout bonnement son fils à la porte.
Qu’on se rassure : le jeune homme, tout juste âgé de seize ans, trouve auprès d’une bonne âme complice des fureurs paternelles, un logis provisoire. Il y reçoit un ultimatum : il ne pourra réintégrer son foyer que s’il signe en toutes lettres un certain nombre de conditions, rédigées par son père. Ne plus sortir le soir. Travailler avec assiduité à l’atelier, tout au long du jour. Ne plus rien vendre à des fins personnelles. Et, pis que tout, renoncer à la musique. La mort dans l’âme, Pierre-Augustin signe. Il n’a pas vraiment le choix : pourtant, qu’elle est cruelle, l’obligation de ne plus jouer de sa harpe !
Il accepte de se défaire provisoirement de sa liberté parce qu’il sait qu’il doit parfaire son apprentissage avant de voler de ses propres ailes. En outre, il est extrêmement attaché à sa famille – il le restera toute sa vie – et notamment à ses sœurs, qu’il adore. Il rentre donc dans le droit chemin de la morale bourgeoise propre à son milieu d’artisans et devient un horloger modèle. Cependant, ce métier l’élève déjà au-dessus de sa condition. Contrairement à beaucoup de métiers artisanaux, qui ne demandent qu’un certain savoir-faire reproduit de génération en génération, l’art de l’horlogerie exige, en plus d’une extrême minutie des gestes et d’une excellente compréhension technique, un talent de créateur. Les clients qui commandent des montres n’exigent pas seulement qu’elles indiquent l’heure : elles doivent aussi être ouvragées comme des bijoux et refléter l’appartenance sociale de leur propriétaire.
Pierre-Augustin comprend très bien ces subtilités ; il s’y plie habilement. Le commerce paternel lui offre l’occasion de se familiariser avec les classes privilégiées : ses clients appartiennent à la noblesse ou à la riche bourgeoisie de négoce. À leur contact, il apprend l’aisance d’une conversation déliée, pleine d’esprit. Sa nature curieuse le pousse à observer les manières d’être, les attitudes.
Revenons à cette première visite à Versailles. Lorsqu’il est présenté au roi, il n’a que vingt-deux ans, mais il est rompu aux usages du grand monde. Il mime avec plaisir les gestes mille fois observés. Son père compte sur lui pour reprendre l’entreprise familiale, mais il ne l’entend pas de cette oreille. Son esprit est trop inventif pour se contenter d’une vie bien réglée d’artisan, même talentueux. Bien qu’il se soit servi de l’horlogerie pour faire ses premiers pas à la cour, il souhaite profiter de sa réputation pour s’élever encore.
2 Un habile courtisan
Le savoir-faire vaut mieux que le savoir.
Le Mariage de Figaro, I, 1
Grâce à son titre de fournisseur du roi, Pierre-Augustin Caron a ses entrées à la cour. Il s’y fait remarquer par sa constante gaieté, son charme plein de vivacité – mais aussi son arrogance, digne d’un parvenu. Il fréquente maintenant ceux qui possèdent des charges dans la maison royale. Il aimerait les imiter : ce serait la garantie de posséder une place sûre à Versailles. Une conquête féminine lui donne l’occasion de se mettre en avant.
Madeleine-Catherine Aubertin est la jeune épouse – elle a quinze ans de moins que son mari – du sieur Franquet, contrôleur clerc d’office de la Maison du roi et de l’Extraordinaire des guerres. Elle croise Pierre-Augustin à Versailles et est séduite par ce sémillant jeune homme. Elle se rend à l’atelier Caron sous le prétexte d’une montre à réparer. Pierre-Augustin la reçoit et comprend rapidement le motif réel de sa venue : il rapportera la montre lui-même, dans la demeure de la jeune femme…
Franquet apprécie la compagnie de Pierre-Augustin. Il lui ouvre grand sa porte. Son hôte profite de cette bienveillance et devient l’amant de Madeleine-Catherine. Le mari trompé et dupe lui fait alors une proposition alléchante : il est malade et fatigué, sa charge lui pèse ; il souhaite vendre son office de contrôleur clerc d’office. Quelle aubaine pour Pierre-Augustin ! Comme il n’a pas de liquidités, il promet de verser une rente viagère qui finira de payer la charge, acquise le 9 novembre 1755.
Cet office est trop modeste pour anoblir celui qui le possède ; toutefois, il consolide la position de Pierre-Augustin à la cour. Désormais, celui-ci renonce à sa qualité d’horloger et se rend régulièrement à Versailles pour y remplir sa charge, essentiellement honorifique, puisqu’il s’agit de servir la table royale. C’est l’occasion d’apercevoir quotidiennement le roi et sa famille. La chance sert le jeune homme et son amante : Franquet meurt brusquement d’une apoplexie, le 3 janvier 1756. Pierre-Augustin n’a plus de rente à verser, et surtout, il n’existe plus aucun obstacle entre la belle veuve et lui ! Les deux amants font fi des conventions et n’attendent pas l’année de deuil réglementaire : ils se marient dès le 22 novembre 1756.
Pierre-Augustin Caron profite de l’occasion pour troquer son patronyme contre celui de Beaumarchais, du nom d’une terre qui appartient à Madeleine-Catherine. Désormais, c’est ainsi qu’il se fera appeler. Ce nouveau nom lui permettra, le temps venu, de se revendiquer l’égal des plus grands seigneurs. Ce changement de titre traduit aussi l’augmentation de ses appétits.
Hélas ! La prospérité ne dure pas longtemps. Pour commencer, le mariage n’est pas heureux. Libertin par nature autant que par conviction, Pierre-Augustin n’aime être contraint par aucune règle, et surtout pas par les obligations du foyer conjugal. Madeleine-Catherine passait comme amante, pas comme épouse légitime. Il aime jouir de la compagnie des belles femmes. Du reste, la cohabitation des époux est de courte durée : en dépit de l’intervention des médecins qui se succèdent à son chevet, Madeleine-Catherine meurt le 29 septembre 1757, moins d’un an après avoir épousé Beaumarchais, d’une « fièvre maligne ».
D’elle, Pierre-Augustin ne gardera en héritage que le nom de Beaumarchais. Il doit par ailleurs renoncer à ses possessions. Lors de leurs noces, les jeunes époux avaient négligé de faire enregistrer l’acte de donation au dernier vivant, qui reste par conséquent sans effet. Les autres héritiers de la défunte intentent un procès à Beaumarchais, insinuant qu’il a tué sa femme pour recevoir ses biens. Pierre-Augustin se défend avec ardeur ; il est finalement blanchi de l’accusation de meurtre, mais doit renoncer à tout héritage. Il se retrouve démuni, avec seulement sa rente de contrôleur clerc d’office, bien insuffisante pour soutenir son train de vie.
En dépit des dettes qui s’accumulent, Pierre-Augustin traverse vaillamment les épreuves : après la mort de sa femme survient celle de sa mère, l’année suivante. Malgré son chagrin, il continue à accomplir fidèlement sa charge à la cour. Il guette une occasion. En attendant, il améliore sa culture, dont il connaît l’imperfection due à une scolarité trop courte, plus destinée à un apprenti horloger qu’au courtisan qu’il est devenu. Beaumarchais comble ses lacunes en dévorant les auteurs du XVIe siècle (Marot, Rabelais, Montaigne) et du XVIIe siècle (Molière, Racine, Corneille, mais également les moralistes, La Bruyère, Pascal, La Fontaine), sans oublier ses contemporains. Il a une affection particulière pour les philosophes, notamment Montesquieu, Rousseau, Diderot et le grand Voltaire.
Dès cette époque, il apparaît comme un homme des Lumières, avide de culture et prêt à s’interroger sur le monde qui l’entoure. Il continue à écrire des poèmes, qui illustrent bien son état d’esprit : avec un zeste d’anticléricalisme, il défend la liberté de pensée et fait l’éloge d’une intelligence ouverte. Dans le domaine de l’esprit aussi, Beaumarchais se défie de toute contrainte.
Cette quête d’indépendance ne l’empêche pas de remplir avec déférence son rôle de courtisan. Il cherche à se creuser une meilleure place à la cour. Pour y parvenir, ce sont cette fois ses talents de musicien qu’il met en avant ! Il maîtrise différents instruments mais a une prédilection pour la harpe, dont il joue à merveille. Il a même contribué à améliorer l’instrument en modifiant le système de pédales existant. Or, au début des années 1760, la harpe est très en vogue dans les salons, et jusqu’à la cour. On apprécie la beauté de l’instrument et la clarté de sa sonorité. La réputation de musicien averti dont jouit Beaumarchais parvient alors aux oreilles de Mesdames – c’est ainsi que l’étiquette nomme les filles du roi, Madame Adélaïde, Madame Victoire, Madame Sophie et Madame Louise, alors âgées de vingt à vingt-cinq ans. Beaumarchais devient maître de harpe auprès d’elles.
Il se contente d’abord de leur apprendre les techniques de jeu de cet instrument subtil, aux sons délicats, avant de sortir rapidement de ce rôle initial. À peine plus âgé que Mesdames, il comprend leurs goûts et leurs émois. De leur côté, les quatre jeunes filles se trouvent, à Versailles, dans une sorte de prison dorée : soumises aux règles de l’étiquette, elles ne sortent du château que rarement et toujours entourées d’une nombreuse cour. Dès lors, quoi de plus naturel qu’elles trouvent en Beaumarchais un aimable compagnon, et parfois même un confident ? Il se plie bien volontiers à leurs désirs. Pour commencer, il organise avec elles de petits concerts de musique de chambre, où il les accompagne. À la cour, tous lui envient sa position. Son succès fulgurant lui offre une position de choix, proche des membres de la famille royale : le roi vient souvent écouter ses filles chéries et leur professeur de harpe, charmé par ces concerts.
Outre ces distractions, leur professeur de musique se montre bien utile aux princesses : dévoué, Beaumarchais accepte de remplir pour elles toutes les petites commissions qu’elles ne peuvent pas accomplir elles-mêmes. Il se plie au moindre de leurs caprices et leur apporte les babioles qu’elles lui ont commandées – sans toujours les payer… Beaumarchais y va de sa poche, quoique celle-ci ne soit pas bien remplie : peut-on désobéir à une fille de roi ? Il sait aussi qu’en acceptant ce rôle de commis bienveillant, il investit sur l’avenir. En se rendant indispensable, il obtient une autre forme de fortune : il devient familier des appartements royaux.
Cette position privilégiée ne manque pas de lui attirer des ennuis. Des courtisans plus anciens, mieux rompus aux jeux de la cour, lui en veulent de cette réussite trop rapide. On lui reproche ses trop modestes origines. Ses adversaires soulignent son ancien état d’horloger, jugé déclassant. C’est ainsi qu’un jour, alors qu’il sort de l’appartement de Mesdames, Beaumarchais se fait aborder en public par un impertinent qui, lui mettant sa montre déréglée sous le nez, lui demande de la réparer : après tout, n’est-il pas horloger de métier ? Sans se démonter, Beaumarchais réplique qu’il ne se préoccupe plus d’horlogerie et qu’il est devenu, depuis, bien maladroit dans ce domaine. L’autre insiste si bien qu’il oblige Beaumarchais à prendre sa montre dans les mains. Celui-ci la laisse sciemment tomber et se briser par terre : « Je vous avais prévenu, Monsieur, de mon extrême maladresse », dit-il à l’insolent, au milieu des rires de la foule.
Mais les courtisans n’ont de cesse de briser la grande faveur dont jouit le jeune homme auprès des membres de la famille royale. Insulté par des médisances, il se bat en duel contre un chevalier : les duellistes s’affrontent à l’épée dans les bois de Meudon. Beaumarchais s’en tire indemne, mais son adversaire est mortellement blessé. Le jeune homme est très affecté de lui avoir donné la mort pour un motif si futile. Cette affaire illustre l’immense réticence des nobles à accepter la présence d’un roturier de modeste naissance à la cour.
Cependant, l’ascension sociale de Beaumarchais n’est pas terminée. Pour parvenir à jouer un rôle réellement important, il lui manque une qualité essentielle au XVIIIe siècle, grande époque du négoce : la richesse. Grâce à l’influence dont il jouit à la cour, le jeune ambitieux va rapidement trouver le moyen d’obtenir la fortune qui lui fait tant défaut.
3 L’initiation aux affaires
Ambitieux par vanité, laborieux par nécessité.
Le Mariage de Figaro, V, 3
Aimé des dames, Beaumarchais est apprécié dans les salons. Il est ainsi amené à fréquenter le milieu des financiers et des hommes d’affaires : des roturiers comme lui, mais qui grâce à leur talent et à leur esprit d’entreprise sont parvenus à faire fortune et à s’imposer dans la société bourgeoise, et même parfois à se pousser jusqu’aux cercles du pouvoir. Après avoir fait la connaissance de Charles Le Normant, il est invité dans son château d’Étiolles où son ancienne épouse, Madame de Pompadour, s’est entourée d’une prestigieuse compagnie, notamment des philosophes comme Voltaire, Montesquieu ou Fontenelle.
Beaumarchais se montre très à l’aise parmi cette société choisie. Il amuse l’assemblée en faisant représenter des parades de son invention : il s’agit de comédies en un acte, très courtes. Inspirées du théâtre de foire, elles mettent l’accent sur la bouffonnerie des personnages, sans négliger les jeux de mots douteux et les situations grivoises. Les textes de Beaumarchais frôlent parfois l’indécence : ils sont destinés à un cercle restreint, réuni dans l’intimité et désireux de s’amuser. Le jeune auteur rencontre ici son premier succès littéraire. Il se souviendra plus tard de cette expérience théâtrale lorsqu’il verra ses pièces jouées sur de grandes scènes.
Les parades illustrent assez bien la manière dont Beaumarchais envisage la carrière littéraire : à aucun instant, il ne désire devenir un homme de lettres à plein temps. Pour lui, la création artistique relève du loisir ; c’est un bon moyen pour s’amuser, pour amuser les autres, et donc, occasionnellement, pour se trouver au centre de l’attention générale. À aucun moment il ne s’agit d’une fin en soi. Beaumarchais souhaite avant tout s’élever dans la société. À cet effet, il doit s’enrichir.
Grâce à ses relations, il rencontre Paris-Duverney. Parti de rien, cet habile négociant a su s’élever au plus haut rang : de 1723 à 1725, il a été secrétaire des commandements pour le premier ministre, le duc de Bourbon. Il a bâti sa fortune sur les fournitures aux armées et sur son sens aigu des affaires. La vivacité d’esprit de Beaumarchais plaît beaucoup au vieil homme, qui n’a pas d’héritier direct puisque son unique fille est décédée. Il décide de prendre son jeune ami sous son aile et de l’initier aux affaires. Il reconnaît en lui son double encore inexpérimenté. Tous deux poursuivent le même idéal de vie, la même audace, le même esprit d’entreprise défendu par un sens affiné des relations humaines, la même volonté de s’enrichir, mais également le même amour du négoce. Le caractère habile et vif de Beaumarchais séduit Paris-Duverney : qui sait si ce garçon novice aux affaires ne pourrait pas lui rendre service grâce à ses relations ? Un marché implicite lie les deux hommes, l’un pas encore trentenaire et l’autre vieillard de bientôt quatre-vingts ans : le premier apportera au second le soutien de ses relations et la vigueur de sa jeunesse, le second aidera le premier à s’initier à l’art du commerce et lui offrira même, à cet effet, de sérieux émoluments.
Car Paris-Duverney, en dépit de sa grande fortune, a besoin d’aide. Il est obsédé par son idée de construire une École royale militaire destinée à former cinq cents jeunes nobles sans fortune. Le financier a trouvé les premiers fonds et a obtenu l’accord de principe de Louis XV, notamment grâce au soutien de sa maîtresse, Madame de Pompadour. Cependant le projet s’avère un gouffre financier : pour achever l’édification du somptueux bâtiment imaginé par l’architecte du roi, Gabriel, il faudrait des millions ! Or les caisses de l’État sont vides. Paris-Duverney ne trouve plus de bailleurs de fonds. Pour y parvenir, il doit montrer l’intérêt du roi Louis XV pour cette École. Il souhaite donc commanditer Beaumarchais afin d’obtenir la visite royale qui redonnera du crédit à l’institution.
Pour le service de son ami, Beaumarchais met en œuvre ses relations. Il compte surtout sur sa position de favori auprès de Mesdames : il les persuade du profit qu’on peut tirer de l’École militaire. La réputation du roi est entamée par des impôts toujours plus lourds ; le peuple gronde. Pour l’apaiser, quoi de mieux que cet établissement destiné aux nobles sans le sou ? Il offre l’occasion de présenter une autre image du souverain, attentif à ses sujets et soucieux de la gloire militaire de la France. Mesdames sont convaincues : à leur tour, elles persuadent le roi de la nécessité de se rendre sur le chantier de l’École. Louis XV accepte de visiter les premiers bâtiments construits en août 1760. Si l’édifice, qui ferme aujourd’hui le Champ-de-Mars, sera finalement moins grandiose que celui initialement prévu par Gabriel, du moins pourra-t-il accueillir ses jeunes élèves.
Dans la même période, Paris-Duverney associe Beaumarchais à des spéculations financières. Il lui constitue une rente, indice qu’il le considère comme son héritier spirituel. Grâce à lui, Beaumarchais se forme à l’art du négoce, condition nécessaire pour s’enrichir. En effet, au XVIIIe siècle, le commerce se développe grâce aux échanges avec les autres pays d’Europe comme des autres continents. C’est d’ailleurs sur cette réalité des transferts de marchandises que se fonde l’esprit des Lumières : au libéralisme économique théorisé par Locke correspond également l’échange, non plus de biens matériels, mais d’idées et de personnes. Le commerce offre la possibilité d’une ouverture culturelle inédite.
Beaumarchais adhère complètement à cette culture des Lumières. En s’adonnant au négoce, il épouse son siècle. Sous le règne de Louis XIV, il était honteux de désirer s’enrichir : le travail et ses revenus étaient considérés comme infamants, puisque c’était une marque de la malédiction divine sur les hommes. La noblesse, par conséquent, était exemptée de travail. Au début du XVIIIe siècle, ces rigidités disparaissent. L’ancien souverain accordait la prééminence sociale à la noblesse d’épée, plus ancienne et liée à une tradition militaire et à un fief, sur la noblesse de robe, acquise grâce à des charges. En aucun cas un roturier ne pouvait prétendre occuper certains postes de pouvoir. Sous Louis XV, les mentalités évoluent. Grâce à la multiplication des offices, la noblesse de robe est plus répandue ; comme on l’a vu avec le financier Paris-Duverney, ancien vilain devenu membre du gouvernement, d’autres critères contrebalancent l’origine sociale : la culture, l’esprit d’entreprise, la préférence royale – et, surtout, la richesse.
Beaumarchais a déjà su, grâce à ses divers talents, se faire remarquer du roi ; l’appui de Paris-Duverney lui offre à présent l’occasion de faire fortune. Son ascension sociale correspond parfaitement à l’évolution de la société française au cours du XVIIIe