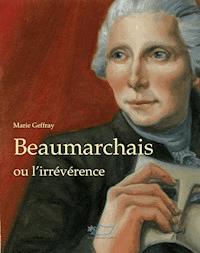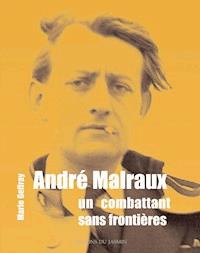Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Vingt ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Albert Göring revient sur son passé. Son frère aîné, Hermann, continue à le hanter. Leurs opinions politiques les opposaient davantage à mesure que le règne du nazisme s’étendait sur l’Allemagne, puis sur l’Europe. Pourtant, Albert n’a jamais rompu leurs liens fraternels. Peu avant sa mort, alors qu’il est rejeté par la société à cause de son nom, il essaie de remettre de l’ordre dans le tourbillon des souvenirs qui l’emportent dans la période obscure du troisième Reich, jusqu’à sa chute.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Professeure de français,
Marie Geffray cherche à transmettre sa passion de la lecture à ses élèves. Après plusieurs romans jeunesse et un autre historique, elle revient avec
Göring, mon frère, ouvrage qui nous replonge dans la Deuxième Guerre mondiale, cette fois de l’autre côté du Rhin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Geffray
Göring, mon frère
Roman
© Lys Bleu Éditions – Marie Geffray
ISBN : 979-10-377-6734-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Pour Gauvain, Anselme, Amaury, Armance et Nathanaël,
que la fraternité vous unisse.
Merci à Nolwenn et à mes premiers lecteurs,
Edouard, Chantal, Caroline, Marianne.
Partie I
1
On a toujours envie de se faire croire qu’on a le choix. C’est tellement plus confortable, tu comprends ce que je veux dire ? Cette impression de maîtriser son destin. Même quand on est confronté à un fléau, on cherche à lui donner une explication rationnelle, comme s’il était nécessaire de trouver une logique à l’irréparable.
Moi, je n’ai pas pu faire autrement. Je suis né deux ans après toi, et voilà tout. Impossible d’échapper à ce nom. Je n’avais plus qu’à le porter haut et fort, à l’assumer. Si j’avais porté un autre patronyme, tout aurait été différent. Je n’aurais pas été obligé de me révolter. J’aurais mené une vie calme, parfaitement désintéressé de la politique, entouré de mes proches et investi dans mon entreprise : une existence morne et plate, un peu ennuyeuse en somme. Seul ton engagement m’a obligé à assumer mes propres convictions, en rejetant avec force tout ce que tu approuvais, toi, l’oppression, la tyrannie, la violence. J’ai dû faire ce que je pouvais, à ma mesure, pour combattre le mal.
Paradoxalement, c’est en m’imposant ton choix avec fracas que tu m’as obligé à la liberté. Tu m’as forcé à l’émancipation, tu m’as poussé à devenir ce que tu ne voulais pas que je sois. À devenir l’autre. Mon frère. Celui qui aurait dû m’aimer sans réserve, celui que j’aurais dû aimer sans retenue.
Mon frère… Mais non, il n’y a personne dans cette pièce : juste moi, et la silhouette d’une bouteille abandonnée. Une bouteille vide. J’ai beau la secouer, il n’en coule même pas quelques gouttes inutiles. Ma soif est trop profonde, elle vient de trop longtemps, du plus loin de mon enfance.
Je scrute l’ombre, mais l’alcool est impuissant à le ressusciter, sinon par brèves allusions, délires trop vite revenus à la réalité. Après toutes ces années, je continue à le chercher, comme je continue à porter mon nom, ces lettres ignominieuses étalées sur la boîte aux lettres. Inutile de me leurrer : même après sa mort, après le désaveu collectif, je continue à l’admirer. Par-delà ce qui nous sépare, je continue à lui offrir cet amour inconditionnel dont je n’ai jamais reçu la moindre contrepartie.
La plupart du temps, quand je pense à Hermann, je ne le vois pas comme dans les derniers temps, avec son visage bouffi de graisse et ses yeux déments où brillaient toujours des traces de la drogue qu’il était forcé d’ingurgiter quotidiennement ; je ne le vois pas comme il apparaissait dans les journaux, salué par tous comme sauveur de la nation, arborant une mine confiante ; j’oublie aussi son air hautain, sur le banc des accusés. Je me le figure enfant, avec ses cheveux châtain clair ébouriffés par sa course au grand air, l’air un peu bravache, et les oreilles décollées qui lui conféraient un air perpétuellement étonné.
Quelles parties, dans notre château de Veldenstein ! Quand la pluie nous interdisait de sortir dans le parc, nous courions à travers l’enfilade des pièces, dévalant les escaliers du grenier haut perché aux caves les plus reculées, étouffant nos rires derrière d’épaisses portes pour ne pas briser le silence que nos pas dissipaient trop violemment, non sans soulever au passage des nuages de poussière. J’avais cinq ans, et le château m’apparaissait comme un univers illimité, dont je n’aurais jamais terminé d’explorer les multiples salles. Mon frère m’entraînait à sa suite, guide malin qui donnait l’impression de tout savoir ; il assurait qu’il était incapable de se perdre dans ce dédale, et je le croyais.
Lorsque je pense à mon enfance heureuse, me reviennent d’abord ces déambulations infinies à travers Veldenstein, auxquelles se joignaient parfois nos sœurs Olga et Paula. Chaque porte s’ouvrait sur un monde inconnu, pièce déserte dont le plafond armorié constituait le seul ornement, penderie débordant de vêtements mités ou boudoir aux meubles couverts de housses blanches. L’enfant naïf que j’étais alors était persuadé que sa vie entière ressemblerait à ces explorations sans péril, dans la joie des découvertes, à la suite d’un meneur infaillible.
J’ai été trahi et je préférerais ne pas avoir la nostalgie de ces années. Rien à faire : on ne commande pas ses souvenirs. J’y retourne sans cesse, comme au seul temps heureux que j’aie traversé. Mon existence est fondée sur cette imposture. Notre château restera toujours le lieu de prédilection, le territoire comblé de l’enfance.
Je dis notre château, parce que Veldenstein restait à notre disposition une bonne partie de l’année. Mon parrain Epenstein nous hébergeait gracieusement depuis que mon père était revenu de son poste en Haïti, peu avant ma naissance. Des rares confidences de ma mère sur les premières années de leur mariage, je reconstitue un milieu hostile, d’abord en Afrique de l’Ouest, puis en Haïti : une chaleur écrasante, des étendues désertes de savane ou de mer, des autochtones indociles et une faune indomptable. Les yeux de ma mère brillaient plus larges ici, dans notre patrie de Bavière que la neige blanchissait tout l’hiver, et je me réjouissais de n’avoir pas connu ces contrées lointaines, puisque mon père avait pris précocement sa retraite.
C’était d’ailleurs mon seul motif de reconnaissance à l’égard de mon père. Quoi de plus naturel ? Sa bougonnerie permanente m’éloignait de lui aussi sûrement que m’attirait le doux parfum de ma mère ; j’aimais me réfugier dans ce cocon tiède qui me préservait des malheurs qui, à en croire les contes que la nourrice me racontait, patientaient au pied des remparts en attendant le moment propice pour se jeter sur moi. Mon père, lui, avait sûrement connaissance de ces monstres tapis dans l’ombre : il en balbutiait de colère ou de peur, je n’ai jamais su quel sentiment le dominait quand il était arrivé au bout de sa bouteille.
Dans quel mépris ma mère le tenait ! Par mimétisme, je restais aussi à distance. Pauvre père, isolé dans un recoin du château, méprisé par ses propres enfants ! Il m’est plus proche aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. À mesure que je m’enfonce dans la solitude et dans l’alcool, je marche dans ses pas. Les monstres m’ont rattrapé, un à un. Je les ai affrontés comme j’ai pu ; j’ai pris des coups, j’ai souffert multiples blessures, et maintenant que la mort s’apprête à triompher, il ne me reste que cet expédient minable pour les écarter : boire une dernière gorgée, et une autre encore, pour rester sur le fil, dans un précaire équilibre entre reniement et lucidité.
2
Te rappelles-tu, Hermann, comme notre mère était belle, alors ? Pas étonnant qu’elle ait fui cet époux trop âgé, que le corps diplomatique avait fini par rejeter comme un rebut incapable de mener à bien ses grands projets pour l’Allemagne. Notre mère était jeune, elle : des yeux bleus lumineux, une chevelure étincelante, et dans son sillage un air de grâce et de douceur. Princesse tutélaire du château, elle veillait complaisamment sur notre monde. « Karin ! » appelait Epenstein ; et voilà qu’elle s’éloignait avec lui. J’attendais impatiemment son retour. Je te suivais dans tes jeux guerriers, et quand je brandissais mon épée en bois, c’était pour mieux défendre ma belle au regard de ciel.
Aujourd’hui, son visage s’estompe dans ma mémoire ; les photographies en noir et blanc sont impuissantes à ranimer ses traits de jeunesse épanouie et heureuse. D’autres souvenirs se sont accumulés depuis : notre mère à Berlin, puis Munich, rejetée par Epenstein, vacillante dans l’ombre de père, rattrapée par la misère et l’insignifiance… Une rasade supplémentaire, l’alcool fait courir son feu dans mes veines, allume un incendie dans ma mémoire, et elle réapparaît, intacte, le teint pâle et le sourire radieux, auréolée des flammes vives du temps. J’arrive presque à oublier qu’elle m’a abandonné.
Tu étais si courageux, Hermann ! Toujours à courir sans crainte des coups ni des bosses ! Comment aurais-je pu faire bonne figure auprès de toi ? Tant que tu te tenais à mes côtés, j’arrivais encore à faire illusion, mais le soir, seul dans mon lit, les angoisses me reprenaient et je commençais à hurler. J’avais peur de tout, de l’obscurité, du jugement des autres, et même de l’avenir. Mon corps débile, mes membres trop fins m’empêchaient de grimper ou de cogner avec ta vigueur. Fasciné, j’observais ton assurance, ton insolence. Tu étais le digne fils de la famille, la dernière branche d’une dynastie de petits seigneurs, dans la lignée de notre lointain ancêtre administrateur de Frédéric-le-Grand, au service de l’État prussien depuis le XVIIe siècle ; en bon rejeton d’un père qui avait combattu sous Bismarck contre l’empire austro-hongrois et contre la France, tu affichais avec désinvolture les qualités guerrières dont tu avais hérité.
Et chevaleresque, avec ça ! Prêt à prendre la défense de l’opprimé. Tu jouais surtout les protecteurs avec Olga et Paula ; tu aimais à te dépenser pour recevoir en retour l’expression de leur reconnaissance. Tu avais besoin de te sentir vénéré pour ta force et ton dévouement ; alors, tu jouissais d’un sentiment de supériorité dont tu n’as jamais réussi à te passer par la suite. Quand tu ne pouvais te mettre au service de tes frères et sœurs, tu t’occupais de tes bêtes. Combien de chiens malades ou blessés as-tu veillés, leur dispensant soins et nourriture, jusqu’à ce qu’ils recouvrent la santé ! Après, l’animal te suivait partout, fidèle et déférent. Tu aimais déjà être entouré d’une foule d’adorateurs. En seigneur des lieux.
Et moi ! Chétif et frêle, j’aurais peut-être pu compenser ma défaillance physique par une agilité hors du commun, par la souplesse et l’endurance, terrains sur lesquels j’aurais réussi à te battre, enfin ! Mais cette fragilité de corps allait de pair avec celle de l’âme. Je restais fade, effacé ; celui que personne ne remarque, et qu’on craignait de remarquer de peur de déceler sur mon visage la trahison de la bâtardise. Le moindre obstacle me faisait trembler ; je redoutais les ténèbres de la nuit, le danger des falaises, la solitude des bois. « Suis ton frère ! » m’enjoignait ma mère. « Allez, un peu de nerf ! » renchérissait Epenstein. Je faisais de mon mieux, pourtant. Aspirant une grande goulée d’air pour me gonfler de courage, j’essayais quelques pas : et je me mettais à pleurer. Les sanglots me venaient d’un seul coup, comme une soupape qui lâche, parce que je savais que, malgré mes efforts, je ne serais jamais à la hauteur de celui qui me précédait.
Il fallait m’endurcir. Ma mère, appuyée par Epenstein, trouva le meilleur moyen : m’envoyer, dès cinq ans, dans ce pensionnat de jeunes garçons. « Là-bas, au moins, il apprendra à être un homme ! » grondait Epenstein. Mon père ne disait rien. Aujourd’hui, je me plais à penser qu’il aurait aimé protester et que c’est seulement par manque de force, ou par crainte de devoir quitter Veldenstein, qu’il me laissa emmener contre mon gré hors du giron familial. L’expédient s’est avéré contre-productif. Mon cœur est toujours aussi mou qu’alors, une vraie gélatine qui flanche à la moindre contrariété : j’ai la poitrine toute pleine de tremblements ; mais j’ai appris à vivre avec. Je suis le seul à connaître ces fissures qui me minent l’intérieur, je me suis construit une carapace de silence, lisse et solide, une apparence qui plaisait aux femmes. Je me suis laissé aimer, en guise de consolation ; puisque ma mère avait été déçue par moi, je m’efforçais de ne pas déplaire aux dames.
Il ne faut pas remuer cette mémoire vieillie. De nouveau le visage de ma mère se ternit, des gouttes salées menacent de tomber dans mon verre… Plutôt revenir aux souvenirs heureux, comme lorsqu’au soir je me retrouvais coincé entre les draps rêches du dortoir, plus seul au milieu de ces vingt garçons de mon âge que je ne l’avais jamais été : seul autant que le vieux débris que je suis aujourd’hui, sans ami, ni femme, ni enfant, ni rien d’autre que l’échappatoire facile de l’alcool. J’avais mis au point une méthode pour laisser le chagrin à distance : au lieu de penser à ma famille, ce qui aurait nécessairement provoqué une avalanche de larmes, j’évoquais des lieux. Je me rappelais les couloirs de Veldenstein, le vaste salon décoré de boiseries, la bibliothèque, le petit salon de musique, la salle à manger austère, les tableaux obscurcis, les tapisseries, les meubles, puis je m’aventurais dans les chambres, les vivantes et les mortes, celles qu’on réservait aux amis de passage et celles qu’on avait définitivement abandonnées, avant de monter plus haut encore, de me perdre dans les étages, à travers les greniers, jusque dans la tour qui dominait la vallée…
Je continuais la promenade, et avec la facilité brusque que permet la rêverie, je me rendais à Mauterndorf, le second château d’Epenstein. Nous y allions moins souvent ; cette forteresse m’était d’autant plus précieuse. Epenstein nous assurait qu’elle avait été bâtie mille ans auparavant. Mille ans ! Mon imagination enfantine s’enthousiasmait. Je considérais cette vieille bâtisse comme un rempart sûr et familier qui saurait me protéger de tout, y compris du passage du temps. Encore maintenant, il me semble que, si je retournais à l’abri de ses murs, je redeviendrais le petit garçon renfermé que j’étais alors, qui fixait sa mère avec un air d’adoration et de tourment, qui essayait bravement de suivre son grand frère… Même si nous n’avions ici aucun autre titre que celui d’invité d’Epenstein, j’avais fini par considérer comme mon chez-moi cette forteresse de pierres, perchée sur une falaise, flanquée de ses tours, qui surplombait le village de Mauterndorf de toute sa hauteur. Je me sentais plus à l’aise, si haut placé ; je respirais largement, j’étais à l’abri des dangers grouillant dans la vallée, au pied des remparts.
Te rappelles-tu, Hermann ? De retour au bercail, nous avions tous deux l’impression d’être les princes des lieux, des seigneurs très anciens, directs héritiers des chevaliers médiévaux. Nous vivions dans un jeu. Des domestiques nous levaient et nous lavaient ; le cor sonnait pour annoncer le repas : sur la table dressée, les victuailles s’accumulaient, chevreuils et lièvres tués à la chasse ; un échanson emplissait les verres, et parfois, des musiciens se tenaient dans la galerie qui surplombait le vaste hall : Epenstein les engageait pour égayer les festins qu’il offrait à ses invités. Car les hôtes se pressaient dans nos châteaux. On venait de loin, de Berlin, de toute l’Allemagne, pour le plaisir de rencontrer notre parrain ; quoi de plus naturel ? Nous étions des rois auréolés de gloire, régnant sur la forêt alentour. Je n’imaginais pas que le monde pût se perpétuer au-delà.
Ma mémoire est complaisante : elle m’offre à nouveau ces yeux d’enfant naïf qui ne s’intéressait pas à la question de savoir pourquoi, tout le temps du séjour de nos hôtes, mon père devait rester à demeure dans sa chambre, ni pourquoi moi-même ne devais paraître que le moins possible, quand il plaisait de me montrer. Je reste le gamin ébloui par ces belles dames splendidement habillées, qui sentaient si bon, et qui devaient être si importantes, puisque maman les accueillait avec tant de prévenance : sans doute d’autres reines venues de lointains royaumes. Je me délectais de la tournure de leurs robes, du teint frais de leur visage, des nattes compliquées de leur coiffure ; je brûlais de me serrer contre elles, quitte à froisser la riche étoffe de leur tenue.
Epenstein trônait au milieu de ses hôtes, et je brûlais, de jalousie cette fois. Comme tous l’entouraient, le pressaient, l’admiraient ! À l’époque, je le trouvais beau : je le regardais à travers les yeux de ma mère. Il me fallut du temps pour comprendre que cet homme bedonnant, aux traits plutôt banals, n’avait d’autre grâce que celle de ses manières impeccables, de son allure décidée, de sa voix puissante. Son charisme tenait aussi à sa façon plaisante de raconter des anecdotes qui, toutes, le mettaient en scène sous un angle avantageux. Volontiers fanfaron, il ne trouvait pourtant personne pour remettre en cause ses exploits. Sa richesse et son prestige – il venait d’être anobli pour services rendus à la cour – comptaient certainement aux yeux des invités. Pas aux miens, si neufs.
Ses excentricités me paraissaient normales : ses vêtements, toujours extravagants, ou encore sa passion presque maniaque pour les opéras. J’ai grandi en prenant ces caprices pour la norme ; j’en suis resté marqué à mon tour, un peu décalé, si peu soucieux des règles. Sans doute, plus tard, ai-je été sauvé par cette inappétence à suivre la foule ; mais à l’heure de la vieillesse, elle me pèse singulièrement. J’aimerais tant déchirer ma solitude… Ah ! je me trompe. Tu es là, mon frère. Il suffit de t’appeler pour te susciter intact, goguenard et hautain… Toi aussi, ne t’en défends pas, tu aimais Epenstein, même si, bien sûr, ton affection à son égard n’a pu être de la même nature que pour moi.
Quand ai-je compris que je ressemblais un peu trop à Epenstein ? Je n’avais pas hérité des yeux si bleus de ma mère ni de la blondeur des Göring, dont toi, Hermann, tu es si bon représentant. Non, chez moi, rien de cette splendeur aryenne que, plus tard, tu incarnas complaisamment : j’avais le poil noir et le corps chétif, avec des traits qui, très vite, ont eu tendance à se creuser, un vrai type d’Europe centrale. Un type de juif, me souffles-tu à l’oreille. Eh ? Comment m’en défendrais-je ? Il n’était un secret pour personne qu’Epenstein, qui se proclamait bon chrétien afin de ménager sa place dans la bonne société allemande qu’il fréquentait, avait un père juif. Même mon père n’arrivait pas à se reconnaître en moi.
Je ressemble à l’amant de ma mère. Qu’y puis-je ? On répète aux enfants qu’on n’a tous qu’un seul père. Erreur. Le mien me paraissait distant ; je m’en accommodais. Ma mère, mes sœurs aînées et mon frère me comblaient assez pour que je n’aie pas davantage besoin de famille. Ce n’est qu’au fil des mois, des années, que je compris, de paroles malencontreuses, d’allusions trop souvent assenées, de remarques des domestiques, que je ressemblais fort à mon parrain Epenstein. Le ton plein de sous-entendus ne laissait guère de doute. Mon père est resté mon père, malgré tout, mon frère est resté mon frère ; je m’étais habitué à les considérer ainsi, pourquoi changer ? Je désirais juste me faire aimer de celui dont mon frère portait le Vorname, le prénom : Hermann. Quelle ironie, toute cette histoire ; le patronyme que je porte m’a fait souffrir toute ma vie et il n’est mien que par usurpation, tandis que mon frère portait le prénom bien-aimé de notre parrain, lui qui n’était pas son fils ! Albert Göring aurait dû être Albert Epenstein ; à quoi se joue un destin ! Serai-je donc toujours poursuivi par ce nom qui aurait dû être autre, et que j’ai porté comme une croix tout au long de mon existence ? Je n’ai jamais pu me remettre tout à fait de cet effroyable malentendu.
3
Comment me faire aimer d’Epenstein ? Il m’a toujours manqué cette aura que tu dégageais, toi, cette façon désinvolte de jouer avec le danger et, pour cette raison, de t’attirer l’admiration de tous, particulièrement des femmes. Même dans ce domaine, tu auras raflé la mise, avec tes deux mariages : un d’amour, un de prestige, tu auras décidément eu tout ce qui se fait de mieux. Moi, je n’ai connu que des divorces et des femmes occasionnelles, manquées de peu ou vite écartées. Je partageais avec mon parrain ce goût pour les conquêtes passagères, les regards un peu trop voilés derrière des paupières lourdement fardées. Parfois, une femme m’attirait ; au moment de m’engager davantage, je me délivrai d’un brusque sursaut. J’ai toujours tenu à rester libre de toute entrave, et c’est libre que je me présenterai devant la mort.
Libre ? Je t’entends ricaner dans l’ombre, et je n’ai pas à fournir d’effort pour me représenter ton rictus moqueur. J’étais si fier de ma liberté, j’ai tant lutté pour elle ! Et je finis prisonnier de mes souvenirs un à un suscités par l’alcool. C’est ta faute aussi. Tu as toujours occupé tout l’espace, y compris celui de héros auquel j’aurais peut-être pu prétendre…
J’ai dû miser sur la seule qualité qui te faisait défaut : l’esprit scolaire. Je me suis défendu comme j’ai pu, en investissant l’unique domaine où, enfin, tu ne triomphais pas : j’étais doué en calcul, en physique. Les professeurs saluaient ma clarté de raisonnement. Epenstein n’y prêtait guère attention ; il préférait chasser avec toi, son filleul préféré. Il admirait tes cheveux blonds, qui me faisaient paraître si terne, à côté, quand nous nous tenions au soleil dans la cour de Veldenstein. Les retours de chasse ! J’y assistais de loin, d’une galerie supérieure, à demi dissimulé. J’enviais l’air de sauvagerie qui restait imprégné sur vos traits. Vous veniez de tuer ; vous dégagiez une aura particulière, celle de la puissance bestiale, irréfléchie, vous étiez comme des dieux. Moi, l’avorton, je restais caché dans l’ombre. J’avais beau être dégoûté par l’odeur de sang qui flottait dans l’air, par les canines blanches des chiens encore excités par la poursuite, par les dépouilles souillées que vous jetiez sur le pavé, je ne pouvais m’empêcher de t’envier. Tu brandissais fièrement le fusil qu’Epenstein t’avait offert ; tu avais juste douze ans… Un jour que tu avais le dos tourné, je touchai furtivement l’arme de chasse. Je caressai le bois lisse, étonné que ce bâton puisse blesser à mort ; et le froid de l’acier me fit frissonner. Je n’étais pas un tueur, je n’ai jamais réussi à le devenir.
Puisque je ne pouvais pas suivre Epenstein dans ses longues chasses à travers les collines bavaroises, je m’échinais à obtenir les meilleures notes au collège. La science me fascinait. Elle me promettait d’expliquer rationnellement le monde, alors que toi, tu voulais à tout prix le sentir. Tu l’accaparais, comme un jeune animal qui se fie à ses instincts ; je voulais le comprendre.
C’est ce que j’aimais dans la musique. La musique allemande est rationnelle ; elle construit les émotions selon un certain nombre de règles bien établies, qui empêchent les débordements et canalisent la passion. La musique m’a sauvé. Avec Epenstein, ce fut notre premier terrain d’entente. Après, il y eut les femmes. Notre connivence s’arrêtait là ; qui peut en dire autant de ses rapports avec son père ?
J’étais un pianiste appliqué, sinon doué. Epenstein appréciait de m’entendre jouer. Il prit l’habitude de m’entraîner dans des concerts, même plus tard, quand, jeune homme, j’eus terminé mes études d’ingénieur. Je me plaisais à imaginer que tu étais jaloux de ces soirées complices. Tu n’as jamais compris le bonheur qu’on peut éprouver à se tenir assis, au premier rang, submergé par les vagues successives de notes qui se chevauchent, s’emmêlent, joutent, afin de composer une harmonie puissante qui fait vibrer tout entier, jusqu’au bout des ongles. Maintenant, je me prive des salles de concert. C’est le seul sacrifice réel que j’endure : la musique console même de la perte des rapports humains. Mais j’ai trop peur qu’on me reconnaisse. Je m’imagine à l’opéra de Munich : la rumeur qui enfle autour de moi, répétant mon nom sur un ton offensé, scrutant ma tenue pour vérifier que je suis bien l’ordure que je dois être, jusqu’à ce qu’obligé d’abdiquer je quitte les lieux pour laisser le public à sa désapprobation.
Chaque été, il m’entraînait à Bayreuth. De la scène qui dissimulait l’orchestre, la musique montait vers moi, magiquement amplifiée par l’espace ouvert de l’amphithéâtre ; j’épousais les variations mélodiques, jusqu’à me reconnaître dans chacun des personnages qui se mouvaient sur scène, qui se débattaient, qui s’aimaient, se tuaient ou se livraient. J’étais ce drame qui dépouille l’âme humaine et revient à l’essentiel : l’amour et la mort.
La plupart des hommes n’ont pas conscience du tragique de leur destinée. Ils s’adonnent par mimétisme aux joies de la copulation, se reproduisent benoîtement et quand enfin la mort arrive, ils l’accueillent avec une stupéfaction vaguement dégoûtée. Grâce à Wagner, j’ai très tôt pris conscience que ma petite existence aussi était concernée par ces grandes luttes qui se jouaient sur scène ; l’étroitesse de mon quotidien n’empêchait pas que des forces transcendantes m’habitent, à ma faible mesure, et tantôt me livrent à cette fascination morbide que j’éprouvais pour la mort, et tantôt me poussent vers la conquête jubilatoire du présent, dans l’exultation des sens et la joie d’exister.
Alors, pris par la musique, j’entrevoyais Dieu. Hermann a toujours professé un certain mépris pour la religion. Comme il s’ennuyait, enfant, durant les messes où nous suivions notre protecteur ! Epenstein avait besoin de ce pensum, les cérémonies auxquelles il assistait en grande pompe constituaient un passage obligé pour faire oublier ses origines juives et asseoir sa place dans la bonne société. Moi, je restais à mille lieues de ce dédain comme de ce calcul. J’attendais Dieu. Je me tenais assis, réceptif, les oreilles grandes ouvertes, les yeux levés vers les vitraux d’où tombait la lumière, dans un état d’attentive tension. Très jeune, j’ai eu conscience qu’Il existait. Je n’aurais pas su expliquer pourquoi ni comment ; Il était là, il suffisait de se mettre à Son écoute pour Le sentir. Je n’ai jamais eu besoin des rites fatigués ni des textes sacrés ; je n’ai jamais ressenti le moindre doute. Dieu s’imposait, détaché de toute morale, de toute religion : puissance incommensurable, susceptible de réconcilier ces instincts contradictoires qui se jouaient de moi, jusqu’à les dépasser.
Toute ma vie, je me suis montré attentif à ce flux vital qui me reliait aux autres hommes, tout en le protégeant des attaques que certains perpétraient contre lui. Quand on dégrade l’humanité, c’est Dieu qu’on abîme, qu’on blesse ou qu’on renie. Aussi me suis-je essayé, de mon mieux, à la justice, en me mettant au service de mes semblables ou en luttant contre les forces de destruction à l’œuvre dans notre temps. Je n’ai pas toujours été à la hauteur. En beaucoup de circonstances, j’aurais pu faire mieux. Quand bien même j’ai pu accomplir quelque action digne d’éloges, le prix ne m’en revient guère. J’ai juste tenté de me conformer au mieux à l’impulsion vitale que je percevais.
J’aurais voulu montrer à Hermann la profondeur du mal dans lequel il s’enfonçait. Mais il n’a jamais compris que nos actes avaient des prolongements dans les racines de la vie ; qu’aucun geste n’est anodin quand il s’agit de frapper son prochain, parce qu’alors c’est à Dieu lui-même qu’on s’en prend. Hermann s’en tenait toujours à l’immédiat et au matériel. Incapable de voir au-delà. Frapper quelqu’un, c’était assurer sa propre force : rien de plus. Il détruisait pour le plaisir de détruire, comme un dieu païen égaré sur la terre, doté du pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Son matérialisme forcené m’a toujours effrayé, en même temps qu’il m’arrivait de le jalouser. Comme tout était simple, ainsi. Il suffisait de prendre, sans considération d’ordre éthique ou spirituel ; il suffisait de jouir de l’instant. La mort n’était qu’une formalité ennuyeuse, mais sans enjeu : elle mettait un point final au plaisir, au désir. Inutile de la redouter. Elle viendrait à son heure : d’ici là, il était préférable de l’oublier.
Wagner m’a aidé à sentir tout cela. Certes, ses héros déchirés meurent, d’amour ou de haine ; auparavant, ils ont tous perçu la transcendance. Leur drame est d’être incapable de la suivre sans succomber au terrible effort qu’il est nécessaire de fournir pour s’élever à son niveau. Personnellement, je n’ai jamais consenti au sacrifice. C’est pourquoi je suis encore vivant ; un peu raté, un peu minable, héros manqué.
Hermann a beau dire, il n’a jamais rien compris à Wagner. Quand c’est devenu à la mode, il a écouté benoîtement les hurlements hystériques des Walkyries et la marche funèbre de Siegfried en évoquant la grande âme allemande par des mots volés à d’autres bouches. En réalité, il n’entendait qu’une succession de notes plus ou moins échevelées qui martelaient le cœur, des rythmes propices pour entraîner le peuple à l’abîme, comme le joueur de flûte emmène les enfants de Hamelin afin de les noyer dans le fleuve…
À l’académie militaire de Karlsruhe, on saluait unanimement ses qualités d’audace et de courage ; pourtant ce garçon d’origine médiocre n’était pas noble, doté d’illustres ancêtres, sorti en Athéna tout armé du ventre de sa mère, comme la plupart de ses camarades, d’emblée voués à une grande carrière militaire. Hermann remplaçait sa naissance par des aspirations héroïques que lui soufflait notre enfance, digne de l’héritage des chevaliers teutoniques. Il refermait le poing sur son fusil et, le corps dur comme la pierre, il partait affronter la neige et le vent, il se sentait invincible, et pur, et beau ! Et moi, qui restais à l’abri des murs du château, dans ma chambre bien chauffée, un livre à la main, je nourrissais de la haine à l’égard de mon torse étroit, de mes membres chétifs, en même temps que j’admirais mon frère. Je le vouais au plus brillant avenir, et j’essayais, tant bien que mal, de m’endurcir en m’exposant au froid et en pratiquant des exercices physiques.
Nous errions à travers les forêts, apercevant à travers les branches les tours du château qui se découpaient contre le ciel, nous croyions être revenus aux temps anciens des héros. Tu ressusciterais les vieilles légendes, tu abattrais les monstres dont nous avions hérité de ces périodes troublées. Qu’as-tu fait de ce mythe, Hermann ? Maintenant je n’entends plus que les cris d’effroi de tes victimes. Tu as sali la pureté de nos rêves, et le sang se mêle au bleu éblouissant de tes yeux.
Le sang, l’alcool, encore une longue lampée pour étrangler le sanglot qui me monte à la gorge. Hermann ! Qu’as-tu fait ?
4
Il aimait trop la discipline : il faut croire que c’est ce qui l’a perdu.
Je cherche encore à le justifier, malgré ses dérives. Je cherche encore à l’aimer.
Il appréciait la discipline militaire, pas celle que je mettais en œuvre, moi, à la Realschule que je fréquentais à Munich depuis mes onze ans : cette rigueur scientifique me faisait explorer avec méthode les différents domaines d’étude, les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences physiques, la chimie. La chimie surtout, qui me fascinait tant à cause de l’instabilité des molécules et de leurs combinaisons, en réaction les unes aux autres, une fois liées ou déliées. Les molécules sont comme les êtres, elles dépendent de leur environnement ; sans modifier leur nature, elles donnent un résultat complètement différent en fonction des contraintes extérieures et des autres molécules auxquelles elles se sont associées.
J’explorais les sciences avec intérêt ; Hermann, lui, obéissait. Il faut reconnaître que ça lui réussissait. Le médiocre élève était entré dans le rang ; à force d’application, galvanisé par la perspective d’une carrière militaire, il avait obtenu les meilleures notes à la sortie de l’académie. On lui offrit d’entrer à l’école des Cadets. C’était en 1909, il avait seize ans, il ne rêvait que de combats acharnés et d’actions téméraires. Cinq ans plus tard, cinq ans seulement, les évènements lui donneraient raison… Hermann s’était préparé à la guerre, il n’attendait qu’elle : elle constituait à ses yeux le plus sûr moyen de mettre en valeur ses compétences, de se faire remarquer comme un élément hors du commun.
Au contraire, la guerre m’a brisé : il m’arrive encore que le bruit des obus qui pleuvaient sur nos tranchées passe par-dessus les horreurs de la dernière guerre et s’impose à ma terreur avec une actualité renouvelée. Que veux-tu, je suis un trouillard, je ne suis pas comme toi, Hermann. J’ai besoin de boire encore un peu, juste un peu, pour affronter ces images terribles qui m’envahissent dès que je pense à cette période, pendant que tu m’observes, goguenard… Oui, j’ai peur, tu peux ricaner tranquille ! Je ne ferai pas d’ombre à ta gloire. Je me contente de l’éclat limpide de l’eau-de-vie quand je lève mon verre à la clarté de la lampe.
Tu as beau dire, Hermann, toi aussi, tu as encaissé le choc. Malgré ton uniforme et tes décorations, malgré l’admiration que tu lisais dans les yeux des hommes et le désir dans celui des femmes, malgré tes réussites, tes entrées dans le monde, te rappelles-tu ? Nous étions deux chiots mouillés glacés par le froid du dehors quand Epenstein nous a jetés à la porte…
Ah, tu ne fais plus le fier ! Tu te recroquevilles dans ton coin, tu redoutes ce souvenir tout autant que moi ! Pourtant Epenstein n’était que ton parrain, rien d’autre ; mais tu n’as pas supporté qu’on te détrône du statut de seigneur que tu occupais à Veldenstein et à Mauterndorf, roitelet tout faraud avec ses droits de chasse et de cuissage, avec sa préséance et ses privilèges ! Avais-tu oublié que tu n’existais pas sans Epenstein, que toute cette fortune n’appartenait qu’à lui ? À lui, les chevaux, les fusils, les tours et les donjons, les domestiques, et même le pouvoir de rendre notre mère heureuse !
Maman : tu l’as trop vite oubliée. C’est pourtant elle qui a le plus souffert. À moins qu’il ne s’agisse de notre père. Il avait tout enduré en silence, comme un lâche, parce qu’il se croyait tranquille, assuré d’un refuge paisible ; et voilà que ses sacrifices ne servaient plus à rien, il était jeté dehors avec ma mère et sa minable petite pension de diplomate retraité… Olga et Paula étaient déjà mariées, toi et moi presque adultes, tirés d’affaire. Nos parents ont supporté le retour à Berlin en seconde classe : Epenstein avait payé les billets, il ne leur avait pas fait l’affront de les mettre avec leurs malles sur les bancs de bois des derniers wagons. Puis l’installation dans un pauvre appartement, nanti d’un mobilier défraîchi ; l’existence misérable, à tirer sur les fournisseurs, à vivoter dans le souvenir des fastes passés…
J’ai détesté Epenstein, du moins jusqu’à mon premier divorce. S’enticher de cette fille ! Mademoiselle Lili était mièvre à vomir, battements de cil et bouche en cœur, rire niais, décolleté profond, bouclettes blondes volant sur sa nuque. À peine plus de vingt ans, et Epenstein, qui aurait pu être mon père, qui était mon père, avait déjà dépassé la soixantaine. Elle avait la cheville fine, une certaine grâce dans le mouvement, un visage plein et délicat. Elle était adorable. Je n’ai pas seulement détesté Epenstein, j’ai été jaloux de lui.
À présent que le temps et l’alcool émoussent mes sentiments, je ne lui reproche plus de l’avoir épousée. Il avait de l’argent, elle acceptait de se lier à un vieil homme au ventre proéminent et au rire charmeur : quoi de plus naturel ? Il a eu raison d’en profiter. Si j’avais été à sa place, je n’aurais pas agi autrement. Moi-même, je n’ai pas hésité à changer de femme quand la mienne ne me convenait plus. Trois épouses, et combien d’amantes ?
Tu souris de satisfaction, Hermann. Tu me trouves odieux et tu t’en réjouis. Tu t’aperçois que, moi aussi, j’ai mes lâchetés. Tu guettes mes faiblesses comme autant de victoires. Mais je ne suis pas si abject que j’en ai l’air. J’ai pleuré avec maman, et toi aussi, même si tu n’arrives pas à en convenir. Tu étais un cadet, un dur ! Tu n’allais tout de même pas t’attendrir sur elle ! Laisse-moi te rappeler, après toutes ces années, le chagrin qui étreignait ton torse large, aux muscles puissants : laisse-moi dégager ton vrai visage. Nous étions tous les deux bouleversés par ce que nous appelions la trahison d’Epenstein. Nous nous sentions bafoués.
Nous avions connu le paradis et on nous en avait chassés brutalement. Oh, Epenstein s’est montré parfait, comme toujours ! Un vrai gentleman. En ce printemps de 1913, il multiplia les cajoleries, nous invitant tour à tour au restaurant, au concert ; il assurait son rôle de parrain en même temps qu’il coupait les ponts avec notre mère. Il n’empêche qu’il nous avait définitivement interdit tout séjour au royaume de l’enfance et que cette brutale entrée dans la vie adulte nous marqua bien plus que tu n’as jamais voulu l’admettre.
On regrette tous son enfance, paradis perdu de l’insouciance : légèreté, clarté, certitude. Moi plus que les autres ; perdre l’enfance, c’était aussi te perdre. Déjà nos voies divergeaient ; tandis que je me passionnais pour mes études dans la recherche et l’innovation technologiques, imaginant pour l’homme un avenir plus aisé grâce aux progrès de l’industrie, tu te complaisais dans les traditions de l’armée et dans les rêves de chevalerie. Je voulais construire du neuf, tu te passionnais pour le passé. Il nous restait une mémoire commune : le domaine mythique de notre enfance. La rupture entre Epenstein et maman nous en privait définitivement.
Et puis mon père est mort. Je parle de mon vrai père, celui qui m’a donné le jour ; pas celui dont le sang juif coule dans mes veines. Je parle de mon père qui m’a offert son nom, si lourd à porter parce que c’était aussi le tien. Mon père assez lâche pour supporter de vivre aux crochets de l’amant de sa femme, mon père assez fort pour rester détaché, en-dehors de toutes ces affaires trop humaines, préoccupé uniquement de sa vie intérieure. Mon père. Les années passent et j’ai atteint à peu de choses près son âge ; j’ai fini par lui ressembler, bien plus qu’à Epenstein, à force de sombrer dans l’alcool qui endurcit l’esprit et qui brouille le cœur.
J’ai pleuré sa mort, sais-tu ? J’ai pleuré, je l’avoue. Je l’ai aimé davantage que je l’aurais cru, et ce n’est pas une reconstruction débile d’un homme âgé qui se complaît à embellir le passé : c’est la stricte vérité. Toi tu t’es dépêché d’essuyer quelques larmes de circonstance, pour faire plaisir à maman ; en réalité, tu t’en fichais. Papa devenait gênant, avec sa mauvaise habitude de subir l’existence sans se battre le moins du monde. Tout le contraire de toi, qui te voulais si fort, si beau, invincible. J’ai caché mes larmes et j’ai étouffé mes grimaces. Je n’arrivais pas à devenir orphelin. Je n’y suis jamais parvenu. Encore aujourd’hui, je souffre de toutes ces absences : un parrain qui ne me laisse pas tomber, un père attentif, une mère heureuse, une patrie d’enfance où je puisse retourner pour y revigorer mon cœur d’adulte ; tout ce qui m’a manqué.
Dans la guerre, nos chemins se sont séparés encore plus radicalement. Je devrais m’en féliciter ; je devrais me réjouir de si peu te ressembler. Te l’avouerais-je ? Je me prends parfois à rêver d’une fraternité par-delà nos divergences…
Je te revois, enfant, quand nous courions ensemble dans les bois de Veldenstein. Je ne trahirai pas cette image. On pourra m’arracher tous les aveux, tous les regrets ; on ne pourra jamais me forcer à renoncer à ce lien qui nous unit encore, malgré nos désaccords, malgré la mort qui t’a emporté le premier et dans laquelle j’irai bientôt te rejoindre.
Mon frère perdu, je te retrouve par bribes, dans des souvenirs enfouis sous les replis les plus profonds de ma mémoire, et qu’une bouffée de chaleur, une gorgée de schnaps viennent exhumer par miracle. Je me plais à imaginer ce que tu aurais pu devenir, si seulement tu n’avais pas suivi cette voie. Je te remodèle, frère aimé, semblable à l’ami que j’aurais souhaité avoir, proche et complice. Je te cherche dans ma solitude ; mais bientôt l’alcool ne suffit plus, tu t’éloignes à toute vitesse, tu me fuis…
Hermann ! Reste avec moi !
Disparu. De nouveau seul. Seul ! Il ne me reste plus qu’à boire encore… Oublier… Me perdre ; jusqu’au vertige, jusqu’à l’inconscience.
5
Couché dans mon lit, sans aucun souvenir, et le crâne déchiré par une douleur insupportable. Brunhilde. Elle est là aussi. J’essaie de me détourner, je ne veux pas voir en face son air de reproche muet ; mais rien à faire, ma nuque reste trop raide pour que je puisse m’autoriser ce genre de gymnastique. Je n’ai plus qu’à faire face à ses yeux trop limpides, à sa moue ennuyée. Pardonne-moi, Brunhilde, je ne voulais pas te faire souffrir. Je sais que je ne devrais pas ; je ne peux pas m’empêcher…
Depuis mon retour à Munich, elle me veille silencieusement. Jamais une parole inutile, en ménagère efficace, si discrète que je finis par l’oublier. Mais quand je suis allé trop loin dans le fond de l’ivresse, elle est toujours là pour me ramener à la surface. Les draps sont bien lissés sur mon corps las, l’oreiller exhale une odeur de buanderie et de lavande, le jour coule à travers la fenêtre. Merci, Brunhilde.
Les mêmes yeux que ma mère, la douleur en plus. Je n’ai jamais interrogé Brunhilde sur son passé, sur sa famille. C’est un principe ici : nous sommes encore trop près de la guerre ; chacun a une peine à exhumer, une cicatrice pas encore refermée, mieux vaut ne pas y toucher. Pour moi, c’est différent, je porte mon nom comme une accusation ; lui aussi, Brunhilde l’a accepté sans la moindre question. Bénie soit-elle. Elle a accepté de prendre sur elle les retombées de ma honte. Le partage est inégal. Parfois je pars en rêve et je me plais à penser que ma mère aurait pu lui ressembler… Mais non, ma mère a toujours préféré Hermann.
Le beau Hermann… Brunhilde, t’ai-je déjà parlé d’Hermann ? Elle secoue lentement la tête et s’enfuit à petits pas pressés, retourne à la cuisine, à son labeur. Elle craint mes délires, et aussi, sans doute, les fantômes sanglants que je pourrais arracher à ma mémoire. Brunhilde ne sait pas qu’avant de porter l’uniforme Hermann était un garçon gai et intrépide, toujours prêt à défier les lois, celles de la société comme celles de la pesanteur ! C’est l’uniforme qui a gâté Hermann.
Comme il faisait briller les yeux de ma mère, dans sa tenue de cadet ! Il se campait fièrement sur ses jambes, le torse bombé, comme s’il posait perpétuellement devant le photographe ! Quand j’ai eu à paraître en uniforme, moi aussi, dans ma tenue kaki des Transmissions, bien moins glorieuse, je paraissais tout frêle, le cou écrasé par le col en passementerie ; les épaulettes faisaient ressortir l’étroitesse de mon torse. Hermann brillait, lui ; il était si beau, il plaisait tant qu’il a cru indispensable de revêtir, en même temps que sa veste galonnée, l’obéissance, la soumission, l’aveuglement nationaliste et la haine du faible.
Il y en a qui ont toujours de la chance, au moins en apparence. Comme la plupart d’entre nous, comme moi, Hermann était voué à ramper à même la terre de France, les ongles fichés dans la boue. Pourtant, au bout de quelques mois de ce régime, il s’est trouvé malade. Malade, notre héros ! Pas blessé glorieusement, mais atteint de mauvaise fièvre et de rhumatismes, dus à l’humidité des tranchées qu’il occupait près de Mulhouse… Et le voici à l’hôpital, comme un démissionnaire, comme un lâche. Oh, bien sûr, il a réussi à arranger ça par la suite ; Hermann a toujours eu le don de transformer ses faiblesses en acte de bravoure. Son biographe officiel, commandité pour organiser la louange de ce modèle du Reich, assura que le pauvre jeune homme, frustré de voir des avions passer si haut dans le ciel alors qu’il restait impuissant, cloué au sol, s’arrangea pour voler un appareil. Ce néophyte était si doué qu’il parvint à conduire sans embûche son avion jusqu’à la base la plus proche, exploit qui lui valut d’être accepté avec enthousiasme dans ce corps militaire prestigieux. Tout y était : l’audace, le défi, la réussite, la gloire. L’image qu’il voulait construire de lui.
Je connais, moi, le fin mot de l’histoire : Hermann rencontra à l’hôpital où il se morfondait un ami qui lui fit l’éloge de l’aviation ; cette arme nouvelle concentrait l’aristocratie des militaires. Enfin un terrain à sa mesure ! Le ciel : espace libre, encore à conquérir. Hermann proposa sa candidature à l’École de l’air. Elle fut acceptée : l’aviation, qui en était à ses balbutiements, avait besoin de futures victimes, car la majorité des pilotes avaient été assez heureux pour ne pas voir la fin de la guerre. Ni mon puissant mal de tête ni ma mauvaise humeur chronique n’excusent mon ironie ; je suis obligé de convenir qu’Hermann a réellement accompli des exploits aux commandes de son avion, bien davantage que moi, qui me suis contenté de suivre les ordres et d’accomplir ma tâche du mieux que les circonstances me le permettaient, au sol, toujours au sol ! Misérable asticot rampant sur la boue, vermine dégoulinant de sueur, d’angoisse et de sang.
Hermann ! De sa sortie de l’école en octobre 1915 à sa blessure de juin 1916, il avait remporté de nombreuses victoires aériennes. Il s’était battu seul contre six avions anglais dans une bataille qui lui valut un nouveau passage à l’hôpital, cette fois pour des motifs beaucoup plus honorables. Cette épreuve le consacra véritablement. Il recommença à voler. Avoir affronté de si près le danger lui donnait une nouvelle assurance. Quand il prenait les commandes de sa carlingue, ses instincts de chasseur lui revenaient : il devenait habile calculateur, déployant une acuité visuelle qui lui permettait de viser son adversaire au cœur et de se détourner de la mort, au dernier moment…
Lorsqu’il partait en permission, les femmes se pâmaient devant son uniforme bleu azur, si bien accordé à ses yeux. Les journalistes se pressaient pour lui arracher une photographie, quelques impressions, un récit épique. Les hommages pleuvaient : il reçut les honneurs des rois de Saxe, de Bavière, du Wurtemberg. Les meilleurs salons de Berlin lui ouvraient leurs portes. On oubliait ses origines modestes et son peu de bien : sa prestance et ses exploits effaçaient le reste.
Nous avions tous les deux reçu la même éducation : le sens du devoir était devenu notre seconde nature, si profondément gravé en nous que nous n’aurions pu y renoncer sans nous arracher la peau. Pour moi, la guerre n’était qu’une occasion où il fallait faire particulièrement preuve de ce sens du devoir : grâce à lui, je ne pris jamais les jambes à mon cou devant les explosions qui se rapprochaient ; à cause de lui, je sortis d’un endroit dangereux après mes hommes, non sans avoir vérifié qu’ils avaient tous évacué ; soutenu par lui, je fis plus ou moins bonne figure quand la conduite des combats tourna au désastre.
Hermann alla encore plus loin. Cette guerre me paraissait une catastrophe parce qu’elle mettait un frein brutal à tous les progrès que j’espérais pour l’humanité ; pour mon frère, elle se révélait une formidable aubaine. Grâce aux relations qu’il nouait, il s’assurait un avenir brillant, au sein de la meilleure société… Comme j’étais jaloux, alors ! Jaloux aussi de toutes ces femmes qui tombaient à ses pieds. J’enviais ses belles conquêtes, son prestige.
En somme, nous étions des frères semblables aux autres ; jaloux, comme tous depuis Ésaü et Jacob, jaloux au point de vouloir verser le sang, des Caïn et Abel, des fauves assoiffés, des Étéocle et Polynice. Je convoitais sa réussite. Tout le monde le connaissait ; ses exploits étaient racontés dans les journaux ; on levait son verre à ses prouesses… Ce fut bien pire, après ; d’abord en 1918, quand il remplaça le Baron rouge comme commandant du Richthofen Squadron, pire encore dans les années 1930, quand il approcha si près du pouvoir…
Moi aussi, j’aurais aimé susciter cet intérêt effrayé. J’aurais aimé étendre mon influence d’un bout à l’autre de l’Europe, à travers le Reich immense qu’il avait contribué à construire. Être craint. Être adulé.
Brunhilde a raison : l’alcool ne me réussit pas. Quand j’en reviens, j’en arrive à penser des choses effroyables. Maudite jalousie ! Arriverai-je à m’en défaire complètement ? Ou suis-je condamné à envier jusqu’à la mort sa gloire ensanglantée ? Il faudrait changer de nom. Ce serait tellement plus simple. Je me laisse parfois prendre à ce piège ; effacer un nom, comme on efface une ardoise. Repartir de zéro.
On peut renier son passé, on ne change rien à ce qui a été. Je suis Albert Göring et j’ai un frère que j’ai aimé. Je n’ai rien à me reprocher : juste la faiblesse de ne pas rompre ces liens de sang.
6
Je n’aurais pas dû évoquer ces souvenirs. Quand je pense à la guerre, même un instant, les images s’engouffrent comme un courant d’air dans une maison : impossible de refermer la porte. Les éclairs se succèdent, tous plus cruels. Les courses effrénées à travers les tranchées pour établir un fil de téléphone, et les épis déchiquetés des sapes éventrées par un obus ; les repérages frénétiques avant une offensive sur un terrain labouré, sans arbre ni vivant ; les morts croisés en chemin, leurs grands yeux mangés de vermine ouverts sur le néant… Avec mes hommes, j’étais chargé d’établir la communication entre les troupes et l’état-major. Les fils que j’installais, aux meilleurs endroits, bien enfouis dans la terre ou protégés par les replis du terrain, véhiculaient des injonctions sans nuance. Offensive à 6 heures – prendre batterie ennemie – aucun repli.