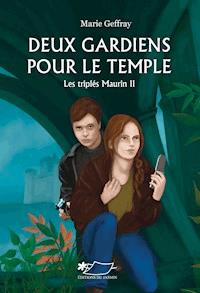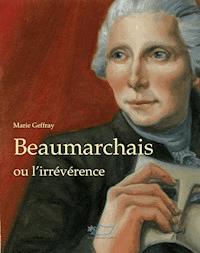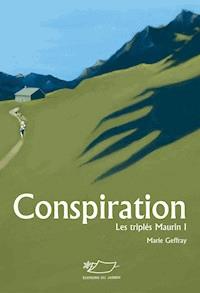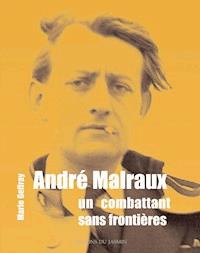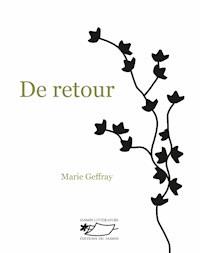
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Jasmin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Comment raconter l'indicible ?
Fin de la guerre. Le temps des combats s’achève. Un nouvel espoir se lève. Mais comment vivre auprès de ceux qui n’ont ni vu ni vécu les souffrances et la mort au quotidien ? Peut-on se consacrer à l’avenir en laissant les fantômes du passé derrière soi ?
Autant d’interrogations que nous livre Marie Geffray, dans ce récit sur la vie d’après-guerre. Dans un style sobre et puissant, l’auteur nous entraîne au plus profond du cœur des hommes… Vers un retour à l’humanité ?
Plongez dans ce roman historique et découvrez un récit bouleversant qui, en se penchant sur l'une des période les plus sombres de l'Histoire, entraîne le lecteur au plus profond du coeur des hommes.
EXTRAIT
Le repas est terminé. Je suis un homme comblé. Émile est à côté de moi ; il somnole à moitié. Nous pourrions discuter, maintenant que nous sommes repus, échanger quelques mots, en hommes bien élevés, peut-être même argumenter sur un sujet. C’est encore au-dessus de nos forces. Notre rééducation n’en est qu’à ses débuts. Il faut nous laisser le temps. La digestion nous entraîne dans une sieste de brute, sans cauchemar cette fois. Je n’ai pas encore retrouvé ma conscience, et pourtant, je me sens presque heureux.
La convalescence continue. Jusqu’ici me manquait la force nécessaire pour me traîner jusqu’aux sanitaires autrefois réservés aux soldats, dont nous bénéficions maintenant de l’usage. Les vêtements me collent comme une seconde peau. Je m’étais habitué à leur douceur poisseuse. On nous a distribué de nouveaux vêtements : des restes de stock, des habits usés, dont on ne connaît pas la provenance, mais dont l’état est en tous les cas meilleur que l’uniforme des détenus mille fois bricolé avec des bouts de chiffon. Autre luxe : ces vêtements sont propres. J’ai hérité d’un pantalon trop grand ; une ficelle permettra de l’ajuster. On m’a aussi offert une veste marron aux coudes usés, mais qui convient à ma taille : je la mettrai par-dessus ma chemise qui part en lambeaux et mon paletot mille fois rapiécé. Peut-être, enfin, cesserai-je d’avoir froid, surtout si j’ajoute à ce costume une longue ceinture de laine découpée dans notre ancienne couverture. Émile m’en a montré l’exemple : le tissu chaud lui enveloppe le ventre et, tout en le protégeant des coups de froid, l’empêche de trop souffrir des multiples problèmes digestifs qui nous martyrisent depuis notre arrivée au camp.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Le style est précis et efficace, d’une irréprochable sensibilité. -
Christophe Giolito, Lelittéraire.com
A PROPOS DE L'AUTEUR
Née en 1980,
Marie Geffray a suivi des études de lettres: elle a rédigé une thèse de doctorat sur les écrits et les discours d'André Malraux et Charles de Gaulle. Agrégée de lettres modernes, elle cherche à transmettre auprès des plus jeunes sa passion pour la littérature. C'est aussi cette volonté de faire aimer les livres qui la pousse à écrire pour les adolescents.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Collection
CollectionJASMIN LITTÉRATURE
1.Nouvelles d’Elles
Philippe de Boissy
2.De retour
Marie Geffray
3.Je rêve que Marguerite Duras vient me voir
Isabelle Minière
CollectionJASMIN LITTÉRATURE POCHE
1.Temps croisés
Jean Clavilier
2.Une si brève rencontre
Jean Clavilier
3.Chemins de soi
Amel Isyès
4.Semoule de blé dur
Amel Isyès
5.Bonhomme Écriture
Philippe de Boissy
6.Le manuscrit de Fatipour
Jean-Michel Touche
7.Les moelleuses au chocolat
Silène
8.La femme du physiologiste
Arthur Conan Doyle
Titre
Copyright
Marie Geffray
Agrégée de lettres modernes,Marie Geffray a soutenu une thèse de doctorat sur les écrits et les discours d’André Malraux et de Charles de Gaulle.
Auteur de plusieurs livres chez différents éditeurs, elle cherche àtransmettre aux plus jeunes sa passion pour la littérature, en publiant également de la littérature pour la jeunesse.
Tous droits de reproduction, de traduction
et d’adaptation réservés pour tous pays.
© 2013 Éditions du Jasmin
Dépôt légal : 1ertrimestre 2013
Du même auteur
DU MÊME AUTEUR
AUX ÉDITIONS DU JASMIN
Conspiration, 2011
Malraux, un combattant sans frontières, 2011
CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
De Gaulle et Malraux, le discours et l’action, François-Xavier de Guibert, 2011
En direction du large, Pascal Galodé Éditeurs, 2008
Dedicaces
À tous ceux qui m’ont raconté leur guerre, notamment Georgette G., Robert G. et Paul D., et à ceux qu’on a empêchés de le faire, parce qu’on préférait oublier.
M. G.
De retour
La Libération est passée. Depuis cinq ans, je ne vis que pour elle : son avènement me rend aussi démuni qu’un nourrisson, la candeur en moins. J’ai emporté de haute lutte le droit de vivre encore. Il me pèse déjà comme un devoir à accomplir, particulièrement pénible. Au terme de ces périls où je l’ai si souvent côtoyée, c’est la mort qui paraît légère.
Je ne suis plus rien qu’un fantôme indécis. Durant ces terribles mois de captivité, l’obstination d’un combat à livrer m’a maintenu debout. J’ai résisté aux tortures, aux humiliations, aux angoisses qui me dévoraient la poitrine : j’y suis parvenu parce que je savais qu’en dépit de mon apparente passivité, je livrais une bataille sans répit contre des forces néfastes. Soudain la lutte n’a plus lieu d’être. Je me retrouve dépouillé, la tête vide, le thorax sonnant creux, avec un cœur qui bat sans savoir, qui bat encore, par habitude.
Les combats ont été brefs : les soldats, las de lutter pour mourir, avaient déserté le camp bien avant l’arrivée des Alliés. Seuls quelques SS ont fait mine de combattre. Ils étaient peu nombreux. Les Britanniques eurent tôt fait de les mater. Ensuite, ils ne rencontrèrent plus la moindre résistance.
Alors un silence de mort retomba sur nous. Les soldats alliés avançaient. Ils s’attendaient à ce qu’ils allaient trouver ici : l’inscription, au-dessus de la porte d’entrée, les avait avertis qu’ils se trouvaient dans un camp de déportation. Pourtant la stupeur les terrassait, mêlée d’une amertume nauséeuse. Ils n’auraient jamais cru que l’horreur puisse atteindre ce comble. Les déportés n’osaient pas encore sortir. Ils se terraient à l’intérieur des baraquements, comme on le leur avait ordonné. D’ailleurs, la plupart étaient trop faibles pour quitter leur couche.
Quelques-uns pourtant se montrèrent plus curieux, ou moins exténués. Sans un bruit, le corps vacillant à peine porté par leurs jambes décharnées, ils se sont avancés vers les portes des baraquements. Je me suis mêlé à eux, appuyé sur Émile, qui s’appuyait sur moi. Nos deux débilités conjointes sont parvenues à atteindre la porte. Un timide soleil d’avril est tombé sur nous. Ils étaient là. Les Alliés. J’ai porté les mains à mes yeux ; ce n’était pas une hallucination. Le soleil s’est caché, voilé par un nuage. Ils étaient toujours là.
Ils nous regardaient en silence. Ils faisaient d’abord le geste de tendre les mains vers nous, comme pour nous soutenir. Puis ils reculaient, frappés d’hébètement. Nous étions trop nombreux, nous étions trop faibles. Ils étaient condamnés à l’impuissance ; et ce châtiment les faisait souffrir, tout autant que nous, les véritables condamnés… Leur recul m’a fait aussi mal que la haine des nazis, et même que leur indifférence.
Là, devant ces libérateurs, mon rêve de délivrance mille fois ressassé se brise soudain. Ne pourrai-je donc jamais redevenir un homme ?
Enfin, ils ont paru se familiariser avec l’horreur. Quelques sous-officiers ont lancé des ordres, ils se sont tournés vers nous. Ils ont fouillé dans leurs besaces, ils en ont tiré tout ce qu’ils avaient – trois fois rien, de véritables trésors : des bouts de chocolat, des biscuits de l’armée. Un homme s’est penché sur moi. Il était si jeune ! C’est ce que je me suis dit, jusqu’à ce que je réalise qu’en réalité il devait avoir une vingtaine d’années, comme moi ; mais son corps était jeune, sa peau lisse. Sa chair restait consistante, les muscles saillaient sous sa chemise d’uniforme. Son front se plissait sous l’effet de la terreur qu’il ressentait, en face de moi. Ses lèvres étaient encore capables de trembler sous le coup de l’émotion. Il m’a donné un biscuit. Je l’ai pris, avidement – oh, comme je me maudis de l’avoir saisi ainsi, avec cette frénésie ! Je voulais redevenir un homme, et je n’ai rien su faire d’autre que me comporter comme une bête.
J’ai pris le biscuit avidement, je l’ai coupé en deux et j’en ai donné la seconde moitié à Émile, qui s’était recroquevillé contre le mur à côté de moi. Le jeune soldat me regardait toujours. Dans ses yeux, le sentiment de pitié brillait si intensément que j’ai eu peur de moi-même, de ce que j’étais devenu. Puis il a fouillé dans sa sacoche et en a extirpé un second biscuit. Un immense espoir m’a envahi ; mais il avait tant à faire, ce pauvre jeune homme ! Il s’est tourné vers un autre détenu, qui n’avait encore rien eu. Ensuite, il s’est avancé vers la porte du baraquement et a disparu quelques instants à l’intérieur. Il en est ressorti en courant et est allé vomir dans un coin. Juste à l’entrée du baraquement, nous avons entreposé les corps de la nuit, à cause des odeurs : trois morts. L’épidémie de typhus continue à faire des ravages.
La Libération est passée, avec ces soldats hagards et bien portants, aux jambes solides mais aux regards titubants. Rien n’a changé.
Dans les baraquements, on meurt toujours au milieu des souillures. Les agonies sont muettes. La mort est solitaire. La faim gronde. La faiblesse m’assaille comme un essaim de guêpes bourdonnantes, qui me piquent les yeux, la peau, et mes sens m’abandonnent… Je me laisse aller à la léthargie qui s’empare de moi plusieurs heures par jour, depuis que j’ai traversé le typhus.
Quand je retrouve un peu de ma lucidité, en fin d’après-midi, ma conscience est devenue très claire. Je suis encore perdu au fin fond de la nuit ; cependant, l’espérance devient possible. Je dois survivre – je survivrai – mais je sens tout à coup l’ampleur de la tâche. Depuis le début de mon internement, je savais que la Libération viendrait un jour. Quand j’ai été arrêté, fin 43, les puissances de l’Axe s’affaiblissaient déjà. Depuis, des nouvelles parvenaient de temps à autre à percer l’étanchéité du monde concentrationnaire : nous savions que la fin était possible, que la fin était proche. Au début, je ne pensais pas pouvoir survivre assez longtemps pour y assister. J’attachais pourtant tous mes rêves à cet instant de la Libération : mon avenir y était entièrement suspendu. J’imaginais des soldats grands et forts, distribuant en riant du pain frais et du fromage, tout en servant des verres de vin rouge… J’imaginais des accolades, une fraternité immédiate et spontanée… J’imaginais un train aussitôt avancé, roulant sans heurt à travers l’Allemagne, d’une seule traite jusqu’à Paris…
La Libération est terminée. Mon corps ne parvient pas à en prendre conscience. Un demi-biscuit ingurgité depuis la veille : mon ventre est douloureux. La soif me tiraille, mais je n’ai pas la force de me lever pour aller chercher de l’eau à la fontaine. Émile a disparu. Des soldats britanniques passent selon un ordre qui doit avoir du sens. Des véhicules lourdement chargés cahotent sur la route. Les déportés les plus vaillants les suivent, dans l’espoir d’obtenir à manger. Dans le baraquement, un homme continue à râler. Il va mourir sans avoir seulement conscience qu’il meurt libre.
J’avais espéré une rémission collective, un souffle fraternel et puissant qui nous emporterait tous. Mais la guerre continue. Nous ne sommes que ses victimes parmi d’autres victimes – encore avons-nous eu la chance de ne pas y succomber tout à fait. Nous n’avons rien à attendre, que de la nourriture. Émile revient. Il me tend sa gamelle : de l’eau. Je bois avec délice. Il paraît que les Alliés vont bientôt servir de la soupe, devant chaque baraque. De la nourriture en abondance ! Un vrai potage, avec des pommes de terre et des lardons – pas cet infâme bouillon dilué dans une eau sale qu’on nous a servi durant des mois… Émile en frémit d’impatience. Il aperçoit enfin le vrai visage de la Libération : de la soupe et du pain.
Alors j’attends mon tour, moi aussi. Il ne s’agit pas de mourir maintenant : il me reste tant à reconquérir.
Je me retourne sur moi-même, je compte mes forces. Que me reste-t-il ? Jusqu’ici, à en juger par tous les cadavres que j’ai abandonnés sur ma route, j’ai montré une aptitude extraordinaire à la survie. Je suis allé bien au-delà de toute souffrance imaginable ; j’ai dépassé les limites que j’avais fixées à mon existence.
Dans l’épreuve, j’ai d’abord gardé à l’esprit le prénom de ma bien-aimée. Des heures durant, je me suis bercé de l’espoir de la retrouver, de la tenir vivante entre mes bras. Je fermais les yeux, j’évoquais son visage. Sa silhouette rêvée se penchait pour veiller mon âme. Suzanne ! Suzanne ! Son nom me portait, redonnait un peu de force à mes membres épuisés, un peu d’énergie à mon corps débile. Son souvenir m’imposait de poursuivre le combat contre la mort.
Puis la magie s’est évanouie, le charme s’est rompu. La douleur m’avait conduit trop loin : elle faisait de moi un squelette hébété, couvert d’indélébiles meurtrissures. Préoccupé par les immédiates nécessités du corps, j’ai oublié Suzanne. Pour seul horizon, il ne me restait plus que ma quotidienne survie, assaillie de toutes parts : les amis d’hier se transformaient en meurtriers potentiels ; la nuit, le froid, le soleil, la chaleur, tout devenait infiniment dangereux. Je me suis replié sur moi-même – sur cette seule certitude dont j’aie vraiment gardé, jusqu’au bout, la conscience : j’étais encore vivant. À ce moment-là, je me montrais enragé. J’étais vivant, je voulais le rester, désespérément.
Tout à coup, quelque chose s’est brisé en moi. J’ai voulu renoncer. Même cette envie de vivre m’avait abandonné : à quoi bon poursuivre, si tant de douleurs en résultaient ? Rien n’était plus facile que de se laisser aller à la tentation de la mort, facile et désirable. J’ai essayé. Au bord du gouffre, une main terrible m’a remis sur pied – et j’ai continué, porté par ce soutien, poussé par lui, parfois contre ma volonté ! La main était plus forte que moi. J’y ai cédé. Maintenant que j’ai retrouvé un peu de ma lucidité, je la reconnais bien : c’est celle de la vengeance.
Qui m’a trahi ? Je veux savoir. Si je mourais, je ne trouverais rien d’autre que le néant – et, peut-être, le pardon. Alors je vis. Avant de me laisser glisser dans la tombe, je veux savoir qui m’a dénoncé.
Je veux meurtrir celui qui m’a meurtri.
Nous appartenions à un monde de mort et de larves.La dernière trace de civilisation avait disparu autour de nous et en nous.[…] Ils avaient bel et bien fait de nous des bêtes.
Primo Levi,Si c’est un homme
Tout était si facile, avant. Le temps s’écoulait, et je trouvais sans peine à m’insérer dans cette vie naturelle, aisée. La famille et les amis, le travail de la semaine et les distractions du dimanche : maintenant, même cette existence simple paraît inaccessible. Comment ai-je pu, un jour, me comporter avec une telle innocence ? Comment ai-je pu oublier que la mort est toujours si proche, prête à vous assaillir ? Le système concentrationnaire a fait de moi un angoissé perpétuel, pliant sous son insupportable fardeau : cette culpabilité incessante, qui s’attache à notre simple fait d’exister. Nous n’avons pas le droit de vivre ! Nous subsistons pourtant, traqués, diminués…
J’oubliais, alors, que la vie est un privilège. Devant les yeux barbouillés de mon père, qui se perdaient dans d’obscures réminiscences, j’éprouvais une honte muette… Mon père, Auguste-Paul Desmarais, comme je te comprends maintenant ! Tu regardais ton potager dans la lueur orangée de la fin du jour (le potager était le seul lieu au monde auquel tu attachais réellement de l’importance). Devant les lignées ordonnées des poireaux et des choux, tu t’arrêtais soudain de me parler, comme pris d’un hoquet. Ta main convulsive cherchait à toucher ta poitrine : tu souffrais d’oppression, les larmes montaient à tes yeux soudain vidés d’expression. Alors, je le sais maintenant, tu voyais des choses qui n’appartenaient plus à la réalité… Tu étais brutalement ramené vingt ans en arrière.
Tu étais revenu au milieu de la tranchée. Les feux ennemis ne cessaient de se croiser, et autour de toi, les camarades tombaient, l’un après l’autre. Tu en avais déjà connu, de semblables batailles ! Aussi ardente que celle-ci, jamais. Au tir des obus avait succédé le feu crépitant de la mitraille, proche, de plus en plus proche ! Les camarades tombaient. Tu te relevais, tu tendais ton fusil, tu tirais au commandement de l’officier. Et puis, vite, tu ramenais ta face contre la terre, pour y chercher une illusoire protection. Ton pantalon était souillé du sang d’un autre, ses entrailles avaient giclé sur toi. Tu étais encore vivant. Ton seul espoir était d’en finir avec l’horreur – en finir, par n’importe quel moyen, ne plus avoir à subir le feu, la terreur, la mort des copains, le devoir de prendre son fusil et de tirer…
Soudain, un obus est tombé. La voix de l’officier s’est trouvée happée par le souffle de l’explosion – tu es resté sourd durant trois jours. Tu as été protégé par la tranchée : ton corps a souffert de multiples contusions, mais seul ton bras gauche a été grièvement blessé. Un éclat d’obus l’a réduit en miettes. Sans doute, s’ils avaient pris le temps, les chirurgiens auraient-ils été en mesure de le sauver. Les médecins étaient pressés. Ils ont coupé le bras, juste en dessous de l’épaule. Le silence dans lequel tu étais plongé ne t’empêchait pas de rester bien conscient – jusqu’au bout, face à la douleur. La surdité t’a évité d’entendre le diagnostic des infirmiers, et aussi les hurlements déchirants que tu as poussés avant qu’on ne t’endorme, du chloroforme posé sur ton nez.
Lorsque tu t’es réveillé, tu étais manchot. Tu souffrais horriblement. Tu étais toujours sourd. Et ton vœu s’était accompli : tout était terminé.
Contre toute attente, tu étais vivant.
Tu as retrouvé une bonne partie de ton audition. Pourtant, ton regard ne te ressemblait plus – de même qu’aujourd’hui, je le devine, je pose sur les choses des yeux profondément modifiés. Je connais maintenant ton tourment, lorsqu’au soir, ton seul fils à tes côtés, tu contemplais le potager dans lequel tu avais travaillé tout au long de la journée. C’était la représentation de ton espoir. Tu t’es cramponné à lui, toutes ces journées de 1914 et de 1915 où tu survivais accroupi dans la boue, à attendre la prochaine attaque d’un improbable ennemi. Quand la mort même était imminente, l’image te poursuivait : celle d’un avenir possible, patiemment construit autour d’une famille, éternellement rattaché aux terres d’origine.
Ainsi, mon père, Auguste Desmarais, pardonne-moi : je ne savais pas alors. Je te dédaignais pour les larmes qui te venaient aux yeux. Je te croyais faible, peut-être sénile. Rien de tout cela. L’image soudain te revenait en pleine face, et tu pleurais de gratitude – de reconnaissance envers cette vie qui pourtant ne t’a jamais gâté. Tu reconnaissais soudain le fils sur lequel pouvait s’appuyer ton corps perclus, et la terre bien noire, riche d’avoir été si soigneusement retournée.
Tu me paraissais méprisable. Si je reviens un jour, je m’ouvrirai à toi de ma profonde erreur. Cette confession me paraîtra difficile ; j’éprouverai des difficultés à trouver les mots nécessaires. J’y parviendrai pourtant. Je te parlerai d’abord de ton potager. Je louerai ses rangées bien alignées, savamment alternées. Les bouquets du persil mettaient au milieu de la raideur des poireaux une note floue ; les salades s’épanouissaient, côte à côte avec des choux-fleurs tendrement enfouis sous leurs protections feuillues ; différentes espèces de haricots se côtoyaient, précoces ou tardives, grimpantes ou rampantes. Mais ce que tu préférais, c’était ces légumes qui mettent une certaine coquetterie à ne rien laisser voir. Ils se cachaient sous la terre ; au-dehors, ils ne laissaient apparaître que des feuilles sans intérêt. Et toi, pour éblouir l’enfant que j’étais alors, tu extrayais soudain d’un petit monticule une poignée de pommes de terre, ou encore des carottes, des navets et des radis.
C’était ton coin de paradis, le lieu où la chasse au trésor restait possible, malgré toutes les horreurs rencontrées sur ton parcours. Tu parvenais presque à oublier. Et moi, je te méprisais ! Oh, pas immédiatement ; seulement quand je suis devenu plus âgé. Peu avant la guerre, la suivante, mes deux sœurs se sont mariées – Ginette et Georgette – l’une après l’autre, elles ont quitté le foyer parental. Je n’avais pas encore quinze ans. Je me retrouvais seul face à toi et à ma mère. D’un coup, je me suis rendu compte de toutes ces données qu’un enfant ne saisit pas, parce que l’habitude, et aussi la naïveté propre à l’enfance, l’empêchent de les voir : tu n’endossais pas le rôle que les pères jouent d’ordinaire dans une famille.
Il régnait entre toi et ma mère une entente cordiale, souvent tacite ; d’amour, il n’en était pas question. Tu ne parlais jamais beaucoup, tu désertais souvent la maison. Pourquoi t’étais-tu décidé à épouser Louise ? Pour répondre à l’image du bonheur qui t’avait poursuivi durant les combats, et qui impliquait ton appartenance à une lignée ? – Certes, mais Louise, pourquoi avait-elle bien voulu de toi ? Beaucoup d’hommes étaient morts à la guerre, elle ne voulait pas terminer vieille fille comme sa sœur. Une femme si belle… Permets que j’utilise ce terme à propos de ma mère : elle était belle, réellement. Je ne te l’ai encore jamais dit – il y a beaucoup de choses que je n’ai jamais dites – j’ai longtemps admiré en secret votre photo de mariage.
Ma mère est assise dans sa robe très simple, blanche et étroite, qui tombe jusqu’à ses chevilles ; elle porte dans les cheveux un turban blanc, avec une légère voilette qui ne dissimule pas son front ni ses grands yeux noirs, songeurs, un peu trop sérieux pour une noce. Toi, tu es debout derrière elle, et ta main droite repose sur son épaule, comme pour trouver un soutien. Tu te tiens un peu de biais, de telle sorte qu’on n’aperçoit pas la manche vide, rattachée à ton costume sombre, seulement égayé par un mouchoir blanc à moitié sorti de la poche de devant. Ta moustache est bien taillée, noire comme jais ! Pour ma part, j’ai toujours connu tes cheveux et ta moustache poivre et sel.
Dès le début, votre mariage était biaisé. Tu offrais à ta femme, dernière fille d’une longue fratrie, une situation aisée : Louise était comme toi fille d’arboriculteur, mais elle ne pouvait s’attendre à rien de la part de ses frères aînés qui avaient repris l’exploitation familiale. Toi, en échange, tu lui demandais de s’occuper de tout. Tes parents étaient trop vieux pour continuer à travailler ; tu étais fils unique ; pourtant, diriger les travaux, gérer les ouvriers et visiter les champs constituaient autant de besognes qui te déplaisaient souverainement. Louise a tout fait. Elle a mené de front ses trois grossesses successives, les tâches ménagères réservées aux femmes, et la direction de l’exploitation. De temps à autre, elle te demandait d’aider les ouvriers ou de visiter un champ ; quatre jours par semaine, tu allais au marché à Paris pour vendre la marchandise. En réalité, tu fuyais. Il te déplaisait de détailler, chaque soir, aux trois ouvriers agricoles engagés à l’année leur labeur du lendemain, de même que tu ne souhaitais pas trop t’éloigner de la vaste demeure familiale léguée par tes parents.
Quand tu le pouvais, tu t’évadais dans le potager tout en longueur qui occupait l’espace, derrière le hangar refermant la cour de la maison. Ce travail, du moins, tu pouvais le réaliser sans trop de difficulté, avec une seule main. À coups de haricots et de carottes, tu recréais un univers parfait, rectiligne, où jamais les mauvaises herbes n’avaient le temps de s’installer. Un monde où les frontières restaient stables : chaque légume dans son rang, sans confusion possible.
Parfois aussi, tu te rendais auprès de tes amis, d’anciens poilus, comme toi ; durant des heures, tout en dégustant quelques verres de blanc, vous racontiez pour la centième fois des histoires connues par cœur et toujours mal digérées… De temps à autre, tu partais pour la soirée à Paris. Ma mère maugréait. J’ai toujours attaché à ces escapades une impression de culpabilité latente – jusqu’à ce que je découvre, alors que j’avais une douzaine d’années, ce que tu faisais réellement : ce soir-là, tu m’emmenas avec toi, sans un mot d’explication. Nous prîmes le train et nous marchâmes dans Paris ; tu me fis entrer le premier dans un cabaret étouffant de fumée, où des hommes un peu fous jouaient du jazz.
Après le certificat d’études, qui m’a permis de cesser la fréquentation de l’école, je suis devenu le véritable homme de la maison. À l’issue de quelques saisons passées dehors, parmi les ouvriers, à travailler comme un homme fait, j’étais suffisamment endurci pour supporter de pénibles travaux. En dépit de l’aspect chétif de mon corps de quinze ans, je pouvais traîner de lourdes charges, passer des journées dans le froid et travailler sans relâche douze heures d’affilée. Je ne regrette pas cette endurance : elle m’a donné la force de survivre dans ce lieu où les possibilités du corps humain sont tirées à l’extrême.
Tu te désengageais de plus en plus des activités familiales. Tu poussais la solitude à outrance. Même quand tu venais partager le dîner avec nous, tes pensées étaient ailleurs, bien loin des préoccupations de l’exploitation : la floraison était précoce, cette année ; pourvu que le gel ne compromette pas la récolte ! Le froid avait déjà abîmé les poiriers. Il fallait trouver des ouvriers pour la saison des pivoines, qui viendrait bientôt… Toi, tu n’écoutais pas. Ton visage s’obstruait, tes yeux restaient fixes. De temps en temps, tu te retournais vers la fenêtre ; on n’apercevait que le ciel et le hangar, situé de l’autre côté de la cour, où reposaient les caisses de la récolte. Tu aspirais à retrouver la paix de ton jardin.
Ma mère s’usait. Sa beauté de jeune fille s’était estompée, à force d’années et de labeur. Elle ne parvenait plus, comme avant, à faire face à l’afflux de travail. Son corps était abîmé, sa voix aussi : elle était moins leste, restait parfois muette devant les interrogations des ouvriers. Peu à peu, j’ai pris ma place. Je t’ai remplacé, les matins de marché : Antoine, qui savait conduire, m’emmenait avec lui dans le camion chargé de fruits, et nous nous rendions au marché des Enfants-Rouges, dans le troisième arrondissement, pour vendre la récolte. Je me chargeais de la caisse, pendant qu’Antoine servait les clients.
Le changement s’est fait naturellement. Au bout de quelques mois, c’était vers moi que les ouvriers se tournaient. J’ai pris seul les décisions d’importance : le moment de tailler, le moment de récolter… Ma mère ne donnait plus son avis qu’à titre consultatif. Mes sœurs mariées vaquaient à d’autres affaires. J’étais le maître de la maison. J’avais à peine quinze ans.
J’ai regretté parfois que cette maturité trop vite venue m’éloigne des facéties ordinaires des garçons de mon âge, qui obéissaient encore scrupuleusement aux ordres de leurs pères, et qui souvent rôdaient en bandes, le soir, pour prendre du bon temps. Je n’étais pas seul, pourtant ! Il y avait Jean, Jean le camarade de toujours, et qu’est-il devenu ? Éteint dans la fange et l’oubli, comme tant d’autres…
Je ne dois pas penser à Jean. Je pourrai peut-être, plus tard – si je survis aux prochaines heures. Pour le moment, je ne dois pas penser à Jean. Son souvenir risque de m’entraîner vers la terre, l’abandon tant désiré à la mort…
Le sentiment de notre existence dépend pour une bonne part du regard que les autres portent sur nous.
Primo Levi,Si c’est un homme
Non, ma jeunesse ne fut pas misérable. Jusqu’à un certain jour de 1943, et malgré le début de la guerre, je ne fus pas malheureux. J’avais des joies solides : j’aimais les livres. Oh, je n’étais pas bon élève pour autant ! Je l’avoue, je fus bien soulagé d’obtenir le certificat d’études qui me dispensait enfin de ces interminables heures passées à l’école, à observer désespérément l’aiguille qui pointait à l’horloge du clocher : et l’aiguille ne bougeait qu’avec une incommensurable lenteur ! Jusqu’à ce que M. Laignon, le vieil instituteur serré dans son antique habit noir, interrompe brusquement ma rêverie et m’oblige à me pencher de nouveau sur les exercices de mathématiques auxquels mon esprit se dérobait infailliblement…
À la fin de chaque année scolaire, j’attendais avec impatience le jour des prix. Même les cancres avaient droit à un magnifique livre, relié en écru et décoré de losanges, tiré de la collection Nelson. Walter Scott, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Paul Féval… Comme ces livres ont pu enchanter mon quotidien ! Quand j’avais achevé mon propre volume, j’allais quémander celui de mes camarades, qui ne s’y intéressaient guère et me le laissaient en échange de quelques bonbons. Mon maigre argent de poche, je le dépensais dans l’achat d’un de ces livres vert kaki entrevus dans le bazar de Mme Giroud.
Et parfois – parfois ! à trois reprises dans toute mon enfance ! – ma mère m’emmenait dans la librairie de Chant-la-Reine, le bourg voisin. L’odeur un peu aigre des reliures poussiéreuses me faisait pénétrer dans un univers fantastique. Je suis sûr qu’aujourd’hui encore, au milieu du camp de Bergen-Belsen, réduit à l’état de loque, presque cadavre, sans doute bientôt forcé à le devenir, si on me mettait sous le nez ce parfum de délices, je me transporterais immédiatement en pensée dans l’antre magique de cette librairie… Les rayonnages me paraissaient monstrueux : ils occupaient la majeure partie de l’étroite boutique et s’élevaient jusqu’au plafond. Comme les livres débordaient pourtant, quelques piles occupaient encore le sol, entre l’escabeau et le comptoir où trônait le vieux libraire myope et desséché. Lorsque ma mère lui indiquait un ouvrage de la collection Nelson, mon cœur bondissait dans ma poitrine. Après avoir payé, elle m’offrait le livre ; j’osais à peine le regarder, je le fourrais sous mon paletot, en me promettant des heures de félicité…
Ma mère aussi aimait la littérature. Quand le travail lui en laissait le temps, elle lisait quelques pages de Flaubert ou de Balzac ; elle se plaignait toujours d’avoir tant de linge à recoudre, et une si mauvaise vue… Pour le divertissement, la couture ne vaut rien. Elle abîme les yeux sans qu’on puisse en tirer la moindre satisfaction. Alors que les livres ! Avant la guerre, quand je devins en âge de comprendre, ma mère m’emmena plusieurs fois au théâtre. Nous vîmes Molière, Racine, et Marivaux. La Comédie-Française m’éblouit, avec son décor de trompe-l’œil et ses acteurs, monstres sacrés capables de déclamer des vers de Corneille comme s’ils venaient de les inventer. Mes sœurs préféraient le cinéma. Elles m’emmenaient avec elles quand une séance avait lieu à la salle des fêtes de Montillon. Ma mère marmonnait des propos incompréhensibles. Son visage se figeait sur sa désapprobation.
J’étais un enfant privilégié : ma mère m’avait ouvert les voies de l’évasion. Grâce à la lecture, j’étais fait pour être libre. Les soirs d’hiver, quand le jour tombait tôt et que le travail aux champs se faisait moins pressant, je prenais place à la table de la cuisine, où brillait l’unique lampe. Ma mère et mes sœurs cousaient. Parfois, mon père lisait son journal dans un recoin sombre, tout en mâchonnant sa pipe : mais la plupart du temps, il restait dehors, dans un café avec ses amis de la guerre, ou dans le hangar. Mes sœurs n’aimaient pas me voir inactif. Elles trouvaient toujours une tâche à accomplir : chercher du bois pour le poêle, nettoyer les outils, aiguiser les couteaux de la cuisine, nourrir les lapins qui emplissaient les clapiers, au fond de la cour…
Ma mère intervenait toujours : « laissez-le, disait-elle, il lit ». J’accomplissais mon travail plus tard, quitte à arriver en retard pour le souper. Mes sœurs maugréaient et bavardaient haut dans l’espoir de me voir lever le nez de ma page. Rien ne pouvait me distraire : je suivais aveuglément les aventures du comte de Monte-Cristo ou les déboires de Don Quichotte. Plus tard, quand mes sœurs furent parties, ma mère se sentit plus libre ; elle avait vieilli, elle était lasse. Alors elle commença à m’accompagner dans mes lectures. Elle préférait Maupassant ou Zola. La chandelle découpait un trou lumineux où resplendissaient en dansant les caractères imprimés. Nous lisions tous les deux, silencieusement, de part et d’autre de la table recouverte d’une nappe cirée à carreaux rouge et blanc, jusqu’à ce que la silhouette noire de mon père apparaisse et prenne place sans mot dire à la table, attendant la soupe laissée à chauffer sur le poêle.
Ma mère poussait un petit soupir au moment où elle s’arrachait de sa lecture, de ce monde imaginaire où elle avait plongé. Elle posait sur la réalité des yeux effarés. Je la sentais vieillir : elle n’était plus aussi à l’aise avec les choses. L’organisation de la maison lui échappait progressivement. Quand les ouvriers lui posaient une question sur la recette du marché ou sur la cueillette des pivoines, elle avait tendance à s’affoler légèrement ; je l’apaisais d’un geste, je répondais à sa place. Peu à peu, elle me laissa gérer le porte-monnaie de la maison. Au retour du marché, je comptais l’argent. Je le répartissais en fonction des besoins : un tas pour la paie de la semaine des trois ouvriers ; un petit tas pour les courses quotidiennes ; un plus gros tas de réserve, qui servirait aux dépenses exceptionnelles ou à la paie des ouvriers occasionnels embauchés pour l’été.
Quand son mari, Henri Favet, a été mobilisé, ma sœur Georgette est revenue vivre avec nous. Elle a rendu la chambre minuscule où logeait le jeune couple. Leur premier bébé allait naître : il y avait de la place dans la grande demeure familiale, alors que les parents d’Henri hébergeaient déjà leur fils aîné et sa femme. Cependant, même après son retour, mon beau-frère continuait d’aller travailler avec ses parents : ainsi je demeurais le seul à diriger les travaux. J’en étais fier, alors ; mais aujourd’hui, je suis heureux de savoir que ma mère n’est pas seule à gérer la maison. J’aime Georgette, ses gestes efficaces, son esprit de décision et sa voix péremptoire. Je sais qu’elle s’occupera au mieux de l’exploitation. Elle comptera les sous et les répartira au plus juste. Elle saura trouver de la nourriture, même quand il n’en reste plus nulle part.
Georgette a toujours été ma préférée. Elle ressemble à ma mère, avec son visage effilé, terminé par un menton un peu pointu. Ses traits sont vigoureux, témoins d’une grande force de caractère. Pourtant ses grands yeux noirs, débordés par les longs cils, adoucissent cette impression de vigueur : ils se posent lentement sur les choses et prennent leur temps pour les analyser. Alors ils se plissent dans un sourire muet, approbateur. Georgette a l’amitié longue et une précieuse franchise. C’est pour cette raison qu’elle s’est toujours disputée avec Ginette – le surnom de Geneviève – née un an après.
Ginette est chicaneuse. Elle n’a jamais accepté d’être seulement la seconde de la famille : elle cherche à retrouver des prérogatives d’aînée en faisant tout mieux que les autres. Elle met les plus belles robes, rit plus fort que quiconque, feint un esprit supérieur… Elle s’est mariée la première, quelques mois avant sa sœur. Quant à moi, elle ne m’a jamais trop aimé. J’étais le seul fils, le garçon chéri venu plus tardivement, alors que mes parents croyaient devoir se contenter de deux filles. Mon père surtout n’a jamais accordé d’importance particulière à ses aînées, tandis qu’il m’a distingué en cherchant à m’intéresser à son potager et à ses histoires de la guerre. Pauvre père ! Je l’ai toujours écouté d’une oreille trop distraite, pressé de retrouver mes jeux ou mes livres, et la sécurité apaisante de ma mère…
Pourtant je tire de lui un précieux enseignement : celui du jazz – cette musique de dégénérés, lâchait ma mère à tout bout de champ. Avant la guerre, mon père allait à Paris une fois par mois, irrégulièrement. Il partait à la nuit tombée. Depuis mes douze ans, je l’accompagnais souvent, sauf les veilles de marché, où il me fallait partir à 4 heures du matin et charger le camion des caisses de fruits. Lorsqu’il m’avait emmené pour la première fois dans ce cabaret, j’étais tombé amoureux de ces mélodies un peu barbares (elles nous venaient d’outre-Atlantique), mais si suaves ; si secrètes aussi, beaucoup moins éclatantes que celles que j’avais coutume d’entendre à la radio, musique triomphante où éclataient les cuivres dans un rythme consensuel. L’harmonie de Montillon avait dans son répertoire, à côté des chants traditionnels et des sonneries militaires, quelques concertos arrangés de Bach, de Pachelbel ou de Haendel : musique superficielle, faite pour charmer les apparences ou les esprits naïfs, dénués d’états d’âme.
Au contraire, j’avais l’impression que le jazz plongeait au fond de moi-même. Il m’arrachait les tripes et me mordait le cœur. Face à l’orchestre composé d’une batterie, de deux trompettes, d’un trombone et d’un piano, je me sentais soudain mis à nu, l’âme à vif. Le chanteur poussait un long soupir dans une langue inconnue, et je chavirais. Le rythme m’emportait, tantôt lent, tantôt dément, je ne pouvais m’y soustraire ! Le jazz était magique. Il me révélait à moi-même.
Durant ces séances de communion musicale, mon père et moi n’échangions aucun mot – pas même dans le train du retour. Nous fumions en chœur, nous écoutions. Nous aurions pu être deux parfaits inconnus réunis par hasard à la même table, autour du même verre de blanc. Mon père a mis de longues années avant de me découvrir le fin mot de son secret. Un jour (c’était en 1938 ou 1939, je crois), il m’a entraîné au grenier avec un air de conspirateur. J’ai craint qu’il ne me montre encore une de ses vieilleries : une balle qui s’était fichée dans la terre de la tranchée juste à côté de son visage ; une cuillère de métal tordue et gravée, à laquelle on avait fixé quelques fils de fer pour figurer un personnage de soldat ; ou encore sa gourde, que durant la Grande Guerre il remplissait toujours de vin largement mêlé d’eau, pour avoir l’illusion d’en boire plus.
Rien de tout cela. D’un vieux drap soigneusement plié, Auguste-Paul Desmarais extirpa un trombone.
Un vrai trombone, avec sa coulisse en parfait état de marche, astiqué, huilé ! Mon père continuait à l’entretenir soigneusement. Il n’avait pu en jouer depuis vingt ans. Il me jeta un regard grave, pour vérifier que je comprenais bien l’importance de l’évènement. Sans doute satisfait de l’intérêt que je manifestais, il prit l’instrument de sa main valide et plaça l’embouchure sur sa bouche : un son puissant, long et profond, sortit du vieil instrument. Mon père le fit glisser de son épaule gauche, puis, de sa main droite terriblement habile, il fit coulisser le tube. Dès qu’il eut de nouveau placé l’instrument sur sa bouche, un nouveau son en sortit, plus grave.
Mon père continua son manège. Avec l’embouchure, il pouvait changer d’octave ; jamais de note. Dans sa main unique, le trombone semblait aussi dérisoire qu’un jouet brisé. Mon père le savait. Ses yeux s’attristaient. Il reposa l’instrument. Il avait appris à jouer avant la guerre, quand, jeune garçon, il faisait partie de l’harmonie de Montillon, avec son propre père. Il aurait aimé apprendre cette nouvelle musique, le jazz, et laisser rebondir les notes au gré de son humeur… Depuis vingt ans, l’instrument reposait dans le grenier.