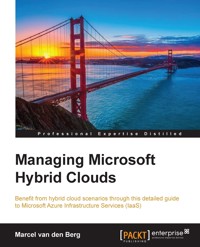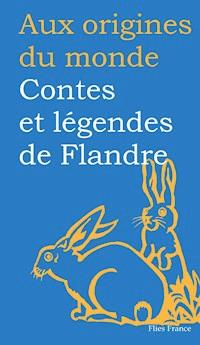
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Flies France Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aux origines du monde
- Sprache: Französisch
Un florilège de mythes, de contes et de légendes permet de pénétrer dans l'imaginaire de Flandre
La principale industrie des habitants de la vallée du Geer, c’est le tressage de chapeaux de paille. Selon une vieille légende que l’on se raconte toujours dans cette région, le tressage doit son origine aux lutins qui vivaient dans les sombres grottes de la vallée voici des siècles et des siècles. Ces nains avaient pour coutume d’emprunter, la nuit, toutes sortes de ustensiles aux villageois ; ils les leur remettaient au lever du jour, non sans les avoir nettoyés et astiqués, tout en leur donnant de petits cadeaux en osier. Ainsi ces lutins, qui maîtrisaient l’art du tressage, auraient-ils appris à nos ancêtres à tresser divers objets.
À PROPOS DE LA COLLECTION
« Aux origines du monde » (à partir de 12 ans) permet de découvrir des contes et légendes variés qui permettent de comprendre comment chaque culture explique la création du monde et les phénomènes les plus quotidiens. L’objectif de cette collection est de faire découvrir au plus grand nombre des contes traditionnels du monde entier, inédits ou peu connus en France. Et par le biais du conte, s’amuser, frissonner, s’évader… mais aussi apprendre, approcher de nouvelles cultures, s’émerveiller de la sagesse (ou de la malice !) populaire.
DANS LA MÊME COLLECTION
•
Contes et légendes de France
•
Contes et légendes de la Chine
•
Contes et légendes du Japon
•
Contes et légendes d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche
•
Contes et récits des Mayas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contes et légendes de Flandre
À partir d’un certain âge, les enfants se mettent à importuner leurs parents en leur posant des questions sur le pourquoi des choses et des phénomènes qu’ils découvrent dans leur petit univers. On peut penser que certains contes étiologiques sont le fruit de cette soif de savoir. Les adultes, eux aussi, n’ont de cesse d’interroger les phénomènes de la nature, de sonder l’origine du monde et le sens de l’existence. Cette curiosité innée et jamais rassasiée, on la retrouve à la base de la religion, de la philosophie et de la science.
Jadis, dans toutes les cultures, des personnes inventaient des histoires pour expliquer comment et pourquoi les humains, les animaux et les choses sont ce qu’ils sont. Mythes, légendes étiologiques et contes sont ainsi nés. Expression d’une expérience religieuse ou sacrée et d’une certaine « philosophie » de la vie, les mythes décrivent l’origine du cosmos, celle de la création et de l’humanité du fait d’un dieu Tout-Puissant ou de plusieurs dieux, sous la forme d’histoires faisant la part belle à l’imagination et à la symbolique. Les événements narrés se situent dans une époque mythique hors du temps.
Les légendes profanes et les légendes religieuses font en revanche se rencontrer, dans un passé concret, fiction et faits historiques réels ou imaginaires, des créatures comme les ogres et le diable ou encore des personnes comme les sorcières et les saints. Certaines légendes étiologiques tentent par exemple d’expliquer l’origine de phénomènes naturels insolites, comme la présence de rochers isolés dans un paysage pour le reste plat, ou celle de constructions et d’œuvres d’arts (statues) énigmatiques. Si on a accordé foi à ces légendes – et si certains le font encore –, il en allait autrement des courtes histoires traitant de lieux-dits qui témoignent d’une trop grande naïveté. C’est d’ailleurs en vain qu’on en chercherait dans la présente anthologie.
Celle-ci rassemble simplement les contes étiologiques, contes dans lesquels l’homme a laissé libre cours à son imagination, son ingéniosité et à son talent narratif. Il s’agit en réalité d’un genre spécifique qui prend place entre la légende et le conte de fées. Voilà pourquoi – hormis quelques contes d’animaux – ils sont absents de la plupart des catalogues de contes. À l’image des contes de fées, ces histoires puisent leur origine dans un passé bien vague, et étant donné qu’elles se sont répandues dans différents pays, elles ont subi au fil du temps toutes sortes de modifica-tions. Le lecteur ne sera donc point surpris de retrouver nombre de nos histoires flamandes dans tel ou tel recueil français ou étranger.
Les histoires flamandes que nous présentons ont été consignées au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle ou de la première moitié du XXe. Les recherches menées dans la littérature plus récente n’ont apporté aucune histoire ou version que nous ne connaissions pas, si ce n’est celles reprises dans de nouvelles collections de contes non sans avoir été adaptées au niveau de la langue ou encore en partie réécrites. On en retrouve d’autres dans des éditions récentes et toilettées de vieux livres de contes. Le plus souvent, nous avons opté pour la version la plus ancienne, généralement rédigée dans un patois haut en couleur. Malheureusement, la traduction ne permet guère de restituer cette saveur bien particulière.
Les contes réunis dans ce petit volume illustrent à quel point les hommes étaient proches de la nature et combien les plantes et les animaux leur étaient familiers. Ils connaissaient manifestement dans les moindres détails l’aspect des poissons, des oiseaux et des fleurs, n’éprouvaient guère de difficultés à poser un nom sur les choses et les animaux, le comportement de ces derniers n’ayant d’ailleurs pratiquement aucun secret pour eux. D’autre part, il est évident que ces hommes étaient marqués par la culture chrétienne occidentale, plus particulièrement le catholicisme. Beaucoup d’histoires s’inspirent de la Genèse, certes revisitée sous un angle ludique. Le bon Dieu, mais aussi Jésus et Marie ou tel saint, sont souvent de la partie.
La Flandre a déjà vu la publication d’un recueil similaire en 1912 : les Natuurverklarende sprookjes (Contes étiologiques) de A. De Cock. Il s’agit toutefois d’une compilation de contes de différents pays. Ce livre, dont la grande partie des contes flamands qu’il contient avaient antérieurement paru dans diverses revues ou recueils, nous a néanmoins été très utile pour établir notre sélection. De Vlaamsche vertelselschat (le Trésor des contes flamands, 1925-1933), ouvrage en 4 volumes que l’on doit à V. De Meyere, a constitué une autre de nos sources majeures. Il s’agit de l’une des éditions les plus précieuses dans le domaine. Elle est dotée d’un appareil critique ; les textes qu’elle rassemble avaient été publiés dans la revue Volkskunde (Folklore). Les contes de caractère étiologique figurent pour la plupart dans le quatrième volume. Il est surprenant de constater que bon nombre d’entre eux sont totalement originaux ; aussi est-on parfois autorisé à s’interroger sur leur caractéristique populaire. Du fait de l’unicité de ces versions, V. De Meyere est mieux représenté dans nos pages que tout autre source.
Guidé toutefois par un souci de diversité, nous avons puisé dans l’éventail le plus large de sources issues des cinq provinces flamandes sans nous priver de reprendre une ou deux adaptations littéraires. Les notes qui figurent en fin d’ouvrage renvoient à ces sources. Elles mentionnent par ailleurs les lieux d’où proviennent les différentes variantes. Nous pouvons avancer que ces Contes et légendes de Flandre contiennent la quasi-totalité des types de contes étiologiques de Flandre. Le nombre de mentions relatives à tel ou tel conte suffit à mesurer l’énorme popularité dont jouissait certaines histoires. Pour nous aider dans notre recherche des variantes et types différents, nous avons eu recours aux diverses bibliographies folkloriques et plus encore au catalogue des contes établi par Maurits de Meyer en 1921. Malheureusement, dans l’édition augmentée et mise à jour de son ouvrage (1968), ce même auteur a cru bon de supprimer les contes étiologiques.
Laissons à présent au lecteur le plaisir de découvrir ce que la Flandre recèle comme contes étiologiques et espérons que ce livre fera son chemin non seulement en France, mais aussi en Wallonie et dans toute la Belgique.
Marcel Van den Berg
Terre et ciel
1.Le soleil et la lune
Alors que le monde venait d’être créé, on pouvait voir en permanence le soleil et la lune dans le ciel, de jour comme de nuit. Il en était ainsi, afin que tout fût bien ordonné, les hommes comme les choses. Mais la lune était un peu « coureuse ». Pendant un certain temps, elle fit ce que Dieu attendait d’elle ; mais il advint qu’elle s’échappa, un après-midi, afin de n’en faire qu’à sa guise. Elle ne réapparut pas le soir ni même la nuit qui suivit. Il semble qu’elle ait alors trouvé un gîte plus qu’agréable, car sa première escapade fut bientôt suivie d’une deuxième puis d’une troisième, et il ne se passa guère de temps avant qu’elle ne fût toujours en vadrouille. Aussi Dieu entérina-t-il une nouvelle loi afin de régler les affaires de ce monde. Et il dit :
— Toi, le soleil, tu monteras la garde toute la journée, et toi, la lune, toute la nuit. Et aucun de vous ne devra abandonner son poste une seule seconde. Pour le reste, vous pourrez faire comme bon vous semble, toi, le soleil, durant la nuit, et toi, la lune, durant la journée.
2.Le petit bonhomme sur la lune I
Un père envoya son fils couper des haies pour fabriquer des ruches. Sur le chemin du retour, le garçon ployait tellement sous son fardeau qu’il n’avançait qu’à grand-peine. Le soir arriva. Il faisait un beau clair de lune : c’était la pleine lune. Notre petit gars poussait des soupirs de fatigue ; et à la seule pensée du chemin qu’il devait encore parcourir, il soupira de plus belle. Levant les yeux vers la lune, il s’exclama :
— Comme elle est belle ! Comme j’aimerais être là-haut avec mon fagot !
A peine avait-il prononcé ces mots que, hop ! le voilà qui décollait vers la lune. Une vieille femme s’y trouvait.
— Tu ne rentreras pas chez toi avant de m’avoir fait une belle ruche, dit-elle au garçonnet.
Celui-ci fabriqua une ruche, mais le chien de la vieille femme la réduisit en morceaux ; il en fabriqua une deuxième, mais le chien la déchiqueta pareillement. Alors la femme lui dit :
— Tu vas devoir rester sur la lune aussi longtemps que le monde tournera.
Levez les yeux au ciel lorsque c’est la pleine lune, et vous le verrez en effet là-bas assis à côté de son fagot. Et le jour où le chien laissera le petit garçon finir sa ruche, le monde disparaîtra.
3.Le petit bonhomme sur la lune II
Il était une fois une femme pauvre ; elle avait un fils qui s’appelait Janneken. Un beau jour, elle envoya Janneken dans la forêt pour y ramasser du bois.
Comme le petit vaurien n’avait guère envie de s’aventurer tout seul dans la forêt et qu’il n’avait pas non plus l’intention de s’y attarder, il s’empara à l’insu de sa mère d’une serpette et s’en alla. Au lieu de ramasser du bois sec, il coupa du bois vert, une bonne brassée dont il fit un fagot qu’il jeta sur son dos.
Il n’avait pas fait cinquante pas que le garde forestier l’interpellait :
— Janneken ! Le bois que je vois là, tu l’as coupé !
— Ce n’est pas vrai, rétorqua Janneken, je l’ai trouvé sur place.
— Dis plutôt que tu l’as volé ! reprit le garde forestier, on ne trouve nulle part du bois vert par terre.
— Je vous jure que je l’ai trouvé, fit Janneken.
— Si c’est comme ça, petit menteur, tu vas me suivre chez le châtelain, dit le garde forestier.
— Si je mens, assura Janneken en prêtant serment, que je me retrouve illico sur la lune.
Et voilà ce qui se produisit : Janneken n’avait pas eu le temps de finir sa phrase qu’il se trouva soulevé de terre et transporté sur la lune. Et quand la lune brille, on peut le voir là-haut, avec son fagot sur le dos.
4.Le bonhomme sur la lune III
Un bûcheron, qui n’était guère attaché à Dieu ni à ses commandements, se rendit dans la forêt un dimanche matin pour y couper du bois. Quand il en eut récolté suffisamment et qu’il eut lié son fagot, il reprit la direction de sa maison.
En chemin, il rencontra un vieil homme qui portait une grande barbe blanche. Ce vieil homme, c’était Dieu, le Seigneur en personne.
— Qu’as-tu fait ! fit Dieu au bûcheron. Ne sais-tu pas que le dimanche est le jour du Seigneur et que le troisième commandement t’interdit de travailler ce jour-là ?
— Pour moi, le dimanche n’est pas un jour plus important que le lundi. C’est du pareil au même et je célèbre d’ailleurs le lundi plus volontiers que le dimanche. Ainsi, je travaille le dimanche et me repose le lundi. Et il serait préférable que vous vous mêliez de vos propres affaires…
Alors, Dieu répondit sur un ton qui cingla aux oreilles du bûcheron comme le tonnerre :
— S’il en est ainsi, et si le dimanche n’est pas un jour plus important que le lundi, tous les jours seront dorénavant pour toi des lundis que tu passeras pour l’éternité là-haut sur la lune, où tu resteras à jamais avec ton fagot sur le dos.
Et ainsi en advint-il.
5.La Voie lactée
Un jour, un homme arriva au village. Il venait d’une très lointaine contrée. Aucun villageois ne le connaissait. Alors qu’il séjournait dans le village depuis un certain temps, une meule de foin partit en fumée au beau milieu de la nuit. Puis une autre la nuit suivante… Et toutes les meules de foin et de paille des environs s’envolèrent ainsi en fumée, les unes après les autres. L’étranger, c’était lui l’incendiaire. Personne ne le savait, personne n’aurait osé imaginer une chose pareille, car cet homme était toujours l’un des premiers à intervenir pour combattre le feu.
Mais à quoi cela sert-il de donner un coup de main quand une meule est en flammes ? Un jour, la vérité éclata. Ce soir-là, la dernière meule du village était en flammes. Une nouvelle fois, l’homme se trouvait sur place avec son seau d’eau. C’est alors qu’une grande main enflammée surgit du ciel, s’empara de l’incendiaire et le projeta dans la fournaise. Tous les villageois assistaient à la scène.
Depuis ce jour, par temps clair, on voit régulièrement une lueur apparaître dans le ciel en souvenir de ce méchant homme qui commit tant de méfaits.
6.Les larmes de saint Laurent
Si jamais vous voyez le soir de la Saint-Laurent, le 10 août, des étoiles filantes traverser le ciel, surtout n’allez pas imaginer qu’il s’agit d’étoiles filantes, comme on peut en voir à d’autres moments, et évitez de faire un vœu. Il s’agit des larmes de saint Laurent qui tombent du ciel, car c’est lors d’un 10 août que saint Laurent a été rôti par les Juifs.
7.Pourquoi le soleil brille toujours le samedi
Le soleil brille toujours le samedi, qu’il vente ou qu’il pleuve ! S’il ne brille parfois que l’espace de quelques secondes, il brille juste le temps dont la Sainte Vierge a besoin pour passer une chemise propre.
8.L’origine des montagnes I
En ce temps-là, le monde était uniquement peuplé de géants. Et ces géants étaient divisés en deux clans qui se déclarèrent un jour la guerre. Cette guerre se prolongea jusqu’à ce que les deux parties fussent pratiquement entièrement décimées. Quelques géants survécurent çà et là ; ils se retranchèrent dans des châteaux forts. L’ultime bataille put alors commencer. D’un château à l’autre, les géants s’envoyaient d’énormes rochers. Ces rochers s’amoncelèrent jusqu’à former de hautes montagnes.
9.L’origine des montagnes II
Dieu, pour rendre le monde fertile, jeta des poignées et des poignées de terre partout où il ne voulait pas que la mer soit. Quand Dieu eut terminé, le diable arriva ; il répartit en plusieurs endroits le tas de terre qui restait. C’est ainsi qu’apparurent des montagnes qui s’élèvent jusqu’aux nuages et qui séparent les contrées fertiles les unes des autres.
10.L’origine du Kluisberg (mont de l’Enclus)
J’ai souvent entendu feu mon oncle paternel raconter — et il n’était pas le seul à le faire — qu’un paysan de la région travaillait avec un âne aveugle. Une fois, l’âne traça un sillon et, alors qu’il devait se retourner, il ne put avancer, tant la terre pesait sur le socle de la charrue. C’est alors que le paysan projeta au loin la charrue ; et ainsi apparut le mont de l’Enclus.
Et si le lit de l’Escaut est aussi oblique, c’est pour la même raison.
11.L’origine des mers et des fleuves
Quand Dieu créa la Terre, le diable ne resta pas à ne rien faire. Le hasard voulut que ce dernier tienne dans ses mains le globe terrestre fraîchement pétri avant même que Dieu ne le mette à sécher. Et que pensez-vous que le diable fit ? Il mit ses mains çà et là dans la terre meuble, tandis que le globe ne cessait de tourner. Et aux endroits où il ne pouvait creuser des abîmes avec ses paluches, il y gratta des fossés.
Ces abîmes sont devenus des mers, ces fossés des fleuves et des rivières. Oui, le diable souhaitait voir la Terre recouverte de mers afin de rendre toute vie impossible. Mais il n’est pas parvenu à ses fins.
12.L’origine du sel de mer
Il était une fois deux frères qui s’appelaient Jan et Klaai. L’un était riche, l’autre pauvre, et ils vivaient dans des endroits relativement éloignés l’un de l’autre.
On allait sur le Nouvel An et Jan, le pauvre, se mit en route pour rendre visite à son frère et lui quémander une libéralité ; pourquoi, se disait-il, ne pourrais-je pas manger autre chose que la tranche de pain sec dont je suis obligé de faire mon quotidien ? Klaai était un gars borné et obtus, assez avare par-dessus le marché pour rogner sur le moindre centime. Toutefois, puisque Jan était son frère, il eut pitié et alla prendre à la cave un jambon dont il lui fit cadeau.
— Je vous suis reconnaissant de cette marque d’affection, lui dit Jan, qui, heureux comme un pape, quitta la demeure de son riche frère.
Il fallait à présent à notre Jan traverser une forêt pour s’en retourner chez lui ; alors qu’il se trouvait au cœur de la forêt, il rencontra un bûcheron aux cheveux blancs et à la longue barbe blanche, qui était en train de fendre du bois.
— Bonsoir !
— Bonsoir ! répondit le vieillard. Que vous avez là un beau jambon !
— Pour sûr, fit Jan, et il raconta comment il avait obtenu une aussi belle cuisse de cochon.
— Estimez-vous heureux d’être passé par ici, lui dit le bûcheron, car si vous allez au pays des lutins avec votre jambon, vous en obtiendrez un bel avantage en contrepartie ; pour tout vous dire, les lutins sont des amateurs de jambon et ils n’élèvent pas de porcs là où ils habitent.
— Et pourquoi ne m’y rendrais-je pas ? songea Jan, si jamais ça peut me rapporter une somme rondelette. Mais dites-moi, l’ami, quel chemin dois-je prendre pour aller dans ce pays ?
— Vous voyez cette porte, là, sous les racines de ce chêne centenaire ?… Eh bien, c’est l’entrée de ce pays souterrain. Surtout, renoncez à demander de l’argent en échange de votre jambon. Réclamez plutôt le vieux moulin à légumes qui se trouve derrière la porte ; et quand vous reviendrez, je vous expliquerai son fonctionnement.
Jan se rendit dans la direction indiquée. Toc-toc-toc fit la porte, et on le laissa entrer. A peine était-il à l’intérieur avec son jambon que les lutins, dont les narines étaient caressées par l’odeur de la viande, accoururent de tous côtés, et ce fut un essaim de trente, de cent lutins qui tournoya bientôt autour de lui, tous convoitant du regard son jambon.
— Voulez-vous vendre votre jambon, mon brave ? demanda un lutin gros et gras qui portait une grande et longue barbe, ainsi qu’une petite bosse sur le dos, et qui faisait figure de chef dans ce pays : voulez-vous nous le céder, nous vous en donnerons deux pots d’or ou quatre d’argent !
— Je n’ai que faire de votre argent, mon gros monsieur, mais j’échangerais bien en revanche mon jambon contre ce vieux moulin à légumes qui se trouve derrière la porte. Le gros petit bonhomme refusa car les lutins étaient les seuls à posséder un tel moulin.
— Monseigneur, glissa un lutin bien plus maigre à l’oreille du chef, donnez-le lui : ce moulin est vétuste, et cet homme ignore de toute façon comment on doit s’en servir ! Et nous, nous gagnons ce beau jambon.
La vente fut conclue ; le pauvre Jan emporta le moulin qui ne faisait que la moitié du poids du jambon, et s’en retourna dans la forêt. Il y trouva le bûcheron qui avait repris sa tâche.
— Voici le moulin, s’écria Jan, fier comme un pape, en montrant l’objet au vieil homme qui lui expliqua sur-le-champ comment l’utiliser. Jan chargea l’ustensile sur son épaule ; bravant tous les dangers, il retrouva sa moitié dans leur maison alors qu’il était près de minuit.
— Mais qu’as-tu fabriqué pendant tout ce temps ? lui demanda sa femme, ça fait des heures et des heures que je t’attends, et nous n’avons pas même du bois pour faire du feu, et rien non plus à mettre dans la marmite ce soir. Je grelotte de froid et je crève de faim.
— C’est vrai, femme, répondit Jan en souriant, il fait froid et sombre ici, sans compter qu’il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ; mais attends une seconde et je vais faire des miracles !
Il posa le petit moulin sur la table et le fit tourner. Le bûcheron avait dit à Jan de faire un vœu en fonction de ce qu’il désirait. Il forma des vœux tout en continuant de mouliner.
Il en sortit d’abord des bougies allumées, puis du feu pour l’âtre, puis un bol de soupe. Moulinant toujours, Jan fit apparaître une nappe, des assiettes blanches, des fourchettes, des cuillers et des couteaux ; du pain, du beurre et ensuite de la viande. La femme observait tout cela d’un air ébahi et tous deux étaient transportés de bonheur. Ils mangèrent et ils burent tout leur soûl, puis se remirent à mouliner, tant et si bien qu’au petit matin, on ne reconnaissait plus leur chaumière : elle était richement tapissée de tentures et équipée de précieux ustensiles. Quand Jan se rendit le dimanche à la messe avec sa femme, les gens n’en revenaient pas de voir les beaux vêtements qu’ils portaient.
— Ça cache quelque chose de bizarre, disait tout le monde.
— Je n’en crois pas mes yeux, s’exclama le riche Klaai un jour qu’il était invité à prendre part à un grand festin chez son frère. La nappe était blanche comme neige, les plats et couverts d’or et d’argent.
Non, Klaai ne pouvait plus en imposer à Jan avec son luxe et ses fastes ; il le sentait bien et conçut de la jalousie en voyant son frère si heureux. Il essaya même de s’approprier sournoisement le moulin, mais sans y parvenir. Jan se refusait à le prêter car le vieux bûcheron lui avait dit : « Ne vendez jamais le moulin et ne le prêtez à personne, c’est compris ? »
Des années s’écoulèrent ainsi dans le bonheur et le luxe. Jan construisit un immense château au bord de la mer, dont les tours majestueuses servaient de phares aux marins ; une armée de voyageurs vint admirer ce magnifique édifice ainsi que le moulin magique.
Un marchand étranger, qui avait entendu parler de ce moulin miraculeux qui faisait apparaître tout ce que Jan demandait, rendit un beau jour visite au châtelain et lui offrit une fortune contre son appareil. Il entendait l’utiliser pour moudre du sel, disait-il ! D’ailleurs, il faisait le commerce de sel et entreprenait de longs voyages sur les mers pour se procurer sa marchandise. Le moulin devait lui permettre d’accumuler d’énormes richesses en peu de temps.
Notre Jan était riche, formidablement riche, et il n’avait que faire de l’argent. Il n’utilisait plus son moulin qu’une fois l’an, à l’approche de l’hiver, pour en obtenir de la nourriture, des vêtements et du charbon pour les pauvres. Mais il refusait toujours de céder son moulin tandis que le marchand voulait l’obtenir coûte que coûte. C’est pourquoi il soudoya un des valets du châtelain pour s’emparer la nuit venue du moulin ; puis il s’embarqua sur un bateau et s’enfuit très loin.
A peine le marchand avait-il couvert quelques miles qu’il éprouva le besoin d’essayer le moulin.
— Petit moulin, veux-tu moudre du sel ! cria-t-il, mouds du sel, autant qu’il t’est possible ; du sel, encore du sel, toujours du sel !
Le moulin se mit en marche et il en sortit des tas de sel ; l’équipage en remplit des sacs jusqu’à ras bord. Et le moulin continuait de moudre, de moudre à une cadence telle qu’il émettait comme un sifflement.
— Moulin, arrête-toi ! cria le marchand.
Oui, mais voilà, ce moulin farouche ne comprenait pas le langage de l’étranger, et il continua de moudre et de moudre sans s’arrêter si bien que le bateau fut à son tour rempli de sel. Le marchand avait beau crier : « Stop ! », le moulin moulait du sel, encore du sel et toujours du sel ; et comme il ne voulait plus s’arrêter, le bateau finit par rompre sous le poids et coula corps et bien en pleine mer.
Et le moulin ?… Le moulin se trouve toujours au fond de la mer et il continue de moudre du sel, encore du sel, toujours du sel ! C’est ainsi, cher lecteur, que la mer devint salée et qu’elle l’est toujours. Pour ce qui est de l’endroit où se trouve cet extraordinaire moulin, la baguette de sourcier est impuissante à nous l’indiquer ; nous attendrons pour aller le chercher que la mer s’assèche.
13.L’origine du charbon
Notre-Seigneur Jésus-Christ et saint Pierre faisaient une promenade. En chemin, comme Jésus avait perdu la pointe de son bâton, ils se rendirent chez un forgeron pour en faire poser une autre.
Ce forgeron, homme extrêmement pauvre, se plaignait, tout en battant le fer, de l’excessive cherté du bois.
— C’est vrai, reconnut Jésus, une fois le travail terminé, le bois coûte les yeux de la tête. Ami, je n’ai pas d’argent pour vous payer, mais prenez votre bêche et suivez-nous, je vous procurerai quelque chose qui vous sera d’une bien plus grande valeur que quelque argent.
Ils s’en allèrent et atteignirent une haute montagne.
— Creusez ici la terre de quelques pieds de profondeur, dit Jésus à l’homme.
Le forgeron fit ce qu’on lui disait de faire et il mit à jour des morceaux de pierre noire.
— Mettez ces morceaux sur votre feu, poursuivit Jésus, ils brûleront mieux que le bois et donneront plus de chaleur.
Et effectivement ! les choses se passèrent ainsi. Peu après, tout le monde était au courant ; les autres gens allèrent eux aussi y chercher du combustible, creusant toujours plus profond ; peu à peu apparurent les puits dont nous tirons aujourd’hui encore du charbon pour nous chauffer.
14.L’origine du tonnerre et des éclairs
Lorsque Jésus était encore un petit garçon, il montrait une force et une intelligence singulières dans toutes les circonstances, ceci malgré une constitution frêle et fragile. Qui plus est, pas paresseux pour un sou, il faisait preuve d’un beau courage à gagner honnêtement son pain.
La première fois qu’il dut se mettre au service de quelqu’un, il se rendit chez un forgeron à qui il demanda d’être pris comme apprenti. Le forgeron, une armoire à glace, se mit à sourire en voyant ce petit gars frêle.
— Je n’ai jamais vu un gamin aussi fluet que toi, lui dit l’homme.
— C’est bien possible, répondit Notre-Seigneur Jésus, et il est bien certain qu’il y en a de plus costauds que moi. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et l’habit ne fait pas le moine. Vous n’êtes pas obligé de me croire, mais pour ce qui est du travail, je sais me défendre. De plus, vous n’avez pas à me donner un salaire élevé : je veux simplement vous servir pendant un an en échange du couvert et dans la mesure où, à l’issue de cette période, vous me laisserez fabriquer un petit marteau et quatre petites boules, suffisamment légers pour que je puisse les emporter.
« Je n’ai pas grand-chose à perdre en concluant un tel accord », pensa le forgeron et, tendant la main à Jésus, il dit :
— C’est bon, tu es l’homme qu’il me faut !
Et Jésus entra à son service, travaillant avec l’application du meilleur des apprentis, et apprenant à son patron mille choses qu’il ne savait pas. Mais quand l’année fut écoulée et que Jésus, conformément à l’accord passé, forgea son marteau et ses quatre petites boules, il les fit d’une taille si colossale et employa une telle quantité de fer, qu’il vida entièrement la forge ! Il ne laissa pas traîner une seule tige de métal d’une taille supérieure à celle d’une tête d’épingle. Lorsque son patron vit la chose, il entra dans une humeur massacrante.
— Qu’est-ce que c’est que ce travail !… Hors de ma vue ! rugit-il. Et Notre-Seigneur Jésus, qui ne se le fit pas répéter deux fois, s’en alla de bonne humeur, portant son marteau et ses quatre boules de fer comme s’ils avaient été en papier mâché.
Son deuxième voyage l’amena chez un charron à qui il proposa ses services.