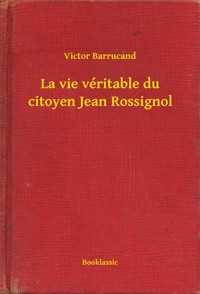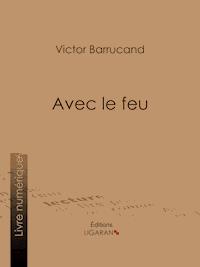1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
J’avais quitté Aïn-Sefra l’an dernier aux souffles de l’hiver. Elle était transie de froid, et de grands vents glapissants la balayaient, courbant la nudité frêle des arbres. Je la revois aujourd’hui tout autre, redevenue elle-même, dans le rayonnement morne de l’été : très saharienne, très somnolente, avec son ksar fauve au pied de la dune en or, avec ses koubba saintes et ses jardins bleuâtres.
C’est bien la petite capitale de l’Oranie désertique, esseulée dans sa vallée de sable, entre l’immensité monotone des Hauts-Plateaux et la fournaise du Sud.
Elle m’avait semblé morose, sans charme, parce que la magie du soleil ne l’enveloppait pas de l’atmosphère lumineuse qui est tout le luxe des villes d’Afrique. Et maintenant que j’y vis en un petit logis provisoire, je commence à l’aimer. D’ailleurs, je ne la quitterai plus pour un maussade retour vers le Tell banalisé, et cela suffit pour que je la regarde avec d’autres yeux. Quand je partirai, ce ne sera que pour descendre plus loin, pour m’en aller là-bas, vers le grand Sud, où dorment les « hamada » sous l’éternel soleil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Isabelle EBERHARDT & Victor BARRUCAND
DANS L’OMBRE CHAUDE DE L’ISLAM
1921© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383839620
DANS L’OMBRE CHAUDE DE L’ISLAM
ÉLOIGNEMENT
Aïn-Sefra, mai 1904.
J’avais quitté Aïn-Sefra l’an dernier aux souffles de l’hiver. Elle était transie de froid, et de grands vents glapissants la balayaient, courbant la nudité frêle des arbres. Je la revois aujourd’hui tout autre, redevenue elle-même, dans le rayonnement morne de l’été : très saharienne, très somnolente, avec son ksar fauve au pied de la dune en or, avec ses koubba saintes et ses jardins bleuâtres.
C’est bien la petite capitale de l’Oranie désertique, esseulée dans sa vallée de sable, entre l’immensité monotone des Hauts-Plateaux et la fournaise du Sud.
Elle m’avait semblé morose, sans charme, parce que la magie du soleil ne l’enveloppait pas de l’atmosphère lumineuse qui est tout le luxe des villes d’Afrique. Et maintenant que j’y vis en un petit logis provisoire, je commence à l’aimer. D’ailleurs, je ne la quitterai plus pour un maussade retour vers le Tell banalisé, et cela suffit pour que je la regarde avec d’autres yeux. Quand je partirai, ce ne sera que pour descendre plus loin, pour m’en aller là-bas, vers le grand Sud, où dorment les « hamada » sous l’éternel soleil.
Parmi les peupliers à troncs blancs, en longs sentiers, suivant les premières ondulations de la dune, avec des parfums retrouvés de sève et de résine, j’ai l’illusion de me perdre en forêt. C’est une sensation très douce et très pure que teinte par moments de sensualité l’haleine plus lointaine d’un bouquet d’acacias en fleurs. — Que j’aime la verdure exubérante et les troncs vivants, plissés d’une peau d’éléphant, de ces figuiers gonflés de lait amer, autour desquels bourdonnent des essaims de mouches dorées !
Dans ce jardin surpris en pleine aridité j’ai passé des heures longues, couchée à la renverse, me grisant d’immobilité sous la caresse tiède des brises, à regarder les branches, à peine agitées, aller et venir sur le fond éblouissant du ciel, comme les agrès d’un navire balancé doucement.
Au delà des derniers peupliers, déjà plus grêles et plus rabougris, la piste de sable monte et finit brusquement au pied de la dune immaculée, qui semble en poudre d’or fin.
Là, les vents du ciel se jouent librement, édifiant des collines, creusant des vallées, ouvrant des précipices, créant, au caprice de chaque jour, de nouveaux paysages éphémères.
Tout en haut, hasardeusement posé sur un coteau un peu plus stable, avec ses arêtes de pierres noires, un « blockhaus » rougeâtre veille sur la vallée, sentinelle aux yeux vides, qui a vu passer des armées et des bandes pillardes, et qui regarde maintenant le silence et la paix des horizons vagues.
La dune d’un rouge doré ardent tranche violemment sur le fond bleu et sévère du Djebel Mektar. Le jour finit doucement sur Aïn-Sefra, noyée de vapeurs légères et de fumées odorantes. J’éprouve la sensation de mélancolie délicieuse et d’étrange rajeunissement des veilles de départ. Tous les soucis, le lourd malaise des derniers mois dans la fastidieuse et énervante Alger, tout ce qui constituait mon noir, mon « cafard », est resté là-bas.
A Alger, j’avais dû mépriser des choses et des gens. Je n’aime pas à mépriser. Je voudrais tout comprendre et tout excuser. Pourquoi faut-il se défendre contre la sottise, quand on n’a rien à lui disputer, quand on n’est pas de la partie ! Je ne sais plus. — Ces choses ne m’intéressent pas : le soleil me reste et la route me tente. Ce serait pour un peu toute une philosophie.
Plus près de moi, j’avais eu l’occasion de voir grandir, dans une âme que je croyais plus affranchie, une passion pure et forte, et je disais à mon ami : « Prenez garde, quand on est heureux on ne comprend plus rien aux souffrances des autres… »
Il partit vers le bonheur, du moins le croyait-il, et moi vers ma destinée.
Maintenant je me suis éloignée, et je sens mon âme redevenir plus saine, naïvement ouverte à toutes les joies, à toutes les sensualités délicates des yeux et du rêve.
Je retrouve dans la seule rue arabe du village des impressions calmes de « chez moi », qui datent du mois de ramadhân, l’an passé.
Beaucoup de visages connus, sur les bancs et sur les nattes, devant les cahouadji. Beaucoup de saluts à échanger amicalement.
Et, avec cela, la joie intime de penser que je vais partir demain, dès l’aube, et quitter toutes ces choses, qui pourtant me plaisent ce soir et me sont douces.
Mais qui donc, sauf un nomade, un vagabond, pourrait comprendre cette double jouissance ?
Le cœur encore ému de tout ce qui m’avait prise et que j’ai laissé, je me dis que l’amour est une inquiétude et qu’il faut aimer à quitter, puisque les êtres et les choses n’ont de beauté que passagère.
Contre les barreaux en fer de la fenêtre d’un café maure, devant les pots de basilic, un rassemblement se forme peu à peu.
On y joue du chalumeau et j’entre : cette musique monotone et triste bercera ma rêverie et surtout me dispensera de parler…
MUSICIENS DE L’OUEST
Une salle carrée, peinte en bleu pâle, avec des panneaux roses. A droite, au fond, « l’oudjak »[1] en plâtre enfumé et, sur des rayons de bois, les tasses, les verres et les plateaux. Des bancs en bois et de banales tables en fer rouillé encombrent le café. Dans une cage un oiseau captif sommeille.
[1]Oudjak, fourneau des cafetiers maures, en forme de petit portail voûté.
Étrange petit café saharien, que fréquentent les Marocains et les nomades ! L’assistance y est compacte. Parmi les Arabes, en burnous et haïks terreux, quelques spahis et des « mokhazni », cavaliers indigènes.
Les coudes aux genoux, tous se taisent, tournés attentivement vers le fond de la salle, où, sur un banc, les musiciens sont alignés.
Ceux-là sont des Beni-Guil du Chott Tigri.
Avec leurs loques rougeâtres et leurs sandales, ils ressemblent bien peu aux chanteurs et aux musiciens des Hauts-Plateaux algériens, qui portent, comme les lettrés, des vêtements propres, et, avec des essais de coquetterie arabe, des gilets brodés et des cordons de soie dans les cordelettes du turban. Ces musiciens de l’Ouest conservent le type de leur race fruste, et leur collier de barbe noire et raide donne à leur visage un faux air hindou.
Pourtant, chez l’un deux, le voile épais qui recouvre le turban blanc et évasé, encadre une belle figure régulière, au nez aquilin et aux narines nerveuses, avec des yeux de tristesse. L’autre, joueur de flûte, est aveugle. Il met toute son âme dans les plaintes et les susurrements de son roseau. Comme s’il y parlait, il roule les globes ternes de ses yeux morts, et son buste, avec un balancement cadencé, marque la mesure. La troupe compte encore un vieux batteur de tympanon et, un peu à l’écart, un étrange chanteur, les yeux fermés, la tête renversée, comme ivre.
Le seul luxe de ces miséreux consiste en deux chalumeaux cerclés de cuir et d’anneaux de cuivre poli, avec des tresses de soie bleue entremêlées de chaînettes d’argent et de pièces de monnaie marocaine.
Symphonie de la hamada inhospitalière !
Le tambourin prolonge à l’infini son battement sourd, à contretemps, son battement de cœur humain tour à tour ému et courroucé, faiblissant, lassé et mourant voluptueusement. Brodant sur cette vie artérielle, les durs chalumeaux sonnent parfois des marches de guerre ou tiennent de longues notes mystérieuses qui ont l’air de planer, et les roseaux nasillent des murmures à peine distincts d’eau tranquille ou de brise tiède.
Les Beni-Guil qui circulent dans le village envahissent la salle, gauches, encombrants, gens du désert que les bancs et les tables étonnent.
Pourtant, ils sourient, ils sont fiers du succès de leurs frères parmi les « M’zanat »[2].
[2] Terme de mépris par lequel les Marocains du Sud désignent les Algériens indigènes, qu’ils considèrent comme des renégats.
Sur un plateau posé à terre, les gros sous et les pièces blanches tombent avec un bruit clair. A chaque offrande, le joueur de tambourin bénit à la cantonade la générosité du donateur.
Cependant les Beni-Guil se contentent d’encourager les musiciens par leur attitude et leurs exclamations approbatives. Bien rare celui qui se résigne à jeter un sou sur le plateau, après avoir longtemps fouillé dans sa « zaboula », sorte de sacoche en « filali » (cuir rouge du Tafilalet) que portent les nomades.
Mais voilà que l’un d’eux, tout jeune, se lève tout à coup et esquisse une danse cadencée, lente, le bout de son bâton noueux appuyé contre sa poitrine.
On rit de sa rusticité. Ce geste est celui d’un berger.
Le cafetier, les reins ceints d’une « fouta » rouge et verte, circule, présente ses breuvages fumants sur des plateaux et, chaque fois, il nomme tout haut celui qui a commandé le thé, en appelant sur lui la bénédiction du Rétributeur…
MORT MUSULMANE
Le premier soleil du matin s’épanouit à l’horizon, comme une grande fleur pourpre. La dune de sable, piquée de touffes d’alfa, s’embrase autour de la petite koubba de Sidi-Bou-Djemâa, qui domine la route de Beni-Yaho et de Sfissifa. Des lueurs roses s’allument à la crête des figuiers noirs, et les grands saules pleurent des larmes d’argent irisé.
Autour de la koubba, des Arabes se lèvent. Ce sont des pèlerins, venus de loin pour demander la protection du grand saint. Ils se rangent tous, face au jour levant, et prient longuement, avec les beaux gestes graves du rite musulman qui grandit les plus loqueteux.
Derrière le petit mur d’enceinte, les femmes babillent déjà autour d’un feu de bois mort. Ce sont des nomades, venues avec les hommes de leur tribu. Elles se voilent à peine le visage.
Sous un arbre, un fou en haillons, appuyé sur un bâton, psalmodie le Coran, au hasard, mêlant des versets sans suite. Il est beau avec son visage émacié, ses cheveux noirs, attachés autour du front d’un lambeau de linge blanc, et ses grands yeux ardents et inquiets, fixés sur un point invisible de l’espace.
De temps en temps, du groupe des femmes part le « you-you » cristallin des jours de fête.
Mais, au haut de la dune un cortège paraît. Des Arabes s’avancent lentement, sur un chant grave et cadencé.
Derrière le premier groupe, quatre hommes portent sur leurs épaules un brancard recouvert d’un long drap blanc, et, à l’apparition de ce croyant inconnu, qui s’en vient vers l’éternité, dans la gloire du matin, tous les bruits se taisent.
Alors les hommes entrent dans le cimetière sans clôture.
Parmi les tombes essaimées dans la dune, parmi ces pierres anonymes et sans dates, une fosse est creusée, rapidement, si rapidement dans le sable léger ! Et sur le bord de ce petit fossé on pose le mort, face au soleil.
Maintenant, en demi-cercle, les musulmans prient leur dernière prière, à voix basse, sans se prosterner.
Très vite, sur une simple rangée de briques, on remblaie la fosse, et on plante trois palmes vertes dans le sable du tertre que la brise fraîche entame déjà. Tout le monde s’en va.
Que c’est simple de mourir !
A côté de moi, Si Abdelali, un lettré de Marrakech, se met à chanter à mi-voix une complainte ancienne sur le sort de ceux qui ne sont plus.
Voici : je suis mort, mon âme a quitté mon corps
On a pleuré sur moi les larmes du dernier jour.
Quatre hommes m’ont pris sur leurs épaules,
En attestant leur foi au Dieu unique.
Ils m’ont porté jusqu’au cimetière,
Ils ont prié sur moi la prière sans prosternation,
La dernière des prières de ce monde.
Ils ont rejeté sur moi la terre.
Mes amis sont partis comme s’ils ne m’avaient jamais connu,
Et je suis resté seul dans les ténèbres de la tombe,
Où il n’y a ni joie, ni chagrins, ni lune, ni soleil.
Je n’ai plus eu d’autre compagnon que le ver aveugle.
Les larmes ont séché sur les joues de mes proches,
Et les épines sèches ont poussé sur ma terre.
Mon fils a dit : « Dieu lui accorde sa miséricorde ! »
Sachez que celui qui est parti vers la miséricorde de son Créateur
Est en même temps sorti du cœur des créatures.
Sachez que nul n’a souci des absents dans la demeure des morts.
O toi qui es devant ma tombe,
Ne t’étonne pas de mon sort
Il fut un temps où j’étais comme toi,
Viendra le temps où tu seras comme moi.
L’air de cette complainte est mélancolique et doux, la voix du taleb harmonieuse… Et je regarde le petit tertre abandonné là, pour toujours, dans le vide du désert de sable.
… Nous allions à Sfissifa, un petit bourg tout musulman, sans un seul Européen, sans même un juif.
Encore les rochers sombres du Sud-Oranais, et, dans l’intérieur du ksar, une vie délabrée, des murs de pisé qui s’écroulent, des faces de momies qui se voilent. Tout tombe en ruines, mais nous goûtons un sommeil très doux sous un large grenadier, dans l’éblouissement du soleil déjà haut…
Là je vous retrouvai, si curieusement, ksouriens malingres, au teint blafard et aux attitudes humbles, aux vêtements efféminés, race dégénérée par la vie sédentaire entassée et par la consanguinité séculaire des mariages ! Je vous revis, ksour tombant en ruines, à l’ombre des jardins délicieux que le désert envahit peu à peu et dévore. Et je pensai qu’il est aussi des peuples qui ont l’air de mourir.
Au retour, le soleil venait de disparaître, mais une grande clarté rouge baignait encore la vallée.
Nous repassons devant Sidi-Bou-Djemâa.
Un silence profond, un silence qu’on sent, presque une angoisse, pèse sur la koubba et sur le cimetière, où, parmi les petites pierres anonymes s’élèvent quelques tombeaux maraboutiques, rectangles frustes de terre sèche.
La porte est close, et devant s’est assis un vieux mendiant, son bâton posé contre le mur. Doucement, dans l’ombre de sa cécité, il marmonne des mots sans accent, comme s’il se racontait des choses à soi-même.
Sur la hauteur, deux mokhazni en burnous noirs sont descendus de cheval et prient, tout seuls, dans le dernier rayonnement du jour.
Un chien enchaîné tend vers le ciel son museau de loup aux petits yeux sanglants et obliques, et pousse un long aboiement, une sorte de lamentation d’une tristesse infinie.
EN ROUTE
Après une courte nuit lunaire passée sur une natte, devant le café maure du « Makhzen », au ksar de Beni-Ounif, je m’éveille heureuse, avec cette griserie légère qui me prend quand j’ai dormi dehors, sous le grand ciel, et quand je vais me remettre en route.
Assise sur une pierre, au bord de la route, j’attends Djilali ould Bahti, le mokhazni qui m’accompagnera sur la route de Béchar.
Aller à Béchar ! Dépasser enfin cette limite fatidique de Beni-Ounif, cela suffit pour que je me sente calme et joyeuse, pour que l’ennui qui commençait à m’envahir à Aïn-Sefra achève de se dissiper…
Le temps passe, et ce Djilali tarde à venir.
Le jour se lève, un jour splendide d’été, sans un nuage, sans une brume. Une brise fraîche, qui souffle depuis hier soir, a chassé toutes les poussières, toutes les vapeurs. Le ciel s’ouvre, infini, profond, d’une transparence verte d’océan tranquille.
A l’horizon, dans tout ce vert doré, une lueur plus jaune et plus ardente monte, passant bientôt à l’orangé vif, puis au rouge. En face, dans l’occident obscur, la lune descend, livide, comme le visage d’un mourant.
Tout près de nous, la grande koubba blanche de Sidi Slimane se profile en or, sur le cuivre encore vert du ciel. Des rayons orangés baignent le sol sombre, les tombeaux et les maisons lézardées.
Enfin Djilali arrive, et nous partons, tournant nos chevaux vers la lune qui s’éteint.
Ce mokhazni est un grand garçon brun, bonne et franche figure de nomade Tarfaoui[3] de Géryville. Il est avenant et « dégourdi », et sera pour moi un bon compagnon de route.
[3] De la tribu des Trafi.
… Nous cheminons dans la vallée de pierre noire, entre le Djebel Grouz, encore tout irisé, et les basses collines brûlées du Gara.
Vers la droite passe la jolie petite palmeraie de Mélias, assoupie avec ses « séguia » et ses bassins limpides, à l’entrée d’une gorge profonde du Grouz.
L’an dernier, les bandes de pillards pourchassées venaient s’abreuver là, dans ces jardins déserts, si paisibles et si souriants aujourd’hui.
A mesure que nous nous éloignons de la stérilité de Beni-Ounif, l’alfa apparaît sur le sol sablonneux. Des oueds se creusent, remplis d’arbustes de plus en plus touffus. Quelques grands lentisques, — l’arbre providentiel des solitudes ardentes — y promènent leur ombre circulaire sur le sol rouge, au cours des heures vides.
… Un nuage de poussière vient sur nous de l’Ouest, à l’encontre du vent.
C’est une compagnie de la Légion, des hommes blonds et fortement bronzés, couverts de poussière, qui rentrent du Sud en chantant des romances allemandes ou italiennes.
Sur les araba du train chargés de bagages, les malades sont couchés.
Juchés très haut, ils regardent la monotonie du paysage avec l’indifférence morne des fiévreux, en supputant en silence l’heure probable de l’arrivée à Beni-Ounif, d’où, demain, on les transportera, par chemin de fer, à l’hôpital d’Aïn-Sefra.
… Une heure se passe. Nous rejoignons encore un petit convoi d’araba, escorté de tirailleurs.
Les hommes se sont débarrassés de leurs sacs et de leurs fusils, qu’ils ont chargés sur les carrioles ; ils marchent tout doucement, au petit pas des mulets, avec l’air de gens qui se promènent.
Ils passent. Nous retombons au silence de la route.
De temps en temps, Djilali commence une complainte, qu’il n’achève pas.
Il y a un peu de brise, nous tournons le dos au soleil, la chaleur n’est pas accablante. Nous sommes bien, sans envie de parler.
Il est ainsi, sur les routes désertes du Sud, de longues heures sans tristesse, sans ennui, vagues et reposantes, où l’on peut vivre de silence… Je n’ai jamais regretté une seule de ces heures perdues.
LE DRAME DES HEURES
Voyager, ce n’est pas penser, mais voir se succéder des choses, avoir le sens de sa vie dans la mesure de l’espace. La monotonie des paysages, qui se déploient lentement, contribue à nous délasser des plis pris sur nous-mêmes, à nous pénétrer d’un sentiment de légèreté et de quiétude, que les déplacements à la vapeur ne sauraient apporter au voyageur fiévreux. Au pas calmé des chevaux que la chaleur accable, les moindres accidents de la route conservent à mes yeux leur beauté de tableaux. Ce ne sont pas des situations agitées, c’est un état d’esprit calme et vital, qui fut celui de toutes les races humaines et qui s’éternise encore près de nous dans le sang des nomades.
A Alger, en voyant tous les Européens se porter, aux mêmes heures, du même côté des arcades, pour se donner l’illusion d’être une foule, ou tourner en rond autour de la musique du square, j’éprouvais une déprimante impression de troupeau, qui s’est dissipée ici. Je sens qu’il vaut mieux pousser des moutons que de faire corps avec une foule, et je ne mets certainement aucun orgueil, aucun romantisme dans cette constatation.
Je vis cette vie du désert aussi simplement que les sokhar, conducteurs de chameaux, et les mokhazni.
J’ai toujours été simple. Dans cette simplicité j’ai trouvé des jouissances fortes, que je ne me flatte pas d’exprimer.
Quand j’ai dormi à la belle étoile, sous ces ciels du Sud-Oranais qui sont d’une profondeur religieuse, je me sens pénétrée des énergies de la terre, une sorte de brutalité est en moi avec le besoin d’enfourcher ma jument et de pousser tout droit devant, sans faire aucune réflexion. Je ne veux rien imaginer ; je vois les étapes de la route et je les compte à des détails insignifiants. Dans ce pays sans verdure, dans ce pays de pierre, quelque chose existe : les heures. Les aurores et les crépuscules sont des drames.
Le Bédouin au haïk terreux comprend cela et ne le dit pas, mais il chante… Djilali ne m’a jamais expliqué pourquoi il n’achevait pas ses chansons.
HALTE AU DÉSERT
L’an dernier, pour aller à Béchar, on passait vers l’est, derrière les montagnes, par le petit poste de Bou-Yala, qu’on a abandonné depuis pour reporter plus à l’ouest la ligne de protection de la frontière. C’est maintenant Bou-Ayech qui est la première étape après Beni-Ounif, à trente-cinq kilomètres.
… Il est dix heures et la vallée s’embrase. Des vapeurs rousses tremblent à l’horizon qui se déforme. La chaleur devient brûlante. Un mince filet de sang coule des narines desséchées de nos juments. Une grande langueur m’envahit, et je me laisse bercer sur ma selle arabe, commode comme un fauteuil.
Ben-Zireg n’est plus qu’à vingt-huit kilomètres, et nous aurons tout le temps d’y aller coucher. Mais à quoi bon nous presser ?
Il faut arriver à l’entrée du « village » de Bou-Ayech pour l’apercevoir, tellement il est de la même couleur que le sol.
Une dizaine de baraques en planches, une redoute en terre jaunâtre et une centaine d’informes gourbis en broussailles, où gîtent les ouvriers marocains de la voie ferrée en construction. A cent mètres, tout cela se confond avec l’alfa et la poussière, et ce coin de la vallée semble aussi désert que les autres.
La ligne du railway de l’État s’arrête, pour le moment, à quelques kilomètres au-delà de Bou-Ayech, et les travaux donnent un air de vitalité commerçante à ce poste perdu.
Déjà le pays prend des aspects à la fois plus sahariens et moins lugubres qu’à Beni-Ounif ; le sable pâle, sous le manteau vert doré de l’alfa, ne produit pas l’impression, pénible parfois jusqu’à l’angoisse, de la hamada noire d’Ounif.
Dans l’une des baraques du « village », sur une table en bois, des Espagnols boivent l’anisette.
Figures taillées à coups de serpe, rasées, tannées et recuites, grands chapeaux de feutre noir, petites vestes rondes, espadrilles — une race fruste et rude, qui se fait à toutes les solitudes, à toutes les privations, sous les plus incléments soleils.
Par un guichet dans la muraille de la baraque, le commis des entrepôts francs de Beni-Ounif distribue les vivres aux ouvriers. Je remarque que ceux-ci ont presque tous abandonné leurs belles loques indigènes pour l’affreuse défroque européenne du « trabadjar », qui jure avec leur large turban blanc.
Voici des Marocains du Nord : figures barbues et énergiques ; beaucoup de caractère pittoresque ; des traits réguliers et durs, avec de longs yeux farouches.
J’observe, au nombre de ces travailleurs, quelques Berbères blonds, aux yeux bleus, de ce type particulier qu’on rencontre en Kabylie et qui est certainement dû à un lointain apport de sang vandale.
Seuls, les Figuiguiens et les gens du Tafilala conservent leurs guenilles arabes : travailleurs provisoires, il leur aura suffi d’avoir gagné quelques sous pour rentrer aussitôt dans leurs ksour.
Bou-Ayech nous fut un repos.
Comme nous cuisions des pommes de terre dans un trou de sable, un peu à l’écart des baraquements du poste et du café maure, à l’ombre circulaire de beaux lentisques grands comme des chênes, des hommes en vareuse et en béret gris circulaient autour de nous, sous l’œil des légionnaires. Je reconnus en eux des « exclus » de l’armée, de la dernière catégorie, des condamnés militaires, qu’on emploie aux travaux publics dans les postes reculés. Quelques-uns étaient nus jusqu’à la ceinture. D’une autre sauvagerie sur cette terre sauvage, ils étalaient d’extraordinaires tatouages parisiens, soulignés de devises pessimistes, révoltées ou obscènes.
Par ennui, exclus et légionnaires viennent nous parler. Cela m’amuse d’abord, et j’ai peine à ne pas rire en les entendant dire entre eux :
— Il est girond, le petit spahi, il a la peau fine !
Quelques mokhazni nous rejoignent. Ils sont de Beni-Ounif et je reconnais en eux des figures amies de l’an dernier.
Avec eux nous préparons le café dans une gamelle et nous causons, comme causent les gens du Sud, en répliques courtes, avec des plaisanteries naïves sans mots malsonnants.
Des sokhar Douï-Menia, campés sur la hauteur, en plein soleil, viennent s’asseoir à côté de nous. Les mokhazni les taquinent, tournant en ridicule leur parler bizarre. Les nomades répondent de leur mieux, sans colère apparente. Mais au fond on sent très bien la vieille haine qui divise les gens des Hauts-Plateaux algériens et les Marocains.
Les sokhar finissent par s’en aller, et les mokhazni se mettent à préparer la « mella », le pain de route saharien.
L’un d’eux pétrit la semoule avec de l’eau de peau de bouc sur une musette pliée. Djilali creuse un trou dans le sable, avec ses mains, tandis que les autres apportent des brassées de bois.
— La mella, déclare un cavalier Trafi, c’est pour les hommes comme l’alfa pour les chevaux : ça n’engraisse pas, mais ça donne du nerf.
Le soir, les sous-officiers du 1er Étranger, qui m’ont vue l’an dernier en excursion à Hadjerath-M’guil, m’ont reconnue et fêtée.
J’emporterai d’eux un souvenir d’autant meilleur que, sachant fort bien qui je suis, ils respectent strictement mon incognito.
Nous nous sommes attardés en une causerie insignifiante, pour le seul plaisir de parler du pays saharien, du « bled », des mouvements de troupes, des travaux de construction, de l’avenir de ce coin de terre perdue. Ce soir-là, après la « popote », je me sentais l’âme camarade d’un soldat du Sud. Sans aucune contrainte je m’intéressais aux histoires de ces braves gens, comme on se plaît aux contes de la veillée dans une ferme de paysans, trouvée après une longue marche de campagne…
J’ai comme cela des familles, des foyers et des feux de bivouac dans mon souvenir. Aux heures d’isolement et de rêvasserie, je retrouve tout cela dans la fumée d’une cigarette, et ce m’est encore plus tonique que le souvenir des grands enthousiasmes, qui laissent après eux des trous, et que les grandes espérances, fondées sur la valeur des êtres, qui finissent toujours, presque toujours, en désillusions et en faillites.
J’en arrive à cette conclusion, qu’il ne faut jamais chercher le bonheur. Il passe sur la route, mais toujours en sens inverse… Souvent je l’ai reconnu.
Maintenant, la nuit sommeille toute bleue sur le calme de la vallée.
A la redoute, le clairon de la Légion égrène lentement les notes mélancoliques de l’extinction des feux.
Dans ces petits postes isolés, au milieu des solitudes silencieuses, la sonnerie du soir a quelque chose de poignant : après elle, on sent autour de soi le désert…
Les derniers bruits et les dernières lumières s’éteignent. Je m’endors en un bien-être infini. Demain, je m’en irai vers d’autres paysages, et qui sait si je reviendrai jamais dormir là, au pied de cette redoute, dans ce décor qui m’a plu ?…
BEN-ZIREG
Nous quittons Bou-Ayech dans la délicieuse fraîcheur d’avant l’aube. La lune décroissante nage dans un ciel verdâtre, et sa faible lumière triste glisse sur les pierres noires de la piste. Djilali, songeur, finit par me dire qu’il vaut mieux attendre le jour pour franchir les gorges de Ben-Zireg, le vieux passage des rôdeurs.
Nous mettons pied à terre dans le lit large et peu profond d’un oued à sec, et, les chevaux lâchés dans l’alfa, nous nous couchons sur le sable fin, pour un assoupissement léger de sieste.
Quand nous nous réveillons, il fait grand jour.
Nous avons dormi dans un site charmant. Des arbustes sauvages, à fleurs en minces grappes violettes, s’élèvent au-dessus de la houle très verte de l’alfa, où les lavandes et les absinthes font de larges taches argentées. A l’ombre des grands lentisques, des asters éparpillent leurs petites étoiles mauves c’est tout un luxe naïf de fleurs, de vie végétale en pleine hamada.
Nous entrons dans des gorges ravinées, tortueuses, où la route surplombe un oued profond, encastré entre de hautes falaises rouges, et bientôt nous débouchons dans la vallée de Ben-Zireg.
Quelle inoubliable vision désolée à la sortie des gorges ! Le plus lugubre, le plus désolé de tous les décors arides du Sud s’étend devant nous.
Entre l’éperon abrupt du Djebel-Béchar et la haute muraille de l’Antar, des collines aiguës comme les dents d’une scie, des chaînes de pitons enserrent encore la vallée inclinée en pente douce vers l’oued. Et tout, les collines, le sol d’ardoise pulvérisée, les pierres rugueuses, tout est noir, d’un noir olivâtre et terne de foie corrompu. Au pied des coteaux que domine le Béchar, la redoute blanche, d’une blancheur livide, accentue l’horreur de ce paysage de deuil.
Le « village » ne compte encore que quelques masures, cantines militaires et cafés maures.
Sur la rive opposée de l’oued s’alignent les croix en bois du cimetière chrétien.
Pas une ombre, pas une herbe, seulement deux ou trois maigres dattiers dans l’oued.
Affreux pays d’exil, où les imaginations d’un visionnaire appelleraient les phalanges de la mort. Jamais rien ne poussera dans ce vallon maudit. Quel misanthrope, quel amant surhumain de la solitude stérile, quel fou sublime du tombeau, consentirait à vivre ici, en face de ces collines de suie, dans ce cirque calciné et sans horizon ?
J’éprouve une impression de grandeur et de malaise : Ben-Zireg ressemble à ces pays funestes qu’on voit dans les mauvais rêves. Il y a quelque part, dans les Mille et une Nuits, un de ces paysages de basalte qu’habite un géant nègre enchaîné.
Le plus féroce caprice d’un halluciné d’opium n’imaginerait pas cette funèbre splendeur minérale.
La chaleur devient accablante. Des légions de mouches se collent sur nos yeux. Une haleine de four brûlant me prend à la gorge. — J’ai tendu les rênes de ma jument blanche dans un sentiment d’effroi, quand je suis entrée dans cette dernière vallée de la sécheresse…
Nous avons attendu le soir avec angoisse. Le jour s’est éteint en vapeur d’incendie. La redoute flambait comme un métal en fusion. Et pendant les courts instants d’avant la nuit, ce sombre coin de Ben-Zireg sembla beau, d’une saisissante beauté d’apothéose.
Puis, tout de suite, ce fut fini. Brusquement la nuit tomba, pleine, brumeuse, riche de mystère, et veloutée comme des ailes chaudes.
Nous couchons devant le café maure, sur une natte. — Je partirai avant le jour, pour garder de Ben-Zireg la dernière vision du soir.
EAU DE MENSONGE
Aujourd’hui l’étape sera longue. Nous en avons pour des heures à cheminer lentement, au pas régulier et patient de nos juments.
Depuis que nous sommes sortis du cirque de Ben-Zireg, la vallée, toujours la même, s’élargit ; çà et là un oued avec un peu de verdure et de beaux lentisques puis, de nouveau, de la poussière et des pierres à l’infini.
A Hassi-en-Nous, à mi-chemin, nous déjeunons et nous allons ensuite prendre le café chez les mokhazni du poste de Bel-Haouari, des nomades « Rzaïn » du cercle de Saïda, campés sous de légers gourbis.
On les prendrait facilement pour un « djich », ces braves gens qui, dans le désert, ont repris leurs burnous terreux de bédouins.
Au delà de Bel-Haouari[4], dans une perspective d’horizon incandescent, immensément ouvert, nous longeons une double chaîne de collines d’un aspect amusant et singulier. Comme il convient de s’instruire en voyage, je demande à mon compagnon le nom de cette architecture géologique.
[4] Pour suivre cet itinéraire on consultera avec intérêt la belle carte de l’Extrême-Sud de l’Algérie, partie occidentale, dressée à l’échelle de 1/800.000e et publiée, en 1904, par les soins du Gouvernement général de l’Algérie.
— Regarde bien, dit-il, et tu sauras pourquoi les gens d’ici disent les Bezaz el Kelba (mamelles de la chienne).
En passant, il me désigne encore du doigt une ligne noire dans la vallée ouverte comme une plaine : la palmeraie d’Ouagda.
Sous le flamboiement du soleil, déjà les perspectives commencent à se déformer. Impossible d’apprécier les distances : une sorte de vertige danse devant nos yeux et toujours, à droite et à gauche, ces fantastiques « bezaz el kelba ».
Les moindres variations de terrains influencent la lumière et sont pour ma vue des souffrances ou des repos.
Après la région des pierres s’ouvre une zone de sable pur. Pour la première fois dans le Sud-Oranais, je retrouve l’impression profonde éprouvée jadis à l’entrée d’autres régions sahariennes.
Je la reconnais dans toute sa splendeur, avec ses enchantements mornes et ses féeries, la terre qui se pâme dans une éternelle caresse solaire, sans aucune secousse volcanique, sans l’immense effort des montagnes.
Tout à coup, l’horizon oscille, les lointains se déforment et le sable roux disparaît. Une grande nappe d’eau bleue s’étale au loin, et des dattiers s’y reflètent.
L’eau miroite sous le soleil, d’une pureté infinie… Djilali se met à rire, en grand enfant qu’il est.
— Si Mahmoud, vois comme le srab (mirage) se moque de nous qui avons si soif ! Si nous n’avions que cette maudite eau de mensonge pour nous désaltérer, nous pourrions tirer la langue ou téter les mamelles de la chienne !
… Au bord du lac chimérique, une troupe de cavaliers rouges s’avance. Au-dessus des rangs serrés, un grand étendard écarlate flotte au vent… L’escadron passe et disparaît. — C’étaient des ânes qui rentraient à Ouagda, et c’était aussi la haute armature d’un puits saharien où le mirage avait accroché des lambeaux de pourpre.
L’arrivée à Béchar ravive ainsi en moi les souvenirs déjà lointains de l’Oued-Rir’ et des chotts salés, dans le Sud-Constantinois, autre pays de fièvre et de mirage.
Nous longeons de loin la palmeraie d’Ouagda, entre les petites tombes semées le long de la route. En face, une dune rousse, avec, au bas, une tache blanche : la redoute de « Collomb ».
Béchar, Taagda, Collomb, tous ces noms divers se sont confondus. En fait, Béchar est le nom du pays, comme il est celui de la montagne qui ferme l’horizon.
Taagda, c’est le ksar et la palmeraie supérieure au-dessus d’Ouagda.
Un nom dépaysé « Collomb » désigne le village en construction.
LE PARFUM DES OASIS
… Le lac mystérieux a disparu. Au loin, quelques flaques subsistent seules, lambeaux d’azur éparpillés dans les sables fauves. Mais déjà l’ombre de la palmeraie tente nos montures. Nous arrivons enfin sous les arceaux serrés des dattiers, et nos chevaux allongent leurs naseaux saignants vers de la vraie eau, en entrant à mi-jambe dans l’oued très large au milieu des joncs.
Quel soulagement, quelle joie toute physique, cette arrivée à l’ombre, où la brise est un peu fraîche, où nos yeux douloureux se reposent sur le vert profond des beaux palmiers, sur les grenadiers aux fleurs de sang et sur les lauriers-roses en touffes.
Après l’eau de mensonge, le goût de la vérité.
Nous nous étendons à terre, pour n’entrer à Béchar que vers le soir, après la sieste.
Djilali s’endort, et moi je regarde ce décor nouveau qui ressemble à d’autres que j’ai aimés, qui m’ont révélé le charme mystérieux des oasis. J’y retrouve aussi cette légère odeur de salpêtre, si spéciale aux palmeraies humides, cette odeur de fruit coupé qui pimente tous les autres parfums de la vie à l’ombre.