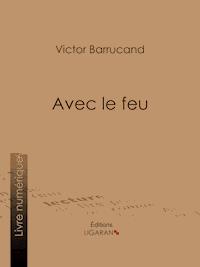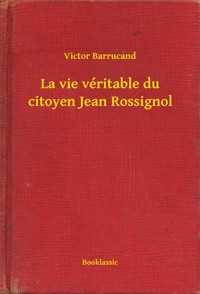
0,88 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Orfevre de son état, révolutionnaire de la premiere heure, dés la prise de la Bastille, Jean Rossignol devint général en chef de l'armée de l'Ouest en 1793. Il sera déporté en 1801 par Bonaparte, en tant que jacobin et mourra l'année suivante. Ses mémoires sont l'occasion de revisiter cette période si importante de notre histoire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
La vie véritable du citoyen Jean Rossignol
Victor Barrucand
PRÉFACE
Encore des mémoires touchant intimement à l’histoire de la Révolution poursuivie jusqu’à la domination consulaire, mais des mémoires d’extrême-gauche, par conséquent, plus rares, car les ouvriers de la Révolution maniaient mieux la pique que la plume. Beaucoup d’entre eux quittèrent du reste la scène au fort de l’action, sans avoir eu le temps de juger les événements et de se convertir aux régimes successifs. Ils se faisaient sans doute une haute idée de leur œuvre, une idée trop nette même et sans nuances, c’est pourquoi ils eussent été bien empêchés d’en écrire avec esprit et de mettre en bonne place le bloc qu’ils avaient dégrossi à coups de hache. Le peuple n’écrit d’ordinaire ses mémoires qu’en édifiant ou en détruisant ; il s’attelle aux rudes besognes historiques en y croyant comme aux travaux de la terre, prend pour lui la peine, laisse à d’autres la gloire et les profits de l’aventure, et s’en remet à l’histoire du soin de le trahir. Mais si, pour quelque raison que ce soit, il s’essaye à parler avec des mots, il est bien évident que la critique voulant être compréhensive doit oublier toute infime rigueur, s’humaniser, et, sans indulgence, s’élever à quelque hauteur philosophique, pour apprécier la juste valeur des motifs qui ne s’expriment pas et qui font agir.
D’ailleurs, la psychologie historique encore incertaine reconnaît dans toute contribution à un fait une valeur de touche que les conséquences générales n’altèrent pas : les choses et les hommes valent par eux-mêmes, en dehors de toute synthèse. Par ces notations à vif, par ces touches individuelles que recherche la méthode nouvelle et qui sont comme des plaques sensibilisées plus immédiates que les clichés de jadis, par la multiplicité des apparences successives dont elle tient compte, le sang du passé remonte sous le masque de la froide vérité acceptée et souvent la transfigure. Mais en même temps, et pour ces raisons, la chronique d’hier reste mystérieuse ; et, pour ne parler que d’un relief mémorable, devant un examen plus attentif, les aspects de la Révolution perdent leur rigueur logique, les noms impérieux de la Montagne s’atténuent et, comme au chaos des nuages, l’esprit inquiet demande à la foule le secret des illuminations soudaines.
Que savons-nous des véritables auteurs de cette révolution par laquelle on jure, et qui a ses prêtres, ses docteurs et ses pharisiens ? Presque rien que des calomnies et des injures. L’étude des clubs et des motionneurs, la sensibilité des foules excitées par le sang et la famine, le hasard des stratégies populaires, l’inspiration des démagogues et la folie d’une race débordée déroutent une opinion rectiligne. Il devient difficile de prouver quelque chose, même la raison du peuple, dès qu’on scrute ces dessous : l’instinct collectif, la contagion de l’exemple, l’irresponsabilité, le réveil atavique des massacres dans le sang des journées chaudes ; en vertu de telles circonstances à jamais inconnues, les mots et les émotions s’opposent ou s’exaltent ; et tout est possible et tout est douteux, avec ces facteurs d’énergie, l’hallucination du danger et la naïveté des masses.
C’est en somme le système du mouvement impersonnel donnant une science plus compliquée, et plus vraie sans doute, à cause des centres et des foyers innombrables, véritable tourbillon où la théorie des grands hommes s’efface.
L’intérêt d’une telle décentralisation historique apparaît un peu frivolement dans le succès de certains mémoires ; mais cette vogue à tout prendre n’est pas insignifiante si le défilé des personnages de second plan modifie nos idées sur le passé appris, et si la vie contemporaine s’en trouve influencée autant et mieux peut-être que par des lectures romanesques.
Rossignol dont nous publions les Mémoires est-il donc un de ces personnages écoutant aux portes des salons et des chancelleries, potinant sur les choses vues et sur les hommes rencontrés ?
Plus curieux son rôle est peut-être unique. Si Rossignol avait eu le tempérament littéraire, ses mémoires composeraient plusieurs tomes car il fut toujours mêlé aux actions de son temps et les suscita parfois ; mais il n’a pas le sentiment des nuances et des proportions ; le moindre incident de sa vie d’atelier ou de garnison a pour ce batailleur plus d’importance que le récit d’une bataille rangée. Irrespectueux et naïf, insoumis et brave, non sans vantardise, ridicule souvent, entêté jusqu’à l’inconscience et parfois énergique jusqu’au frisson, Rossignol est une étonnante personnification de ce peuple de Paris qui fit les grandes journées ratifiées par les constitutions. Il semble que sa robustesse franche, où les défauts s’accusent sans honte, explique l’âme obscure de la Révolution, non pas la vie des assemblées, mais l’émotion d’un peuple s’essayant à la liberté avec des gaucheries et des cataclysmes. Sans effort et sans pose qui ne soit naturelle, ce compagnon orfèvre devient nécessairement général quand la foule a pris la tête du mouvement révolutionnaire ; sans se guinder il atteste ainsi le rôle du peuple qu’il ne peut pas trahir sans se trahir lui-même. Ses mémoires ont à ce titre une importance autre que littéraire et vraiment typique.
Le 12 juillet 89, Rossignol, c’est lui-même qui le dit, ne savait rien de la Révolution et ne se doutait en aucune manière de tout ce qu’on pouvait tenter, et le 14 il était avec ceux qui prenaient la Bastille ; dans la démonstration d’octobre, il était à Versailles avec les femmes et les masses indisciplinées qui réclamaient à Paris le Boulanger, la Boulangère et le petit Mitron ; délégué par la section des Quinze-Vingts à la commune insurrectionnelle, il était à la journée du Dix-Août ; son nom figure sur les registres de la Force parmi ceux des magistrats du peuple envoyés pour calmer l’effervescence, qui firent acte de présence aux exécutions de septembre et ne purent rien empêcher. Le cahier de ses mémoires qui intéresse le Dix-Août et les Journées de Septembre a disparu, à l’instigation sans doute de Fouché.
On retrouve Rossignol, « l’enfant du Faubourg », partout où l’exaltation populaire s’affirma sans mesure. Il était en Vendée presque au début de la guerre opposant le fanatisme du nouveau dogme patriotique à la superstition séculaire ; d’accord avec les « exagérés » à moustaches de la cour de Saumur comme avec les hébertistes et les enragés de Paris, il poursuivait l’exécution des plus grands desseins : avec eux, la guerre civile tendait à devenir guerre de religion ; ils avaient eu l’intention de déchristianiser la France, et d’ailleurs ils « sanctifiaient » les excès de la démagogie par l’espoir entrevu d’une rénovation sociale qui manqua avec ses inspirateurs, quand prévalut par tant de ruses la politique des « hommes d’État ».
Plus favorisé par les succès de son parti que par ses luttes personnelles, bien qu’il fût brave à l’excès et doué d’un rare esprit naturel – mais les meilleurs généraux éprouvèrent des défaites en Vendée, – Rossignol apparaît toujours fidèle à son caractère, et ce que nous savons de la péripétie de sa fortune et de la fin tourmentée de sa vie concentre beaucoup d’intérêt et de grandeur sur le front vulgaire de ce combattant aux prises avec la fatalité. Après avoir connu les honneurs militaires, les acclamations de la Convention, les applaudissements des tribunes et la confiance inébranlable du Comité de salut public, après avoir conduit des foules et des armées, Rossignol, « le fils aîné de la patrie », fut le jouet des successives réactions post-thermidoriennes qui, de chute en chute, précipitèrent la République aux mains de Bonaparte. Il avait été des premiers combattants révolutionnaires et tomba le dernier. Acquitté dans le procès fait aux babouvistes, participant de près ou de loin à tous les mouvements du Faubourg, tant qu’il resta un espoir d’aboutir il fut un démagogue infatigable ; et, même à l’heure des défections obligées, il se résignait mal au culte naissant de César. Pendant plus d’un an il attendait à Toulon une occasion de s’embarquer, sans mettre aucun empressement à rejoindre en Égypte le général Bonaparte, comme il en avait reçu l’ordre du Directoire. La nostalgie du Faubourg le retenait, et sans doute gardait-il encore cette répugnance de sa jeunesse à faire la guerre « à des gens qu’il ne connaissait pas ». Sa santé était du reste ébranlée, il demanda la permission de retourner à Paris « pour y respirer l’air natal » et l’obtint ; mais Paris silencieux, oublieux des grands principes et tendant aux sommeils du despotisme, n’était plus pour lui le chef-lieu du monde ; un ordre de police l’en éloigna du reste bientôt, au moment où, convaincu de son impuissance à lutter contre le courant nouveau, « il passait ses journées sur la rivière à pécher à la ligne ». Retiré près de Melun, il n’aspirait plus qu’au repos ; dans sa petite maison des champs, il allait rappeler près de lui sa femme et sa fille, restées à Toulon, et déjà n’était plus que « Monsieur Durand », quand l’attentat royaliste de la rue Saint-Nicaise fut pour Bonaparte un facile prétexte à se débarrasser des républicains compromis qui restaient en France. La liste promulguée en vertu du sénatus-consulte du 14 nivôse an IX, portait cent trente-deux noms arbitrairement choisis. Sans autre forme de procès et sans plus attendre, soixante et onze d’entre eux furent déportés aux îles Seychelles. Quelques mois après une nouvelle proscription coloniale, voulue à l’Île-de-France par des propriétaires négriers, frappait au hasard trente-trois de ces malheureux, dont Rossignol, et les conduisait sur l’îlot insalubre d’Anjouan, où ils moururent presque tous en peu de jours dans les plus atroces souffrances. Leurs incroyables misères et la grandeur d’âme de Rossignol nous sont attestées par l’architecte Lefranc, « l’une des deux seules victimes qui aient survécu à la déportation ».
Rossignol mourut à Anjouan en 1802. Mais le peuple refusa de croire à la mort de son héros : il semblait que ce fût le suicide du Faubourg. Rossignol se survivait donc dans les souvenirs, et il prenait position dans la légende avec un mauvais roman en quatre volumes : LE ROBINSON DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE. Au frontispice de ce roman, le général plébéien est représenté, comme fondateur d’une république nouvelle en des Indes imaginaires, avec un diadème de plumes farouches. Ainsi, « finalement il arriva au port de Utopie, distant de la ville des Amaurotes par trois lieues ».
La conduite du général Rossignol en Vendée, comme celle de tous les généraux hébertistes, a été mal appréciée par des historiens qui jugeaient les passions de loin. L’opinion du général Turreau consignée en ses « Mémoires pour servir à l’histoire de la Vendée », est plus près de la vérité et des motifs intérieurs qui présidèrent à la destinée du général Rossignol.
On sait que le Comité de Salut public redoutait la dictature militaire à l’égal de la trahison et que les principes et le caractère de Rossignol furent pour beaucoup dans son élévation au premier grade. Certes, il supportait mal l’esprit d’autorité, et cette indication de « Parisien mauvaise tête » se manifeste déjà dans la première partie de ses mémoires. Son mépris de la hiérarchie lui vaut de la part des historiens plus d’une rebuffade ; mais on oublie trop que l’époque tendait au nivellement des institutions, et rien n’est moins contradictoire à ce principe que l’esprit de camaraderie et d’égalité apporté dans l’armée par ceux-là mêmes qui l’avaient proclamé dans la vie civile. À ce point de vue, les généraux de l’armée de Mayence étaient des réactionnaires pénétrés de l’importance du grade et souffrant mal l’élection d’un illettré au premier commandement. De là ces jalousies, ces rivalités, ces désaccords néfastes dont parlent tous les historiens de la guerre vendéenne. Le jugement que Rossignol porte sur Kléber, dans une lettre au ministre Bouchotte, est très significatif de l’état d’esprit qui les divisait : « C’est un bon militaire qui sait le métier de la guerre, mais qui sert la République comme il servirait un despote. »
Pour remplacer avantageusement, en théorie, l’obéissance passive dénoncée par Rossignol comme insupportable à des hommes libres, il ne fallait que de l’entente fraternelle et du dévouement à la chose publique et, dans la simplicité de son âme, il ne doutait pas que les soldats de la Raison fussent à la hauteur des principes républicains, mais c’était compter sans les contradictions humaines et les ambitions personnelles.
À plus forte raison, l’âpre attitude de Rossignol ne pouvait être approuvée par les écrivains hostiles à l’esprit de la Révolution ; mais leurs railleries sont trop faciles et leurs calomnies évidentes : ils n’ont voulu voir en lui qu’un général incapable. Certes Rossignol n’était pas un grand stratège. Quand il accepta la charge redoutable de général en chef dans cette grande campagne de la Vendée, charge qui eût été lourde à d’autres épaules que les siennes, il ne le fit qu’à contre-cœur en confessant « l’insuffisance de ses lumières », mais ses amis et les représentants du peuple promettaient de l’assister ; il savait que, derrière Ronsin, il y avait Berthier, homme à talents, et il pensait naïvement que l’art de la guerre n’est qu’un moyen au service d’idées plus hautes ; il se savait sûr de lui-même, incapable de trahir ou de temporiser ; on le persuada que si un bon patriote comme lui n’acceptait pas le premier grade, la guerre s’éterniserait par la mauvaise volonté des chefs, et que, d’ailleurs, les intrigants étaient nombreux tout prêts à profiter de cette place pour ensuite trahir le peuple plus facilement ; il accepta donc, et non sans bravoure morale, de représenter à la tête de l’armée l’intransigeance des principes républicains. Voilà ce qu’on n’a pas voulu voir, et ceux qui ont compris la franchise désintéressée de Rossignol lui en ont fait un crime. Le Comité de salut public était mieux inspiré, et la fin de la République le démontre assez.
Dans son « Histoire de la Terreur », M. Mortimer-Ternaux pousse la haine des démocraties jusqu’à l’erreur volontaire quand, sans plus de preuves, il porte contre Rossignol l’accusation de lâcheté. Au contraire, tous les témoignages sont unanimes à reconnaître sa bravoure et son patriotisme. Ses ennemis contemporains eux-mêmes ne lui contestaient point ces titres.
L’empreinte matérielle de Rossignol sur la destinée de la Révolution n’est pas non plus négligeable ; on le voit encore bien vivant en dehors des figurations idéales. Les événements de la Vendée, on le sait, eurent à Paris une influence directrice. Rossignol pèse sur Robespierre qui le soutient d’accord avec le Comité de salut public et les assemblées populaires : c’est toute une politique.
Quand Rossignol est attaqué devant la Convention et aux Jacobins par un faux personnage comme Bourdon de l’Oise, ce n’est qu’un écho de la grande querelle qui se poursuit en Vendée et qui divise les représentants du peuple ; en ces occasions, Robespierre lui-même défend Rossignol appuyé par le parti populaire et par Hébert reprochant aux généraux qui ont précédé Rossignol en Vendée d’avoir fait de cette guerre civile leur pot-au-feu ; il met Bourdon de l’Oise et ses amis en mauvaise posture ; bien plus, il porte contre eux des menaces non équivoques et les invite à revenir de leurs erreurs.
Rossignol, général, est accusé d’impéritie ; plus près des faits nous voyons ceci : le plan qu’il proposait aux avocats du conseil de guerre de Saumur était qualifié d’absurde par le vertueux et peu clairvoyant Philippeaux et par les guerriers de l’armée de Mayence intéressés en la circonstance ; Rossignol insiste et montre que le projet qu’il soutient est le seul qu’on puisse exécuter ; les votes se partagent également. – Je vois ce qu’il en est, dit en substance Rossignol, le plan est indiscutable, et c’est moi qui vous gêne ; eh bien, je me retire : il ne faut pas abaisser notre grande décision jusqu’à des rivalités personnelles ; j’accepte de servir sous les ordres de Canclaux, pour faire cesser toute querelle, si Canclaux veut commander la marche qui s’impose.
Ce beau mouvement ne décida personne et Rossignol, en s’abstenant de prendre part au second vote, permit à ses présomptueux contradicteurs de triompher en principe, mais en principe seulement, car la marche tournante qu’ils avaient conçue eut pour résultats les retards que l’on sait et la glorieuse défaite des Mayençais eux-mêmes.
On pourrait croire que le plan de Rossignol, ce général ignorant, n’était pas meilleur, mais nous avons sur ce point une autorité de quelque valeur, celle de Napoléon Ier qui, jugeant à distance les opérations de la guerre vendéenne, déclare que le seul parti à prendre au Conseil de Saumur était de marcher directement et en masse, et Napoléon refait en quelques lignes le plan proposé par Rossignol.
À suivre autrement l’histoire que par la marche des événements extérieurement enregistrés, en étudiant plutôt les déformations que ceux-ci exercent sur le caractère des peuples, Rossignol atteste une façon d’être, un état d’autant plus intéressant que son personnage est plus simple et que la morsure des faits y accuse, comme sur une pierre de touche, son caractère franc, incapable de se plier adroitement aux circonstances. Rossignol n’est pas un esprit supérieur, car il ne doute jamais ; il va droit à son but et persiste ; les ruses qu’il emploie sont très apparentes et font sourire ; mais il représente un élément avec lequel les esprits les plus fins devront toujours compter : la force d’action, la volonté vivace qui, en dehors de toute prévision, crée les événements. Sans Rossignol et les hommes de sa trempe, la Révolution était impossible, car la logique des assemblées parlantes ne fait pas de révolutions, et c’est, pour une bonne part, grâce aux émeutiers et aux justiciers révolutionnaires se portant à des excès, comme tous les justiciers, que les délibérations de la Convention furent possibles, et que ce qui est arrivé arriva. Il ne s’agit point ici de légitimer l’histoire ni de la combattre au nom d’une vérité supérieure au jeu des événements, mais de comprendre sans aigreur les hommes et les choses du passé : et c’est pourquoi on lira Rossignol ; car, si de son propre aveu, il fut entraîné par le courant sans pouvoir en apprécier rien, il fut encore un des éléments actifs de ce courant et chorège de la foule, premier acteur, du reste toujours semblable à lui-même, et tel qu’on le voit déjà aux années d’enfance, d’apprentissage et de service militaire.
Malgré que la littérature des écrivains soit absente de ses mémoires et même les passages soignés, on y trouvera pourtant des choses de lecture très impressionnantes et des mots d’un grand style. Les naïvetés de Rossignol sont souvent superbes ; ainsi, quand on veut l’incarcérer à Niort sur l’ordre de Westermann : « Je pensais, dit-il, qu’il ne devait plus exister de cachots depuis que j’avais renversé la Bastille. » Cependant je me persuade aisément qu’on pourrait mal juger ce récit d’un ouvrier illettré qui devint général. D’ailleurs, il faut y apporter une intelligence assez parfaite des scènes accessoires du drame révolutionnaire, et ne pas y chercher la vérité complexe et littéraire, mais une note essentielle et la première, qui rarement apparaît dans les documents vulgaires de cette sorte : j’entends le caractère d’un homme du peuple, acteur et jouet des événements les plus considérables et leur opposant une âme toujours ferme avec la sainteté de son ignorance. Le sourire indulgent du critique qui juge des caractères par leur complexité serait ici hors de propos : on peut rire de Rossignol, mais c’est un homme de Plutarque.
À preuve de l’authenticité rigoureuse des mémoires que nous publions, on consultera, aux Archives historiques de la guerre, les cahiers rédigés par Rossignol lui-même pendant sa détention au fort de Ham, et l’on verra que notre texte, en redressant parfois l’écriture fruste de cette autobiographie, n’en altère jamais le style. L’allure de la phrase et tous les détails sont conservés ; quelques dates à leur place et des justifications orthographiques sont la seule correction qu’ait subie le travail original qui garde ainsi toute sa valeur documentaire.
La narration de Rossignol s’interrompt, en 1791, brusquement, à la fin d’un cahier, pour reprendre avec le départ par la Vendée des Vainqueurs de la Bastille, et sans doute il ne faut voir là qu’une lacune étrangère à sa volonté, à moins qu’on ne préfère croire que, Rossignol écrivant après les événements de Thermidor, il eût été imprudent à lui, dans les circonstances où il se trouvait, de préciser l’importance de son rôle révolutionnaire au Dix-Août comme aux jours de septembre, et qu’il s’en abstint. Elle s’arrête en 1795 avec un mémoire justificatif publié en deux fois sur la fin de la même année.
Mais dans les détails du procès Babeuf, dans les lettres qui sont au dossier administratif de Rossignol et dans les relations inédites de la déportation aux îles Seychelles et à l’île d’Anjouan, où il fut compris, nous en avons cherché la suite.
Il se trouve, en effet, que les compagnons d’exil de Rossignol, dans l’espoir d’une justice tardive, ont noté scrupuleusement un récit collectif de leurs misères communes, où la vie de notre auteur se confond habituellement, pour reparaître, à l’occasion et d’une façon émouvante, sur le relief des événements. Ce mémoire et quelques autres pièces que nous citons sont aux Archives coloniales.
« La vie véritable du citoyen Jean Rossignol » n’est donc point une fantaisie écrite après coup par quelque secrétaire zélé, ou moins directement encore, comme presque tous les mémoires de l’époque révolutionnaire ; ce n’est point une contrefaçon moderne de la mode de 1820, mais un document complet relevé sur les écritures originales, et présentant les meilleures garanties.[1]
VICTOR BARRUCAND.
Partie 1
Chapitre1
L’état de mes parents. – Quand j’étais petit. – Entre les écoliers des maîtres d’écriture. – Le caractère de ma mère. – Contre le guet. – J’entre en apprentissage. – Pour être mon maître.
Je suis né d’une famille pauvre[2]. Défunt mon père était Bourguignon. Il vint à Paris et, après quelques années, il chercha à se marier. Il fit donc connaissance de ma mère et ils se marièrent. Des cinq enfants qu’ils eurent, trois garçons et deux filles, j’étais le dernier.
Par sa bonne conduite, mon père avait obtenu une place à la Messagerie de Lyon ; il y était facteur ; ma mère y était factrice. Je n’avais que neuf ans à la mort de mon père, mais j’étais déjà en âge de le connaître et je me souviens qu’il m’aimait beaucoup parce que j’étais de mes frères le plus espiègle.
J’allais à l’école aux enfants de la paroisse et, comme j’avais une assez belle voix, je devins enfant de chœur à Sainte-Catherine, ci-devant canonicat de Sainte-Geneviève.
Je n’y fus que très peu de temps parce que j’eus une dispute avec le cuisinier de la maison. On me retira de cet endroit, et l’on me remit à ma première école jusqu’à l’âge de douze ans ; alors je changeai pour aller de suite chez un nommé Gourmera, maître d’écriture. Ce fut là le commencement de ma jeunesse. Tous les jours, en sortant de l’école, j’allais avec les autres enfants jouer à la ci-devant place Royale.
Au bout d’un an, comme je promettais d’écrire assez bien, on nous envoya les trois garçons que nous étions chez un maître d’école pour l’écriture nommé Roland.
Cette classe avait alors dispute avec les écoliers de Gourmera : ce fut là, deux ou trois fois par semaine, que nous nous battions les uns contre les autres avec les armes des écoliers : règles, compas, canifs, tout en était ; plusieurs fois je fus blessé, cela ne me dégoûtait pas. Sitôt que j’étais à même de reprendre ma revanche, je m’y trouvais avec plaisir, et par un nouveau combat je revenais quelquefois vainqueur ou d’autres fois vaincu.
Je mentais assez bien à la maison, surtout quand j’avais été battu : c’était que j’étais tombé ou que l’on m’avait fait cela sans le vouloir. J’avais une mère à qui il ne fallait jamais se plaindre ; elle était très dure ; elle ne nous cajolait pas, au contraire : « Va, disait-elle, aujourd’hui t’as trouvé ton maître. » Cela m’outrait à un tel point que souvent je sortais en colère de la maison, et, sur le premier que je rencontrais il fallait que je passe ma colère, puis j’étais satisfait. Un jour, je me souviens que nous avions fait une partie carrée de six contre six sur la demi-lune des boulevards, mais, comme nous étions très animés, la garde vint nous surprendre et le guet de Paris tenait déjà deux de nous, lorsque tout à coup notre colère cessa les uns contre les autres, et nous cherchâmes à retirer des mains de la garde nos camarades ; mais cela fut inutile, car j’avais fait tomber un soldat du guet par terre ; je tombai aussi ; alors un autre soldat me prit et l’on nous emmena tous au corps de garde et l’on nous menaçait de la charbonnière. Mes autres camarades eurent peur de la garde, s’enfuirent et furent avertir plusieurs personnes qui vinrent nous réclamer : nous en fûmes quittes pour la peur. Sitôt que nous rencontrâmes les fuyards, nous leur dîmes des injures : qu’ils étaient des poltrons, qu’ils n’avaient point de cœur.
Enfin ma mère se résolut à me faire apprendre un métier, et j’ai choisi celui d’orfèvre. Me voilà en apprentissage. Le marché était ainsi conclu que j’y resterais quatre années pour quatre cents francs d’argent. J’étais content d’avoir quitté la maison paternelle. Le bourgeois chez qui j’étais était un brave homme, mais sa femme, vieille bigote, était le bon Dieu à l’église et le diable à la maison. J’étais forcé les dimanches et fêtes d’aller à la messe de la paroisse avec elle : cela m’ennuyait assez ; enfin, comme j’avais la voix très forte, je faisais tous mes efforts pour l’empêcher de prier, et je chantais tant que je pouvais afin de l’étourdir dans ses prières ; ce qui lui fit prendre le parti de m’envoyer du côté du Cours, avec ordre de la venir reprendre sitôt la grand’messe finie. Je profitais de cette occasion pour aller jouer avec les autres apprentis sur le portail, puis je rentrais reprendre ma bourgeoise.
Je restai dans cette boutique pendant trois années et, comme je savais un peu travailler, je croyais qu’en province les alouettes tombaient toutes rôties ; ce qui m’a décidé à voyager : et le tout pour être mon maître.
Alors je n’avais que quatorze ans. J’étais assez fort pour mon âge, mais je n’avais point de taille.
Chapitre2
Projet d’embarquement. – À Bordeaux, mon patron me met à la porte. – Je travaille à La Rochelle. – Dispute à la canne avec mon premier. – Chez un brave homme de Niort. – Le pan de mon habit en payement. – Retour à Paris. – Je gagne ma vie. – La petite drôlerie.
Quand je partis de Paris j’avais deux desseins : le premier, en arrivant à Bordeaux, de chercher un bâtiment pour passer à l’île Saint-Domingue, parce que j’avais un de mes oncles du côté de ma mère qui était très riche. Il était sûrement fripon, car il était procureur. Je ne puis attester le fait, mais le proverbe dit : « tel métier, tel homme, » et j’avoue que, quoique très jeune, j’avais déjà mauvaise opinion de son état ; mais je me disais : il me fera sûrement apprendre le commerce et je ferai fortune dans ce pays-là.
Arrivé à Bordeaux, je parlai à plusieurs capitaines de vaisseaux ; aucun ne voulut me passer à moins de trois cents livres. Je n’en avais alors que deux cents, et par conséquent je fus réduit à chercher de l’ouvrage, ce qui était mon second point de vue.
Je n’étais pas encore bien fort dans mon état, cependant je trouvai un marchand orfèvre qui m’occupa, je ne fis pas son ouvrage à son goût et, au bout de huit jours, il me mit à la porte. Je commençai à sentir ce que c’était que la province et je me repentis d’avoir quitté Paris.
Je revins de Bordeaux à La Rochelle ; là j’entrai chez un orfèvre et j’y restai deux mois. Je n’y « faisais » que pour vivre.
Il y avait dans cette boutique un premier ouvrier qui se moquait de moi. Nous eûmes ensemble une dispute très vive et il me proposa de me battre, mais, le sentant plus fort que moi à la poigne, je lui proposai la canne et nous fûmes nous battre. Je fus heureusement le vainqueur, et je lui donnai entre autres deux coups sur la figure, si bien qu’il lui fut impossible de venir travailler le lendemain. Le bourgeois, qui avait besoin de cet ouvrier, sut qu’il avait été blessé par moi et me mit à la porte.
Me voilà encore en route et très léger d’argent.
Je vins à Niort en Poitou, là je trouvai de l’ouvrage. J’étais tombé chez un brave homme, et au bout de quelque temps il me regarda comme son enfant : je mangeais chez lui, à sa table, et il me donnait dix-huit livres par mois. J’étais selon la circonstance et mon âge assez heureux.
Je n’avais qu’un seul habit. Un jour, un danseur de corde vint dans la ville pour y faire des tours. Il fit battre au son de la caisse qu’un grand voltigeur ferait ses exercices à cinq heures du soir au Château, et qu’il prendrait deux sols par personne, et que l’on ne payerait qu’en sortant. Il avait fait fermer la grande porte et il fallait passer par la petite qui ressemblait beaucoup à une porte de prison. Là, il avait placé deux personnes pour recevoir la recette. Je ne voulais pas le payer parce qu’il nous avait annoncé des tours de force qu’il ne nous avait pas faits. Je m’y connaissais assez, car j’avais été plusieurs fois chez Nicolet, et, comme je me trouvais pressé, l’on m’attrapa par le pan de mon habit qui leur resta dans la main avec tout le côté. Je n’avais pas le moyen d’en avoir un autre, je rentrai chez mon bourgeois : « Où avez-vous donc laissé le reste de votre habit ? Vous voilà joli garçon avec ce costume-là ! » Je lui répondis que plusieurs libertins et ivrognes m’avaient attaqué, je ne sais pourquoi, et que, me voyant frappé, j’avais été contraint de me revenger, mais comme ils étaient plusieurs, j’avais été forcé de leur laisser le champ de bataille, et que cherchant à échapper de leurs mains un d’entre eux m’avait attrapé par mon habit, et par conséquent le morceau lui était resté dans la main, et que je me trouvais fort heureux de n’avoir que cela. Le marchand orfèvre compatissant me fit arranger une de ses vieilles redingotes qu’il me donna jusqu’à ce que mon mois fût échu. Mon mois échu, sur-le-champ j’achetai un habit avec mes dix-huit livres. Vous imaginez bien qu’il n’était pas de la première qualité.
J’ai passé chez ce brave homme tout l’été jusqu’à la fin des vendanges, et puis je pris la route de Paris. J’avais alors quatorze ans et demi.
En arrivant, je cherchai de l’ouvrage et j’eus assez de peine à en trouver. Après bien des démarches, je travaillai chez le sieur Langlois. Je n’y restai que deux mois. De là, je fus chez le nommé Taillepied, au Marché-Neuf. Je gagnais par semaine vingt francs de moyenne. Un jour, je m’avisai d’aller voir les femmes et j’attrapai la petite drôlerie. Les ouvriers avec lesquels je travaillais s’en aperçurent et ce fut une risée dans la boutique. Je me désespérais ; cela m’occasionnait des disputes avec mes camarades. Je me battais souvent, et je me trouvais à dos avec tous mes camarades. Je grandissais à vue d’œil et j’avais à quinze ans la taille de cinq pieds trois pouces, assez bien fait, sans être joli, mais très passable.
Chapitre3
Être soldat. – Le marchand de chair humaine. – Nous ratifions. – Sous le nom de Francœur. – J’apprends à tirer avec des baguettes. – Dans la chambrée. – Mon premier duel. – Ruse de recrue. – Le vainqueur de la Giroflée. – Dispute sur un liard. – Je suis blessé. – Ma revanche. – En vrai luron.
Je pris le parti de me faire soldat. Je fus trouver un officier qui me donna cent livres d’engagement et un billet de dix écus pour le régiment. Je vendis mes outils et je fus faire mes adieux à ma mère avec l’officier à qui je m’étais engagé. L’officier avait ses desseins : il croyait que ma mère ne me laisserait pas partir et, apparemment, il comptait sur quelques louis d’or de bénéfice. Mais ma mère, sitôt qu’elle me vit avec une cocarde, me dit : « Ah, ah Monsieur, vous avez fait la sottise, vous la boirez ! » Cependant l’officier lui dit : « Madame, si vous le voulez, il ne partira pas ; moyennant quelque petite chose, je vous rendrai votre fils. » Mais à l’instant je dis que je m’engagerais à un autre. Ma mère prit le parti de me dire : « Eh bien, Monsieur, allez et soyez sage. » Je partis sans rien regretter.
Mon recruteur, marchand de chair humaine, avait aussi engagé un boulanger. Ce même jour-là nous ratifiâmes chez Sommeiller ensemble. Le lendemain, le recruteur, un sergent dudit régiment et un de mes frères, l’horloger, que je n’ai plus vu depuis, vinrent jusqu’à une auberge que l’on appelait le Chaudron ; là, nous déjeunâmes, et après nous nous dîmes adieu.
Me voilà en route jusqu’à Dunkerque qui fut ma première garnison.
J’arrivai avec mon camarade le 13 août 1775, et le 14 on nous signala tous deux dans la même compagnie de Jumécourt. J’y pris le nom de Francœur, que je portai jusqu’au doublement, qui se fit en 1776. Dans la compagnie que je doublais alors, il se trouva un militaire qui portait mon même nom de guerre ; je fus obligé d’en prendre un autre, et je m’en tins à Rossignol : c’était mon nom de famille, que j’ai toujours porté depuis et que jamais je ne changerai. Aucune bassesse ne s’est jamais faite dans ma famille ; j’ose l’attester à la face du ciel.
Me voilà donc dans le ci-devant Royal-Roussillon-Infanterie. Pour huit jours, je fus d’abord aux exercices militaires comme recrue, et bientôt à la première classe ; en moins de deux mois je montais ma garde ; le troisième mois, je n’allais plus qu’avec la compagnie. À la vérité, j’aimais les évolutions et je me plaisais beaucoup à ce métier-là.
Je fis ensuite connaissance avec un de mes camarades qui apprenait à tirer des armes et, comme je n’avais pas le moyen de payer un maître, je priai mon ami de m’enseigner ce qu’il savait. J’allais chercher des baguettes et, avec cela, j’apprenais de mon ami tout ce qu’il savait. Cet exercice dura pendant plus de quatre mois entiers. Enfin je reçus de mon frère la somme de vingt-quatre livres, qui me fit bien plaisir. Je priai mon ami de venir boire avec moi, mais il ne voulut pas, vu que l’on me traitait encore de recrue. Il disait que l’on trouverait à redire si l’on voyait un vieux soldat aller au cabaret avec des jeunes gens ; cependant quelques jours après je fis une ribote avec les plus lurons : – c’étaient ceux qui se battaient le mieux et le plus souvent que l’on appelait ainsi ; – cela m’occasionna une dispute que des amis arrangèrent à l’amiable.
Un soir que j’étais à fendre du bois entre quatre fers, plusieurs de mes camarades de la chambrée me prièrent donc de conter un conte. Je me mis alors en fonction et, au bout d’une demi-heure, un de mes camarades de lit qui avait besoin que nous soyons endormis tous pour aller voir sa maîtresse, se mit à me dire que, si je ne finissais pas, il allait me faire taire d’une belle manière. Les autres qui n’étaient pas encore endormis me dirent de continuer. Moi, qui ne me plaisais qu’à être en contradiction, je me mis de plus belle à forcer ma voix qui a toujours été très forte. Lui, voyant que je le faisais exprès, me donna un coup de poing. Me sentant frappé, je le lui rendis. Nous voilà à nous battre jusqu’à ce que le caporal de la chambrée se réveillât et mît le bon ordre et fît finir toute l’histoire. Nous cessâmes notre dispute, mais il me dit que je lui payerais cette scène, le matin. En effet, cinq heures sonnent : il me réveille et me dit de prendre ma baïonnette et qu’il allait me corriger. Il prit un de ses amis, et moi, je réveillai un musicien qui couchait avec nous ; celui-ci ne voulait pas venir, disant que j’étais trop jeune et que cela le compromettrait. Je fus donc obligé de dire : Allons-y, nous deux, nous n’avons besoin de personne. Il ne voulut jamais. C’est alors que je fus réveiller mon camarade avec lequel je m’étais engagé : celui-là ne me refusa pas.
Nous voilà partis. Il faisait clair de lune. Quand nous fûmes au bord du rempart, il se déshabilla et moi aussi. Je fis comme lui, j’entortillai mon poignet avec mon mouchoir. C’était la première fois que je me battais avec du fer, en exceptant le temps où j’étais écolier. Après plusieurs minutes de combat, je le serrai de près et je lui portai un coup sur le sein. Il tomba par terre et moi je me mis à dire : Ah mon Dieu, il est mort !
Je repris vite mon habit et je me rendis à la caserne à toutes jambes. Je me mis dans le lit très doucement et je fis semblant de dormir. Pour le blessé, les deux spectateurs lui donnèrent des secours et le portèrent chez une vivandière du régiment. On le pansa ; le chirurgien vint qui le soigna, et on le conduisit à l’hôpital militaire. Il y resta deux mois entiers.
Le matin, l’on questionna les spectateurs que la vivandière connaissait, et l’on sut que c’était moi qui m’étais battu. Un caporal envoyé pour me questionner me demanda où était la baïonnette ; je lui répondis qu’elle était sous le pied du lit. Il la cherche et la trouve : elle était pleine de dents, parce qu’en parant cela avait fait des brèches. Il me demanda si c’était moi qui avais blessé la Giroflée, c’était le nom de celui avec qui je m’étais battu et par conséquent mon camarade de lit. Je lui répondis que je ne savais pas ce qu’il me demandait. Il me dit : « Voilà pourtant ta baïonnette qui a porté le coup car voilà le sang encore après. » Je dis qu’il était très possible qu’un autre que moi eût pris ma baïonnette pour aller se battre avec. – « Allons, jeune homme, venez parler au sergent-major, et prenez votre bonnet de police… Et qu’on lui donne un vieil habit pour aller au cachot. » Ces paroles me firent frémir.
Me voilà bientôt costumé pour aller en prison. Le caporal me mena chez le sergent-major. C’était le matin ; il se faisait coiffer pour aller au rapport à neuf heures du matin. Le sergent-major me questionna et voulut me faire dire la vérité. Après plusieurs interrogatoires que je subis, je me coupai dans mes réponses. Il m’assura que si je ne lui avouais pas que c’était moi, il allait me faire aller au cachot pour trois mois. Cela me fit une si grande peur que je répondis qu’à la vérité cela était vrai, mais que j’y avais été forcé par mon adversaire après des insultes qu’il m’avait faites, et qu’un soldat qui avait reçu des soufflets ne pouvait faire autrement que de se battre, sans quoi il était déshonoré, et que j’aimais mieux, tout jeune que j’étais dans le service, être tué ou blessé plutôt que de passer pour un lâche. Ma réponse fit plaisir au sergent-major : « Allez-vous-en, me dit-il, et que cela ne vous arrive plus. »
Me voilà exempt du maudit cachot. Le jour même, le bruit s’était répandu que l’on avait porté un soldat de la compagnie de Dutrémoy à l’hôpital. (Alors le doublement était fait et Dutrémoy était le nom du capitaine, et Jumécourt le commandant en second.) Ce premier coup d’essai me donna une certaine hardiesse, et j’entendais que l’on disait en parlant de moi : « Tiens, le voilà, celui qui a mis la Giroflée à l’hôpital ! » Il est bon que l’on sache que celui-ci avait douze ans de service, et moi je n’avais alors que six mois de présence.
Un mois après je tombai de garde à un poste qu’on appelait le fort Mardic. Nous nous amusions à jouer de gros sols au liard, le plus près gagnant, avec un nommé Malfilâtre qui était Normand. Nous disputâmes sur un liard, et après avoir bien mesuré, le liard m’appartenait. Il le ramassa. Je me mis en colère et je lui vomis des injures : tout le monde sait ce qu’un soldat peut dire en injures. Le caporal vint aussitôt et nous fit prendre à tous deux nos fusils et il nous mit en faction, l’un d’un côté et l’autre de l’autre. Nous y restâmes trois heures chacun, que nous fîmes en plus des six heures que nous avions à faire. Quand nous fûmes relevés, Malfilâtre me dit qu’en descendant de garde je lui payerais ça. Je lui répondis que je n’avais pas peur de lui : et, à la vérité, nous descendîmes la garde, et, le soir, après la soupe, nous fûmes nous battre. Celui-là avait plus de talents que moi, car il avait quatre ans de salle, et moi je n’avais pas appris grand’chose, encore c’était avec des baguettes. Il me désarma du premier coup et me toucha deux fois : un coup dans le bras et un coup dans le pouce. Je tirais à tort et à travers, mais il parait de la main gauche. Les spectateurs nous séparèrent et réellement je fus content car le coup du bras me faisait extrêmement mal. Je revins à la chambre et un camarade me pansa. Personne, que ceux de la chambrée, ne s’en aperçut, et en six jours de temps je fus guéri.
Ce fut après ma guérison que je voulus me revenger avec le même, et la seconde fois, je fus vainqueur : je le blessai à mon tour. Depuis ce temps nous avons toujours été amis ensemble sans plus jamais avoir aucune discussion.
Cela m’avait fait un renom dans la compagnie et les lurons commencèrent à frayer avec moi. J’étais content de voir qu’on ne me regardait plus comme un blanc-bec. Mon premier maître, qui m’avait donné des leçons avec des baguettes, se fortifiait de jour en jour sur les armes.
Chapitre4
Prévôt d’armes. – Rivalités. – Le travail des soldats. – Comment je manquai d’être pendu à Paramé. – Intervention de l’aumônier, du major, et de la marquise de mon capitaine. – Sur la paille. – Je fais des excuses. – Quelques bons tours à ce coquin de sergent. – Une rossée comme il faut. – J’avais une maîtresse.