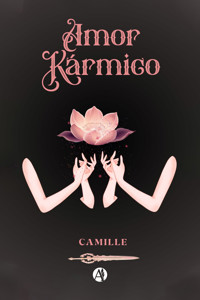Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Bâtir un récit collectif, attractif et crédible pour une société plus alignée avec la finitude de notre Terre, ne serait-ce pas l’un des enjeux majeurs de notre époque ?
Demain viendra présente une société des années 2060. Bien que toujours en transition, celle-ci a permis d’éviter une débâcle écologique. Au fil des pages, vous suivrez grands-parents et petits-enfants au cours d’un voyage dans leur présent et son quotidien, leur passé et ses changements, ainsi que leur futur et ses interrogations.
Vous ne trouverez ni meurtre ni enquête, mais une contribution à une discussion publique qu’il me paraît urgent d’avoir : que peut-on espérer pour demain ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Camille
Demain Viendra
Merci d’avoir tourné la page. Le contenu de ce livre est maintenant vôtre, puisse-t-il vous apporter quelque chose.
Avant-propos
Afin de m’assurer un début de livre confortable, j’ai décidé de faire les questions et les réponses moi-même.
(I) Qu’est-ce qui a animé ce livre ?
C’est une excellente question, merci de me l’avoir posée. Je dirais le constat que la société dans laquelle nous vivons ne me permettra pas de vivre en bonne santé, ce qui, pourtant, représente un besoin primaire qui me tient particulièrement à cœur. Pour être sûr que nous nous comprenons bien, je précise que je fais ici référence à la définition du mot « santé », selon l’Organisation mondiale de la santé : « [...] un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
(II) À la lecture de cette définition, le défi semble colossal. Pensez-vous qu’il puisse exister une société à même de fournir à toutes et à tous une « bonne santé » ?
Sans doute non, mais sans doute pouvons-nous faire mieux qu’aujourd’hui. Il me semble que nous nous censurons dans nos petites ou grandes révolutions quotidiennes. Peut-être estimons-nous qu’elles ne sont pas au niveau, qu’elles ne sont pas parfaites. Mais pourquoi leur en demander autant ? Le monde dans lequel nous vivons n’est ni au niveau ni parfait, et il n’a pas vocation à le devenir. Le changement nécessite une remise en question, mais en aucun cas la perfection. Agissons, nous verrons bien où cela nousmène.
La liste exhaustive des entraves de notre système envers ma « bonne santé » serait une lecture bien trop fastidieuse que je me propose de vous épargner. Je me contenterai d’en citer trois, pour exemple.
Le premier point est que le système actuel échouera à maintenir un environnement sécuritaire à moyen terme pour moi et mes proches. Je préfère m’exprimer sans détour là-dessus. La nécessité d’une prise en compte des limites planétaires va bien au-delà d’une histoire de grands sentiments. Il ne s’agit pas non plus de « sauver la planète », il s’agit de sauver nos fesses. En tant qu’habitant d’un pays privilégié, il m’est facile de considérer la démocratie, la paix, la présence d’eau aux robinets, d’électricité aux prises et de pain à la boulangerie du coin, comme des acquis. Toutes ces certitudes quotidiennes, qui servent de base à notre société actuelle, nous semblent anodines. Néanmoins, il est important de se rappeler qu’aucun de ces faits n’est inscrit dans le marbre et qu’aucune loi physique ne les rend immuables. Ils dépendent tous de processus en équilibre qui peuvent s’effriter, et ce, jusqu’à disparaître. Dans un monde où les ressources se raréfient et où toutes nos garanties d’approvisionnements primaires s’évaporent, quelle marge de manœuvre nous reste-t-il pour espérer faire société ? Dans un monde où des milliards d’individus sont contraints de fuir leurs terres devenues inexploitables ou inhabitables, quelle place occupera le mot « paix » ? Dans un monde régi à chaque instant par des impératifs de survie, quelle place reste-t-il à la tranquillité et aux bons moments ?
Si la débâcle écologique que nous vivons se poursuit, je ne sais pas si vous, qui lisez ces lignes, ou moi, qui les ai écrites, perdrons la vie, mais nous en perdrons la saveur dont nous jouissons aujourd’hui.
Le second point concerne notre héritage. Celui que nous recevons et celui que nous léguerons, notre éducation et notre épitaphe. Si les choses ne changent pas, je sais d’ores et déjà que je ne serai pas fier.ère de ce qui me survivra. Ainsi, à la question « qu’est-ce qui a animé ce livre ? », ma réponse était incomplète. J’y ajoute ceci : le besoin de montrer à mes enfants et à moi-même que, peu importe la finalité, j’ai essayé. Il doit tout de même s’agir d’un sentiment de grande sérénité d’entendre la mort arriver et de pouvoir se dire que nous n’avons pas perdu notre temps, que nous avons essayé de laisser ce monde un peu meilleur qu’il ne l’était quand nous y sommes venus et qu’en tout état de cause, nous avons fait de notre mieux1.
L’héritage est une notion multiple. Il peut, par exemple, être technologique. Dans ce domaine, force est de constater que l’humanité l’enrichit de jour en jour. La course à la modernisation a produit une évolution rapide de nos outils, à tel point que nous n’avons pas pris, collectivement, le temps de mûrir avec eux. Nous voilà ainsi propulsés, candides, dans une époque où notre capacité d’impact sur notre Terre a été considérablement accrue, alors que nous sommes, à quelques poils près, restés les mêmes primates qu’autrefois.
L’héritage peut également être idéologique. L’anthro-pocentrisme domine aujourd’hui. Il sépare la nature et l’humain et met ce dernier au centre des récits et au sommet de l’évolution. Difficile pour les 99,99 % de la biomasse de lutter lorsque les critères sont énoncés par les 0,01 % qui restent, et que l’on appelle « Humanité ». Transposons, si 0,01 % des êtres humains, les plus riches par exemple, énonçaient les critères de la supériorité, est-ce que les 99,99 % restants seraient d’accord avec ces critères ? Peut-être tenons-nous là un sujet de recherche intéressant : quel parallèle entre la considération de l’Humanité vis-à-vis du reste du vivant et celle des 0,01 % des plus riches vis-à-vis du reste de l’Humanité ? Pour en revenir à l’anthropocentrisme, à cette « supériorité humaine », il est peu surprenant qu’elle imprègne notre imaginaire jusqu’à nous en convaincre, plus ou moins, toutes et tous : on nous la perfuse depuis notre plus tendre enfance.
Les récits religieux : « L’homme à l’image de Dieu. »
Les récits historiques : « Évolution de l’humanité à travers son passé, son présent, son avenir. »
Les récits économiques : « Les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques », Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique,1803.
Le vocabulaire : sauvage ; civilisé ; un jardin propre ; une belle météo ; il n’y a pas mort d’homme…
La liste est encore longue : le système juridique ; la morale ; la protection du vivant...
Comment nier les corollaires destructeurs de cette idéologie ? Notre cécité trouve son paroxysme dans notre insatiabilité technologique : « Si je peux le faire, pourquoi ne le ferais-je pas ? Après tout, je suis ce qu’il y a de mieux dans l’univers. » Mais ce n’est pas parce que l’on peut faire quelque chose, qu’il est pertinent de le faire, #bombeatomique, #transhumanisme, #brulertoutlecharbon, #raserunemontagne, #raseruneforet, #mettreundoigtdansuneprise,#…
À ceux qui pensent que c’est dans la nature humaine, je leur indiquerai qu’il n’est pas sain de confondre habituelle et naturelle. Toutes les civilisations humaines ne se sont pas construites autour de l’anthropocentrisme, il en reste des vestiges encore aujourd’hui. Mais alors, comment expliquer une telle propagation de cette idéologie ? Voici un premier élément de réponse : à la fin du XIXe siècle, la civilisation occidentale, berceau de cette idéologie, avait une emprise sur la grande majorité des terres habitées. Une occasion en or de diffuser un mode de pensée. Ils le pouvaient, ils l’ont fait, certes, mais était-ce pertinent ?
À ceux qui invoquent le darwinisme et justifient ce comportement par une plus grande évolution de la civilisation occidentale sur les autres, voici une question : si un individu immensément riche et influent arrive chez vous et déclare prendre le contrôle de vos biens et de votre famille, que feriez-vous ? Plaideriez-vous coupable d’être moins évolué.e ?
Je vois au moins une troisième dimension à l’héritage. Sans doute celle qui m’impressionne et me fascine le plus : notre héritage biologique. Encore une fois, comprenons-nous bien, ici je m’éloigne de l’héritage anthropocentré et je m’incline devant les trois milliards d’années durant lesquels un mouvement mystique, que l’on appelle la vie, a échafaudé l’héritage que l’on peut apprécier aujourd’hui. « Nous sommes vivants. » Au-delà de rassurer le lecteur ou la lectrice qui en doutait, cette affirmation signifie que la ligne de vie, dont nous sommes aujourd’hui une des extrémités, ne s’est jamais interrompue, pas une seule fois depuis nos plus lointains ancêtres, pas une seule fois depuis trois milliards d’années. Cette caractéristique ne nous est pas propre, nous la partageons avec l’ensemble des milliards de milliards […] de milliards de terriens qu’abrite actuellement notre planète. Prenons quelques secondes pour imaginer ce que cela représente.
Quel que soit l’être vivant que nous croisons, ses ancêtres ont côtoyé les nôtres. Et durant ces quelque trois derniers milliards d’années, ils se sont sans doute croisés, mangés ou sauvés les uns les autres. En tout état de cause, si nous sommes là, ensemble dans ce monde, c’est bien qu’ils ont, quelque part, réussi ensemble.
Aujourd’hui, ce riche héritage biologique s’appauvrit sans retour sur un rythme effréné, et nous en sommes la principale cause. Notre comportement collectif en est la principale cause. Quelle pitié si notre rôle dans cette incroyable épopée se résume à n’être que les porteurs d’une mort à peine maquillée.
Après une sécurité non garantie et un héritage funeste, le troisième et dernier point consiste en une frustration grandissante entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Prenons l’image passablement usitée de la Terre vue comme un monumental vaisseau spatial de quelques milliers de milliards de milliards de tonnes. Dans cette métaphore, il s’avère que l’humanité participe davantage à la dégradation des systèmes de support de vie de ce précieux vaisseau, plutôt qu’à leur maintien. Comme certaines évidences se portent mieux une fois énoncées, en voici une : la Terre, en tant que planète et écosystème, est la condition fondamentale de notre survie dans l’univers. Elle est la source de tout. Mais cet état de fait trouve-t-il sa réciproque dans nos comportements ? La Terre, en tant que planète et écosystème, est-elle omniprésente dans nos choix ? Intervient-elle comme une composante essentielle de nos décisions quotidiennes ? Lui donnons-nous la place qu’elle mérite dans nos existences ? Toutes les dérives écologiques auxquelles nous assistons lessivent mes tripes. Au-delà de nous-mêmes, ce sont nos frères terriens depuis plus de trois milliards d’années que nous regardons crever. Et au-delà de cette fameuse phrase « ce sont nos actes qui nous définissent », je préfère raisonner en matière d’opportunités saisies ou laissées passées. Il me semble ainsi bon de rester humble face à la réalité du monde au regard des opportunités que nous avons croisées. Tant d’occasions manquées, et celle qui nous sera fatale se rapproche, d’un pas, à chaque rendez-vousraté.
(III) Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire ?
Au gré de mon cheminement personnel, la vision d’un futur dans lequel la société humaine serait plus apaisée avec elle-même et ses colocataires terriens m’est devenue essentielle. Nous sommes, toutes et tous, maintenus dans une représentation étroite de l’humanité, de ses codes sociaux et de ses rapports au reste du monde. Pourtant, encore une fois, « habituel » ne signifie pas « naturel », et « habituel » ne signifie pas non plus « véridique », soyons créatifs. À travers ce livre, mon objectif est d’alimenter, au mieux de mes capacités, la réflexion collective sur cette grande question : que peut-on espérer pour demain ? Il n’est pas question de bâtir une société parfaite, ni même meilleure sur tous les aspects, mais une société globalement meilleure que la nôtre. À ces mots, deux interrogations me viennent : « Meilleure pour qui ? » et « une baisse organisée de certains aspects ne serait-elle pas salutaire, si elle permet des gains substantiels sur de nombreux autres aspects ? »
Ainsi, les pages qui constituent ce livre parlent de futur, mais ne prétendent en aucun cas le prédire. Comme toute œuvre, ces pages représentent avant tout leur auteur.trice. Le futur décrit est ainsi imprégné de mes valeurs, de mes expériences, de ma sensibilité et de mes connaissances qui sont, à l’instar de tout ce qui nous entoure, limitées. Aussi, les changements et évolutions rapportés à travers les personnages, leurs pensées et leurs dialogues ne sont pas à recevoir comme des réponses, mais comme ma contribution à une discussion publique qu’il me paraît urgent d’avoir. Je vous invite à appréhender ce livre, non comme un recueil immuable, mais plutôt comme une photographie, depuis ma position, d’un process complexe et en mouvement permanent. Ce livre fige ainsi ma pensée au moment de sa capture par l’écriture. Et alors que je m’apprête à le publier, après trois années de travail, une ultime relecture me confirme que ma pensée a changé durant cette période. Si je découvrais l’histoire que je vous livre aujourd’hui, je trouverais des choses à redire. L’écueil le plus important à mes yeux est que, malgré les remaniements successifs et mon discours sur l’anthropocentrisme que je viens de vous déclamer, mon récit reste marqué par l’anthropocentrisme latent de nos sociétés. Ma récente lecture d’Ethnographie des mondes à venir de Philippe Descola et d’Alessandro Pignocchi renforce sans doute ce sentiment, mais elle m’a également éclairé sur les raisons de cette empreinte : « Notre concept de nature limite nos relations aux non-humains à un choix unique entre exploitation et protection […] une atrophie générale de la sociabilité. » Réinterroger nos rapports sociaux avec les vivants non humains, voilà également une opportunité d’élargir nos imaginaires pour y trouver les ressources nécessaires à l’élaboration d’une autre « façon d’être au monde »2.
Pour conclure sur le choix de l’histoire racontée, il me tient à cœur de préciser que si les futurs sont en effet multiples, nous nous devons d’être réalistes quant au caractère fini de notre planète. Ainsi, les futurs permettant le maintien d’une société humaine appréciable pour le plus grand nombre ne tiennent, eux, qu’à quelques fils qu’il s’agira de bien dérouler.
(IV) Pensez-vous que la société dépeinte dans votre roman permette d’atteindre les objectifs internationaux ?
Je suppose que vous parlez de l’accord de Paris : « Maintenir, d’ici à 2100, la température planétaire en deçà de 2 °C supplémentaires par rapport à l’ère préindustrielle. » Je ne sais pas, et j’ai envie de dire que la finalité de ce livre n’est pas là. L’empreinte carbone d’un Français est en moyenne égale à dix tonnes d’équivalent CO2, pour imager : un aller-retour France/Australie représente environ cinq tonnes d’équivalent CO2, un repas de viande rouge par jour représente sur un an deux tonnes d’équivalent CO2. Pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris, nous devons, d’ici 2030, atteindre environ quatre tonnes par personne et par an en moyenne à l’échelle mondiale, et donc à notre échelle individuelle si l’on ne veut pas faire porter notre surplus à d’autres.
À la vue de cet objectif et de son corollaire, voici ce qui me vient à l’esprit :
–Quatre tonnes, ce n’est pas zéro tonne. Une raison supplémentaire de ne pas chercher la perfection ;
–Une donnée ne juge ou ne félicite pas, elle informe ;
–Entre ces « 1,2 °C » supplémentaires et les possibles « 4,4 °C » supplémentaires d’ici à 2100, il y a une infinité de mondes différents. Chaque dixième de degré compte. Dépasser les « +2 °C », c’est risquer d’atterrir dans un monde où toute adaptation massive sera impossible ;
–Le climat est un défi majeur. Néanmoins, il ne doit pas éclipser l’enjeu de la biodiversité, celui de la raréfaction des ressources et il ne doit pas non plus balayer la dimension sociale. Il est important de garder à l’esprit que tous ces enjeux s’entremêlent et que la dégradation de l’un entraînera, souvent, la dégradation des autres.
(V) J’ai pu voir qu’à la suite de cet avant-propos, il y a une dizaine de pages recueillant des données sur la situation actuelle, pourquoi ce choix ?
Avant de vouloir conjuguer ensemble le futur, il me paraissait important que nous parlions le même présent. La description objective d’une situation existante est un exercice périlleux et qui ne peut être qu’incomplet. J’ai opté pour la mise à disposition de quelques données et informations brutes. Vous les trouverez de la page 25 à la page 45. Elles sont réparties en sept thématiques. Certains chiffres sont des arrondis, l’important demeure dans les ordres de grandeur. Les sources sont très variées, cela peut être préjudiciable concernant l’homogénéité de la donnée, mais cela permet de fournir une large palette de ressources mobilisables. Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive et il y a de fortes chances que vos données « favorites » ne soient pas indiquées. C’est une évidence, je n’ai moi-même pas pu toutes les mettre. En complément, ou à la place de la lecture de ces données, je ne peux que vous conseiller la participation à une « Fresque du Climat » ; à l’écoute de podcast tels que « Sismique », « Présage », « Le Réveilleur » ou « ThinkerView » ; à la lecture du média « Bon pote » ou encore du rapport « Limits to growth », écrit en 1972 et également connu sous le nom de « rapport Meadows » en référence à deux des auteurs principaux, Donella et Dennis Meadows ; et à beaucoup d’autres ressources aujourd’hui disponibles sur tous ces sujets.
J’aimerais revenir sur l’association « La Fresque du Climat », afin de rendre hommage à son mode de gouvernance : un mélange de do-ocratie et d’essaimage. Il s’agit d’un fonctionnement participatif et décentralisé dans lequel ceux qui pensent que quelque chose doit être fait le font, sans être dérangés par ceux qui ne le pensent pas. Une mise en pratique de cette fameuse phrase d’Einstein : « Ceux qui pensent que ce n’est pas possible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. »
(VI) Avez-vous un autre sujet que vous souhaitiez aborder ?
Merci de poser une question aussi ouverte, j’avais un peu de mal à trouver la transition avec un point que je voulais aborder avec vous : l’IA. Il s’agit d’un sujet peu abordé explicitement dans le livre, mais il n’en demeure pas moins majeur dans nos sociétés et notre futur. Dans ce genre de grand mouvement technologique, ne pas s’informer revient à le subir. Apprendre à connaître ce qui se cache derrière ces deux lettres nous donne néanmoins une chance d’être capables, individuellement et collectivement, de faire le tri entre fantasme et réalité. Apprendre à connaître l’IA nous donne une chance d’identifier ses avantages et ses dangers. Apprendre à connaître l’IA, nous donne une chance de bien l’utiliser.
Voici les quatre principales raisons qui m’ont amené à ne pas aborder l’IA dans le livre :
–Tout d’abord, il s’agit d’un dossier sur lequel je manque de recul et de connaissances brutes et connexes pour le saisir dans sa diversité et l’insérer dans un environnement plus global. Je laisse ainsi, à d’autres, le soin de l’aborder de manière étendue.
–La seconde raison tient à la réponse que l’on peut apporter à la question suivante : qu’est-ce que l’IA ? Comme premier élément, j’aimerais vous livrer une réflexion que j’ai entendue lors d’un épisode de l’émission-débat « ThinkerView », avec pour invité M. Étienne Klein. Le terme français « intelligence artificielle » pourrait provenir d’une erreur de traduction du terme anglais « artificial intelligence », dans lequel « intelligence » peut se traduire, non par intelligence, mais par renseignement.
En partant de cet angle, il me semble intéressant d’aborder l’IA sous le prisme de l’apprentissage, qui est une accumulation de renseignements. En effet, les domaines d’application de l’IA sont plus ou moins sans limites. Difficile d’être synthétique en l’abordant sous ce point de vue. Du côté de l’apprentissage, il n’existe que trois grandes méthodes : l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé et l’apprentissage par renforcement. En restant dans la simplification et donc dans l’imprécision et le raccourci – charge à vous d’approfondir le sujet – voici une brève présentation de ces modes.
Commençons par les deux premiers que nous allons regrouper. Il est tout d’abord important de noter qu’ils sont, à l’heure actuelle, très majoritaires sur le troisième. Ces deux modes d’apprentissage reposent sur notre capacité à fournir de la donnée à l’IA. Cette dernière sert de réceptacle et capitalise l’expérience de milliers, de millions, voire de milliards d’humains sur un domaine spécifique. Elle sera alors capable de fournir la meilleure réponse possible, selon le point de vue de la population dont ont été extraites les données utilisées pour son apprentissage. Il ne s’agit pas d’une révolution de nos systèmes de pensée, mais d’une formidable optimisation. De cela, nous pouvons en tirer deux éléments. Le premier concerne l’importance des données servant à former une IA. C’est à travers le choix de ces données que nous transmettons un « système de valeurs » à l’IA et c’est sur cette base que l’IA émettra ses résultats. Le second élément concerne le lien entre résilience et optimisation. Pour cela, je vous renvoie au graphique page 46 intitulé : « Window of Viability ». Une extrême optimisation entraîne une extrême fragilité.
Passons au troisième mode : l’apprentissage par renforcement. Celui-ci ne nécessite pas de grandes quantités de données. Dans ce mode, l’IA apprend seule, sous le principe d’« essais erreurs ». Pour ce faire, il est nécessaire de coder un environnement, une palette d’actions possibles, les états dans lesquels l’IA pourra se trouver suivant les actions effectuées et un système d’évaluation de ces dernières. Une fois tous ces éléments élaborés, l’IA sera capable d’apprendre seule, en multipliant les actions et en étudiant les résultats obtenus. L’un des points les plus marquants de cette technologie est que, contrairement aux deux premiers modes qui ne font qu’optimiser des créations humaines, l’apprentissage par renforcement a été capable de faire preuve de créativité en inventant ses propres stratégies, dans des temps record. Sur le papier, cette technologie semble incroyable et presque effrayante. Néanmoins, bien qu’impressionnante, elle possède des limites non négligeables, certaines technologiques, telles que la mémoire colossale nécessaire à l’enregistrement de tous les états possibles et qui augmente exponentiellement avec la complexité de l’environnement, d’autres encore plus réconfortantes, car humaines. En effet, tout environnement, toute action, tout système d’évaluation doivent être codés. Là aussi, plus le monde dans lequel évoluera l’IA sera complexe, plus la tâche sera exponentiellement ardue. Tout cela explique que, jusqu’à présent, cette technologie n’a été utilisée que dans des systèmes avec un nombre de possibilités et un nombre d’intervenants limités.
–Nous arrivons à la troisième raison qui m’a poussé à ne pas m’étendre sur l’IA au sein de l’histoire qui suit. L’IA est déjà tout autour de nous. L’ensemble des dispositifs d’aide à la décision que nous utilisons sont des systèmes d’IA, plus ou moins élaborés. Comme l’ensemble des outils que nous avons créés, l’IA sera ce que l’on en fera. Il est tout de même une chose dont il faut se souvenir, la plupart des IA se nourrissent de données pour être précises et efficaces. Ainsi, plus nous nous orienterons dans la voie de leur développement, plus il faudra leur en fournir.
–Voici enfin la quatrième et dernière raison : ce livre repose sur diverses hypothèses, certaines sont développées au travers des pages, et d’autres non. Concernant l’IA, une hypothèse majeure fait partie de la deuxième catégorie : l’instauration de mécanismes de régulation stricts et intuitifs sur l’accaparement et la revente des données personnelles. L’hypothèse de tels mécanismes suivis et se donnant les moyens d’être respectés conduit à la mise en place d’un garde-fou sur la vitesse de développement des IA, par le musellement des GAFAM. Il n’est pas étonnant que les GAFAM soient les leaders dans le domaine des IA. Ils disposent des deux ingrédients nécessaires : les moyens et les données. Plus nous limiterons le nombre de données disponibles pour alimenter une IA, plus nous en contrôlerons son expansion, au moins à court terme. L’objectif n’est pas de stopper le déploiement de l’IA, cela serait illusoire, mais de se donner le temps de l’analyse et de la réflexion, afin de nous laisser, collectivement, l’opportunité de mieux connaître ce nouvel outil et de choisir la façon dont nous souhaitons l’utiliser.
Il est tout de même important de noter que limiter le développement des IA revient à accepter de se priver d’une partie du confort et de la sécurité qu’elles pourraient nous apporter. Néanmoins, il me semble nécessaire de se questionner sur le prix de ce surplus de confort et de sécurité, ainsi que sur sa soutenabilité.
Je profite de cette parenthèse pour glisser un message d’importance : la nécessité de transparence et de contrôle, aujourd’hui inexistante, sur les algorithmes derrière les GAFAM. Des mécanismes de contrôles sanitaires existent pour éviter que les restaurateurs ou les agro-industriels ne nous empoisonnent pas trop, pourquoi ne pas mettre en place la même chose sur l’éthique des algorithmes pour que les GAFAM n’empoisonnent pas trop nos sociétés ?
Pour conclure sur l’IA, il serait une grave erreur de ne pas prêter autant d’attention à l’IA qu’elle aura d’impact sur nos vies, et suivant les choix de société que nous prendrons dans les prochaines années, les impacts peuvent être colossaux. Une généralisation de l’IA conduirait à une réelle restriction des libertés de mouvement, qu’ils soient physiques, mentaux ou même émotionnels, ainsi qu’à une stupéfiante uniformité. Bien que les bonnes réactions face à une situation donnée soient multiples, la meilleure, suivant un corpus de valeurs définies, est, elle, par définition, unique. Dans un tel schéma de société, où trouver les fameux « crapauds fous », moteurs de l’évolution ? En ce qui me concerne, je dirais que l’IA est un moyen de supplanter l’individu par la moyenne. Je reprends la réflexion de M. Koenig à mon compte, je ne crains pas que l’IA soit un jour robotisée et nous échappe, je crains que l’IA nous robotise et que cela soit notre vie qui nous échappe.
Vous trouverez ici des informations sur notre monde actuel. Il n’est pas nécessaire de les lire pour commencer le roman, elles ne s’envolerontpas.
Pour aller directement au roman, vous pouvez vous rendre à la page 47.
Climat
➢Le climat ne se caractérise pas seulement par la température, il intègre l’ensemble des phénomènes météorologiques (température, humidité, ensoleillement, pression, vent, précipitations) afin de caractériser l’état moyen de l’atmosphère en un lieu donné [Source : Larousse]. Ainsi, avec le réchauffement climatique, c’est l’ensemble de ces caractéristiques qui sont impactées.
➢Le dérèglement climatique observé aujourd’hui est en totalité imputable aux activités humaines. En fonction des émissions anthropiques de Gaz à Effet de Serre (GES), la température moyenne terrestre se sera réchauffée de +1,5 °C à +4,4 °C à horizon 2100. La température de référence correspondant à la moyenne mondiale au moment de l’ère préindustrielle (1880-1899). Aujourd’hui (2023), nous sommes à environ +1,2 °C. [Source : GIEC AR6, 2021]
➢Évaluation des risques :
Évaluation des risques et des impacts en fonction du réchauffement climatique, en supposant une adaptation faible ou inexistante [Sources : GIEC AR6, 2022].
RFC1 : Impacts sur les systèmes uniques et menacés (récifs coralliens, peuples autochtones, glaciers de montagne, points chauds de la biodiversité…) ;
RFC2 : Impacts sur la société humaine et les écosystèmes des événements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, fortes pluies, sécheresses, incendies, inondations côtières …) ;
RFC3 : Exposition des groupes les plus vulnérables aux impacts ;
RFC4 : Impacts globaux sur les systèmes socio-écologiques (les systèmes monétaires, les vies …) ;
RFC5 : Changements importants, brusques et parfois irréversibles (désintégration des calottes glaciaires, ralentissement de la circulation thermohaline …) ;
➢L’objectif de l’accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique à horion 2100 à « bien en deçà de 2 °C, et en poursuivant l’action menée pour le limiter à 1,5 °C » [Source : stratégie nationale bas-carbone, 2020].
➢Depuis les accords de Paris, les diverses politiques publiques mises en œuvre à l’échelle mondiale ont permis d’infléchir la trajectoire du scénario tendanciel : en passant d’un réchauffement à horizon 2100 de +3,6 °C à + 2,7 °C [Source : Climate Action Tracker, 2022]. Cela souligne une prise de conscience globale. Néanmoins, les politiques publiques actuelles, à l’échelle mondiale, ne permettent pas encore d’atteindre l’objectif fixé et nous situent dans un monde à horion 2100 avec de graves conséquences pour la société humaine et les écosystèmes (cf figure « Évaluation des risques »).
➢L’empreinte carbone évalue la totalité (en cycle de vie) des émissions de GES nécessaire pour que le consommateur final bénéficie d’un service ou d’un bien. Elle diffère des émissions directes qui ne comptabilisent que les émissions ayant eu lieu sur un territoire alors que l’empreinte carbone comptabilise les émissions nécessaires au fonctionnement du territoire [Source : gouvernement.fr].
➢Une empreinte carbone se mesure en tonne équivalent CO2 (teqCO2). Chaque GES possède un pouvoir de réchauffement global (PRG) qui lui est propre. Autrement dit, tous les gaz à effet de serre n’ont pas le même impact sur le climat. Plus un PRG est élevé, plus le gaz à effet de serre aura un fort impact sur le climat. Par convention, le PRG du CO2 est de 1. Le PRG du méthane est de 28. Le méthane a donc un impact vingt-huit fois plus important sur le climat que le CO2, une tonne de méthane émise correspondra à vingt-huit tonnes d’équivalentCO2.
➢L’empreinte carbone mondiale moyenne est estimée à 6,5 teqCO2/personne /an ; avec des émissions de GES mondiales atteignant 52,5 GteqCO2 en 2021[Source : Base de données EDGAR, 2022] pour une population d’environ 8Md d’individus [Source : ONU, 2022].
➢Maintenir un réchauffement planétaire inférieur à 1,5 °C implique que les émissions mondiales de GES passent en dessous de 35 GteqCO2/an à horizon 2030, (en privilégiant l’intervalle 25-30 GteqCO2/an) [Source : GIEC, RS15, 2018]. En prenant en compte l’évolution de la population à horizon 2030, 8,5Md d’individus, [Source : ONU], cela représente une empreinte carbone maximale d’environ 4teqCO2 /personne/an à partir de2030.
➢L’empreinte carbone d’un.e français.e moyen était estimée, pour l’année 2018, à 11,2 teqCO2/personne/an [Source : stratégie nationale bas-carbone, 2020].
➢En 2018, 10 % de la population mondiale a pris un avion pour un total de 2,5 % des émissions de GES mondiales [Source : Stefan Gössling & Andreas Humpe, 2020]. Un aller-retour Paris/New York représente 1,8 teqCO2 par passager ; un aller-retour Paris/Sydney représente 5,1 teqCO2 par passager [Source : Base Carbone - Ademe 2020].
➢Manger de la viande (180 g) une fois par jour représente 2,2 teqCO2 sur un an, un repas avec du bœuf (180 g) représente 7,3 kgeqCO2 ; un repas avec du poulet (180 g) représente 1,9 kgeqCO2 ; un repas végétarien (2 œufs) représente 0,8 kgeqCO2 [Source :Base Carbone - Ademe 2019].
➢L’élevage représente deux tiers des émissions de GES de l’agriculture à l’échelle mondiale (soit 14,5 % des GES mondiaux), la plus grosse part de ses émissions (75 %) est liée aux ruminants. L’élevage fait également vivre plus d’un milliard de personnes à travers le monde, et notamment dans ses régions les plus pauvres. En sus, en maintenant une présence sur les terres agricoles, l’élevage extensif permet de diminuer la pression foncière immobilière dont elles font l’objet. [Sources : FAO – 2014 ; « La place de l’élevage face aux enjeux actuels, éléments de réflexion » – Solaro 2021].
➢L’empreinte carbone représente uniquement l’impact sur le climat. L’impact sur la biodiversité, les ressources et la société ne sont donc pas pris en compte.
Énergie :
➢Différence entre énergie et puissance, une analogie célèbre fait le parallèle avec l’eau. La puissance représenterait le débit et l’énergie le volume d’eau.
L’énergie se mesure en kilowattheure (kWh), 1 kWh correspond à l’énergie utilisée par un appareil d’une puissancede :
•1 kWh (aspirateur relativement récent, appareil à raclette) qui fonctionnerait pendant 1 heure ;
•0,2 kWh – ou 200 W – (un ordinateur fixe) qui fonctionnerait pendant 5 heures ;
•0,6 kWh – ou 600 W – (panneau publicitaire numérique) qui fonctionnerait pendant 1 heure et 40 minutes ;
•3,5 kWh (foyer principal d’une plaque à induction) qui fonctionnerait pendant 17 minutes.
➢Avec ses muscles, un humain est capable de fournir, en 8 heures d’effort, environ 0,025 kWh : 0,05 kWh pour les jambes et 0,01 kWh pour les bras [Source : JM Jancovici – Combien suis-je un esclavagiste ?].
➢1 litre de pétrole contient entre 1 et 4 kWh utiles (en fonction du rendement de la machine utilisée).
➢En 2019, l’énergie primaire utilisée au niveau mondial représentait d’environ 160 000 TWh. 85 % de cette énergie sont issus de sources fossiles, 5 % de l’hydroélectricité, 5 % des autres sources renouvelables et 5 % du nucléaire [Sources : IAE etBP].
➢Comparatifs des principales sources d’énergie primaires :
Source d’énergie
Facteur d’émission
[geqCO2/kWh]
Coût de production
[c€/kWh]
Production surfacique
[MWh/m²/an]
Charbon
1000
12
10
Pétrole
730
12
10
Gaz naturel
420
13
10
Biomasse/bois
30*
7
10
Photovoltaïque
40
5
0,2**
Éolien
15
4,5/10 (In/Offshore)
0,1
Nucléaire
10
9,5
10
Hydraulique
10
4,5
0,2
* pour une ressource bien gérée.
** pour un champ PV au sol. À noter que pour le PV sur toit, l’utilisation de nouvelle surface est nulle.
[Sources : GES : Ademe, 2021 / coûts : IEA, 2022 ; IRENA, 2020 / surfaces : greenandgreatagain,2020]
Quelques approfondissements :
✓Le dihydrogène, nommé hydrogène par simplification dans notre société, n’est pas dans cette liste. Comme l’électricité, le dihydrogène n’est pas une source d’énergie primaire. Il s’agit d’un intermédiaire entre une source d’énergie et l’utilisation de l’énergie issue de cette source. Le dihydrogène et l’électricité sont ainsi appelés des vecteurs énergétiques, ils permettent de faciliter les modalités de transport et de stockage de l’énergie avant son utilisation.
Complément sur l’hydrogène [Source : La Revue de l’Énergie n° 639, 2018] :
–l’hydrogène est avant tout un gaz industriel (99 % des usages) et donc très minoritairement utilisé comme vecteur énergétique (1 % des usages). Dans son usage industriel, l’hydrogène est utilisé comme réactif dans des procédés chimiques : fabrication de l’engrais (plus de la moitié des usages), raffinage du pétrole (environ un tiers des usages).
–l’hydrogène est à l’heure actuelle issu à 96 % directement de sources d’énergie fossiles, gaz naturel (70 %), charbon (25 %), pétrole (1 %), seuls 4 % sont issus de l’électricité (dont à l’échelle mondiale deux tiers sont produits par des sources fossiles).
✓Les coûts sont exprimés en LCOE, cela prend en compte l’ensemble des coûts directs (construction, maintenance, tonne de CO2, démantèlement …), mais pas les coûts indirects (connexion au réseau). À noter que les coûts de connexion au réseau sont importants dans le cas de sources d’énergie diffuses, nécessitant de nombreux collecteurs (éolien, PV). À noter que le coût de démantèlement dépend de l’hypothèse de durée de vie des installations. L’IEA (la source des données pour les coûts) n’a précisé cette valeur que pour les installations PV et éolien : 25 ans.
✓En matière d’énergie, il est nécessaire de distinguer les sources pilotables, qui assurent une production à la demande (centrales thermiques et barrages) et les sources intermittentes, qui assurent une production en fonction des conditions (éolien, solaire…). Afin de rendre l’énergie issue de sources intermittentes pilotable, il est nécessaire de prévoir des dispositifs de stockage, électrique, hydrogène, ou mécanique (retenue d’eau). Ces dispositifs viennent augmenter l’empreinte carbone des dispositifs et diminuer leur rendement.
✓La quantité de matériaux nécessaires par kilowattheure serait également une donnée intéressante. On parle d’intensité matière. En première approximation, on peut noter que plus une source d’énergie est diffuse (faible densité énergétique), tel que le solaire ou l’éolien, plus il faudra de nombreux dispositifs collecteurs et donc, de matériaux. Si l’on prend l’exemple de l’acier, on parlera alors d’« intensité acier », elle est de 250 tonnes par MW pour l’éolien, de 70 t/MW pour les centrales au fioul et au charbon, de 60 t/MW pour les centrales nucléaires et de 40 t/MW pour les centrales au gaz [Source : CNRS, ISTerre, 2018].
✓La durabilité de la source énergétique dans le temps est également une donnée indispensable. Les trois sources d’énergie fossiles (charbon, gaz, pétrole) et le nucléaire ont des stocks limités. Pour le bois, le verdict dépend de la gestion de nos forêts. Les sources renouvelables sont, quant à elles, inépuisables.
➢Le lien entre croissance économique et consommation énergétique :
L’élasticité entre la consommation d’énergie primaire et la croissance du PIB se situe entre 0,6 et 0,7. De plus, la consommation d’énergie primaire provoque de manière univoque la croissance du PIB [Source : How Dependent is Growth from Primary Energy ? – Gaël Giraud & Zeynep Kahraman – 2014].
Ressources
➢La Terre est une entité finie, avec des limites physiques. Ainsi, les ressources qu’elle héberge sont elles-mêmes finies et limitées.
➢Si l’on prend une ressource et qu’on lui attribue les deux hypothèses suivantes : présence d’un stock fini et une vitesse d’extraction non nulle, on peut alors affirmer que le stock de cette ressource ne sera pas éternel et que son taux d’extraction passera par un pic avant de décroître. Au-delà de la vision quantitative, un stock doit être considéré pour son aspect qualitatif. Par pragmatisme, on commence à extraire le stock le plus facile à atteindre et le plus concentré en ressource (aspect qualitatif du gisement). Si le quantitatif est important, mais que le qualitatif est faible, l’extraction ne sera rentable que si le coût de la ressource est élevé. Ainsi, la valeur quantitative absolue du stock restant n’est pas nécessairement représentative du stock réellement mobilisable.Nous pouvons imager le paragraphe ci-dessus avec l’exemple du pétrole. Ce dernier a connu son pic de ressource la plus qualitative (pétrole conventionnel) en 2008. Aujourd’hui, une part de plus en plus importante du pétrole est issue de pétrole de schiste (ressource moins qualitative) nécessitant, pour être rentable, un coût du baril plus élevé.
➢Plus un objet possède un poids important, plus il utilise de matériaux. Un objet deux fois moins lourd utilisera deux fois moins de matériaux.
➢Les matériaux ont un poids écologique important dans le cycle de vie d’un produit (extraction et/ou fabrication, transformation, transport, réutilisation et/ou recyclage). Dans le domaine du bâtiment par exemple, les matériaux de construction représentent environ les deux tiers de l’empreinte carbone d’un bâtiment (sur l’ensemble de son cycle de vie, construction, utilisation, démolition). Cette valeur prend en compte les matériaux mobilisés lors des éventuelles rénovations [Sources : carbone4, IFPEB, 2020].
➢La ressource eneau :
✓L’eau douce représente 2,6 % de la quantité d’eau présente sur Terre. 75 % de l’eau douce (soit 2 % de la ressource totale) se trouve dans les glaciers, les 25 % restants (soit 0,6 % de la ressource totale) sont sous forme liquide (très majoritairement dans les nappes phréatiques). Les glaciers continentaux jouent le rôle de réservoir saisonnier d’eau douce. Leur disparition progressive a un impact sur la disponibilité d’eau douce enété.
✓Dans un futur où la température moyenne sera plus élevée et où les périodes de sécheresse seront plus fréquentes [Source : GIEC AR6, 2021], nous aurons un besoin plus important en eau, mais une disponibilité moindre.
➢En 2020, 52 % des sols sont dits « dégradés » (détérioration plus ou moins réversible d’une ou de plusieurs de ses fonctions : habitat, régulation, archivage, production, support, réservoir). D’ici 2050, cela pourrait représenter 90 % des sols de la planète. Pour maintenir sa fonction productive, un sol nécessite une teneur en matière organique d’au moins 3 %, ainsi, la production alimentaire pourrait chuter de 30 % en 20 ans [Sources : ONU, CNULD – 2020, forum économique mondial].
➢25 % des terres arables et la totalité des prairies permanentes (prairies difficilement valorisables économiquement autrement), soit au total 75 % des terres agricoles mondiales, sont dédiées à l’élevage d’animaux de consommation [Source : La place de l’élevage face aux enjeux actuels, éléments de réflexion – Solaro 2021 ; étude menée dans le cadre du programme Afterres2050].
➢Les produits issus de l’extractivisme sont présents tout autour de nous (métaux en tout genre, électronique, béton, plastique, pétrole…). Leur nombre ne cesse d’augmenter, impliquant une raréfaction des ressources (aspect quantitatif du gisement) et une difficulté croissante à les extraire (aspect qualitatif du gisement). Leur extraction nécessite ainsi de plus en plus d’énergie et de matériaux entraînant des externalités de plus en plus importantes et souvent irréversibles : violations des droits de la personne, bouleversements socio-économiques, impacts environnementaux et sanitaires [approfondissements : systext].
➢Le secteur minier est le plus gros producteur de déchets. En moyenne, seuls 15 % de la matière extraite est commercialisée, 85 % sont du déchet. Exemple du cuivre : la concentration moyenne, en cuivre, d’une mine de cuivre est inférieure à 1 %. Ainsi, même avec les coproduits, 96 % de la matière extraite est du déchet qu’il a tout même fallu transporter et traiter pour en extraire le cuivre et les autres coproduits [Source : P. Bihouix – 2010 ; Silogora – 2020].
➢Les technologies du numérique (smartphone, ordinateur…), du stockage électrique (batteries) et des énergies renouvelables ont au moins deux points communs : elles suivent une croissance exponentielle et elles utilisent en partie les mêmes matériaux (cuivre, métaux dits « rares »…). Cela induit une très forte pression sur ces ressources et un conflit d’usage inévitable dans les années à venir.
➢Bâtir une société plus soutenable et plus durable implique de se rapprocher au maximum d’un « état d’équilibre » entre ce que nous prenons et ce que nous laissons derrière nous, le livre Ecotopia (1975) d’Ernest Callenbach donne une riche représentation de ce que pourrait être une société à l’« état d’équilibre ». Il nécessitera une profonde interrogation de notre notion de déchets, qu’ils soient artificiels ou bien naturels.