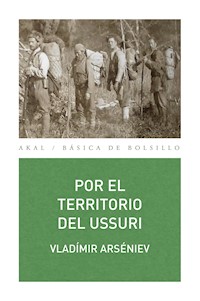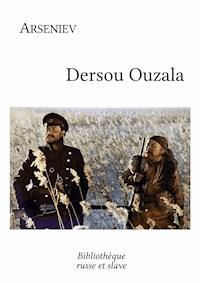
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1902, Vladimir Arseniev, chef d'une expédition d'exploration de l'extrême-est sibérien nouvellement cédé par la Chine à la Russie, croise un vieux chasseur nommé Dersou Ouzala qui accepte de le guider à travers la taïga sauvage. Avant de devenir cinquante ans après le célèbre film d'Akira Kurosawa,
Dersou Ouzala était ce livre, récit d'aventures et d'amitié, hymne à la nature et à l'homme.
Traduction de Pierre P. Wolkonsky, 1939.
EXTRAIT
Au cours de l’année 1902, lors d’une mission que j’accomplissais à la tête d’une équipe de chasseurs, je remontais la rivière Tzimou-khé qui se jette dans la baie de l’Oussouri, près du village de Chkotovo. Mon convoi se composait de six tireurs sibériens et comportait quatre chevaux chargés de bagages. L’objet de cette mission était l’étude pour les services de l’armée de la région de Chkotovo et l’exploration des cols du massif montagneux du Da-dian-chan1 où prennent leurs sources quatre fleuves : le Tzimou, le Maï-khé, la Daoubi-khé et le Léfou. Je devais ensuite relever toutes les pistes avoisinant le lac de Hanka et le chemin de fer de l’Oussouri.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Vladimir Klavdievitch Arseniev né à Saint-Pétersbourg, sous l'Empire russe, le 29 août 1872 et mort le 4 septembre 1930 à Vladivostok, est un officier-topographe de l'armée russe, explorateur de la Sibérie orientale (appelée aussi « Extrême-Orient russe »).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Vladimir Arseniev
Арсеньев Владимир Клавдиевич
1872-1930
DERSOU OUZALA
LA TAÏGA DE L’OUSSOURI :MES EXPÉDITIONS AVEC LE CHASSEUR GOLD DERSOU
Дерсу Узала
1923
Traduction de Pierre P. Wolkonsky, 1939.
© La Bibliothèque russe et slave, 2016.
© Famille Wolkonsky, 1939, 2016.
Couverture : © Atelier 41 / Daïei Studio / Mosfilm / Trete Tvorcheskoe Obedinenie / Collection Sunset Boulevard.
AVANT-PROPOS
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’Empire russe entreprit de nombreuses expéditions pour explorer et cartographier l’Extrême-Orient sibérien que la Chine venait officiellement de lui céder, aux confins de la Mandchourie et de la Corée.
Vladimir Arseniev, officier et géographe de l’armée russe, est le plus célèbre de ces explorateurs parmi tous ceux qui sillonnèrent la Sibérie encore presque entièrement inconnue des Européens. Pendant vingt années il parcourut la taïga, en particulier toute la région entre l’Oussouri, affluent du fleuve Amour, et le Sikhoté-Aline, cette longue chaîne montagneuse qui court le long de la côte du Pacifique, au-dessus de Vladivostok. Cette région qui faisait aux alentours de l’an mil partie de l’Empire de la dynastie des Liao, retombée depuis dans les marges de l’histoire, était alors peuplée de tribus nanaï (anciennement appelées goldes) et oudéguéïs (ici écrit oudéhés), que l’on retrouve dans ce récit aux côtés de Chinois, chasseurs, prospecteurs, brigands, ou en quête du ginseng, cette plante si recherchée de leurs compatriotes.
Vladimir Arseniev est surtout devenu célèbre pour le récit qu’il a tiré de ses expéditions aux côtés de Dersou Ouzala, ce chasseur golde rencontré une nuit de bivouac et qui devint son guide à travers ces contrées sublimes mais dangereuses. Il rend compte de son émerveillement à la fois devant cette nature puissante et devant cet homme qui a passé sa vie au sein de celle-ci, qui sait la déchiffrer dans ses moindres signes, qui parle aux êtres comme à ses égaux et pour qui seul le tigre est presque un dieu — l’âme même de la forêt.
Le film qu’a tiré Akira Kurosawa de ce livre a parachevé l’hommage, le plus beau de tous, qu’Arseniev avait rendu à son ami en faisant de lui le symbole éternel de l’homme uni à la nature.
L’ÉDITEUR
PHOTOGRAPHIES DE L’EXPÉDITION D’ARSENIEV :
DERSOU OUZALA.
DERSOU OUZALA ET LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE.
PREMIÈRE PARTIE
I
La Vallée de verre
AU cours de l’année 1902, lors d’une mission que j’accomplissais à la tête d’une équipe de chasseurs, je remontais la rivière Tzimou-khé qui se jette dans la baie de l’Oussouri, près du village de Chkotovo. Mon convoi se composait de six tireurs sibériens et comportait quatre chevaux chargés de bagages. L’objet de cette mission était l’étude pour les services de l’armée de la région de Chkotovo et l’exploration des cols du massif montagneux du Da-dian-chan1 où prennent leurs sources quatre fleuves : le Tzimou, le Maï-khé, la Daoubi-khé et le Léfou. Je devais ensuite relever toutes les pistes avoisinant le lac de Hanka et le chemin de fer de l’Oussouri.
La chaîne de montagnes dont il est question ici commence près de l’Iman et descend vers le sud, parallèlement au fleuve Oussouri, se dirigeant du nord-nord-est vers le sud-sud-ouest, de telle façon qu’elle a à l’ouest le fleuve Soungari et le lac de Hanka et, à l’est, la rivière Daoubi-khé. Puis elle se sépare en deux parties. L’une de celles-ci s’étend vers le sud-ouest et forme la chaîne de montagnes ayant nom La Riche Crinière (Bogataïa Griva) qui s’étire tout le long de la péninsule Mouraviev-Amourski, tandis que l’autre se dirige vers le sud et se fond avec la haute chaîne formant la séparation entre les rivières Daoubi-khé et Soutchan.
La partie nord de la baie de l’Oussouri s’appelle la crique de Maïtoun. Jadis, cette crique entrait bien plus profondément dans le continent. Cela saute aux yeux à première vue. Les falaises sont maintenant reculées de quelque cinq kilomètres de la côte. Jadis, l’embouchure de la Tanegoôuze se trouvait à l’emplacement actuel des lacs Sane et El-Poôuza, tandis que l’embouchure du Maï-khé était un peu plus haut que l’endroit où, de nos jours, cette rivière est coupée par la voie ferrée. Tout cet espace d’une superficie de vingt-deux kilomètres carrés représente une plaine marécageuse remplie par les alluvions du Maï-khé et de la Tanegoôuze. Parmi les marais, il reste encore quelques petits lacs ; ils marquent les endroits qui étaient anciennement les plus profonds. Ce lent processus du retrait de la mer et de la croissance de la terre ferme se poursuit encore. Pareil sort attend aussi la crique de Maïtoun. Déjà maintenant elle est très peu profonde. Ses côtes ouest sont formées de porphyres, ses côtes est sont des terrains tertiaires ; dans la vallée du Maï-khé abondent les granits et les siennites, tandis qu’à l’est de cette rivière dominent les formations basaltiques.
Le village de Chkotovo se trouve sur la rive droite du Tzimou-khé2, près de son embouchure. Construit en 1864, il fut brûlé par des houndhouzes en 1868 et rebâti en 1869. Pijevalski n’y trouva, en 1870, que six maisons avec trente-quatre habitants. Lors de ma venue, c’était déjà un village d’une certaine importance.
Nous y passâmes deux jours, parcourant les environs et nous préparant à notre lointain voyage.
La rivière Tzimou-khé, longue de trente kilomètres, coule dans une direction est-ouest et n’a sur sa rive droite qu’un seul affluent, le Béïtza. La vallée qu’elle parcourt est appelée, par les habitants du pays, la Vallée de Verre. Ce nom lui vient d’une fanza3 chinoise de trappeurs dans la fenêtre de laquelle on avait fixé au milieu un petit carreau de verre. À l’époque, la région de l’Oussouri ne possédait aucune fabrique de verre et celui-ci, auprès de ces populations reculées, en acquérait par là une très grande valeur. Au fond des montagnes et des forêts, le verre formait monnaie d’échange. On pouvait troquer une bouteille vide contre de la farine ou du sel.
Les anciens racontent qu’en cas de disputes, les adversaires essayaient de pénétrer dans la maison l’un de l’autre pour briser la verrerie. Il n’y a pas lieu de s’étonner dans ces conditions qu’un morceau de verre dans la fenêtre d’une fanza chinoise ait été considéré comme un grand luxe. Les premiers colons en demeurèrent tellement frappés, qu’en outre de la fanza chinoise et de la rivière, ils appelèrent toute la région la Vallée de Verre.
De Chkotovo, en remontant la vallée du Tzimou-khé, on suit d’abord une petite route qui, après le village de Novorossisk, se transforme en sentier. Celui-ci conduit au Soutchan et à la rivière Kangoouzon4, dans la direction du village de Novonéjine. La route traverse la rivière à plusieurs reprises, ce qui fait que dans les moments de crue les communications se trouvent interrompues.
Partis de bonne heure de Chkotovo, nous atteignîmes le jour même la Vallée de Verre et nous nous y engageâmes. Le Béïtza coule vers l’ouest-sud-ouest, presque en ligne droite, puis s’infléchit vers l’ouest, mais seulement à proximité de son embouchure. La largeur de la Vallée de Verre varie selon les endroits. Tantôt elle diminue pour se réduire à cent mètres, tantôt, au contraire, elle dépasse un kilomètre. Comme la plupart de celles de la région de l’Oussouri, cette vallée est uniformément plate. Les montagnes qui l’encadrent, recouvertes de maigres chênaies, ont des pentes très abruptes. Le passage de la plaine à la montagne est extrêmement brusque, ce qui témoigne d’importants phénomènes d’érosion. Dans les temps anciens, cette vallée était beaucoup plus profonde ; elle ne se combla que plus tard par les alluvions de la rivière.
À mesure que nous avancions dans la montagne, la végétation devenait riche. Les maigres chênaies firent place à des bois épais d’essences variées où on remarquait de nombreux cèdres. Un petit sentier, formé par des chasseurs chinois et des chercheurs de ginseng, nous servait de fil conducteur. Deux jours après, nous arrivâmes à l’endroit où se trouvait jadis la fameuse fanza de verre, mais il n’en restait que des ruines. Chaque jour, le sentier devenait de plus en plus difficile. Visiblement, aucun pied humain ne s’y était posé depuis longtemps. Il était envahi par les grandes herbes et encombré de bois mort. Peu après, nous le perdîmes tout à fait. Nous rencontrions des pistes d’animaux, nous les suivions tant qu’elles nous menaient dans notre direction.
Le soir du troisième jour, nous approchâmes de la crête du Da-dian-chan qui est orientée, ici, dans le sens du méridien et qui a une hauteur moyenne de sept cents mètres. Laissant mes compagnons au pied de la montagne, je gravis un des sommets les plus proches pour me rendre compte si le col où nous devions passer était encore éloigné. Du sommet, on découvrait nettement toutes les montagnes et je constatai que le col se trouvait à deux ou trois kilomètres de nous. Nous ne pouvions donc pas l’atteindre avant le soir et si même nous y parvenions, nous risquions d’y passer la nuit dépourvus d’eau, les sources de montagnes étant taries à cette époque de l’année. Je décidai, en conséquence, de bivouaquer là où j’avais laissé les chevaux et de reprendre la marche vers le col le lendemain.
Je ne prolongeais jamais notre marche jusqu’à la tombée de la nuit et dressais notre bivouac à un moment où il faisait encore clair pour pouvoir poser les tentes et nous approvisionner en bois.
Pendant que les tireurs travaillaient à installer le bivouac, je profitai du temps libre pour visiter les environs. Mon compagnon dans ces promenades était toujours un certain Polycarpe Olènetiev, excellent homme et adroit chasseur. Il était alors âgé de vingt-six ans ; de taille moyenne et de belle stature, il avait les cheveux d’un blond un peu roux, les traits accentués et de petites moustaches. Olènetiev était un optimiste ; il ne perdait pas sa bonne humeur dans les situations les plus embarrassantes et s’efforçait de me convaincre que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ayant donné les instructions nécessaires, nous prîmes nos fusils et partîmes en reconnaissance.
Le soleil déclinait à l’horizon, et, tandis que ses derniers rayons éclairaient encore les sommets des montagnes, des ombres épaisses recouvraient les vallées. Les cimes des arbres aux feuilles jaunes se profilaient fortement sur le ciel d’un bleu pâle. L’approche de l’automne se sentait dans toutes sortes de choses : comportement des oiseaux et des insectes, l’herbe desséchée et l’air.
Ayant franchi une crête peu élevée, nous pénétrâmes dans la vallée voisine où croissait une forêt épaisse. Le lit large et desséché d’un ancien torrent de montagne en suivait le milieu. Là, nous nous séparâmes ; je pris la gauche, en longeant la bande des galets, et Olènetiev la droite. Deux minutes s’étaient à peine écoulées qu’un coup de feu retentit, venant du côté d’Olènetiev. Je me retournai et entrevis un instant quelque chose de souple et de bigarré qui apparut à une certaine hauteur. Je me précipitai vers Olènetiev. Il essayait en toute hâte de recharger son fusil, mais, par une malheureuse coïncidence, une cartouche s’était coincée dans la boîte et la culasse ne fermait pas.
« Sur quoi as-tu tiré ? » lui demandai-je.
« C’était, je crois, un tigre, dit-il. Il se trouvait sur un arbre. Je l’ai bien visé et dois l’avoir touché. »
Enfin, la cartouche coincée fut extirpée.
Olènetiev rechargea son arme et nous nous dirigeâmes prudemment vers l’endroit où l’animal avait disparu. Du sang répandu sur l’herbe sèche nous montrait qu’il avait été réellement blessé. Soudain, Olènetiev s’arrêta et se mit à prêter l’oreille. Devant nous, un peu sur la droite, on entendait un râle. Mais le fouillis des fougères nous empêchait de rien voir. Un grand arbre tombé par terre nous barrait le chemin. Olènetiev s’apprêtait déjà à le franchir, mais l’animal blessé le devança et bondit en avant. Olènetiev fit feu à bout portant sans avoir même eu le temps d’épauler, et le résultat fut merveilleux. La balle atteignit le fauve droit dans la tête. L’animal tomba sur une branche et y resta affalé de telle manière que la tête pendait d’un côté et le reste du corps de l’autre.
Après quelques mouvements convulsifs, il se mit à mordre la branche, puis perdit l’équilibre et s’écroula lourdement aux pieds du chasseur.
Je reconnus tout de suite que c’était une panthère de Mandchourie (Felis Orientalis). Ce magnifique spécimen de la race des félins comptait parmi les plus grands. La longueur de son corps, du bout du museau à la racine de la queue, atteignait un mètre quarante. Sa peau d’un jaune d’ocre sur les côtés et sur le dos et blanche sur le ventre était marquée de taches noires disposées en rayures comme celles d’un tigre. Sur les côtés, les pattes et la tête, elles étaient petites et d’une seule couleur ; sur le dos et la queue, grandes et ocellées.
Dans la région de l’Oussouri, on ne trouve guère de panthères que dans le sud et plus particulièrement dans les districts de Souïfoun, Possiet et Barabachev. Leur principale nourriture consiste dans les cerfs tachetés, les chevreuils et les faisans. La panthère est un animal extrêmement rusé et prudent. Poursuivie par les chasseurs, elle se réfugie sur les arbres et s’agrippe à la branche qui se trouve juste au-dessus de la place qu’elle vient de quitter, à l’opposé du rayon visuel du chasseur. Étendue sur cette branche, elle pose la tête sur ses pattes de devant et se fige dans cette position, se rendant parfaitement compte que vu par-devant son corps est moins visible que de côté.
Le dépouillement de l’animal que nous venions de tuer nous demanda une heure entière. Quand nous prîmes le chemin du retour, la tombée de la nuit était déjà assez marquée.
Nous avancions lentement. Enfin apparurent les feux du bivouac et bientôt on put distinguer les silhouettes des hommes parmi les arbres ; elles remuaient en formant des ombres devant le feu. Les chiens nous accueillirent par un concert d’aboiements. Les tireurs entourèrent la panthère, la détaillant et émettant leurs avis. On discuta jusqu’à la nuit.
Le lendemain, nous nous remîmes en marche.
La vallée devenait plus étroite et la progression était plus difficile. Le cerf qui habite la région de l’Amour s’appelle le maral (Cervus canadensis). Cet animal est élancé et très gracieux ; il a environ deux mètres de long et un mètre cinquante de haut. Son poids peut atteindre jusqu’à deux cents kilos. Sa robe est brun clair en été et gris fauve avec un disque jaunâtre derrière en hiver. Le cou est long et vigoureux avec une crinière chez les mâles. La tête est belle avec de grandes oreilles mobiles en forme de cornets. Les bois sont fourchus, pourvus de deux andouillers et d’andouillers basilaires. Le nombre des rameaux permet d’établir l’âge du maral en y ajoutant l’année où il a perdu ses bois. Pourtant, leur nombre est limité. En général, un mâle adulte n’en a pas plus de sept. Les jeunes bois qui apparaissent au printemps, recouverts d’une peau sous laquelle circulent des vaisseaux sanguins et qui ne sont pas encore durs, s’appellent « panty ».
Dans la région de l’Oussouri, le maral habite le sud de la contrée, dans toute la vallée de ce fleuve et de ses affluents, ne dépassant pas la zone des conifères de Sihoté-Aline. Sur le littoral de la mer, on le rencontre jusqu’à la baie de l’Olympiade.
En été, le maral se tient dans les endroits ombragés des montagnes boisées ; en hiver, aux endroits ensoleillés, dans les vallées, dans les parties plates de la taïga, dans les clairières et sur les bordures.
À midi, nous fîmes une grand-halte. Nous devions nous trouver, d’après mes suppositions, non loin de la montagne à forme de coupole.
Il faut compter dans une expédition non seulement avec la force de résistance de l’homme, mais surtout avec celle des bêtes de somme. Elles portent de lourdes charges et, à chaque halte plus ou moins prolongée, on doit les en débâter.
Dès que les chevaux furent débarrassés de leurs harnachements, on les mit en liberté ; comme sous les feuillages l’herbe était encore verte, elle nous fournit un bon fourrage.
1. Littéralement : « Les montagnes pointues ».
2. « La rivière où il y eut beaucoup de combats. »
3. Fanza : type de hutte construite par les paysans et les chasseurs chinois et coréens dans ces régions de Sibérie. (N.d.É.)
4. Le nom sibérien signifie : « Vallée de la poussière sèche ».
II
Le visiteur nocturne
Après la halte, notre convoi se remit en marche, mais à cause des difficultés du terrain boisé, nous n’arrivâmes que vers le soir à mi-côte d’une montagne inconnue. J’arrêtai hommes et chevaux et grimpai seul au sommet pour reconnaître un peu le pays. Heureusement, mon incertitude fut aussitôt dissipée ; la hauteur que nous venions d’atteindre représentait bien, dans cette région montagneuse, le noyau central faisant l’objet de nos recherches.
Quand je rejoignis mon détachement, le soleil allait toucher l’horizon et il nous fallut nous hâter de trouver de l’eau, indispensable aux hommes comme aux animaux. Nous dûmes vite redescendre cette hauteur par un autre versant qui offrit au début une pente douce, mais devint ensuite escarpé. Pour pouvoir continuer la marche, les chevaux ployaient leurs jambes de derrière, les charges venant constamment glisser en avant. Si les selles n’étaient pas pourvues d’avaloires, ces fardeaux descendraient jusque sur les têtes des animaux. Nous fûmes obligés d’exécuter maints zigzags bien difficiles au milieu des tas de rompis.
Le col franchi, nous nous trouvâmes aussitôt dans des terrains ravinés.
« Ça va, dirent les soldats, on va coucher tant bien que mal. C’est pas pour toute l’année ! Demain, nous trouverons un pays plus gai. »
Je n’aimais pas trop ce lieu de campement, mais je n’avais pas le choix. Comme un torrent bruyait au fond de la gorge, c’est là que je me dirigeai. Ayant trouvé un endroit assez uni, j’ordonnai d’y planter nos tentes. Dans la paix de la forêt retentirent tout de suite des coups de hache et des voix d’hommes. Mes fusiliers se mirent à apporter du combustible, à desseller les chevaux et à préparer le souper.
Pauvres animaux ! Dans ce pays pierreux et encombré de bois abattu, ils allaient rester affamés. On se consolait en pensant qu’ils seraient bien nourris le lendemain, à condition d’arriver jusqu’à des fanzas agricoles.
Notre bivouac se calmait peu à peu. Après le thé, chacun s’occupa de son travail : l’un nettoyait sa carabine, l’autre raccommodait sa selle ou recousait son vêtement ; il y a toujours beaucoup de cette besogne. Dès qu’ils s’en furent acquittés, les hommes se serrèrent tant qu’ils purent les uns contre les autres, se couvrirent de leurs capotes et dormirent comme des morts. Les chevaux, qui n’avaient pas de quoi se nourrir dans la forêt, se rapprochèrent du camp et s’assoupirent, les têtes penchées tout bas.
Seuls Olènetiev et moi ne nous couchâmes pas de sitôt. J’inscrivais dans mon journal l’itinéraire parcouru, tandis que le soldat réparait ses chaussures. Vers 10 heures du soir, je refermai mon calepin pour m’étendre près du feu, enfoui dans mon « bourka » (burnous caucasien).
Tout à coup, les chevaux levèrent la tête, dressèrent les oreilles, puis ils se calmèrent et s’assoupirent de nouveau. Nous n’y fîmes d’abord pas trop attention et continuâmes à parler. Quelques minutes se passèrent. Je posai une question à Olènetiev ; comme il ne me répondait pas, je me tournai vers lui. Il était debout, aux aguets, regardant au loin et protégeant de la main ses yeux contre la lumière du bûcher.
« Qu’est-il arrivé ? » lui demandai-je.
« Quelqu’un descend la côte », murmura-t-il en réponse.
Nous nous mîmes tous les deux aux écoutes, mais les environs étaient calmes, pénétrés de cette paix qui ne se retrouve qu’aux bois, par une froide nuit d’automne. Soudain, des pierres menues vinrent rouler de la montagne.
« Ça doit être un ours », dit Olènetiev en chargeant son fusil.
« Ne tirez pas ! C’est un homme !... » retentit une voix dans l’obscurité. Peu de minutes après, quelqu’un s’approcha de notre feu.
Cet individu était habillé d’une veste et d’une culotte en peau de renne tannée. Coiffé d’une sorte de bandeau, il portait aux pieds des « ountes » (chaussures sibériennes en peau d’élan ou de chamois tannée et rendue très souple). Une grande besace au dos, il avait en main des « fourches » (petits supports servant à viser) et une carabine aussi longue que démodée.
« Bonjour, capitaine », me dit ce nouveau venu.
Là-dessus, il posa son fusil contre un arbre, enleva de son dos la besace, essuya de la manche son visage en sueur et s’assit près du feu.
Ce n’est qu’à ce moment-là que je pus bien l’examiner. Il faisait environ quarante-cinq ans. Plutôt petit, trapu, il avait le type indigène prononcé : les pommettes saillantes, le nez petit, les yeux distinctement caractérisés par le pli mongol des paupières et la bouche large.
Mais cet inconnu ne nous toisait point de son côté. Il tira de sa poche intérieure une blague à tabac, bourra sa pipe et se mit à fumer en silence. Selon la coutume de la taïga, je l’invitai à souper, sans lui demander qui il était ni d’où il venait.
« Merci, capitaine, dit-il. J’ai très faim, n’ayant pas mangé de la journée.»
Je continuai à l’observer pendant qu’il attaquait la nourriture. Un couteau de chasse pendait à sa ceinture ; c’était évidemment un chasseur. Il avait les mains durcies et égratignées. D’autres éraflures, encore plus profondes, marquaient son visage, l’une au front, l’autre à la joue, près de l’oreille.
Notre convive était de l’espèce silencieuse. Olènetiev, qui n’y tenait plus, finit par lui poser cette question directe :
« Qu’es-tu ? Chinois ou coréen ? »
« Je suis Gold », fut la réponse toute brève.
« Tu dois être chasseur ? » lui demandai-je.
« Oui, répondit-il. Je chasse toujours et n’ai pas d’autre métier. Je ne suis pas pêcheur, rien que chasseur. »
« Mais où habites-tu ? » reprit Olènetiev.
« Je n’ai pas de maison, j’habite toujours la montagne. J’allume un bûcher et installe une tente pour dormir. Comment pourrait-on habiter une maison quand on ne fait que chasser ? »
Puis il nous conta que ce jour-là il avait pourchassé des cerfs et blessé une biche, mais sans l’abattre. Occupé à en suivre la piste sanglante, il vint à repérer notre passage et fut ainsi conduit vers cette gorge. Lorsque la nuit fut tombée, il vit notre feu et y alla directement.
« Je marchais lentement, dit-il. Je me demandais quels pouvaient être ces hommes qui se sont engagés si loin dans la montagne. Puis, apercevant un capitaine et des soldats, je vous ai relancés. »
« Comment t’appelles-tu ? » demandai-je à l’inconnu.
« Dersou Ouzala », répondit-il.
Cet homme m’intéressait. Il avait quelque chose de particulier. Parlant d’une manière simple et à voix basse, il se comportait avec modestie, mais sans la moindre bassesse... Au cours de notre longue conversation, il me raconta sa vie. J’avais devant moi un chasseur primitif qui avait passé toute son existence dans la taïga. Il gagnait par son fusil de quoi vivoter, échangeant les produits de sa chasse contre du tabac, du plomb et de la poudre que lui fournissaient les Chinois. Sa carabine était un héritage qui lui venait de son père.
Il me dit qu’il avait cinquante-trois ans et que jamais il n’avait eu de domicile. Vivant toujours en plein air, ce n’est qu’en hiver qu’il s’aménageait une « yourta » provisoire, faite soit en racines, soit en écorces de bouleau. Ses souvenirs d’enfance les plus reculés, c’étaient la rivière, une hutte, un bûcher, ses parents et sa petite sœur.
« Il y a longtemps qu’ils sont tous morts », conclut-il son récit, et il devint rêveur. Après un court silence, il ajouta encore : « Jadis, j’ai eu aussi une femme, un garçon et une fillette. Tous ont succombé à la variole et me voilà seul. »
J’avais envie de lui témoigner ma sympathie et de lui rendre quelque service, mais je ne savais comment m’y prendre. Enfin, j’eus l’idée de lui proposer d’échanger son vieux fusil contre un neuf, mais il refusa en disant qu’il tenait à sa carabine, souvenir de son père, et qu’il s’était habitué à cette arme qui portait d’ailleurs très bien. Etendant son bras vers l’arbre, il y prit la vieille arme et en caressa la crosse.
Les étoiles avaient déjà fait du chemin dans le ciel et indiquaient qu’il était bien au-delà de minuit, mais nous restions toujours à causer près du feu. Il est vrai que l’interlocuteur principal fut Dersou, tandis que je me bornais la plupart du temps à l’écouter, non sans plaisir. Il me parla de ses chasses, de ses rencontres avec des tigres. Une fois, il avait été attaqué et gravement blessé par un de ces félins. La femme du Gold le chercha pendant quelques jours. Lorsqu’elle le retrouva d’après ses traces, il était épuisé par une hémorragie. Pendant sa maladie, c’est la femme qui le remplaça pour aller à la chasse.
Je questionnai aussi Dersou sur la région où nous nous trouvions. Il m’expliqua que nous étions près des sources de la rivière Léfou et que nous devions arriver le lendemain à une fanza de trappeur.
Un des tirailleurs endormis se réveilla, nous regarda tous les deux d’un air étonné, marmotta quelque chose à part lui et se rendormit avec le sourire aux lèvres.
Le ciel et la terre étaient encore sombres ; on sentait à peine l’approche de l’aube à l’est, où continuaient cependant à paraître encore des étoiles nouvelles. Une rosée abondante couvrit le sol, annonçant avec certitude le beau temps pour la journée.
Au bout d’une heure, l’Orient commença à devenir vermeil. Je regardai ma montre, elle indiquait 6 heures. Il était temps de réveiller l’homme de service. Je le secouai par l’épaule jusqu’à ce qu’il parvînt à s’asseoir en s’étirant. Le feu du bûcher lui faisant mal aux yeux, il se renfrogna un peu. Puis il remarqua Dersou et prononça en souriant : « En voilà un drôle de bonhomme !... » Là-dessus, il commença à se chausser.
Bientôt notre camp se ranima ; les hommes se mirent à parler, les chevaux abandonnèrent leur pose engourdie ; un gravelot gazouilla quelque part ; plus bas, au fond du ravin, un autre lui fit chorus ; puis on entendit le cri du pivert et le piaulement incessant d’un pic noir. La taïga se réveilla. La lumière s’accroissait d’un instant à l’autre et, tout à coup, les rayons brillants du soleil s’échappèrent en gerbe par-dessus la crête des montagnes pour illuminer la forêt tout entière. Notre bivouac changea d’aspect. Un amas de cendres restait à la place de notre beau bûcher d’où le feu avait disparu ; des boîtes de conserves vides traînaient sur le sol et seules quelques perches émergeaient de l’herbe foulée, indiquant l’endroit où s’étaient élevées les tentes.
III
Une chasse au sanglier
Après le thé, les soldats commencèrent à charger nos chevaux. Dersou se prépara également à la marche. Ajustant sur le dos sa besace et prenant en main son fusil ainsi que sa petite fourche, il s’associa à notre détachement quand nous nous remîmes en route.
La gorge que nous eûmes à suivre était longue et sinueuse. D’autres ravins du même genre y venaient déboucher en y déversant leurs eaux. Peu à peu, cependant, elle s’élargissait et prenait le caractère d’une vallée. Les arbres qui y poussaient étaient marqués par de vieilles entailles qui nous amenèrent à un sentier.
Le Gold marchait en tête, ne cessant de regarder attentivement le sol. Parfois, il se baissait pour palper des mains le feuillage.
« Que fais-tu ? » lui demandai-je.
Dersou s’arrêta pour m’expliquer que cette sente, faite pour des piétons et non pour des chevaux, desservait une ligne de trappes à zibelines et qu’un passant solitaire, très probablement un Chinois, l’avait suivie peu de jours auparavant. Ses paroles nous frappèrent tous. Remarquant notre méfiance, Dersou s’exclama :
« Comment ne le comprenez-vous pas ? Eh bien, tu n’as qu’à regarder ! »
Sur quoi, il nous fournit des arguments qui ne laissèrent plus subsister aucun de nos doutes. Le tableau fut clair et simple, au point que je m’étonnai de ne pas l’avoir entrevu plus tôt. La sente ne portait nulle trace de pieds de chevaux et ses bords n’étaient pas dégarnis de branches ; aussi nos animaux ne la suivaient-ils qu’avec difficulté, en heurtant constamment de leurs charges les arbres avoisinants. De plus, les tournants étaient si raides que les chevaux ne pouvaient les emprunter et devaient être conduits par ailleurs. D’autre part, des poutres isolées, jetées à travers les ruisseaux, portaient bien certaines traces de passage, mais nulle part la sente ne descendait vers l’eau. Enfin, le rompis qui barrait le chemin n’était pas enlevé, ne permettant qu’aux hommes seuls d’avancer librement, tandis que les animaux étaient obligés de faire des détours. Tout cela prouvait bien que la sente n’était pas destinée à des bêtes de somme.
« Seuls des piétons ont passé par ici, il y a déjà quelque temps, observa Dersou, en se parlant plutôt à lui-même. Depuis, il est tombé de la pluie. » Là-dessus, il se mit à calculer la date de la dernière pluie.
Nous suivîmes ce chemin pendant près de deux heures. La forêt de conifères fit graduellement place à des bois mélangés. Peupliers, érables, trembles, bouleaux et tilleuls s’y rencontrèrent de plus en plus souvent. J’allais ordonner une seconde halte, mais le Gold me conseilla d’avancer encore un peu.
« Nous allons bientôt trouver une baraque », dit-il en me montrant quelques arbres à l’écorce enlevée.
Je compris aussitôt ce qu’il entendait. Cela indiquait la proximité d’une construction à laquelle l’écorce était destinée. Après dix minutes de marche accélérée, nous trouvâmes une petite baraque protégée par un toit à chevron unilatéral, située au bord d’un ruisseau et aménagée soit par des chasseurs, soit par des chercheurs de ginseng, plante dont la racine possède une vertu curative miraculeuse aux yeux des Chinois. Notre nouveau compagnon fit le tour de la baraque et nous confirma encore qu’un Chinois était venu fouler cette herbe assez récemment et avait passé une nuit à l’intérieur de la construction. La preuve en était fournie par des cendres que la pluie avait abattues depuis lors, par une modeste couche de foin et par une paire de vieilles genouillères jetées dehors, faites en « daba », sorte de drap bleu assez solide dont les Chinois confectionnent leurs vêtements. Je compris définitivement que Dersou n’était pas un homme ordinaire, mais un pionnier fort averti.
Comme il fallait nourrir nos chevaux, je décidai d’en profiter pour aller me coucher à l’ombre d’un cèdre où je m’endormis de suite. Olènetiev vint me réveiller au bout d’environ deux heures. En me relevant, je pus remarquer que Dersou avait fendu du bois, ramassé de l’écorce et déposé le tout dans la baraque. Je m’imaginai qu’il voulait l’incendier et crus devoir le dissuader de ce caprice. Pour toute réponse, il me réclama une pincée de sel et une poignée de riz. Curieux de savoir ses intentions, je lui donnai ce qu’il me demandait. Le Gold enveloppa soigneusement d’écorce quelques allumettes, mit le sel et le riz dans un autre morceau d’écorce et suspendit les deux paquets à un mur intérieur de la construction. Il aplatit ensuite l’écorce et fut prêt à repartir.
« Alors, tu comptes revenir par ici ? » demandai-je à Dersou.
Comme il répondit par un signe de tête négatif, je lui demandai à qui il laissait le riz, le sel et les allumettes.
« Quelqu’un d’autre va bien arriver ici, répondit le Gold. Il verra cette baraque et sera heureux d’y trouver du bois sec, des allumettes et de quoi manger pour ne pas périr. »
J’en fus profondément saisi. Ainsi, Dersou pensait d’avance à quelque passant inconnu. Il ne verrait cependant jamais cet anonyme et celui-ci, à son tour, ne saurait point à qui il serait redevable du feu et de la nourriture. Je me rappelai à ce propos que nos soldats brûlaient toujours, en quittant un bivouac, ce qui restait de combustible dans le bûcher. Ils ne le faisaient d’ailleurs nullement par malice, mais simplement pour s’amuser, et jamais je ne le leur avais interdit.
« Les chevaux sont prêts, il serait temps de partir », me dit Olènetiev en me rejoignant.
« En avant, marche ! » dis-je aux fusiliers et je les précédai sur le sentier, accompagné du Gold.
Au fur et à mesure que nous avancions, ce sentier s’élargissait et s’améliorait. À un endroit, nous passâmes près d’un arbre abattu par des coups de hache. Dersou s’en approcha pour l’examiner et me dit :
« On a coupé ça au printemps. Deux hommes y ont travaillé ensemble : l’un, grand de taille, se servait d’une cognée émoussée ; l’autre, qui était petit, avait une hache bien tranchante. »
Pour cet être surprenant, il n’existait pas de secrets. Il savait tout ce qui se passait dans le pays. Je décidai alors d’être attentif moi-même et de me débrouiller dans les traces que je parviendrais à repérer. Bientôt, je vis un nouveau chicot travaillé à coups de hache. Tout autour, étaient de nombreux copeaux imbibés de résine. Je compris que quelqu’un s’était procuré, à cet endroit, du bois d’allumage. Mais que pouvait-on en conclure de plus ? Je n’y étais point du tout.
« Il y a là une fanza », observa Dersou, comme pour répondre à mes réflexions.
Bientôt, en effet, nous rencontrâmes de nouveau quelques arbres dénudés d’écorce (ce dont je connaissais déjà la signification) et, non loin de là, tout au bord de la rivière, une fanza de chasse installée sur une toute petite pelouse. C’était une construction exiguë aux murs en terre glaise et à la toiture en écorce. Elle était vide, la porte d’entrée étayée par un pieu. Près de la fanza se trouvait un verger minuscule, au sol ravagé par des sangliers.
De cet endroit, notre marche se poursuivit par un sentier bien battu, praticable pour les chevaux. Les soldats lâchèrent leurs brides, les jetant au cou des animaux et abandonnant à ceux-ci le choix de la direction. Les bêtes intelligentes marchaient très bien, s’appliquant à ne pas heurter leurs charges contre les arbres. Dans les terrains marécageux ou pierreux, elles se gardaient de faire des bonds et avançaient avec précaution, en tâtant des pieds le sol sur lequel elles allaient s’engager. C’est là une qualité des chevaux de l’Oussouri accoutumés à transporter des charges à travers la taïga.
Nous arrivâmes ainsi à des fanzas agricoles situées sur la rive droite du Léfou, au pied d’une montagne assez haute, le mont Tou-dinzy.
L’apparition subite d’un détachement militaire jeta le trouble parmi les Chinois. Je chargeai Dersou de leur dire de ne rien avoir à craindre et de continuer leurs travaux. Les habitants de cette région sont moins agriculteurs que chasseurs et trappeurs comme le prouvaient les peaux de lynx, de zibelines, de martres mises à sécher dans leurs fanzas, les bois de cerfs entassés, les outils pour la confection des pièges. Pourtant, il y avait près de ces fanzas quelques petits terrains de culture. Les Chinois y semaient du froment, du sarrasin et du maïs. Mais, récemment, des troupes entières de sangliers étaient descendues des hauteurs, abîmant les champs de ces vallées ; il fallut donc récolter les céréales non encore mûres. Cependant, les glands venant de joncher le sol des chênaies, les animaux s’étaient retirés dans les bois.
Le soleil était encore haut dans le ciel et je décidai de gravir la montagne pour jeter un coup d’œil sur les environs. Dersou m’accompagna. Nous partîmes dépourvus de tout lest inutile, ne prenant que nos carabines.
Les feuilles jaunies avaient déjà commencé à tomber. La forêt se dévêtait partout ; seules les chênaies gardaient leur parure intacte, bien que ternie. La montagne étant escarpée, il nous arriva de faire plus d’une halte au cours de notre ascension. Autour de nous, le sol entier était éventré. Le Gold s’arrêtait souvent pour examiner les pistes. Elles lui servaient à deviner l’âge et le sexe des bêtes. Il remarqua les traces d’un sanglier boiteux, ainsi qu’un endroit où deux de ces animaux avaient lutté, l’un pourchassant l’autre. Ses paroles me permirent de reconstituer nettement ce tableau. Je trouvai même singulier de ne pas avoir observé toutes les traces de ce genre dans le passé.
Au bout d’une heure, nous arrivâmes au sommet du Tou-dinzy, obstrué par des éboulements. Là, nous prîmes place sur des pierres et essayâmes de nous orienter.
À l’est, se prolongeait la ligne de faîte des bassins du Léfou et de la Daoubi-khé. Une autre chaîne montagneuse s’étendait de l’est à l’ouest, séparant le Léfou du Maï-khé.
Du haut du Tou-dinzy, on voyait très bien tout le bassin du haut Léfou, composé de trois rivières d’égale importance.
« Regarde, capitaine, me dit Dersou, en désignant le versant opposé. Qu’est-ce là ? »
En jetant un rapide coup d’œil, je remarquai une tache sombre. Je crus que c’était l’ombre projetée par un nuage et exprimai cette supposition au Gold. Il répondit par un rire, en me montrant le ciel. Je levai la tête et m’aperçus qu’il n’y avait pas un seul nuage, Au bout de quelques minutes, la tache se modifia et changea un peu de place.
« Qu’est-ce donc ? » demandai-je à mon tour.
« Tu ne le comprends pas, me répondit-il. Vas-y et regarde. »
Nous redescendîmes. Je remarquai bientôt que la tache venait également à notre rencontre. Au bout d’une dizaine de minutes, Dersou s’arrêta et s’assit sur une pierre, en me faisant signe de l’imiter.
« Nous devons attendre ici, me dit-il. Mais il faut rester tranquille, sains rien casser, sans parler. »
Après une courte attente, je revis la même tache. Cependant, je pus maintenant distinguer que c’étaient des êtres vivants qui se déplaçaient sans cesse et je devinai ce que c’était : des sangliers !
En effet, il y avait là plus d’une centaine de pachydermes sauvages. Certains de ces animaux s’écartaient de la troupe, mais ne tardaient pas d’y revenir. Bientôt, on put discerner chaque bête séparément.
« Il y a là un homme bien volumineux », remarqua Dersou à voix basse.
Ne comprenant pas de quel homme il voulait parler, je le regardai avec étonnement.
Au milieu de la troupe se détachait, tel un monticule, le dos d’un sanglier énorme, dépassant tous les autres par ses proportions. Les animaux venaient toujours plus près, on entendait distinctement le bruit des feuilles sèches battues par des centaines de pieds, le craquement des branches, les grognements des bêtes adultes et les glapissements des marcassins.
« Il ne faut pas approcher le gros homme », fit Dersou, mais de nouveau je ne pus le comprendre.
Le sanglier énorme se tenait au centre, pendant que maints autres s’en allaient parfois assez loin de la troupe. Ainsi, lorsque ces bêtes isolées arrivèrent tout près de nous, le grand sanglier se trouvait encore hors de la portée de nos fusils. Nous restions assis sans bouger. Soudain, l’un des sangliers les plus proches, en train de mâcher, releva son groin. Je crois revoir encore sa grosse tête, ses oreilles dressées, sa face mobile et ses défenses blanches. La bête se figea, cessa de manger et fixa sur nous ses yeux méchants. Saisissant le danger, l’animal poussa un grognement perçant. Du coup, la troupe entière se jeta de côté en s’ébrouant au milieu du tumulte. À ce moment, un coup de feu partit et l’un des animaux s’écroula.
La carabine du Gold fumait. Pendant quelques secondes encore, on entendit dans la forêt le craquement des branches sèches, puis la paix se rétablit. La bête tuée par Dersou était une laie de deux ans. Elle avait le poil brun, le dos et les jambes noirs, comme tous les sangliers de l’Oussouri, la tête en forme de coin, le cou court et puissant. Le sanglier de l’Oussouri (Sus. leucomystax continentalis) ressemble au sanglier japonais. Son poids peut atteindre deux cent cinquante kilos environ ; les défenses du mâle sont très pointues, elles ont parfois vingt centimètres de longueur. Comme le sanglier aime à se frotter contre les pins et les cèdres, son poil est souvent mêlé de résine. En hiver, il se couche dans la boue, l’eau gèle sur son corps et les glaçons ainsi formés sont si épais qu’ils entravent ses mouvements. Le sanglier de l’Oussouri est aussi alerte que vigoureux. Blessé, il devient très dangereux ; malheur au chasseur qui oserait le poursuivre sans prendre de grandes précautions. Je demandai à mon compagnon pourquoi il n’avait pas abattu un sanglier adulte.
« Oh ! un vieillard ! riposta-t-il, entendant par là tout sanglier mâle aux défenses bien développées. C’est mauvais à manger, la chair a déjà une petite odeur. »
Je fus frappé, comprenant enfin que le Gold appelait les sangliers des « hommes » et l’interrogeai à ce sujet.
« Mais c’est bien des hommes, m’assura-t-il. Bien que vêtus d’une autre manière, ils connaissent la fraude, la colère et tout le reste. Ils sont comme nous... »
Je me rendis compte que cet être primitif professait une sorte d’anthropomorphisme et l’appliquait à tout ce qui l’environnait.
Dersou écorcha sommairement la laie abattue et se la mit sur les épaules. Nous reprîmes aussitôt le chemin des fanzas et arrivâmes au bout d’une heure à notre bivouac.
Comme les habitations chinoises étaient étroites et enfumées, je résolus de coucher à la belle étoile, près de Dersou. Celui-ci, après avoir scruté le ciel, émit cet avis :
« Je pense que la nuit sera chaude, mais, demain soir, nous aurons de la pluie... »
IV
Incident dans un village coréen
Dans la matinée, je me réveillai plus tard que les autres et fus surpris de ne pas voir le soleil. Le ciel entier était couvert. Remarquant que les soldats prenaient soin, au moment d’emballer leurs sacs, de les préserver contre la pluie, Dersou dit simplement :
« Pas de hâte ! Nous marcherons bien pendant la journée, il ne pleuvra que le soir. »
Je lui demandai pourquoi il ne prévoyait pas de pluie durant la journée.
« Regarde un peu de tes propres yeux, me répondit-il. Tu vois que les petits oiseaux vont de tous les côtés, qu’ils jouent et mangent. Quand la pluie est proche, ils restent tranquilles, tout comme s’ils dormaient. »
Je me rappelai que toute pluie, en effet, était précédée d’un temps calme et morne, tandis qu’à ce moment les bois étaient pleins de vie : on entendait partout un concert de piverts, de geais et de casse-noix, auxquels répondaient les sifflements joyeux d’une quantité de grimpereaux affairés.
Après avoir demandé aux Chinois quelques détails sur le chemin à suivre, nous reprîmes la marche.
À partir de cet endroit, la vallée du Léfou gagne subitement en extension et l’on y voit apparaître certaines agglomérations. Vers 2 heures de l’après-midi, nous arrivâmes à un village où je pris un peu de repos, en chargeant Olènetiev d’acheter de l’avoine et de bien nourrir les chevaux. Pour ma part, je continuai aussitôt le chemin en compagnie de Dersou, voulant atteindre au plus vite un autre village, habité par des Coréens, afin d’y assurer au détachement un abri couvert pour la nuit.
En automne, par un temps gris, le crépuscule vient toujours assez tôt. Vers 5 heures, une pluie fine commença à tomber. Nous accélérâmes le pas. Bientôt, la route bifurqua devant nous, l’un de ses embranchements s’en allant traverser la rivière et l’autre semblant conduire vers la montagne. Nous choisîmes ce dernier. Mais d’autres chemins se présentèrent encore, coupant le nôtre dans diverses directions.
Lorsque nous atteignîmes le village coréen, l’obscurité était déjà complète.
Mes soldats, qui arrivaient à cette même heure à un croisement des routes et ne savaient plus où aller, tirèrent deux coups de fusil. Pour ne pas les laisser s’égarer, je leur répondis par le même signal. Soudain, un cri retentit dans la fanza la plus rapprochée, suivi d’un coup de feu, puis d’un second et d’un troisième, si bien qu’une fusillade éclata au bout de quelques minutes dans le village entier. Je n’y comprenais plus rien : cette pluie, ces cris, ces coups de fusil... Qu’était-il arrivé et pourquoi toute cette alarme ? Une lumière brilla subitement à l’angle d’une fanza et un Coréen fit son apparition, portant d’une main une torche à pétrole et de l’autre une carabine. Il courait en poussant des cris incompréhensibles. Nous nous jetâmes à sa rencontre. La lumière vacillante et rougeâtre de sa torche voltigeait d’une mare à l’autre et illuminait sa face altérée par la peur. Quand il nous aperçut, cet homme jeta sa torche, tira à bout portant sur Dersou et s’enfuit. Le pétrole épandu par terre s’enflamma aussitôt, projetant feu et fumée.
« Tu n’es pas blessé ? » demandai-je au Gold.
« Non », répondit-il en ramassant la torche.
Je voyais cependant que l’on tirait encore sur Dersou. Mais lui se dressait de toute sa petite taille, se contentant d’agiter la main et de crier quelque chose aux Coréens.
Entendant la fusillade, Olènetiev en conclut que nous étions attaqués par des houndhouzes. Il laissa deux conducteurs auprès des chevaux et accourut avec le reste du détachement à notre rescousse.
À la fin, on cessa de tirer de la fanza voisine. Dersou en profita pour entrer en pourparlers avec les Coréens. Mais ceux-ci ne voulurent à aucun prix ouvrir leurs portes. Ils lançaient des jurons et menaçaient de recommencer à tirer. Il ne nous restait qu’à installer un bivouac. Nous allumâmes des bûchers au bord de l’eau et plantâmes nos tentes. À côté d’une vieille fanza délabrée, située un peu à l’écart, se dressaient des tas de bois que les Coréens avaient amassés pour l’hiver.
La fusillade ne cessa d’ailleurs point de sitôt dans le village. Toute la nuit, des coups de feu partaient des fanzas plus éloignées. Qui donc voulait-on repousser ? Ces gens ne le savaient pas eux-mêmes.
Le lendemain, j’ordonnai une journée de repos, mais je dis aux soldats d’examiner les selles, de sécher tout ce qui était mouillé et de nettoyer les armes. La pluie avait cessé ; un vent frais, qui venait du nord-ouest, chassa les nuages ; le soleil reparut. Je m’habillai et allai voir le village.
Il eût semblé naturel, après l’escarmouche de la veille, de voir les Coréens arriver à notre camp pour regarder un peu les hommes sur lesquels ils avaient tiré. Eh bien, pas du tout ! Deux individus sortirent d’une fanza voisine, vêtus de vestes blanches aux manches bouffantes et de pantalons de coton blanc. Leurs chaussures étaient faites de cordes tressées. Ils passèrent à côté de nous sans nous jeter un regard. Près d’une fanza était assis un vieillard qui tressait des fils. Quand je m’en approchai, il leva la tête et me regarda d’un œil qui n’exprimait ni curiosité ni étonnement. Une femme venait le long de la route à notre rencontre, vêtue d’une jupe et d’une veste toutes blanches. Portant sur la tête une cruche en grès, elle avançait droit devant elle, d’une démarche mesurée, les yeux baissés vers la terre. En nous croisant, elle ne songea ni à s’écarter, ni à lever les yeux, mais continua tranquillement son chemin. D’ailleurs, n’importe où j’allais, je retrouvais cette indifférence surprenante qui est propre aux Coréens.
Ils habitent des fanzas détachées, qui sont assez éloignées l’une de l’autre et dont chacune est entourée de ses champs et potagers. Un village coréen de peu d’importance occupe ainsi une superficie de plusieurs kilomètres carrés.
En revenant à notre bivouac, j’entrai dans l’une des fanzas. Ses murs minces étaient enduits de glaise tant au-dedans qu’au-dehors. L’habitation avait trois ouvertures grillagées découpées dans les portes et protégées par des feuilles de papier collé. La toiture en paille était couverte d’un réseau d’herbes sèches. À l’intérieur, je retrouvai la même femme que nous avions rencontrée en chemin. Accroupie par terre, elle versait de l’eau, d’un broc en bois, dans une marmite. Elle le faisait lentement, tenant le broc à une grande hauteur et laissant couler l’eau d’une manière singulière, la main renversée à droite. Elle me regarda avec indifférence et poursuivit sa besogne. Un homme quinquagénaire était assis sur le « kang » (sorte de grande couche) à fumer sa pipe. Il ne fit pas un mouvement et ne répondit même pas à mon salut. Je restai assis là pendant une minute et ressortis pour rejoindre mes compagnons.
Après dîner, j’entrepris une excursion aux environs et ne revins qu’au crépuscule. Le village coréen gardait son calme complet. De petites fumées blanches filtraient des cheminées et s’évaporaient rapidement dans l’air frais du soir. Sur les sentiers apparaissaient de-ci de-là quelques silhouettes blanches d’indigènes. Dans le bas, tout au bord de la rivière, brillait un feu : c’était notre bivouac. L’eau du courant semblait noire et sa surface unie reflétait la flamme du bûcher ainsi que les étoiles miroitant au ciel. Les tirailleurs étaient assis autour du feu ; l’un racontait quelque chose, les autres riaient.
« À la soupe ! » cria le soldat de service.
Les rires et les plaisanteries s’arrêtèrent immédiatement.
Après le repas, je m’assis auprès du bûcher et me mis à inscrire quelques notes dans mon journal. Dersou examinait le contenu de sa besace et attisait le feu.
« Ça pique un peu », fit-il en serrant les épaules.
« Va te coucher dans la fanza », lui conseillai-je.
« Je n’y pense pas, répondit-il. Je dors toujours dehors. »
Il planta dans le sol quelques perches de tremble, les entoura d’une grosse toile de tente, étendit par terre une peau de chèvre pour s’y asseoir, jeta sur les épaules sa veste en cuir et alluma sa pipe. Quelques minutes après, j’entendis un léger ronflement. Dersou dormait. Sa tête se pencha sur sa poitrine, ses bras se détendirent, la pipe éteinte tomba de sa bouche et roula sur ses genoux... « Et dire qu’il en va ainsi tout le long de cette existence, pensai-je à ce moment. Ce que ça doit coûter de peines et de privations de gagner sa vie comme le fait cet homme !... »
Le lendemain, nous nous levâmes tous de grand matin. Nos chevaux, qui n’avaient pas trouvé de quoi manger la nuit dans les champs des Coréens, s’en étaient allés paître du regain du côté de la montagne. Pendant qu’on les cherchait, le soldat de service prépara le thé et fit bouillir la « kacha » (gruau). Lorsque les tirailleurs ramenèrent les animaux, j’avais eu le temps de terminer mon travail. Nous partîmes à 8 heures du matin.
Plus nous avancions, plus la vallée prenait l’aspect d’une prairie. Les montagnes semblaient avoir reculé quelque part, pour faire place à de vastes pentes douces, couvertes de petites broussailles. Dans la soirée, assis à côté de Dersou près du bûcher, je discutai avec lui la suite de notre itinéraire qui allait longer tout le Léfou. J’avais bien envie de pousser jusqu’au lac de Hanka, décrit par Prjevalski. Le Gold me prévint cependant, que nous allions trouver de vastes marais et une absence totale de chemins ; aussi me conseilla-t-il de me servir d’un bateau, en laissant en arrière les chevaux et une partie du détachement. C’était là un conseil pleinement justifié.
En conséquence, je ne me fis accompagner, le lendemain matin, que par Olènetiev et par le fusilier Martchenko, expédiant les autres soldats au village de Tchernigovka où je leur dis d’attendre mon retour. Avec le concours du staroste, nous réussîmes très vite à obtenir un canot à fond plat et passâmes la journée à l’aménager.
Dersou ajusta lui-même les rames, se servant de petits pieux pour faire des tolets, installa des banquettes et prépara des perches. J’admirai l’habileté et l’énergie de son travail. Jamais il ne s’agitait, chacun de ses actes était réfléchi et il savait éviter tout délai. On voyait que l’école de la vie lui avait enseigné de ne pas perdre le temps d’une manière inutile.
Par un heureux hasard, nous trouvâmes dans une isba du biscuit bien sec. C’était exactement ce qu’il nous fallait, puisque nous disposions en quantités suffisantes de toutes les autres denrées nécessaires, telles que thé, sucre, sel, gruau et conserves.
Sur le conseil du Gold, l’ensemble de nos fournitures fut transporté le même soir à bord du bateau qui reposait encore sur la berge ; nous passâmes ainsi la nuit sur les rives du fleuve.
Nous fûmes gratifiés d’une nuit froide, accompagnée de rafales. Le manque de bois nous empêcha de faire un grand feu, et nous grelottions sans presque pouvoir dormir. Quoi que je fisse pour mieux m’envelopper dans mon manteau, le vent trouvait toujours quelque part une fente pénétrant tantôt jusqu’à l’épaule, tantôt jusqu’au côté ou au dos. Le bois était assez mauvais ; il crépitait en projetant des étincelles de tous côtés. La couverture de Dersou avait été brûlée par endroits. J’entendais dans mon sommeil comme il maudissait les bûches, les appelant, selon sa manière : « Sales gens. »
« Elles brûlent souvent ainsi ; on croirait qu’elles crient », disait-il comme s’il s’adressait à quelqu’un et imitant de sa voix le crépitement du bois.
J’entendis ensuite un clapotis sur la rivière et le sifflement d’un tison qui tombe. Le vieillard devait l’avoir jeté à l’eau. Puis, je réussis tant bien que mal à me réchauffer et m’endormis.
La nuit, je m’éveillai et aperçus Dersou assis devant le feu et l’arrangeant. Par-dessus ma capote se trouvait la couverture du Gold. C’est donc à lui que je devais de m’être réchauffé et d’avoir pu m’endormir. Les chasseurs, eux aussi, étaient abrités sous sa tente. J’offris à Dersou de se coucher à ma place, mais il refusa.
« Non, capitaine, dit-il. Dors, je garderai le feu. Elles sont si méchantes », dit-il en désignant les bûches.
Plus j’observais cet homme et plus il me plaisait. Chaque jour, je lui découvrais de nouvelles qualités. J’avais toujours pensé auparavant que l’égoïsme est le propre de l’homme primitif et que les sentiments d’humanité étaient inhérents aux seuls civilisés. Ne m’étais-je pas trompé ? Sur ces pensées, je retombai dans le sommeil jusqu’au matin.
V
Notre navigation le long du Léfou
Dersou nous réveilla quand il fit jour. Il fit chauffer le thé et rôtir de la viande. Après le déjeuner, nous lançâmes le bateau à l’eau et commençâmes notre périple.
À l’aide des perches, l’embarcation suivit facilement le courant. Au bout de cinq kilomètres, nous arrivâmes à un pont ferroviaire où nous fîmes un arrêt. Dersou nous raconta qu’il avait accompagné son père dans cette région lorsqu’il n’était encore qu’un gamin. Ils y venaient chasser le daim. Mais jamais le Gold n’avait vu un chemin de fer, bien qu’il en eût entendu parler par les Chinois.
Près du pont s’élevaient les derniers contreforts des montagnes. Je quittai le bateau pour monter sur la hauteur la plus proche et faire un dernier tour d’horizon. Un beau panorama se développa devant mes yeux. En arrière, vers l’est, se massaient des montagnes ; au sud, se déployaient des pentes douces, revêtues de forêts clairsemées et dépourvues de conifères ; au nord, s’étendait à perte de vue un terrain bas, infini et couvert d’herbe. J’avais beau forcer la vue, je n’en voyais pas la limite. Il s’en allait disparaître au-delà de l’horizon. Chaque fois qu’un coup de vent balayait cette plaine, l’herbe ondulait et s’agitait comme une mer. On pouvait suivre de l’œil sur une grande distance le cours du Léfou d’après les bosquets d’aunes et de saules, poussant en abondance sur ses bords.
Ce repos ne fut pas long ; nous nous remîmes en route et fîmes la grande halte d’assez bonne heure. Chacun en avait assez de rester assis pendant des heures dans le bateau ; nous voulions tous en sortir pour détendre nos muscles engourdis. J’avais envie de battre la campagne. Olènetiev et Martchenko se mirent à installer un campement, tandis que Dersou et moi allions chasser.
Dès notre départ, nous fûmes entourés de hautes herbes sauvages. Elles étaient si grandes et si épaisses qu’un homme semblait s’y noyer. Au-dessous comme au-dessus de nous et de tous les côtés à la fois, il n’y eut bientôt plus que de l’herbe ; ce n’est que juste sur notre tête que l’on apercevait le ciel bleu. Il nous semblait que nous marchions au fond d’une mer verte. Cette impression ne faisait que s’accentuer quand je grimpais sur quelque motte d’où je pouvais voir les remous de la steppe. Avec une appréhension prudente, je replongeais dans l’herbe pour continuer le chemin. Dans cette région, on s’égare aussi facilement que dans une forêt. Plus d’une fois, nous perdîmes la direction et dûmes nous empresser de réparer notre faute. Aussitôt que je trouvais une motte, je montais dessus, essayant de voir ce qu’il y avait par-devant. Dersou saisissait des brassées d’herbes sauvages pour les plier à terre et me permettre de regarder devant moi, mais je ne voyais toujours que cette mer verte, infinie et ondulante.
Ces steppes marécageuses sont principalement peuplées d’oiseaux. Par surcroît, c’était le moment de leur migration d’automne. On ne peut s’imaginer ce qui se passe dans le bassin du Léfou lors de cette grande migration. Des millions et des millions d’oiseaux s’en vont vers le Midi, en grandes ou petites troupes. Certains se dirigeaient cependant en sens inverse ou encore en biais. Tantôt leurs volées s’élançaient vers le ciel, tantôt elles redescendaient. L’horizon semblait couvert d’une sorte de toile d’araignée.
Tout en haut, dominaient les aigles. Les ailes étendues, ils planaient en décrivant de larges cercles. Que leur importent les distances ? Certains de ces rois de l’air exécutaient leurs rondes à une telle hauteur qu’ils étaient à peine perceptibles. Au-dessous d’eux, mais toujours très haut, on voyait voler les oies. Ces oiseaux prudents, qui avançaient en triangles réguliers, à mouvements d’ailes lourds et peu coordonnés, faisaient retentir l’air de leurs cris stridents. À la même hauteur volaient des tadornes et des cygnes.
Plus bas, assez rapprochés de la terre, venaient les canards empressés. Il y avait là des troupes de gros canards sauvages ordinaires, ainsi que d’innombrables sarcelles et d’autres espèces plus menues. Les faucons décrivaient à leur tour de belles courbes et s’arrêtaient longtemps à un point fixe, faisant palpiter leurs ailes et épiant leur proie sur la terre. Quelquefois, ils se déplaçaient un peu, tournoyaient de nouveau et descendaient tout à coup en flèche, les ailes ployées, pour venir à peine frôler l’herbe et se relancer aussitôt vers le ciel.
D’autre part, les mouettes de rivière restaient de préférence aux endroits marécageux. Les flaques d’eau stagnante semblaient être des points de repère permettant à ces oiseaux d’observer la direction voulue.
Tout à fait à l’improviste, venant on ne sait d’où, un couple de daims apparut à une soixantaine de pas de l’endroit où nous nous trouvions. On ne pouvait presque pas les remarquer dans l’herbe épaisse à travers laquelle ne se laissaient apercevoir, de temps en temps, que leurs têtes aux oreilles écartées et les taches blanches au-dessus des jambes de derrière. Ils s’enfuirent à une distance de cent cinquante pas. Je tirai sur eux sans succès. L’écho sonore répéta le bruit du coup de feu et le porta tout au long de la rivière. Des milliers d’oiseaux s’envolèrent de l’eau, se sauvant en éventail. Les daims effrayés semblèrent s’arracher au sol et repartirent en grands bonds. Dersou épaula, mais n’appuya sur la détente qu’au moment où il vit la tête de l’un des animaux apparaître au-dessus de l’herbe. Quand la fumée se dissipa, nous n’aperçûmes plus les daims. Le Gold rechargea sa carabine et avança sans hâte. Je le suivis sans parler. Dersou regarda tout autour, fit volte-face et alla d’un autre côté pour revenir encore sur ses pas. Je voyais qu’il cherchait quelque chose.
« Que cherches-tu ? » lui demandai-je.
« Le daim », répondit-il.
« Mais il est parti ! »
« Non, fit-il avec assurance. Je l’ai touché à la tête. »