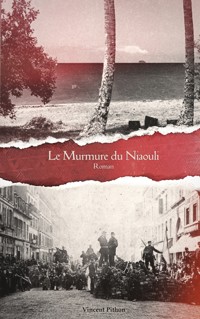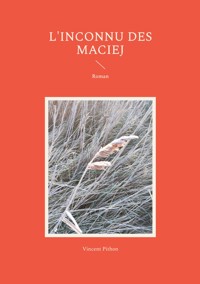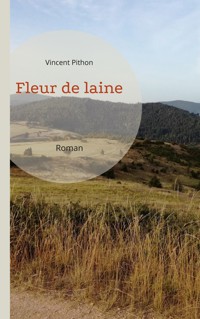Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mahdi est un garçon sensible et fragile, mais volontaire. Dans ce pays lointain, rien ne le dispose à choisir un autre destin. Des événements tragiques durant sa jeunesse le conduisent à prendre des décisions importantes. Sa vie est complètement transformée. La découverte d'un objet insolite lié à son histoire l'amène à entreprendre un long voyage. Il essaie de toutes ses forces de construire un pont entre le présent et son passé. Il tente avec sa naïveté et sa poésie de comprendre ce monde. Un chemin initiatique pour Mahdi. Semé d'embûches, il s'éclaire par de belles rencontres. parvient-il au terme de son périple ? Au bout du compte, réussit-il à trouver ce qu'il cherche ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[…]
Le cri des mouettes les rumeurs de la mer
Trop longtemps j'ai cherché la lumière
J'ai vu se briser tant de vagues sur la plage
Et j'ai chassé les ombres des nuages.
(La plage – Graeme Allwright – 1966)
Table
Chemin des Dames, printemps 1917
Saint-Louis, automne 2008
Paris, hiver 2019
Saint-Louis, été 2015
Bamako, printemps 2018
Gao, printemps 2018
Kidal, printemps 2018
Sahara, printemps 2018
Algérie, printemps 2018
Mer d’Alboran, printemps 2018
El Ejido, printemps 2018
Paris, hiver 2019
Ousmane, avant 2018
Alain, hiver 2019
Le journal, hiver 2019
Hôpital de campagne, printemps 1917
Retour au Sénégal, été 1919
Tours, hiver 2020
Paris, hiver 2019
Calais, hiver 2019
Berry-Au-Bac, hiver 2019
Loire, printemps 2020
Tours, printemps 2020
Calais, printemps 2020
Bord de Loire, printemps 2020
I - CHEMIN DES DAMES, PRINTEMPS 1917
L’épouvantable nuit touchait à sa fin. Un déluge continu de fer et de feu. René-Jean, sorti de sa tranchée la veille pour monter à l’assaut, a trouvé refuge, malgré lui, dans un trou d’obus. Il a senti le souffle de l’explosion contre son visage puis, d’un coup, le sol s’est dérobé sous lui. Il a glissé sur le dos sans pouvoir arrêter sa chute. Il ne pouvait pas se servir de ses mains. Elles étaient crispées sur son fusil. Il était tétanisé par le froid et la peur.
Quelques jours auparavant, il s’était confectionné des mitaines avec le vieux pull donné par un de ses camarades. Récupéré sans doute dans les affaires d’un compagnon d’infortune mort au combat.
Couvert de boue, il est frigorifié. Il tremble. Il a un goût de métal et de charbon dans la bouche. Le fond du trou baigne dans l’eau. En faisant basculer un morceau de bois avec ses pieds, il réussit à se mettre un peu plus au sec. Il est allongé sur le dos contre la paroi humide.
Ses vêtements crasseux puent. Sa peau le gratte. Les puces et les poux l’aiment et ne le quittent plus. Les bandoulières de ses sacs lui irritent le cou et son casque pèse une tonne. Il est pris de tremblements. Ses dents claquent. Il est envahi d’une sensation de froid glacial qui pénètre jusque dans ses os. Il est agrippé à son fusil qu'il colle contre lui. Il trouve la force de lever les yeux vers le haut. Le soleil est resté couché. Une journée ténébreuse s’avance.
Les balles sifflent au-dessus de lui. Le ciel s’est embrasé. Des gerbes de feu jaillissent tout autour de lui. Des morceaux de bois volent et tournoient. Parfois, ils traînent avec eux des fils de fer barbelés. Un mélange de cendres et de terre retombe au sol. Des flocons noirs. Il n’entend plus rien qu’un bourdonnement incessant. L’explosion a rendu sourd René-Jean. Un acouphène de combat. Il ne se souvient plus depuis combien de temps il patauge. Il sent une odeur de bois pourri, de boue et de poudre. Une exhalaison de sang et de cadavre. Il voit du liquide rouge s’écouler doucement le long des bords du trou dans lequel il est abrité et emprisonné. Ce n’est peut-être que de l’eau qui ruisselle. Il ne veut pas savoir. Ses mains sont soudées à son arme. Source de mort ou de vie. Mais il ne peut s’en servir. Pas encore. Impossible de remuer ses doigts.
Et toutes ces questions qui le terrorisent. Comment se sortir de ce trou ? Qu’est-ce qu’il fabrique là ? Va-t-il mourir ici ? Seul ? Sa tombe est déjà creusée. Il n’y a plus qu’à recouvrir sa sépulture. Un obus va s’en charger sans doute. Il préfère fermer les yeux.
René-Jean enterre ses vingt ans dans des tranchées humides et froides. Les vêtements militaires le démangent sans arrêt et son paletot est trop petit. La chaleur de son pays lui manque tellement. Il garde toujours sa chéchia sous son casque pour protéger sa tête de la rigueur du climat. La sangle trop petite lui lacère le cou. Un masque de terre séchée enduit la majeure partie de son visage et accentue la profondeur de ses grands yeux noirs en amandes. D’un revers de la main, il se nettoie la bouche et découvre, au coin de la lèvre, une petite cicatrice. Il s’était blessé un jour de pêche ou la mer poussait sa colère. Une vague avait soulevé son embarcation. Lui avait perdu l’équilibre. Il était tombé dans le bateau et sa tête avait heurté le dessus de l’étrave. Il s’était soigné comme il avait pu avant de pouvoir rentrer sur la terre ferme.
Il pense à sa ville. Au beau mois d’avril. Le bord de l’océan. Sa barque couchée repose sur la plage attendant la prochaine partie de pêche. Il se revoit, assis sur les rochers, pieds nus, et le filet sur les genoux. Il aime les préparer et les ramender, sentir l’odeur salée de la mer et des algues, écouter le bruit des vagues qui s’enroulent et qui retombent avec fracas sur l’estran puis qui glissent jusqu’au sable brûlant. Il adore ajuster son chapeau de paille pour se protéger du soleil vif et généreux. Il apprécie quand la brise soulève sa chemise de coton et lui effleure le dos. Il sent les poissons fraîchement pêchés, préparés et saupoudrés de sel qui sèchent sur des claies de bois. Il goûte à pleine bouche aux fruits gorgés de sucre. Il voit le sourire de l’enfant qui joue sur la plage avec un crabe. Il observe le visage de sa femme là-bas. Ils se contemplent avec la complicité des êtres qui s’aiment. Ils se touchent avec les regards en pensant aux caresses à venir.
Une sensation de mordillement le sort de son humide et froide somnolence. Il rouvre les yeux et aperçoit un rat, effrayé et secoué par tout ce vacarme, qui tente de s’échapper de ce trou en lui grimpant dessus. Lui, il est habitué à voir ces animaux. Ils vivent ensemble depuis des mois. Il regarde ce petit être à quatre pattes se faufiler du piège avec vitesse et agilité. Il disparaît rapidement.
Peu à peu, le sifflement des obus diminue. Les tirs s’apaisent. Le bruit de la guerre semble s’éloigner. Le jour s’est décidé à se lever. Un ciel d’airain. Chargé, lourd, fatigué et triste de cette sauvagerie.
L’offensive doit être terminée. Il essaie un peu de se détendre. Avec la faible lumière, il commence à distinguer son environnement proche. Le trou dans lequel il est doit bien mesurer quatre mètres de diamètre. Le fond est marécageux. Une boue épaisse et glissante recouvre la muraille. Il a du mal à discerner les contours. Des troncs, des poutres et des planches enchevêtrées lui barrent la vue. Il tente de bouger un peu. Tous ses muscles sont endoloris. Le moindre mouvement lui demande un effort énorme.
Il n’a même pas pensé à regarder s’il était blessé. Seuls ses pieds sont gelés. Il pose son fusil à côté de lui en prenant garde de ne pas le laisser tomber dans l’eau boueuse. Il ouvre et ferme ses mains plusieurs fois pour tenter de les réchauffer. Il souffle dedans. Maladroitement, il attrape sa gourde pour se désaltérer. Il a du mal à en dévisser le bouchon. Après plusieurs essais et de fortes douleurs aux doigts, il réussit à prendre quelques gorgées. Une eau trouble et jaune. Il avale avec difficulté. Le goût de métal et de charbon est remplacé par une infâme saveur de terre.
— De l’eau… À boire… Aidez-moi ! entend-il.
René-Jean se raidit d’un coup. Il a perdu la raison et perçoit des paroles. Sa surdité passagère lui fait entendre des voix. A-t-il bien écouté ? Un murmure venu du fond du trou. Il saisit son fusil et dirige le canon vers le bord opposé. Un soldat ? Allemand ? Français ?
— Qui va là ?
— Je meurs… au fond ! réplique tout doucement la voix.
Faible et traînante, elle s’entend à peine.
— Je me trouve de l’autre côté, derrière… J’ai mal… J’ai soif ! poursuit-elle.
René-Jean tente de se redresser. Il voudrait voir au-dessus des morceaux de bois. Il aperçoit un soldat, derrière les branchages, comme lui, accolé au bord du trou.
— Est-ce que tu vas bien ?
Il n’entend pas la réponse. Il arrive à bouger un peu plus. Il décide de se rapprocher du pauvre guerrier. Il referme sa gourde et la fixe à sa ceinture. Il épaule son fusil. En évitant de mettre les pieds dans l’eau, il parvient à se retourner. Tout doucement, il progresse vers l’autre côté. Il enjambe les obstacles. Au bout d’un bon quart d’heure d’effort, il s’avance vers le combattant. Il a l’air épuisé.
— Comment t’appelles-tu ?
L'homme ouvre difficilement les yeux. Ils sont collés par de la boue. Au moment où il peut enfin voir, il est surpris et marque un temps d’arrêt. Au fond de lui, il ne pensait pas se retrouver avec un soldat noir. Il connaissait l’existence des bataillons de militaires de couleurs.
— Je m’app… je m’appelle Michel !
Michel paraît beaucoup plus âgé que René-Jean. Sa petite bouche est crevassée à cause du froid. Il a perdu son casque et ses cheveux bruns et courts sont sales et infestés de vermines. Il a les yeux écarquillés. Ils sont ternes et pleins de terreur.
René-Jean essaie de trouver une position confortable.
— Moi, c’est René-Jean !
Il défait son paquetage, souffle dans ses doigts puis attrape sa gourde. Il dévisse le bouchon. Il s’aperçoit vite que Michel ne peut pas bouger. Pâle, il a les yeux creusés. Un éclat d’obus lui a enlevé la main et une moitié de l’avant-bras droit. Sa manche tombe en lambeau. Étonnamment, il ne perd pas beaucoup de sang. Sans attendre, René-Jean accroche son bidon à une branche. Il sort de son sac une de ses chemises qu’il déchire en lanières grossières.
— Je vais te poser un garrot. Ça va faire mal !
Il entoure le membre meurtri d’un des morceaux de tissu puis il serre de toutes ses forces. Michel hurle de douleur. René-Jean attache l’étoffe avec un double nœud et met les autres bandes pour tenter d’arrêter complètement l’hémorragie. Puis il redresse Michel. Il le tire vers lui et passe son bras autour de ses épaules. Michel semble évanoui.
— Michel ! Michel ! Ouvre les yeux ! Bois un peu !
Michel s’exécute. René-Jean attrape son bidon et pose le goulot sur les lèvres de Michel. Il verse doucement quelques gouttes. Michel recrache directement le liquide. René-Jean recommence l’opération.
— Il faut que tu avales une gorgée !
Il doit s’y reprendre à plusieurs fois pour que Michel finisse par ingurgiter un peu d’eau. Cet effort les a épuisés tous les deux. Michel se tord de douleur. René-Jean s’est un peu réchauffé.
Il fouille dans son sac pour récupérer de quoi manger. Retrouver des forces et sortir de ce trou. S’extraire de cet enfer. Il trouve une conserve de « singe » et quelques biscuits. Il ouvre la boîte et prend dans ses doigts des morceaux de viande. Il en ingurgite deux et en coupe des plus petits pour Michel qu’il lui dépose dans la bouche. Michel rechigne, mais finit par accepter. Il mâche avec difficulté, mais il réussit à avaler la nourriture. Michel et René-Jean récupèrent un peu.
— D’où viens-tu ? demande Michel.
— Je suis de Saint-Louis… au Sénégal. Je suis pêcheur.
— Enchanté, René-Jean de Saint-Louis au Sénégal, moi je suis de Tours. Je suis instituteur. Précise Michel.
Il échange comme ça quelques mots. Anodins. Tels deux inconnus dans le wagon d’un train en partance et qui vont devoir voyager ensemble. Michel raconte qu’il a laissé sa classe précipitamment et qu’il songe souvent à ses élèves.
René-Jean parle de son pays. De « sa » mer et de son bateau. De la pêche et des embruns salés sur sa peau. Des feux sur la plage dans le couchant qui baigne l’horizon et le poisson qui grille. Il salive. Sur les étals du marché de Saint-Louis, on trouve toute sorte d’espèces. Il reste intarissable. Elles n’ont pas de secret pour lui. Il raconte la douceur de vivre de son pays. L’élégance de sa ville. La clémence du fleuve. La lumière et la chaleur du soleil qui réchauffent les cœurs et nourrissent les hommes. Il évoque sa famille. Sa femme et son enfant. Il est ému quand il parle de son départ pour la France et le sourire contraint de sa bien-aimée tenant leur fils dans ses bras. Il revoit ses yeux pleins de peur et de tristesse. Deux ans déjà. Il peste contre ses brodequins qui lui serrent les pieds. Il a toujours froid.
Michel raconte son métier d’instituteur. Il décrit sa classe. Sa voix est empreinte de nostalgie quand il évoque ses élèves. Il dépeint sa maison en pierres blanches et au toit d’ardoises. Elle surplombe la Loire. Ses yeux se teintent de malice au moment où il parle de sa passion pour le jardinage. Il désirerait dire à sa femme et à son enfant combien il pense à eux et combien il les aime. Il ne veut pas finir sa vie dans cet enfer.
La journée s’avance. Une brume monte sur le front et masque les horreurs de la nuit. Le calme est revenu. Juste le silence, le souffle de cet air glacial et quelques fumées. Le froid lui effleure le visage. Il faut qu’ils essaient de rentrer dans leurs lignes avant l’obscurité. René-Jean repose Michel délicatement contre le bord du trou. Il dessangle sa couverture qu’il met autour de Michel. Il décide d’escalader les parois pour s’orienter et voir au-dessus du cratère. De ce côté, grimper semble plus facile. Il passe la tête et regarde alentour. Tout est bouleversé. Il n’y a plus rien debout. Des troncs calcinés, des barbelés et des bois enchevêtrés. Des trous à perte de vue. Des cadavres partout. Et cette odeur de terre brûlée, de sang et de mort. Après l’assourdissant vacarme des combats vient l’effroyable et lancinante plainte du champ de bataille. Des cris de douleurs et des râles. Un champ d’agonies.
Il ne sait pas où se situe son camp. La peur et l’angoisse le saisissent à nouveau. La fraîcheur l’empoigne encore. Un froid comme le métal tombé du ciel. Il baisse la tête puis redescend vers son compagnon de souffrance.
— De quel côté faut-il aller ? Mais dans quel sens ?
Michel arrive à se relever un peu. Il a retrouvé un peu de couleur dans cette palette teintée de guerre.
— Aide-moi ! Aide-moi à chercher un objet dans mon sac ! Je ne peux pas !
René-Jean s’exécute et défait le paquetage de Michel.
— … Trouve un petit étui de cuir.
René-Jean glisse ses doigts dans la partie centrale et fouille le contenu. Il ne lui faut pas trop longtemps pour ressortir sa main avec ledit objet. Il repose la besace et tend la pochette à Michel.
— Ouvre-le !
René-Jean s’exécute et extrait du sachet un engin en métal doré qu’il n’avait jamais vu jusqu’ici. C’est une petite boîte ronde et peu épaisse en laiton. L’une des faces présente un verre transparent. Au fond, on distingue un dessin magnifique. À l’intérieur et au-dessus du motif, une aiguille bicolore s’agite et danse.
— C’est une boussole. Elle nous aidera à rentrer !
René-Jean en avait déjà vu au camp de transit lors de l’instruction. Mais pas aussi belle que celle-là.
— Il faut se hâter… René-Jean, tu placeras toujours la pointe rouge en face du nord et tu marcheras constamment vers l’opposé. Vers le sud ! Le sud…
Pendant que René-Jean remonte pour contrôler si la voie se dégage, Michel trouve la force de s’asseoir. Le mouvement réveille l’insupportable douleur de son bras. Malgré le froid, il transpire beaucoup. Il essaie de rassembler ces affaires. Impossible de récupérer son fusil dans ce trou. Il cherche avec sa main valide, mais en vain. La boue glisse entre ses doigts.
— C’est bon. On peut y aller. Affirme René-Jean en descendant près de lui.
Il charge ses sacs. Michel tente de l’imiter, mais il n’arrive pas à se mettre debout.
— Attends ! Je vais sortir de là et je vais te hisser.
René-Jean s’exécute. En haut, il s’allonge, essaie d’atteindre Michel. Il n’y parvient pas. Trop court. Dans un dernier effort, il lève son bras vers son sauveur. Celui-ci lui attrape le poignet puis la manche et tire de toutes ses forces. Il réussit à l’extraire du piège. Sa blessure recommence à saigner. Il n’arrive pas à se mettre sur ses jambes tout seul. René-Jean s’agenouille à côté de lui. Il passe sa main sous son épaule et se relève doucement. Il se tient presque debout avec son compagnon comme béquille. René-Jean jette un regard alentour. La brume s’est épaissie. Des gémissements se font entendre dans le lointain. Une main pour soutenir Michel, une autre agrippant le compas, voilà l’équipée prête à partir. Les premiers pas s’avèrent hésitants et difficiles sur ce terrain. Le fusil de René-Jean n’arrête pas de glisser de son épaule. Il est sans cesse obligé de les hausser pour réajuster l’arme. Ses bandes molletières sont détrempées et chargées de boue. Michel serre les dents, mais étouffe un cri à chaque mouvement. Les yeux rivés sur l’aiguille de la boussole, ils se fraient un chemin entre les obstacles et les cratères laissés par les obus. Ils progressent doucement. La terre fraîchement labourée devient meuble et à chaque enjambée ils s’enfoncent jusqu’aux genoux. Michel a du mal à se concentrer et à garder les paupières ouvertes. Au bout d’un temps incalculable, une éternité. René-Jean semble apercevoir un lieu familier. Il hésite.
Tout se ressemble ici. Des tranchées. Des trous d’obus. Des barbelés. Des chevaux de frise. Les arbres ont disparu depuis que la guerre s’est installée. La couverture végétale n’existe plus. Une campagne de désolation et de désespoir sur laquelle on s’entretue. Et là, deux hommes qui escomptent regagner leur camp. Les deux soldats ressemblent à deux vers de terre qui voudraient se cacher.
— Je crois qu’on y est !
Michel n’a pas la force de répondre. Observés aux jumelles depuis déjà plusieurs minutes, ils n’ont pas besoin de se faire connaître.
Deux brancardiers viennent à leur rencontre. Ils prennent Michel par les épaules et l’allongent sur la civière. René-Jean récupère quelques secondes. Délesté d’un coup du poids de son compagnon, il ne sent plus son cou, son dos et ses bras. Il a l’impression d’être écrasé par une force invisible. Il est tétanisé. On met une couverture sur le soldat. Ils se faufilent adroitement entre les rideaux de barbelés et regagnent la tranchée. René-Jean laisse les infirmiers s’occuper de Michel. Ils refont rapidement un pansement au blessé. Dans le fossé aménagé, un photographe, qui remontait vers l’arrière des lignes, immortalise la scène. Michel, allongé sur son brancard avec le bras et le torse sanglés d’une bande médicale. Les deux secouristes entourent Michel et René-Jean se tient derrière lui. Il a l’air ailleurs. Ses yeux demeurent inexpressifs. Le jour baisse sur le front. Le champ de bataille encore fumant résonnera bientôt des canonnades, des sifflements des balles et des explosions d’une nouvelle offensive.
« Stella splendens in monte
ut solis radium miraculis
serrato exaudi populum. […] »1
(Livre Merveille de Montserrat — Stella Splendens)
René-Jean est assis là, dans la tranchée. Adossé aux planches qui la bordent, la tête dans les genoux, il récupère. Il est épuisé. Ses mains sont recouvertes de boue et de sang séché et serrent l’étui de cuir dans lequel il a remis précieusement le compas. Avant de l’y glisser, il a pris le temps de la regarder. Il fait lentement descendre ses doigts sur le laiton. Au dos de la boussole, il aperçoit des mots gravés. « Andrée pour Michel — 1910 ». Il voit également que Michel a maladroitement écrit une autre inscription. Il l’a marquée d’une seule main et avec une pointe de métal pendant qu’ils étaient dans le trou : « RJ — 1917 ».
Michel a été conduit rapidement vers l’arrière des lignes. René-Jean se demande comment il va. Lui a encore froid. On lui tend une gamelle de soupe tiède qu’il avale machinalement et sans envie. Il sait que bientôt il va devoir y retourner. Grimper cette échelle de planches et monter à l’assaut. Son cœur se sert. Il voudrait enlacer sa femme et étreindre tendrement son enfant. Son pays lui manque. L’océan. La plage. Son bateau. Il a encore tant d’instants à vivre. Tant d’activités à accomplir. Il se répète sans cesse qu’il ne veut pas finir ici et qu’il ne compte pas mourir là.
1 « Étoile resplendissante sur la montagne Sertie de miracles Telle un rayon du soleil Exauce les prières de ton peuple […] »
II — SAINT-LOUIS, AUTOMNE 2008
La fraîche nuit se dérobe, mais ce matin, dans les rues de la ville, il fait chaud. L’humidité de ce mois de septembre semble exceptionnelle. Mahdi s’est levé tôt. Il s’est habillé après un rapide brin de toilette à l’eau froide. Le petit déjeuner a été vite avalé. Ils ne doivent pas manquer les visites. Rokhaya se trouve déjà prête. Le reste de la maisonnée dort encore. Le dispensaire ne se situe pas si loin, mais il faut compter quand même une bonne heure de marche. Ils passent le portail qui clôt la cour. Rokhaya le referme dans un bruit de grincement.
Rokhaya a toujours vécu à Saint-Louis. Elle habite depuis plusieurs années dans un quartier périphérique de la vieille ville. Elle porte fièrement et avec allant quatre décennies. Le temps ne semble pas flétrir son beau visage. Elle cache sa chevelure noire ondulée avec des foulards colorés. Mahdi affectionne quand elle le prend dans ces bras pour le coller contre elle. Il aime sentir ce curieux mélange de savon, de parfum et d’épices.
Mahdi marche à côté de Rokhaya. Sa main bien calée dans celle de sa tante. Il sent sous ses doigts la douce et fine peau de la paume de Rokhaya il ne va pas à l’école ce matin. Il aurait pourtant préféré s’y rendre. Il n’aime pas les visites au dispensaire. La ville sort petit à petit de sa léthargie. Elle s’éveille doucement. Rokhaya avance vite et Mahdi a du mal à suivre. Elle resserre un peu l’étreinte de ses doigts sur la petite main du garçon.
Les commerçants ambulants roulent leur charrette. Les autobus se remplissent. La poussière de la route se soulève. Depuis qu’Amy, sa mère, se bat contre la maladie, Mahdi habite chez son oncle et sa tante. Il a l’impression de revivre le même cauchemar. Deux ans se sont écoulés depuis la disparition de son père. Il a déjà emprunté ce chemin, mais en tenant la main d’Amy. La grande route d’abord puis les ruelles. La traversée du marché. Les étals de fruits. L’odeur du poisson. Les poules dans leurs petites cages. Son papa est mort de la maladie « sans nom » comme dit Mahdi.
Il se souvient de son père terriblement amaigri sous la moustiquaire. Le visage creusé. Il toussait et crachait sans arrêt. Amy essayait de lui donner à boire. Mahdi revoit avec effroi les tâches sur sa figure, la peur et la souffrance dans son regard. Son agonie a duré des semaines. Jusqu’au jour où Amy est venu le réveiller un matin, les yeux rougis par les larmes, pour lui annoncer qu’il était parti dans la nuit. Elle demeura à son chevet jusqu’au bout. Mahdi avait fondu en pleurs dans les bras de sa mère. Ils étaient restés là, comme ça, pendant un long moment. Mahdi aurait aimé que ça ne finisse jamais.
Il gravit les marches du dispensaire précédé de Rokhaya. Il y a déjà beaucoup de monde à patienter pour des soins ou pour rendre visite à un proche. L’hôpital est encore fermé. Ils prennent leur place dans la file d’attente. Mahdi a mal aux jambes. Il aimerait s’asseoir. Il renonce quand il aperçoit le regard furieux de sa tante. Il reste debout, mais prend appui sur le bardage de bois du bâtiment. Au bout d’une dizaine de changements de position de Mahdi, les portes s’ouvrent enfin. Tout le monde entre dans le hall d’accueil. Rokhaya et Mahdi se dirigent directement vers le dortoir à la lettre « C ».
Une succession de lits blancs surmontés de moustiquaires. Une odeur forte de produits antiseptiques monte aux narines de Mahdi. Il ne supporte pas les toussotements, les râles et les pleurs. Le médecin s’avance vers Rokhaya et lui parle doucement et à voix basse. Il n’entend pas ce qu’il dit à sa tante. Il sent que ça n’augure rien de bon. À la réaction d’effroi de Rokhaya, Mahdi comprend vite que sa mère est morte. Hier encore ils s’étaient promis de se revoir et d’évoquer avec gourmandise les longues promenades sur la plage. Hier encore il l’étreignait tendrement. Il avait bien senti autour de lui ses bras d’une extrême maigreur. Quand il l’avait embrassée, il avait bien touché les os saillants de ses pommettes. Mais au moment où elle lui avait susurré des mots d’amour, il avait posé sa tête contre son sein et écouté le faible rythme de sa respiration.
Mahdi ne peut pas y croire. Il lâche la main de Rokhaya puis s’approche lentement vers le lit. Sa bouche s’assèche. Sa gorge brûle. Son cœur cogne fort dans sa poitrine. Sur ce lit à barreaux en métal, la moustiquaire est pliée. Sa mère est enveloppée dans un linceul blanc. Seule sa tête dépasse du linge. Elle semble endormie. Apaisée. Ses traits sont marqués. Son teint devient presque aussi livide que le drap. Mahdi serre ses poings. Il sent l’émotion le submerger. Il enrage. Il a envie de hurler. Il préfère fuir. Il se retourne. Il regarde Rokhaya puis le médecin. Il pleure puis il se met à courir. Il sort du dispensaire à toutes jambes. Il saute les marches d’entrée. Traverse le parterre, la rue et disparais. Rokhaya tente en vain de le rattraper.
— Il rentrera !
Au bout de quelques heures, il est réapparu. Il est fatigué et perdu. Ses yeux sont rougis. Rokhaya l’étreint longuement. Il a erré une bonne partie de la journée le long du fleuve et sur la plage.
Les semaines qui suivent se révèlent difficiles pour Mahdi. Les funérailles de sa mère. Il pleure beaucoup. Le rangement des affaires. Les discussions familiales interminables. La décision de l’envoyer chez son oncle maternel. Il va changer de quartier et d’école. Rokhaya doit partir quelques mois pour un long voyage. Il est quand même un peu rassuré de rester dans sa ville. Non loin du fleuve et de la mer. Mais inquiet et désemparé, il doit aller dans un endroit où il ne connaît personne. La préparation de ses affaires lui prend un temps infini. Il ne sait pas quoi mettre dans sa petite valise. Ou il ne veut pas.
Mahdi paraît inconsolable. Il reste allongé sur son lit. Il n’a plus envie de jouer dehors avec ses cousins et les voisins. Tout s’écroule autour de lui. Comment est-ce possible ? Pourquoi ça lui arrive à lui ? Est-ce que c’est de sa faute ? Il ne comprend pas. Tout le monde essaie de l’aider, mais rien n’y fait. Mahdi se tait. Il se mure dans le silence. Dans deux jours, il doit partir pour un autre endroit. Une « bonne maison » comme lance Rokhaya. Lui, ce qu’il voulait, s’est resté là, avec sa mère. À huit ans, il perd son père. Maintenant, c’est Amy qui est emportée par cette maladie incurable.
Un après-midi où il est seul. Il s’aventure dans la cour. Le vent soulève la poussière. Il s’ennuie. Il est assis sur les marches de béton. Il médite. Ailleurs. Au bout d’un moment, son regard se porte au fond de l’espace clos. Il y a là un abri fait de parpaings de bois et de tôle qui cache un bric-à-brac où l’on entasse les vieilles affaires de famille. Il a toujours voulu y aller. Comme il est seul, il se lève. Puis, d’un pas décidé, il se dirige vers le local. La porte délabrée et bancale, bloquée par un verrou à moitié dévissé, ne résiste pas longtemps.
Il entre dans le cabanon. Avec le soleil brûlant, il fait une chaleur suffocante. Mahdi rentre quand même. La poussière recouvre tout. Il y a de tout. Des tableaux abîmés, représentants des ancêtres. Des pneus. Des chaises de bois cassées. Des bidons. Des bâches plastiques. Un lavabo ébréché. Des cartons. Des cordages et de vieux filets de pêche. Des pots de peinture et des pinceaux usés et secs. La chaleur et la poussière lui piquent les yeux et la gorge. Il sent l’odeur âcre des produits nettoyants. Une émanation de renfermé. Mahdi est déçu.
— Rien d’intéressant là-dedans !
Il s’apprête à sortir du local quand son regard est attiré par une valise marron en carton épais abîmé bloquée entre deux caisses de bois. Elle porte des coins renforcés de métal rouillé. Elle est cerclée d’une ceinture de cuir craquelée. Il en saisit la poignée à deux mains et la tire vers lui. Elle ne bouge pas. Il insiste et se retrouve par terre, l’anse entre les doigts. Il se relève et pousse un peu les chaises. À genou, il pose ses mains de chaque côté du bagage et serre fort la vieille sangle. En exerçant un mouvement de ses bras vers lui, il la fait glisser dans sa direction. Avec cette chaleur, il transpire. Sa manœuvre a réussi et il peut l’installer devant lui. En haut à gauche il y a une étiquette jaunie aux coins décollés. L’écriture est presque effacée. Il arrive à déchiffrer le prénom, la ville et le pays : René-Jean, Saint-Louis, Sénégal. C’est un personnage qui lui rappelle quelque chose. Il a déjà entendu beaucoup de choses de cet ancêtre. Ses parents, ses oncles et tantes en parlaient quelques fois pendant les repas de fêtes. Il se souvient aussi de cette photographie encadrée et accrochée aux murs de la maison de son grand-père Sano. On y voit René-Jean dans sa tenue de tirailleur, fusil sur l’épaule et paquetage dans le dos, posant fièrement devant le « Sequana » sur le port de Saint-Louis.
Il compte sur ses doigts.
— Un ! Amadou, mon père. Deux ! Sano, mon grand-père. Trois ! Omar, mon arrière-grand-père. Quatre ! René-Jean, mon arrière-arrière-grand-père.
Il se rappelle parfaitement des anecdotes racontées par son entourage sur son aïeul. Il adore les récits. Il aime beaucoup cette histoire, car il n’a jamais connu cet ancêtre. Une figure de la maison. Mettre ses propres images sur les paroles familiales. Construire son roman intime et ajouter cette brique à sa mémoire personnelle. Il sent qu’il a besoin de nouer et de tisser les liens avec son clan. La mort de ses parents a cassé le fil de sa vie. Il est seul et il ne veut pas se perdre dans une lignée devenue muette.