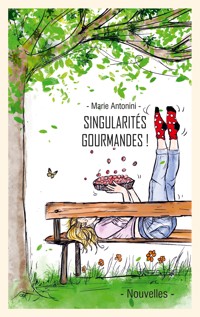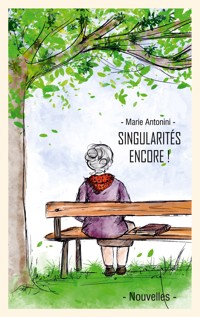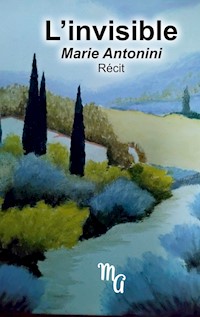Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Même si son entourage ne cesse de lui répéter qu'elle fait sans doute un burn-out, Margaret sait bien qu'il ne s'agit pas de cela ! Si elle décide de quitter ce monde superficiel dans lequel elle évolue depuis dix ans et qu'elle ne supporte plus, c'est pour renouer avec ceux qu'elle a négligés pendant de longues années. Elle part donc à l'aventure, prête à rencontrer des "gens" et à se réconcilier avec son passé. Un roman feel good, une lecture qui fait du bien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Les personnages étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite, certains lieux ont existé, mais la plupart ont été librement inventés. »
« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants causes, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. »
À mes parents absents, mais si présents,
à Jo, attentionné et patient
à Arnaud et Stéphanie, mes enfants si inspirants
à Karine et Julien, encourageants
à Abel et Agathe, enthousiasmants
Sommaire
Préface
Vingt-sept ans auparavant…
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Vingt ans auparavant
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Dix-huit ans auparavant
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Trente ans auparavant
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Quelques mois plus tard…
Remerciements
Préface
Marie nous embarque au fil de la plume avec Margaret, sa sœur, son double :
Margaret, Mag, sur les routes de France, à la recherche de sautres, à la recherche d’elle-même.
D’un coup, elle bouscule sa réussite sociale, son statut, son aisance matérielle et elle part…
Elle découvre les gens : des gens, connus et inconnus, elle va vers des rencontres, attendues ou inattendues, elle retrouve des parents aimants, une cousine chérie qu’elle pense avoir abandonnée, elle promène avec elle sa culpabilité, son rêve de perfection.
Marie, auteure, sait méditer devant les beautés de la nature, les couleurs du ciel, la forme des nuages, les fleurs, les arbres, elle observe les animaux avec une belle sensibilité, elle nous fait partager ses sensations, ses doutes, ses espoirs. Elle nous décrit les architectures, leurs styles, leur histoire, leur variété, c’est la France qu’on aime, celle à laquelle on veut croire encore.
Elle nous parle de la vie dans les villages, des savoir-faire et de tous ceux qui inventent ou réinventent la solidarité.
Elle a le sens de la fête, elle nous donne tout à la fois ses recettes gourmandes, et ses recettes de savoir-vivre dans le respect de l’environnement.
Elle convoque une galerie de portraits, des beaux et aussi des bancals, des souffrants, ceux que l’on peut rencontrer et les autres, ceux qui se confient, ou pas, elle croit à l’écoute et au partage.
Margaret est ce personnage immergé dans le monde d’aujourd’hui, avec ses doutes, ses rêves, son rêve d’un homme qui l’accompagne, l’admire, la désire, respecte sa liberté.
Selim, sera-t-il celui-là ?
Colette Patru
Vingt-sept ans auparavant…
« Le dessin est la base de tout »
Alberto Giacometti
Les deux fillettes étaient penchées sur la table, appliquées et concentrées. On entendait juste le ronron de la radio qui émettait depuis le haut du buffet. Une femme tournait le dos, elle était devant l’évier et lavait une salade, feuille à feuille. Parfois, elle se retournait et observait les deux petites avec un tendre sourire.
La plus grande était une brunette avec un carré légèrement bouclé, quelques taches de rousseur sur les joues et un mignon nez retroussé. Son regard marron-vert était très mobile et curieux. La plus jeune, à ses côtés, relevait la tête régulièrement pour épier le dessin de sa voisine. Elle soupirait et changeait sans arrêt de crayon de couleur.
Blonde, avec une natte sur l’épaule, elle possédait un visage fin, complété par de superbes yeux bleu azur.
Margaret avait huit ans, elle passait une partie de ses vacances chez Félicia, sa tante, mère de Ludivine. Comme il pleuvait dehors, la jeune femme leur avait proposé de faire chacune un dessin à exposer dans la cuisine. Ainsi,quand Roger, son mari et le père de Ludi, rentrerait, il serait plein d’admiration et pousserait des oh ! et des ah !
Ludivine avait un peu rechigné. Du haut de ses six ans, elle savait qu’elle n’avait pas la dextérité de sa cousine. Mais elle colorait, gommait, ajoutait du bleu, du rose, effaçait encore, tirait la langue et s’appliquait à faire un « vrai tableau » !
— Margaret, tu veux faire quoi, comme métier quand tu seras grande ?
— Je serai docteur, le docteur des gens qui sont dans des pays pauvres, comme ça je les soignerai des maladies qu’ils ont là-bas ! Et toi, Ludi, tu veux être quoi ?
— Je serai une princesse, avec un truc qui brille dans les cheveux et des robes longues comme celle de Cendrillon.
Une princesse qui vit dans un château, que je serai !
— Ben dis donc !
— Oui !
Félicia souriait en écoutant les gamines. Elle s’approcha d’elles et se pencha pour regarder les cahiers. Margaret terminait le coloriage, elle avait esquissé des collines vertes,une maison carrée et blanche avec un petit toit rouge pui sau-dessus, une cheminée d’où s’échappait une fumée grise.Le ciel était bleu très clair, parsemé de jolis petits nuages d’un indigo plus foncé.
Ludivine regarda le dessin de sa cousine et s’extasia :— Ouah, comme c’est joli, Mag ! Avec des moutons tout làhaut ?
— Mais non, ce sont des nuages !
— Ouah, c’est beau ! Hein, maman, c’est beau ?
Félicia répondit que oui, vraiment c’était très charmant,surtout les petits nuages bleus. La princesse de Ludivine était magnifique aussi !
Les œuvres furent exposées sur le frigo. Quand Roger rentra du travail le soir, il s’extasia de voir tant de merveilles.
— Mais, dis-moi Mag, pourquoi as-tu dessiné des nuages bleus ?
— Ben, tonton, comment veux-tu que je les fais ?
— On dit : que je les fasse, ma puce !
— Comment veux-tu que je les fasse ? Ils sont toujours bleus les nuages !
— Tu dois avoir raison. En tout cas, ce sont de vrais chefs d’œuvre.
Chapitre 1
« Sois le changement que tu désires voir en ce monde. »
Gandhi
Je ne sais plus à quel moment c’est apparu. Au milieu de la nuit peut-être ? Ça s’est insinué peu à peu. Lentement. Comme une maladie sournoise. Ce matin, je me lève avec un léger malaise, la tête qui tourne. Mes pieds sur le sol ne sont plus solides. De petits signes auxquels sur le moment, je ne prête pas attention. Je ne me sens pas présente à moimême, je prends mon petit déjeuner, l’esprit ailleurs. Pas faim. Où suis-je donc ? Je l’ignore. Je me regarde dans la glace et je ne sais plus qui est là, qui est ce reflet. Une angoisse sourde dans mes entrailles. Et si je devenais folle ? Je respire, m’éloigne vite du miroir, j’achève de me vêtir. Une fois lavée et maquillée, ce qui m’a pris, j’avoue, plus de temps qu’habituellement, j’enfile la veste de mon tailleur bleu préféré. Puis les escarpins noirs. Les plus incroyables. Talons de dix centimètres. Aussitôt, sans savoir pourquoi, je les enlève et marche pieds nus à travers l’appartement. Je ne peux tout de même pas me rendre au bureau sans chaussures. Finalement, je remets les souliers, ferme la porte, après avoir décroché la clé de l’automobile.
J’emprunte l’ascenseur et, arrivée dans le hall de l’immeuble, je me dis que non, ce matin, je n’irai pas au travail en voiture. L’idée même de grimper dans mon véhicule me rend folle. Rester coincée dans les embouteillages, écouter les informations à la radio, me faire injurier au volant, pire, me faire klaxonner ! Non, non et non !
Mais qu’est-ce qui me gêne ? Je fais demi-tour, remonte dans l’ascenseur. Je croise madame Berger qui me salue, je lui réponds à peine. Je pénètre dans mon appartement, m’assieds sur le gros fauteuil bordeaux et ôte les chaussures à talon. Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Et toujours cette boule dans le ventre. Je file à la salle de bain. Pas vraiment de nausée. Devant la glace, au-dessus du lavabo, je m’observe sans complaisance. Qui est cette femme ?
Mince, visage gracieux ? Non, quelconque. De beaux cheveux bruns bouclés. Je suis ordinaire. Je me reprends aussitôt. Je suis dingue, je suis dingue ! Complètement incohérente ce matin. Bon, de toute façon, je suis déjà en retard. Je vais y aller à pied. C’est ça ! Je fouille dans le dressing et tombe sur des baskets, griffées, évidemment.
Cela fera l’affaire. Je les enfile et referme la porte à clé. Sur le palier, j’hésite : ascenseur ? Non, ce sera escalier.
Je descends tranquillement et j’entends le téléphone sonner dans mon sac à main. Sans doute Alice qui s’inquiète. Alice, c’est ma secrétaire, la fidèle des fidèles. Aux ordres comme un petit toutou. Rien qu’à la pensée de cette comparaison, j’ai un haut-le-cœur. Qui suis-je pour juger Alice ? Je lui en fais voir depuis plus de six ans. Et celle qui l’a précédée aussi. Comment s’appelait-elle déjà ? Caroline ? Non, c’était Coraline !
Je suis d’une humeur étrange, alors, puisque je suis à pied et en retard, je décide d’acheter des croissants pour l’équipe.
Je m’arrête à la pâtisserie du coin de la rue. La patronne me dit sans me regarder :
— Elle ne travaille pas la petite dame aujourd’hui ?
— Si, si elle travaille ! Elle est juste un peu en retard !
— Ben, on ne dirait pas, elle n’a pas l’air pressée…
Je sors tranquillement et sans répondre. Toujours cette impression que ma tête n’est pas en cohérence avec le reste de mon corps. Ça n’est pas très confortable… Je traverse le pont.
La rivière après les dernières pluies diluviennes, arrive au milieu du pilier du pont. Je guette les canards pendant quelques minutes. Le téléphone sonne à nouveau au fond de mon sac. Oh la paix !
Je décide de couper par le parc, il fait si beau ce matin. Il est neuf heures vingt-huit. J’aggrave mon cas, je crois bien qu’il y a une réunion à dix heures. J’y serai, pas de problème, j’y serai !
L’air sent le printemps, ça me plaît. Étrange, je ne savais pas que j’ aimais ça. Une impression de première fois, de découvrir la beauté du paysage qui m’entoure. Le parc est tapissé de fleurs. Je les observe et une vieille dame un peu replète, un chihuahua dans les bras, me dit :
— Magnifiques les crocus, vous ne trouvez pas ?
— Ah ? Des crocus ! J’adore. Et… le buisson jaune soleil là-bas, si lumineux ?
— Du forsythia ! Après l’hiver, nous apprécions toutes les fleurs, n’est-ce pas ?
— Oh oui, je suis d’accord avec vous ! Bonne journée madame ! Et à toi aussi, petit chien !
— C’est Madona, c’est une femelle !
Mais que m’arrive-t-il ? Voilà que je souhaite une bonne journée à un chien qui se nomme Madona, en plus ! Classe avec un collier en strass. Je sors du parc, j’accélère le rythme. Je croise un groupe d’enfants très bruyants. Ils ont tous revêtu des gilets réfléchissants, on ne peut pas les manquer. Je ralentis pour les observer, ça piaille, ça saute, ça chahute sous les rappels à l’ordre de la maîtresse.
J’arrive dans le hall de la grosse entreprise Batilem où je suis cadre supérieure.
Je m’appelle Margaret. Margaret Bastien.
Margaret, c’est le prénom dont m’ont affublée mes parents,qui, une fois à la retraite, sont partis s’installer en Lozère.
J’ai trente-cinq ans, célibataire, sans enfant. J’adore mon boulot. Enfin, je l’adorais. Jusqu’à ce matin. Non, je ne fais pas un burn-out !
Ce n’est pas cela du tout. Je vais bien. Je vais très bien même. Sauf que je n’aime plus la vie que je mène. C’est une telle évidence à cet instant où je franchis la porte colossale de l’entreprise. Subitement, je m’y sens étrangère. Et ça me reprend lorsque je pénètre dans mon bureau, immense et lumineux. J’ai toujours le sentiment d’être une visiteuse.
Tout cela m’inquiète et me fait peur, je l’avoue. Je m’assieds et respire en regardant autour de moi. Ça pue ! Ça pue le luxe, à vomir ! Le fauteuil Eames, en cuir haut de gamme. Gris foncé. Coûteux. Ergonomique. Les tableaux chics et dispendieux. Le bureau, digne d’un ministère. Le bouquet de roses, livré tous les matins pour que je sois entourée de gerbes fraîches. Et gare si Alice oublie. Gare si elle ne choisit pas des fleurs odorantes ! Mais comment en suis-je arrivée là ? Comment fait-on pour devenir peu à peu quelqu’un d’aussi détestable ? Alice ne m’aime pas. Je la comprends à cet instant.
Je suis une femme infecte, snob, et si je n’étais pas moi, je dirais que je suis une « pétasse ». Ce tailleur que je porte, par exemple, il n’est même pas élégant, mais provient d’un couturier très en vogue. Et les escarpins que j’ai failli mettre ce matin ? Ils valent une fortune. Au moins cinq cent soixante-quinze euros la paire.
Ma secrétaire pénètre dans le bureau, un sourire jaune sur le visage. Pauvre Alice !
— Je vous ai crue malade, Margaret ! Vous ne répondiez pas au téléphone…
— Non, rien de grave Alice, juste une panne d’oreiller. Ah, je vous ai acheté des croissants !
— Oh, merci, c’est, c’est… gentil !
Elle voulait sans doute dire : étonnant, je suppose. La pauvre paraît en pleine confusion. Elle ouvre des yeux grands comme des soucoupes.
La journée passe. Interminable. Une petite phrase tourne dans ma tête depuis mon entrée dans l’établissement, elle me perturbe pendant les huit heures que je traîne à mon bureau :
« Sauve-toi, que fais-tu là ! » Je comprends bien le sens de cette phrase. Je dois me prendre par la main pour survivre. Avant qu’il ne soit trop tard. Avant de devenir toxique. Je suis malade de cette vie-là. Je me suis déconnectée. « Sauve-toi, sauve ta vie pendant qu’il est temps ! » Je passe la journée à réfléchir, avec ces mots qui se répètent et tournent comme un mantra : « Sauve-toi Margaret ». Mais il ne faut pas agir à la légère.
En rentrant le soir, toujours à pied et avec mes chouettes baskets, je traîne à nouveau dans le parc. Je m’assieds un instant sur un banc à côté des crocus. Je suis étonnée et un peu déçue, je croyais qu’ils sentaient bon, mais non, aucun parfum. Ils sont ravissants, roses, jaunes, violets ! Autour de moi, des arbres, géants, superbes, tantôt vert foncé, tantôt plus clair avec des petites feuilles à peine formées. Je ne sais pas les nommer, mais je reste assise à les admirer.
Je monte l’escalier de la résidence lentement, peu pressée de rentrer chez moi. « Chez moi ». Ces deux mots me semblent subitement inadaptés. J’ouvre la porte en soupirant. Je vais directement m’échouer sur le fauteuil, essoufflée. Il faut dire que trois étages à pied, je n’ai pas vraiment l’habitude. Mon regard se porte sur la pièce, le canapé gris en cuir, le téléviseur, le buffet moderne acheté très cher au magasin Trobois. Au mur, des tableaux de peintres d’avant-garde. Je ne me sens plus chez moi, toujours cette impression bizarre d’être en visite. Ce décor figé, presque faux, comme au cinéma. C’est pourtant mon appartement depuis quelques années. J’étais tellement heureuse de l’acquérir… Cher. Très cher ! Et ce vase sur la table : laid. Oui, mais il coûte les yeux de la tête et vient d’une chic boutique de Londres. D’un coup, je me lève et je me déshabille. Exit l’ensemble de luxe. J’envoie valdinguer la veste à travers la chambre. Je tire la porte de la penderie de mon dressing-room. J’en reste baba, comme si mes yeux s’ouvraient brusquement à la réalité de ma stupidité.
Des robes, des jupes, des tenues de soirée, des tailleurs et des manteaux… Le comble ? Que certains vêtements portent encore leurs étiquettes ! J’ai envie de pleurer.
Que s’est-il passé entre mes douze ans de gentille gamine et maintenant ? J’étais une fillette douce et timide, je vivais avec mes parents, des gens simples. Ils étaient trop jeunes en soixante-huit, mais restés fidèles aux idées de leurs aînés. Maman était institutrice dans une école de village, mon père enseignait l’anglais au lycée de la ville voisine, puis ils se sont installés à Paris à ma naissance. Je crois que c’est à HEC que j’ai changé. Comme j’avais d’excellents résultats, j’ai attrapé la grosse tête. Non, le melon comme on dit. Je suis partie un an à San Francisco : University of San Francisco, School of Management... Puis arriva ce poste de chef, cadre supérieure en management dans la filiale française d’une entreprise internationale.
Bon salaire. Responsabilités, certes, mais, peu à peu, je suis devenue cette femme que je trouve détestable, qui n’a que quelques amis, aussi haïssables qu’elle et qui n’a pas rencontré l’âme sœur à trente-cinq ans… Le travail, l’argent qu’il rapporte… ce cercle infernal a débuté il y a plus de douze ans. Pas d’hommes, ou si peu. Ils ne sont jamais assez bien, assez beaux, ou assez intelligents, ou assez riches aussi. J’ai eu un amoureux au lycée. Je devais être en terminale. Il s’appelait Théo. J’étais folle de lui, puis un été, je n’ai plus eu de nouvelles. Avec du recul, je me dis qu’il était bien ce garçon, je me demande ce qu’il est devenu.
Je suis en soutien-gorge au milieu de la chambre et jette sur le sol des vêtements que je sors du dressing. Manteaux de couturier, robes, chemisiers et pantalons griffés… Hop, j’entasse et je plie dans un carton. C’est comme une rage, une hargne qui me fait m’activer. Avec un marqueur, j’écris le contenu sur chaque boîte. Je passe ensuite aux chaussures, bottes et bottines. J’en mets une paire de côté, classique, grise, ainsi que des Knickers qui proviennent d’une boutique connue. Pour marcher, les deux sont confortables. Le souffle me manque subitement. Je suffoque. Je me précipite pour ouvrir la grande baie vitrée. J’aspire profondément l’air de la ville. Il fait frais en ce début de printemps, ça me fait du bien. Je tourne. Je me sens fébrile. Quelle est cette maladie ? La folie ou juste une prise de conscience de ma frivolité, de mon asociabilité ? Je respire un peu mieux. J’ai toujours les chaussures de sport entre les mains. Je soupire et retourne poursuivre l’exploration de ma garde-robe. Même mes baskets sont luxueuses. Bon, j’en garde une paire, c’est raisonnable. Plus tard, j’aviserai. Je vais emmener tout ça aux magasins de fringues d’occasion, je récupérerai un petit quelque chose. Et demain, pour le travail, je mettrai les bottes, il fait encore frais… Demain… Il faudra que j’y aille. Je ne sais pas. Peut-être pas. Non, je ne crois pas ! J’ai mal dans le creux de l’abdomen à l’idée d’y retourner. Comme un enfant qui souffre du ventre avant la rentrée scolaire. Je dois m’habiller, je commence à avoir froid. J’enfile un jean et un pull. Oui, il est griffé ! Mais le moindre tee-shirt de mon armoire est cher et chic. Il faut néanmoins que je garde quelques vêtements, je ne peux sortir en soutien-gorge dans la rue.
Je dois téléphoner à Céline, je vais tout lui expliquer. Elle va comprendre. C’est une fille pleine de bon sens. Je lui dirai que ne peux plus me regarder dans la glace. Je marche à côté de mes pompes, je suis mal. Je me suis trompée de vie, c’est un mauvais casting. Je dois retrouver mon vrai moi. Elle passe ce soir. C’est mon amie depuis plus de vingt ans. Lycée et fac ensemble. Puis quand je suis entrée à HEC, elle a rencontré Bertrand.
Mais non ! Elle ne me comprend pas Céline. Elle sort de l’appartement à l’instant. Notre échange a été houleux. Un fiasco. Elle m’a traitée de tous les noms. Elle dit que je suis devenue folle, que ça me prend comme un coup de fusil. Je fais forcément une grosse dépression, ce n’est pas la peine d’avoir fait autant d’études, je n’ai qu’à prendre rendezvous chez un psy, d’ailleurs, elle en connaît un fameux.
— Je vais lui téléphoner, tu verras, ça va passer, etc.
Elle est partie en hurlant. Elle n’a même pas voulu boire son petit porto habituel.
Je m’écroule au milieu de cet appartement. Il m’est devenu étranger. Je pleure, je pensais que cette amie-là me comprendrait. Ma vie doit changer, c’est crucial pour moi. Elle n’admet pas. Pourquoi ? Est-ce donc si stupide ? Comment peut-elle ne pas sentir à quel point c’est primordial pour moi ? Je crois que je vais mourir, là. Si rien ne bouge, oui, je vais en mourir. Je suis au milieu de mes cartons, je suis seule, perdue et soudain apeurée comme une enfant qui doit traverser une forêt noire et profonde. Je me mets à douter. Et si c’était effectivement un burn-out ? Et si cette excitation, cet engouement subit n’était qu’un leurre. Elle a hurlé parce que je vais démissionner de mon boulot.
— Et tu vas faire quoi, pauvre pomme ? Bosser comme caissière à Lidl ? Tu crois qu’on t’attend sur le marché du travail ? Tu veux faire des ménages chez les riches ? Tout ça, c’est parce que tu n’as pas de mari ! Voilà, si tu avais épousé Mick, que je t’ai présenté, tu n’en serais pas là ! Caissière, mais ma pauvre Margaret !
Et pourquoi pas, Céline ? Ce n’est pas une honte, si je me sens mieux avec moi-même, si je marche à nouveau droit dans mes chaussures. Si je vais à la vraie rencontre de mon moi… Céline est partie en claquant la porte. Elle a crié quand elle a vu les cartons. Elle a hurlé quand je lui ai annoncé que j’allais vendre mon appartement. Elle a braillé lorsque j’ai dit que j’allais quitter mon travail et que c’était essentiel pour moi de tout changer…
Bref, je lui ai fait péter les plombs. Pauvre Céline ! Elle a rejoint sa petite vie bourgeoise de femme de chirurgien, dont les rares soucis sont : que vais-je m’acheter aujourd’hui ? Quelles sont les nouvelles tendances en matière de vêtements, de bijoux, de sacs ? Dans quelle école prestigieuse vais-je inscrire Victor, qui est un élève prodigieux ? Si, si, ses professeurs n’en reviennent pas !
Je suis seule et incomprise. Demain, je retourne au bureau, je récupère mes affaires et bye, bye, la cadre supérieure de chez Batilem.
Le matin, je me glisse dans un jean, je passe un pull vert angora que j’adore et mes fidèles baskets. Enfin, fidèles depuis hier. Je vais au travail le cœur léger. J’ai pris la décision dans le noir. Car je n’ai pas dormi cette nuit. Après la visite tumultueuse de Céline, j’étais un peu triste, énervée… J’ai ouvert une bouteille de vin blanc et j’en ai bu la moitié. Impossible de trouver le sommeil ensuite. Évidemment.
À trois heures du matin, sur mon ordinateur j’ai découvert un mail : « Remontrances » du mari de Céline, le chirurgien. Il est plutôt sympathique Bertrand d’ordinaire, mais j’ai bien senti qu’il avait été briefé par sa petite femme. — Tu fais la pire bêtise de ta vie, tu risques de le regretter. De quoi vivras-tu ? Faire quoi ? Tu veux finir paysanne comme tes parents, etc.
Sauf qu’ils ont choisi. Au moment de la retraite, ils se sont installés pour faire un jardin et avoir quelques poules, juste pour leurs besoins personnels. Ils adorent ça. Ils ont quitté Paris pour la Lozère, c’était courageux aussi. Peut-être faisje, des années après, le même cheminement qu’eux. En arrivant au bureau, Alice me regarde comme si j’étais gravement malade, elle me parle doucement pour m’épargner, m’apporte le café avec un grand sourire. Je ris toute seule.
Le patron, après avoir avalé l’amère pilule, veut que je forme ma remplaçante. Car de toute façon, je ne peux pas partir ainsi, ça n’est pas correct. Je lui réponds qu’il ou elle fera comme moi à l’époque, il ou elle improvisera. Et, pas de soucis, je respecterai le préavis, je prends tous les congés qu’il me doit, c’est-à-dire trente et un jours ouvrés, et ça dès le lendemain ! Lui non plus ne comprend pas ce qui se passe.
— Ma pauvre Margaret, il faut vous soigner, ça n’est pas grave un burn-out, je connais un bon psychanalyste, je vais vous donner son numéro de téléphone, mieux, je peux lui parler de vous, oui, c’est un ami à moi…
Encore ! Je vais les collectionner, les psys !
Merci, Monsieur le Directeur, ça ne m’intéresse pas. Je suis sortie, le cœur léger. Pour la première fois, je me sens bien, mais bien ! Demain sera ma dernière journée de travail et la suivante, la première de ma nouvelle vie !
Après le parc, où j’admire encore les crocus, je m’arrête à la boulangerie afin d’acheter du pain pour mon souper. La commerçante est là, toujours fidèle à elle-même. Cette femme sèche, brune, aux cheveux coupés très courts, ne sourit pas, ou peu. Elle m’interpelle :
— Elle est bien joyeuse ce soir !
— C’est normal, elle a pris de grandes décisions.
— Ah bon ! Et on peut savoir c’est quoi ?
— Oh oui, changement de vie.
— Elle va faire quoi ?
— Bah, elle ne sait pas encore !
— Ce n’est pas un changement de vie, ça ! Elle va au cassepipe la p’tite dame !
Je souris et depuis la vitrine, j’aperçois un SDF assis de l’autre côté de la rue. Comme une évidence, j’achète un sandwich pour lui. Un Parisien, jambon et beurre, j’espère que ça conviendra. Je traverse la chaussée et lui offre le casse-croûte. Il me guette par en dessous, hésite avant de tendre la main vers le sachet, comme s’il ne pouvait pas monter son regard jusqu’à moi. Il fait partie de ces gens tellement pauvres qu’ils n’osent plus lever les yeux sur les autres.
— Vous n’avez pas froid, monsieur ? Prenez, c’est un sandwich au jambon, ça vous va ou vous préférez autre chose ?
Il paraît interloqué par ma question. Je ne comprends pas ce qu’il répond, mais à la manière dont il se jette sur le pain, je pense que tout lui convient.
Je me dis que demain, je lui descendrai du café dans la thermos rouge qui est au-dessus du placard et que je n’ai jamais utilisée. Pour cause, j’avais, dans mon bureau, une machine à expresso dernier modèle, réservée à mon usage personnel. Je pense que je lui donnerai aussi la couverture écossaise qui est pliée au bas du dressing.
De retour à l’appartement, je commence à ranger, à mettre les livres de ma bibliothèque dans des cartons. Sur le management principalement. « Reinventing Organisations », « Le Management bienveillant », « Coaching en or » et j’en passe. Je vais les offrir à mon successeur, puisqu’aux dernières nouvelles, c’est Damien Bergoux qui reprend mon poste. Grand bien lui fasse, il est exécrable et antipathique. Je plains les gens qui auront affaire à lui. Je ne dois pas dire ça, je n’ai plus envie d’être cette garce qui critique à qui mieux mieux et écrase tous ses collègues de sa supériorité. La nuit précédente, durant mon insomnie, j’ai revu le film : « Le diable s’habille en Prada », je me suis fait peur une nouvelle fois. Cette femme odieuse et sévère interprétée par Meryl Streep, c’est moi. Non, « c’était » moi. Pauvre Alice, c’est normal qu’elle ne m’ait jamais aimée.
Ce matin, dernier jour chez Batilem. Je chantonne sous la douche. Jean, baskets, un adorable pull rose. J’ai gardé l’essentiel. Ce soir, je chargerai les cartons dans la voiture.
Pour l’heure, je me coule un café et ça se bouscule dans ma tête. Mon corps exulte. Voilà ! Je n’ai jamais utilisé le verbe exulter. Je regarde vite sa signification sur Wikipédia.
Exulter : être transporté d’une joie extrême, jubiler. Je suis un peu déçue. Ce que je ressens est plus subtil. Une joie cellulaire, tout mon moi intérieur exulte !
Comme promis, je descends un grand café dans la thermos rouge. Le SDF est souriant quand je le lui offre. Je file à la boulangerie et lui ramène deux croissants.
— Merci Duchesse !
— Ah, non, je vous en prie, je n’aime pas ça, je m’appelle Margaret !
On rit tous les deux.
— Ben, merci Margaret. Moi c’est Richard. Bonne journée !
Je file à travers le parc, tout en pensant que j’aurais dû prendre ma voiture. Je dois vider mon bureau. Les gens sont sinistres au boulot. On me regarde avec condescendance,genre : la pauvre, elle est en dépression… J’imagine assez ce qui se colporte d’un secrétariat à l’autre. La journée se traîne, mais à seize heures, j’appelle mon adjointe.
— Chère Alice, ça n’a pas toujours été simple entre nous.
Mais voilà, Damien va prendre mon bureau maintenant. Je vous souhaite un bel avenir. Je vous donne tout ce qu’il y a dans ces tiroirs. Mon chemisier à fleurs qui vous plaît tant,l’eau de toilette et la trousse de maquillage. Déménagez aussi le réfrigérateur, il y a fort à parier que monsieur Bergoux apportera le sien. Idem pour la cafetière. Je récupère juste la photo de mes parents.
— Vous êtes sûre que tout va bien, Margaret ? Vous n’allez pas regretter votre job ?
— Oui, je suis certaine que tout va bien, et non, je ne vais pas pleurer ma décision. Ah, et une dernière chose. Je vous fais une confidence Alice : je me sens bien et je suis très heureuse, vous comprenez ?
Je quitte Batilem. Je ne me retourne même pas. Je laisse derrière moi douze années de ma vie. Sans regret. Je flâne dans le parc, pour admirer les arbres. Je ne m’en lasse pas.
Je me demande quel âge ils ont. Je dérange un écureuil en passant vers les pins. Nous nous observons un moment, puis il décide de grimper encore plus haut vers la cime. Je marche lentement, épie des gamins qui font du vélo autour du bassin. Un pincement au cœur. J’ai trente-cinq ans, trente-six en septembre, bientôt trop tard pour envisager une grossesse. J’arrive au bas de l’immeuble, le SDF, comment s’appelle-t-il déjà ? Richard n’est pas là. Il fait bon, peut-être a-t-il été se dégourdir les jambes. Je monte marche après marche jusqu’au troisième étage. J’ouvre lentement la porte, tous ces gestes que je fais habituellement à toute vitesse, sans m’en rendre compte. Enlever les chaussures, doucement, masser un peu la plante des pieds, balancer le blouson sur le fauteuil. De mon sac à main, je sors la photo de mes parents. Ils sont rayonnants, c’était le jour de leurs trente ans de mariage. Ils avaient organisé une fête dans une auberge paysanne en Lozère, pas très loin de leur fermette. Maman est belle, elle a une grande natte poivre et sel ramenée sur l’épaule gauche. Papa rit aux éclats, la barbe en broussaille, comme toujours. Je pose le cliché sur le guéridon vers l’entrée. Temporairement puisque je vais tout déménager. J’ai décidé de vendre mon appartement. Je vais demain voir les agences.
Mon téléphone vibre. Céline.
— Tu as réfléchi et changé d’avis, j’espère ?
— Non, ma belle. J’ai quitté Batilem. Je vais aussi abandonner Paris !
Je l’entends hurler dans l’appareil.
— Tu es une grande malade ! Tu vas le regretter !
Je n’ai pas le temps de répondre qu’elle a déjà raccroché. Je la rappelle, mais elle reste muette. Tant pis pour toi !
J’entreprends de ranger la cuisine. Je vais manquer de cartons. La sonnette de l’entrée me fait sursauter. J’écoute l’interphone.
— C’est Alexis ! Tu m’ouvres ?
— Alexis ? Oh, Alexis ! Oui, monte.
Incroyable ! Alexis ! On s’est complètement perdus de vue depuis HEC et pourtant, nous étions de grands amis. Il était brillant comme élève. Beaucoup plus que moi. Aux dernières nouvelles, il travaillait pour l’Aérospatiale à Toulouse. Il frappe discrètement. Je vais ouvrir.
— Ça alors, quelle surprise Alexis !
— Salut Mag ! Tu n’as pas changé toi…
On s’embrasse.
— Entre. Que fais-tu à Paris ? Je te croyais à Toulouse.
— Je suis en vacances depuis dix jours, je reviens voir mon père. Et… j’ai reçu un SMS affolé de Céline. Que se passe t-il, Mag ? Elle dit que tu pètes les plombs.
— Je… Elle est pénible de paniquer tout le monde. Je vais très bien, là ! Franchement, ai-je l’air malade ? Ai-je l’air de faire un burn-out ?
— Non ! Au contraire, je te trouve lumineuse !
— Ah ! Tu vois ! Tout ça parce que j’ai décidé de vivre autrement. Cette vie de petite bourgeoise ne me convient plus. J’ai le droit ! Que désires-tu boire ?
— Si tu as une bière, je veux bien. Absolument, c’est ton droit… Quels sont tes projets ?
Je suis en train d’ouvrir mon réfrigérateur pour chercher deux canettes et je pense que je ne sais pas encore ce que je vais entreprendre. À cet instant, je n’ai aucun plan. Mis à part la fuite…
— Je crois que je vais me mettre au vert quelque temps…
— Prendre des vacances, c’est pas mal. Tu n’en as jamais tellement profité.
— Batilem a absorbé ma vie pendant douze ans !
— Et ensuite ?
— Voilà ce que j’ai dans la tête. Je n’en ai parlé à personne encore… J’aimerais voyager à travers la France. Je veux dire, aller à la rencontre des gens. À la campagne, à la ville,partout ! J’ai le sentiment que je dois faire ça. Tu me trouves stupide ?
— Non. Mais, de quoi vas-tu vivre ?
— Oh, tu sais, j’ai beaucoup d’argent, je vais vendre mon appartement… Un cent mètres carrés parisien, dans un beau quartier…
— Et ?
— Faire des petits boulots, oui. Je m’en sens capable. Ce qui fait hurler Céline. Je voudrais rencontrer des personnes différentes de celles que j’ai côtoyées ces douze dernières années. Les bourgeois, les m’as-tu-vu, les bobos, les snobinards… J’ai besoin de connaître des gens ! Est-ce que tu me comprends ? De vraies gens !
— Je crois, oui. Et, j’imagine que tu n’agis pas à la légère ?
— C’est pour ça, je suis contrariée par la réaction de Céline.
Enfin, tout de même, elle sait que je suis réfléchie et pas idiote…
— Mais Céline ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
Elle aime le luxe offert par Bertrand. Elle dépend complètement de cette vie superficielle et bourgeoise. Et n’oublie pas qu’elle n’a jamais travaillé. Elle est liée à son chirurgien de mari, à ses deux mouflets adorables, mais elle vit dans un petit monde étriqué.
— Essaie de lui expliquer tout ça. Elle m’a raccroché au nez tout à l’heure, après avoir appelé !
On boit notre bière tranquillement en échangeant sur le bon vieux temps. On rit à nos souvenirs d’étudiants. Puis il se lève, enfile son blouson.
— Tu me donneras de tes nouvelles, Mag. As-tu mon numéro de téléphone ?
— Oui, si tu n’as pas changé. Tu es toujours avec Manon ?
— Bien sûr. Et nous prévoyons de faire un bébé. Quand ça arrivera, tu passeras nous voir à Toulouse ?
— Oh oui, tu penses !
Mon portable sonne : ma mère. Alexis m’embrasse et quitte l’appartement. Je décroche et nous parlons pendant une heure et neuf minutes. J’aime ça chez mes parents. Pas de jugement : une écoute attentive. Ils sont bien si je suis heureuse. Si c’est mon choix, alors tout va bien. Mais que je passe les voir en Lozère quand je me mettrai à sillonner la France. Et que je reste quelques jours. On s’embrasse et je raccroche, des larmes aux yeux. Quelle ouvertured’esprit, quelle compassion ils ont pour ceux qui les entourent ! Je voudrais leur ressembler ! Je rêve un moment,assise, le regard dans le vague. Je réalise qu’il est très tard et que je n’ai qu’une canette de bière dans l’estomac. Je grignote un restant de biscuits et quelques fruits au sirop. Je passe à la salle de bains et après un rapide coup d’œil sur le programme télé, décide de bouquiner au lit.
L’an dernier, ma mère m’avait offert le livre de Thomas Mann : « La montagne magique », et j’avoue que je n’ai pa seu, jusque-là, la curiosité de l’ouvrir. Je m’installe bien calée contre mes oreillers et j’attaque le périple de Hans Castorp avec enthousiasme. Il est deux heures du matin quand je décide de refermer l’ouvrage et de dormir.
Ma nuit est entrecoupée de rêves étranges. Je suis au volant d’une voiture, je roule à travers un paysage très noir, avec des arbres foncés et serrés. Tout est sombre et inquiétant. Je tombe en panne au milieu de cette forêt sinistre. Je marche, seule et assez épouvantée, le cœur du bois apparaît rempli de pièges et de monstres effrayants. J’arrive auprès d’une grande demeure dont les volets claquent au vent. Il y a un escalier gigantesque et vétuste, je dois faire attention en montant. Je frappe, Céline ouvre la porte. Elle est en colère contre moi, me dit de rentrer et de faire mes devoirs. Dans la maison étrange, je passe devant un miroir et je vois que j’ai une dizaine d’années. Je me réveille en sursaut. Je me lève et vais boire un verre d’eau à la cuisine. Il est cinq heures.
Je jette un coup d’œil par la baie vitrée du salon. J’aime cette heure où tout est encore noir, mais où certains s’affairent et sont déjà au travail. Au bas de la rue, le camion-poubelle est en train de charger les détritus des riverains. Une ambulance passe au loin. Les merles commencent leur conversation dans les arbres du parc. Je crois que ma nuit est terminée. Je me coule un café et m’installe dans le creux réconfortant du gros fauteuil bordeaux. Celui-là, il me manquera. Je souris à cette absurdité, comme si un siège pouvait devenir irremplaçable. Il est déjà retenu par madame Berger du quatrième. Elle était passée un soir où elle avait égaré ses clés. Elle avait bu un thé avec moi en attendant le retour de son mari et avait eu le coup de cœur. Alors quand je lui ai dit que je mettais tout en vente, elle a crié :
— Oh, le fauteuil bordeaux ! Je vous l’achète, s’il n’est pas trop cher pour moi bien sûr !
J’ai failli éclater de rire, car monsieur et madame Berger sont des joailliers de la place Vendôme. Je profite donc des dernières étreintes de mon accueillant fauteuil. Il se règle, s’allonge presque, soulève les jambes si l’on veut, il creuse le dos à la demande selon la cambrure… Il ne sert pas le café, mais dispose d’un emplacement sur l’accoudoir pour poser sa tasse. Il est top quoi ! Je me lève pour prendre un carnet et un stylo. Une fois réinstallée, je couche mes plans sur le papier, puis liste ce que je dois faire impérativement. Les corvées, les démarches administratives, les tracas de vente…
Dans la colonne projets, j’aligne : trouver un véhicule capable de me transporter et dans lequel je pourrai dormir, genre petit camping-car. Je n’y connais pas grand-chose. J’allume mon ordinateur et commence les recherches. Ah mon Dieu ! Jamais je n’aurais imaginé voir autant de marques, de modèles, de gabarits et de styles si variés. Je sens que cela va être compliqué. Je ne veux pas d’un énorme engin, j’ai toujours conduit des voitures de taille moyenne. Je note des adresses de vendeurs, j’irai cet après-midi. Je suis à nouveau excitée par mon projet. Me rendre à travers le pays en camping-car, visiter des endroits qui n’ont rien de touristique, rencontrer des gens. Cela fait hurler Céline ? La belle affaire, je vais lui montrer de quoi je suis capable !
Je consulte mon compte en banque, je suis rassurée, j’ai de très grosses économies. La vente de l’appartement viendra encore enfler mes réserves. Je fais une évaluation des prochaines dépenses, puis de ce dont j’aurai besoin ensuite. Je prends un grand tournant dans ma vie. Je me cale contre le dossier et réfléchis sur ces douze dernières années. Qu’est-ce qui me faisait avancer ? L’argent ? Le pouvoir ? Que sais-je ?
Le philosophe Alain a écrit : « Tout pouvoir sans contrôle rend fou. »
Douze années qui ne me laisseront aucun bon souvenir. Aucun. J’ai beau me creuser la tête, je ne trouve ni éclats de rire, ni échanges de gestes, ni mots attentionnés ou même simplement gentils. Froideur, indifférence. Je suis ça ? J’étais donc ça ? Une petite nana imbue d’elle-même, de sa réussite et incapable de compassion pour qui que ce soit ? Je me hais. Je m’exècre. Je me donne la nausée. J’envoie un SMS à ma mère : « Maman, suis-je une aussi mauvaise personne ? » Je reçois une réponse cinq minutes plus tard. Elle a peu de sommeil. Le soleil se lève et déjà elle va s’occuper des poules, là-bas dans sa jolie fermette. « Le fait même que tu te poses la question fait de toi quelqu’un de bien ! Je t’aime, ma fille. » Je pleure. Sur moi, sur cette peau répugnante que je veux enlever.
Je respire profondément, retourne sur le balcon. Il y fait frisquet à six heures trente, un dix mars. Je regarde en bas de l’immeuble, Richard est en faction, assis contre un mur non loin de la boulangerie. Laquelle est déjà ouverte, j’aperçois des hommes en bleu de travail entrer et sortir les bras chargés de sachets papier. Je parie qu’ils sont remplis de croissants, petits pains et autres viennoiseries bien chaudes. C’en est trop ! Je vais en profiter aussi. Je verse le café brûlant dans la thermos rouge, je dévale les trois étages, après avoir glissé un roman policier dans ma poche. Incroyable, je ne suis ni maquillée ni coiffée ! Je salue Richard, lui offre la boisson.
— Je me suis mal débrouillée, Richard, il vous faut à boire chaud pour la nuit. Ce soir, je viendrai récupérer la bouteille et je la ramènerai remplie.
— Bah, non, madame, vous n’allez pas monter, descendre et remonter… Je n’en vaux pas la peine !
— Ah ? Vraiment ? Quelle idée ! Je reviens, je vais acheter des petits pains au lait. Ce matin, j’ai envie de viennoiserie, pas vous ? Ah ! J’allais oublier, je vous ai pris un bouquin. Le suspense est fort sympathique.
— Oh, merci !
La boulangère me salue avec le sourire.
— Alors ? C’est vrai ce qu’on dit ? Elle quitte son travail pour aller se promener ?
— Elle va faire ça, oui ! Et elle n’a même pas peur !
— Mais… Elle a de l’argent ou elle va vivre d’amour et d’eau fraîche ?
— Un peu des deux… Bonne journée madame !
Richard mord à belles dents dans le petit pain encore tiède. On voit qu’il y prend plaisir. Je mange avec lui, je me suis installée à ses côtés.
— Vous n’avez pas froid, Richard ? Je veux dire, la nuit ?
— Maintenant, ça va, mais en période d’hiver, je souffre beaucoup. Le mois dernier, il y a eu des nuits à moins cinq degrés. Je me mets à l’abri.
– Co... Comment en êtes-vous arrivé là ?
— Comme tous les gens comme moi. Enfin, la plupart. Je travaillais. J’avais une femme et un fils. J’étais dessinateur-projeteur dans un cabinet d’architectes. Ils étaient trois. Trois types véreux. Ils ont triché, détourné du fric. La boîte a fait faillite. À quarante-cinq piges, je me suis trouvé sans job, mon épouse a perdu le sien dans le même temps. Elle a eu un cancer des ovaires. Au bout de dix-huit mois, on nous a pris notre appartement. Elle est partie vivre chez sa sœur. Elle est décédée il y a trois ans.
— Et votre fils ?
— Il était encore étudiant. Là, il a un boulot, mais il ne me voit plus. Au début, j’ai eu des petits emplois, puis, trop vieux, pas assez compétent. Plus d’appartement, plus d’adresse. Plus d’adresse, pas de papiers. Pas de papiers, pas de travail. Le cercle vicieux. L’étau qui se resserre peu à peu et étouffe. Je n’existe plus. L’enfer, quoi !
— Et personne ne vous aide ? Je veux dire, les services sociaux, les associations de réinsertion ? Que sais-je ?
— J’ai eu soixante ans il y a deux mois. On ne fait plus rien pour les gens de mon âge. On attend qu’ils crèvent de froid ou de la picole. Moi, je ne bois pas… Mon père était alcoolique, ça ne m’a pas laissé de bons souvenirs. Je ne vois plus mon fils, mais je n’aimerais pas qu’il apprenne que je suis une épave pleine de vinasse !
— Je comprends, Richard, je comprends…
Je quitte l’homme, le cœur serré. Pourquoi cette situation si difficile ? Et je sais qu’il y a de nombreux « Richard » dans Paris. Soudain, j’ai une idée. Oui, une excellente idée ! Il y a quelques années, j’ai dépanné le jeune propriétaire d’un bistrot, ami d’une relation de travail : Mehdi. Il avait des problèmes de mise en conformité de son local et était empêtré dans les lois des normes et obligations d’accessibilité. Grâce à mon intervention, il avait gagné des mois de procédure et pas mal d’argent. Je suis repassée plusieurs fois dans sa brasserie et toujours, il m’a répété que je pouvais lui demander n’importe quoi ! « N’importe quoi, Margaret ! » Eh bien, on va voir ! Demain je tente le coup. Non, pas demain. Cet après-midi, puisque je dois visiter le magasin de camping-cars. Juste le même quartier.
Je remonte à l’appartement, très heureuse. La matinée passe vite, je remplis mes cartons. Parfois, je souris devant l’irrationalité de mes rangements. Je retrouve un album de photos entre une boîte de purée instantanée et des céréales. En fouillant dans les papiers de banque, je découvre un dessin que j’ai fait quand j’avais sept ou huit ans. Il était coincé entre deux pages blanches. Il représente un paysage naïf. Des collines vertes, en bas à droite, une maison jaune, avec un toit rouge, une cheminée grise, et de la fumée qui en sort. En haut, dans un ciel très pastel, des nuages bleus.
J’ai toujours dessiné des nuages bleus. Une émotion m’étreint pendant que je regarde ce croquis. C’est l’époque où j’allais en vacances chez mon oncle Roger et ma tante Félicia, dans le centre de la France. Ma cousine Ludivine et moi étions de grandes amies, inséparables. Ma belle cousine… Je soupire et range le dessin. Les cartons s’amoncellent dans le living. À midi, j’ai bien avancé.
L’agence immobilière m’appelle pour prévoir une visite le lendemain à onze heures.
— Il y a un jeune couple très intéressé par le quartier et la proximité du parc.
Je ne suis pas très inquiète au sujet de l’appartement, je sais qu’il partira. Il est en excellent état et la restauration s’était faite dans les normes. Il est parfaitement bien classé.
Je décide d’aller manger en ville quand le téléphone sonne.
Céline a une toute petite voix.
— Mag, je ne t’importune pas ?
— Non, pas du tout. Tu ne me déranges jamais…
— Je… Je souhaitais te dire que… enfin, tu es libre de faire ce que tu veux. Même si je ne comprends pas ton cheminement…
— Je sais, Céline. Il s’agit de mon avenir, et surtout… Je ne te laisserai pas !
Elle sanglote au bout du fil. Ça me serre les tripes. Elle est mon amie, la seule.
— Tu as entendu ? Je serai toujours ton amie, même à l’ autre bout du monde, enfin, de la France.
Elle rit doucement. Puis elle répond en reniflant :
— En fait, tu as raison, j’ai surtout peur de ne plus te voir.
Je me sens si seule. Les enfants vont à l’école, Bertrand travaille comme un fou, moi, je reste là, à la maison à attendre je ne sais quoi. Je vais en ville, dépenser l’argent que mon mari gagne. Et je m’ennuie tellement, Mag ! Tu connais la nouvelle idée de Bertrand ? Trouver un professeur à domicile pour l’aide aux devoirs de Mina et de Victor !
Elle se remet à pleurer. Sa colère monte.
— Tu sais ce que cela veut dire ? Qu’il me juge incapable de seconder mes enfants. Il me prend pour une débile. Je me sens complètement inutile.
— Mais pourquoi fait-il cela ? Ne lâche pas, ne te laisse pas faire. Aide tes gamins et prouve-lui qu’il se trompe. Tu es le meilleur professeur pour eux. En plus, tu les aimes tellement.
— Alors, quand j’ai su que tu allais quitter Paris, j’ai craqué. C’était égoïste.
— Il n’y a rien de grave, je ne t’en veux pas, Céline.
— Pardonne-moi ! Alexis m’a téléphoné et j’ai compris tes projets. Je t’envie, Mag…
— Je t’enverrai des cartes avec des vaches, des charrettes de foin, de magnifiques paysages. Je prendrai des photos et quand je repasserai à Paris, je vous ferai des soirées diapositives aussi nulles que celles qu’on avait sur le campus ! Tu t’en souviens ? Avec des morceaux de piano barbants pour accompagner les images.
On raccroche après un échange de plus de vingt minutes. Je me dis que Bertrand n’est pas très commode comme mari.
C’est étrange, je ne l’imaginais pas ainsi.
Je sors, avec un peu de retard, je vais d’abord voir Mehdi.
Il voudra m’offrir un café ou un thé à la menthe. Je marche pendant une quinzaine de minutes. Depuis le trottoir d’en face, sur l’avenue, j’observe la Brasserie. Une grande enseigne rouge et noire flotte au vent, sur laquelle est inscrit : « La Berbère Brasserie ». Le store n’est pas descendu, mais les tables et les chaises en imitation rotin sont déjà installées sur le devant. Quelques clients terminent leur steak-frites ou leur couscous du jour. J’arrive à peine au niveau des premiers fauteuils, lorsque Mehdi sort de l’établissement.
— Margaret ! Ma, toi ! Entre, viens, assieds-toi ! Je t’amène un thé à la menthe dont tu me donneras des nouvelles !
Maman ! Apporte des makrouts, il y a une amie qui est là !
Tu as mangé au moins ?
— Eh bien, non, je me disais…
— Walida, sers plutôt un couscous !
Puis il prononce quelques mots en marocain. Sa mère arrive avec un plat en terre qu’elle pose délicatement devant moi.
Elle ôte cérémonieusement le couvercle et une odeur d’épices et de légumes me fait terriblement saliver. Elle sort rapidement et réapparaît avec une petite jatte remplie de graines de couscous. Mon estomac bataille à l’intérieur de mon corps et je sens qu’il faut que j’attaque, sinon, je ne réponds plus de moi ! Mehdi entre à son tour avec un thé qu’il verse de très haut, selon la tradition. Puis il pose un verre pour lui et d’autorité s’assied en face de moi.
— Comment vas-tu, Margaret ? Ça me fait trop plaisir de te voir ! Comment trouves-tu ma brasserie ? Elle est belle,hein ? Et tu sais, ça marche bien. Tellement que je pourrais avoir un serveur de plus, avec moi. Ma mère reste plutôt en cuisine, elle n’aime pas venir en salle.
— Justement Mehdi. J’ai quelqu’un qui pourrait te seconder. Mais c’est particulier.
On parle un grand moment, je savoure mon plat tout en discutant. J’ai à peine terminé le couscous que Tadla, la maman, dispose devant moi une assiette de pâtisseries.
Mehdi accepte avec empressement d’aider Richard, même quand je lui annonce son âge, son manque de papiers récents. À un moment, il échange en marocain avec sa mère,se retourne vers moi et dit :
— Il pourra loger en haut, il y a un genre de studio. On le laisse à Brahim, quand il est là, mais en ce moment, il es tau Maroc pour finir son stage.
— Comment te remercier Mehdi, vous êtes tellement aimables !
— Tu l’as déjà fait, Margaret. Sans ton aide, jamais je ne me serais installé ici. Je t’ai toujours dit que je te devais un service. Je suis content, par Allah, ce jour est enfin arrivé !
On se sépare en s’embrassant. Tadla me serre contre elle.
Elle sent bon les épices. Je dois revenir demain avec Richard. Pourvu qu’il accepte ! Je file au garage des camping-cars. Le magasin d’exposition est gigantesque. Je suis complètement perdue. Des gros, des petits, des hauts,des plus bas, certains ont le toit qui se soulève, d’autres sont tellement longs qu’on ne voit pas le bout. Je suis un peu découragée. Je déambule pendant quinze minutes autour de ces engins, quand enfin, un commercial me fait l’honneur de s’intéresser à moi. Un type en costume marine. Il doit avoir environ mon âge. Mince, pas vilain, un côté Johnny Depp.
— Je peux vous aider, madame ?
— Sans doute, oui. Cela fait quinze minutes que je tourne dans le hangar.
— Excusez-moi, j’étais occupé au téléphone.
Mon œil ! Il attendait avant de ferrer la cliente. Savoir si c’est juste une touriste, dans ce cas, aucun intérêt. Ou alors,patienter, qu’elle s’accroche. On visite un bel engin, blanc et gris, rutilant, mais trop gros à mon goût. Nous passons au suivant. Je le trouve mal conçu. Peu pratique. J’essaie de m’imaginer vivant dedans. Un confort nécessaire, du chauffage, bien évidemment. Toilettes, douche. Des rangements fonctionnels. Un bon lit. Oh, ça oui ! Et pour le moteur du véhicule, quelque chose de résistant. J’ai beaucoup lu depuis quelques jours et j’ai mon avis là-dessus. Je déniche ce qu’il me faut. Ou plutôt, le fourgon m’attire ! Gris avec un peu de rouge sur la carrosserie. Il est compact. Je le dis à Johnny Depp, enfin, Christophe. Ce prénom est inscrit sur sa chemise.
— Très bon choix, madame. C’est un véhicule de dernière génération. Avec ça, vous pourrez aller partout.
— J’aimerais en avoir un de ce modèle-là d’ici deux semaines. Ça vous paraît possible ?
— Venez, passons dans mon bureau. Je sais qu’il y a des délais. Après, il faut voir ce que vous voulez comme agencement. Avec un peu de chance, on trouvera vite.
Nous discutons pendant près de deux heures. Quand il me questionne au sujet du financement, je suis désagréable et lui réponds façon ancienne Margaret la garce ! Je me reprends à temps. Puis il comprend que j’ai les fonds nécessaires. J’en profite pour lui demander des aménagements en plus. Gratuits !
– Évidemment, madame. Vous payez votre véhicule au comptant, nous allons faire un geste.
— Oui, à ce prix-là, ça peut en être plusieurs, non ?
Nous nous entendons enfin. Il jubile Johnny. Une vente bien menée pour lui, et pour moi, une affaire aussi. Il est déjà dix-huit heures lorsque je sors de la concession. Je décide de prendre le bus pour rentrer. Arrivée au pied de l’immeuble, j’aperçois Richard plongé dans la lecture du livre que je lui ai donné.
— Richard ! Vous allez bien ?
— Oui, merci. Sympa, le bouquin !
— Je vous ai déniché un travail…J’ai un peu peur en prononçant ces mots. Et s’il m’envoie sur les roses ? Et si, au fond de lui, il n’en veut pas ? S’il ne s’en sent pas capable, ou que sais-je ? Je suis vite rassurée.
— Oh, Margaret, si vous m’avez trouvé du boulot, co...
comment je peux dire ? Je suis bouleversé… De quoi s’agit-il ? Et où est-ce ?
— J’ai un ami qui tient une petite brasserie dans un quartier pas très éloigné. Son business marche plutôt bien et il aimerait avoir deux bras de plus pour le service. Vous vous imaginez être garçon en salle ?
— Oh, oui ! J’ai fait ça dans ma jeunesse. Bon, je vais un peu moins vite, c’est sûr, mais je suis encore vif.
— Demain, si vous êtes d’accord, je vous emmène chez Mehdi. Il est chouette, vous verrez.
— Mais… ma carte d’identité est périmée… Je n’ai pas d’autres papiers. Enfin, si. J’ai mon permis de conduire. Pas d’adresse, oh, mon Dieu !
— Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous régulariserez çaa vec Mehdi.
— Je n’ai pas d’habitation, je vais faire comment ?
— Pas de panique ! Tadla et Mehdi, Tadla c’est la mère de Mehdi, ils sont d’origine marocaine. Ils ont un studio à votre disposition, je crois. Donc, tout va bien, non ? Ah, ne pleurez pas Richard. Pas de ça ! Je vais acheter un sandwich pour votre souper. Et je vais monter finir de ranger mes cartons.
— Ah bon, vous déménagez ?
— Oui, je change de vie.
— Ah, ben moi aussi !
Il rit. Il se racle la gorge. Je file avant que le moment ne devienne trop gênant. Je ne veux pas qu’il se confonde en remerciements. La boulangère me regarde ou plutôt, mereluque curieusement.
— Elle fait quoi, qu’elle traîne avec ce clochard ?
– Pas grand-chose. Elle lui offre juste un sandwich pour son souper !
— Elle l’a pris en amitié ou quoi ?
— On peut dire ça. C’est un brave homme.
— Pour ça ! Elle est bizarre !
— Oh oui, elle est bizarre !
Je sors du commerce en réprimant un fou rire. Richard s’empare du casse-croûte en murmurant un timide merci. Je remarque au passage que ses yeux sont rouges. Je me détourne rapidement après lui avoir souhaité une bonne soirée. Un grand capharnaüm m’attend au troisième étage.
Sur le palier du deuxième, madame Berger m’interpelle.
Elle veut savoir si elle peut faire déménager le fauteuil ce samedi.
— Heu… Vous êtes pressée ? Vous… Heu, on ne va pas se précipiter. En principe, je ne pars que dans une quinzaine.
Je vous fais signe mercredi prochain, ou avant, s’il y a un changement, d’accord ?
— Ah, oui ! Bien sûr ! C’était pour vous débarrasser !
— Voilà, je vous tiendrai au courant. Bonne soirée !
Je me suis rattrapée à temps, car la secrétaire en chef de Batilem a failli ressurgir de mon corps ! Des mots corrosifs allaient se précipiter hors de ma bouche. Arrière Satanas !
Pour un peu, je lui aurais dit des horreurs à madame Berger.
Respire ! C’est normal que tu rechutes. La peste n’est pas très loin. Elle te guette sournoisement à chaque rencontre, à chaque petite difficulté. Encore une mise à l’épreuve. La garce qui a fait partie de toi pendant si longtemps a du mal
à déguerpir. Elle colle à ta peau. Que crois-tu ? Penses-tu devenir aussi sereine que Bouddha en quelques jours ? Je souris à l’image de Bouddha. Être une Margaret qui arrive
à se regarder dans la glace, ça me suffira. Le téléphone vibre dans la poche de mon imperméable, Bertrand. Que me veut-il celui-là ?
— Salut Mag ! J’ai discuté avec Céline. Alors, tu nous quittes ?
— Nuance, je ne vous quitte pas. Je change de vie. Je ne délaisse personne.
— Et, que vas-tu faire ? Elle n’a pas su me dire. Je la trouve un peu confuse en ce moment.
— Je vais… Comment t’expliquer ? Profiter des vacances,visiter du pays, retrouver mes parents, mes amis. Et…
— Et le boulot ? Où vas-tu travailler ?
— J’aviserai…
— Tu es complètement sonnée ! Je ne te croyais pas aussi sotte !
Respire Margaret, respire ! Je prends de grandes goulées d’air depuis mon balcon. Je ne sais que lui répondre.
Comme je sens la colère monter, je fais une expiration plus profonde.
— Ah ? Tu ne me connais pas !
Je ris le plus futilement possible.
— Mag ? Je me disais, avant ton départ, on pourrait se faire un restaurant, juste toi et moi ?
Ben, voyons, Bertrand le séducteur, il recommence, il a déjà essayé de me draguer. Je vais ruser.
— Ah, oui, excellente idée ! Céline me l’a aussi proposé !
On se réunit tous chez Balambrey jeudi !
Silence au bout du fil. Je me retiens de rire.
— Écoute, profite de ton changement de vie. Je te laisse,j’ai une intervention dans quinze minutes.
— Très bien, on se retrouvera au restaurant. Il me tarde de voir les enfants ! Bonne soirée Bertrand.
Il s’est pris un vent. Je m’écroule dans un angle du salon,entre deux gros cartons de livres. Je suis épuisée. Je ferme les yeux. Bizarrement, le visage souriant de Richard m’apparaît. Je suis tellement heureuse pour lui.
Une petite voix sournoise me dit : « C’est quand même grâce à toi ! » Je soupire, et mon autre moi répond : « C’est bon, on se calme, tu n’as pas fait grand-chose, ne te prend pas pour mère Térésa ! » Mais quel cirque sous mon scalp !
Je me lève et vais à la cuisine. Il n’y a plus grand-chose à manger. J’ouvre le réfrigérateur. Une tomate et un œuf me font signe qu’ils sont d’accord pour passer à la casserole.
Eh bien, je me régale.
Le téléphone sonne, mon père appelle. Il a dû être briefé par maman.
— Bonsoir ma fille ! Comment vas-tu ?
— Bien, papa… Voix un peu hésitante.
— Tu es sûre ? Tu as l’air triste. N’aie crainte, tu seras encore assaillie de doutes. Et souvent. Accroche-toi. Tu as pris cette décision, assume-la à présent.
— Je sais. Je m’enthousiasmais jusque-là. Mais ce soir, je suis angoissée…
— Même un chemin de mille lieues commence par un pas,Mag !
— Oui. J’en suis qu’au premier petit pas, hésitant.
— Et, entre nous, tu ne risques rien. Tu as de l’argent.
— Je sais, je n’ai aucun mérite. En plus, je vais encore avoir trois salaires puisque je suis en congé…
— Tu passes nous voir en premier ? Quand vas-tu commencer ton voyage ?