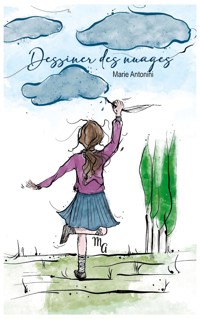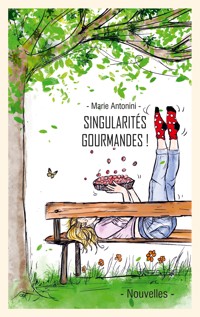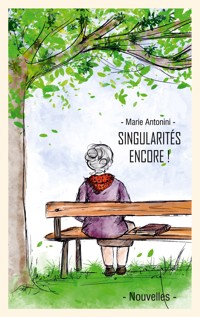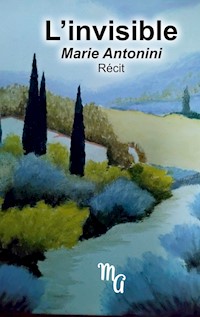Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1929, Emilie, une jeune institutrice native de Besançon, décide de ne pas enseigner, mais d'aller travailler comme journaliste au quotidien La Fronde à Paris. Elle y retrouve des femmes qui se battent pour leurs droits. Elle côtoie les plus illustres, Marguerite Durand, Madeleine Pelletier, Caroline Rémy et tant d'autres... Elle prend conscience des conditions de certaines de ses consoeurs et choisit de combattre avec elles, pour le droit de vote, pour l'égalité des salaires, etc. A la capitale, elle va fréquenter les artistes de Montmartre, rencontrer les écrivains et les célébrités de ce début du XXe siècle. Le lecteur va suivre son travail de journaliste et de militante, ainsi que sa vie de femme mariée. Ce roman où la fiction rejoint parfois la réalité couvre la période de 1928 à 1942. Je tenais à rendre hommage aux féministes, aux suffragettes, aux femmes courageuses qui ont revendiqué le droit d'être les égales de l'homme, et ce, toujours sans violence.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Certains personnages cités dans le livre ont existé et se sont rendus célèbres par leur action ou leur art, mais les situations de ce récit sont purement fictives et dans ce roman de forme uchronique, toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. »
« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.3352 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. »
Tous les éléments composant ce livre sont le résultat de ma propre créativité et n’ont, en aucun cas, été générés par une intelligence artificielle.
Table des matières
Présentation du roman
Préfaces
Présentation des personnages
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Remerciements
Documentation
Personnages célèbres cités dans le livre
Présentation du roman
Nous sommes en 2025. Dans de nombreux pays, les femmes subissent des violences inacceptables. On parle encore d’un top 10 des pays les plus dangereux, les plus répressifs pour les femmes, avec l’Inde, l’Afghanistan, la Syrie, la Somalie en tête de liste...
Je tenais à rendre hommage aux féministes, aux suffragettes, aux femmes courageuses qui ont revendiqué le droit d’être les égales de l’homme.
Le terme de féminisme a été utilisé la première fois par Alexandre Dumas fils, avec un sens péjoratif dans un pamphlet antiféministe justement. Ensuite, Hubertine Auclert lui donne tout son sens actuel.
Le mot suffragette a déjà été connu en Angleterre à la fin du XIXe siècle, il s’agissait de militantes qui réclamaient le droit de vote.
Le féminisme a un sens beaucoup plus large, il se définit comme un ensemble de mouvements et d’idées philosophiques qui partagent un but commun : atteindre l’égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes.
En reprenant cette histoire des femmes entre 1928 et 1940, je voulais montrer combien tout cela est fragile, combien de douleurs, de cris, de blessures parfois, il a fallu pour aboutir à un certain résultat. Je tenais aussi à rappeler que certains hommes ont lutté d’arrache-pied contre les libertés des femmes.
Le droit de vote, l’égalité des salaires, le droit à l’avortement...
Olympe, Louise, Alexandra, Marguerite, Claire, Marthe, Madeleine…
Rencontrer ces femmes courageuses, ces militantes a été pour moi un honneur chaque jour renouvelé. J’y ai ajouté Émilie, mon héroïne, native de Besançon, elle a côtoyé virtuellement toutes ces femmes. Et comme elle le disait si bien :
Le combat n’est pas terminé !
Marie Antonini
Préface de Brigitte Pagnot, artiste peintre
On a beau dire, on a beau faire… Nous, les femmes, aurons toujours à nous battre pour qu’on nous reconnaisse à l’égal des hommes.
Je suis sensibilisée à l’Art depuis mon enfance. Je pense que les artistes féminines ne sont pas valorisées comme elles le méritent. Celles du XVIIe siècle à nos jours ont œuvré sans être reconnues dans ce domaine traditionnellement masculin (aussi bien en dessin, peinture, photographie, sculpture). À l’heure actuelle, on commence à les (re) découvrir grâce à des médias particuliers ou des collectionneurs qui les exposent au grand jour. Mais que de femmes battantes, artistes ou non, ont été ignorées, écartées ou méprisées du fait de leur sexe !
Certaines se sont fait connaître, mais tant d’autres sont restées dans l’ombre (de leur mari ou de leur maître, par exemple Camille Claudel).
Alors merci Marie, d’avoir dédié ton ouvrage à la gent féminine, d’avoir fait toutes ces recherches pour lui rendre hommage !
Préface de Colette Roux
Merci à Marie,
Pour avoir fait revivre toutes ces grandes dames de la lutte des femmes pour leurs droits et leur dignité.
De Christine de Pisan à Olympe de Gouge, qui y laissa sa vie, en passant par Louise Michel, Marie Curie, et au XXe siècle, la voyageuse Alexandra David Néel... l’écrivaine Simone de Beauvoir, Joséphine Baker, Gisèle Halimi, etc.
Comment les citer toutes ?
Merci de nous en avoir fait découvrir tant d’autres, moins connues, actives, opiniâtres, résistantes, comme les journalistes de La Fronde, sans oublier les anonymes, les domestiques, les cousettes, et aussi les faiseuses d’anges...
Grâce au personnage d’Émilie avec ceux, hommes et femmes qui l’entourent, Marie a su nous les rendre proches :
Tant d’histoires dans la grande Histoire !
Et c’est aussi un bel hommage à la sororité qui nous est si précieuse.
Jusqu’à nos jours, le combat continue : Me Too, les Femen.
La vigilance est toujours de mise et les déclarations masculinistes nous le rappellent chaque jour !
Michelle Perrot, grande historienne de la vie des femmes, nous alerte sur la fragilité des conquêtes.
Alors, restons attentives et solidaires !
Préface de Isabelle Bruhl-Bastien, auteure
Au-delà d’être une belle histoire, ce nouveau roman de Marie Antonini est un livre passionnant tant au niveau historique que sociétal, psychologique, voire philosophique. Toutes les femmes, jeunes ou moins jeunes, ainsi que les hommes devraient le lire.
Ces femmes, peut-être nos mères ou nos grands-mères, se sont battues pour que nous puissions avoir des droits au même titre que la gent masculine. Cet ouvrage, très bien documenté, nous montre combien il était difficile pour une femme de se faire respecter, de s’exprimer ou de travailler.
Rien n’est acquis pour autant. Ce roman est malheureusement toujours d’actualité. Je ne peux que conseiller la lecture de « L’étole de cachemire ou le combat des femmes », un ouvrage qui va faire parler de lui. Merci à Marie pour sa confiance en me proposant de lire son manuscrit !
Préface de Nathalie Faure Lombardot, auteure
Je fais partie de la génération X. Née de parents qui « ont vécu » 68, des parents jeunes, à l’esprit plus qu’ouvert ! La liberté des femmes, l’égalité homme/femme, je les croyais acquises et naturelles. Il m’a fallu attendre l’âge dit adulte, pour me rendre compte qu’il n’en était rien, et que les droits des femmes étaient pour la plupart récents ! Le droit de vote des femmes en France date de 1945. Le droit pour une femme d’ouvrir un compte en banque et signer un chèque sans l’autorisation de son mari ou de son père : 1965 ! Hier, quoi ! Mais pire ! Il a fallu attendre 1975 pour obtenir le droit d’avorter ! J’avais 6 ans ! Le droit de porter plainte pour viol contre son mari : un premier arrêt de la Cour de cassation date du 5 septembre 1990, puis un arrêt plus précis est signé en 1992 ! Ce n’est que depuis 2010 que la référence à la présomption de consentement disparaît (en cas de viol entre conjoints) ! On croit rêver, n’est-ce pas ? C’est pourquoi, quand Marie m’a parlé de son manuscrit, j’ai été emballée, enchantée et je la remercie pour ce beau récit de femmes, ce récit du combat qu’ont vécu nos grands-mères et arrière-grands-mères !
J’ai un respect et une admiration sans bornes pour les Louise Michel, Josephine Baker, Emmeline Pankhurst, Frida Kahlo, Marguerite Durand, Nellie Blye, Emma Goldman et autre Clara Zetkin, pour me limiter à cette époque de la fin du XIXème et début du XXème siècle.
Comme l’a dit Marguerite Durand (1864 – 1936), l’un des personnages « vrais » de ce roman, « L’accès des femmes au journalisme moderne est l’une des conquêtes dont le féminisme est justement fier et dont le mérite ne peut lui être contesté. »
Merci Marie, de rendre hommage, à ta façon, à ces femmes auxquelles nous devons tant
La famille d’Émilie Carpentier au Manoir Besançon
Honoré Carpentier Joséphine née Dulac
père d’Emilie mère d’Emilie Se sont mariés en 1904
Adélaïde Carpentier
mère de Romuald, d’Honoré et de Caroline, grand-mère d’Émilie et Marie-Louise
Romuald Thérèse
frère aîné d’Honoré et de Caroline femme de Romuald
Caroline
sœur de Romuald et d’Honoré Veuve
Marie-Louise
fille de Caroline, cousine d’Émilie
Suzanne Dulac Louis
sœur de Joséphine fiancé de Suzanne
Raymond d’Albiny Yvonne
ami d’Honoré, parrain d’Émilie femme de Raymond d’Albiny
Marcelle et Éléonore
filles jumelles des d’Albiny
Jeannine
cuisinière au Manoir
Alvaro et Carmen Pablo Gomez
jardinier et femme de ménage au Manoir, parents de Pablo fils d’Alvaro et Carmen, ami d’enfance Émilie
À la pension Caspari - Paris rue Taitbout
Marthe Caspari
logeuse
Jeanne
sa fille de 8 ans
Georgette
la cuisinière
Madeleine
20 ans, petite main chez Jane Regny
Céleste
19 ans, nurse dans une famille du 16
e
Nestor
25 ans, artiste peintre, caricaturiste
Marcel
32 ans, écrivain
Jean
28 ans, bouquiniste
Victor
la trentaine, clerc de notaire
Charlotte
30 ans, couturière
Au journal La Fronde
Marguerite Durand
directrice. Libertaire
Betty
rédactrice
Séverine
écrivain, journaliste. Libertaire
Madeleine Pelletier
médecin, journaliste, essayiste. Libertaire
Au journal La Française
Cécile Brunschvicg
directrice, journaliste féministe
Blanche
secrétaire de rédaction
Bernadette
secrétaire de rédaction
Chapitre 1
Le soleil d’août dardait ses rayons sur le jardin fleuri.
Émilie attrapa sa capeline en paille et descendit les marches de la terrasse. Sa robe claire virevoltait autour de ses fines chevilles. Elle chantonnait. Dix-huit ans ! Elle avait dix-huit ans aujourd’hui ! Ses parents avaient organisé un repas de famille, et dans quelques heures, ils seraient une douzaine à l’applaudir au moment où elle soufflerait ses bougies devant l’énorme gâteau préparé par Jeanine la cuisinière.
Elle avança entre les rangées de buis parfumés et ferma les yeux. Comme elle aimait l’odeur caractéristique de ces plantes ! C’étaient de douces réminiscences de son enfance lorsqu’elle jouait à cache-cache avec sa cousine Marie-Louise. Un merle siffleur lança ses vocalises depuis le noisetier, elle s’immobilisa quelques instants pour l’écouter.
Le domaine de ses parents se situait à Besançon, dans un quartier boisé à la sortie de la ville. La maison familiale, surnommée le Manoir par les riverains, avait été construite en 1842 par l’aïeul d’Honoré Carpentier. C’était une bâtisse massive en pierres meulières que le temps avait ternies et rendues grises.
Honoré, le père d’Émilie, s’était conduit en héros durant la dernière guerre. Militaire de carrière, il avait mené, en compagnie du général Nivelle, la bataille du Chemin des Dames, en avril 1917. Blessé pendant une attaque en 1918, il était rentré à Besançon pour y retrouver sa jeune épouse Joséphine et leur fillette Émilie, alors âgée de onze ans. Il se lança dans les affaires en 1920, et fit de l’importation de spiritueux d’Espagne, puis profitant de l’américanisation progressive, grâce à un moderne réseau de transport, il fit venir aussi de nombreuses marchandises des États-Unis et d’Asie. Il s’absentait parfois de longs mois afin de rencontrer tel ou tel interlocuteur étranger susceptible de lui procurer de nouvelles denrées.
Émilie n’appréciait pas trop l’architecture du Manoir, elle aurait préféré une maison plus modeste, mais elle adorait le parc, les saules pleureurs proches du Doubs, les bancs de pierre nichés sous les chèvrefeuilles ainsi que la roseraie, soignée depuis toujours par Alvaro, le vieux jardinier.
Celui-ci était arrivé en France en 1903, il avait fui le règne chaotique du roi Alfonso XIII. Parvenu à Besançon pendant l’hiver 1905, il avait cherché du travail. Joséphine, désirant une personne qualifiée pour entretenir la propriété, avait eu vent de ses compétences au cours d’un après-midi au salon de thé du centre-ville. Sa belle-mère, Adélaïde lui avait conseillé de prendre le vigoureux espagnol à son service. Sa femme, Carmen faisait le ménage de l’aïeule. Alvaro, dans la force de l’âge, s’installa avec son épouse dans la maisonnette au bout du terrain. Le cabanon fut restauré, et au printemps 1910, naquit leur fils Pablo.
Émilie marcha jusqu’au bassin, elle s’assit sur le banc et s’abandonna à rêver. Elle n’entendit pas le crissement des pas de Pablo qui posa en douce les mains sur ses yeux.
Surprise, elle cria, puis se mit à rire.
— Pablo ! Tu m’as fait peur !
— C’était le but ! Bon anniversaire Émilie !
Il lui tendit un bouquet de cinq roses blanches.
— Oh, merci, elles sont magnifiques !
— En fait, je les ai prises dans votre roseraie !
— C’est l’intention qui compte, merci ! Je dois y aller, les invités vont arriver. À bientôt ! Pablo, donne le bonjour à tes parents !
Elle s’éloigna dans un léger froufroutement laissant derrière elle des effluves parfumés que Pablo respira les yeux fermés.
La grand-mère Adélaïde bouchait la porte avec son imposante stature, elle était vêtue de la même robe qu’au mariage de son fils Honoré, en 1904. C’était une jupe noire très longue, ornée de plusieurs volants, surmontée d’un corsage piqué de plis, dont le col enserrait la gorge, ce qui n’avantageait pas son double menton. Elle relevait ses cheveux à la mode du début du siècle, faisant dire à Émilie, « Grand-maman est restée bloquée en 1900, elle n’a pas quitté son corset ni son ombrelle ! »
— Émilie, ma petite-fille ! Déjà dix-huit ans !
— Bonjour, Grand-maman, comment allez-vous ? Autour de la table se trouvait, Raymond d’Albiny, le parrain d’Émilie, ami de la famille. Émilie le surnommait
« monsieur n’est-ce pas », car il ponctuait chacune de ses phrases par cette expression. Il était accompagné de sa femme Yvonne, une personne effacée et maigrichonne, qui opinait de la tête dès que son mari ouvrait la bouche, et de deux de leurs enfants, Marcelle et Eugénie, des jumelles de douze ans. Elles étaient habillées de la même robe de forme droite, manches ballons et col rond. Celle de Marcelle était bleue, celle d’Eugénie, jaune pâle. Les gamines se tenaient raides sur leur chaise et ne bougeaient pas. Émilie tenta de leur parler, mais elles respectaient les consignes de leur mère, « Soyez sages, je ne veux pas avoir de remarque à vous faire ! » Face à Émilie, sa tante Suzanne, la plus jeune sœur de Joséphine, buvait du vin avec délectation. Elle s’entretenait avec Adélaïde. C’était une jolie femme, âgée de vingt-cinq ans, célibataire. Elle était sortie de l’École Normale d’institutrices en 1922 et avait un poste dans une institution privée de Besançon.
Au moment du dessert, Adélaïde se leva, embrassa sa petite fille et annonça :
— Nous allons pouvoir trouver un bon mari à cette jeune fille !
Les jumelles pouffèrent, puis s’arrêtèrent aussitôt, le regard implacable de leur mère avait de quoi les terroriser.
Suzanne s’esclaffa, Émilie se dressa sur sa chaise et hurla :
— Ah, ça non ! Il n’en est pas question. Je vais poursuivre mes études !
— Tu as obtenu tes baccalauréats en juillet, cela ne te suffit donc pas ? Une femme n’a nul besoin d’être trop instruite !
Émilie lança son regard « au secours » à son père. Honoré sourit, leva son verre de champagne en disant :
— Bon anniversaire, ma Mimi !
Il se retourna pour attraper un paquet derrière lui, le tendit
à sa fille. Elle fit le tour de la table, embrassa ses parents, se réinstalla et ouvrit la boîte. Elle en sortit une large écharpe, douce, mousseuse et fine à la fois. Elle était dans un dégradé de tons qui évoquaient une forêt d’automne et un coucher de soleil d’été qui seyaient parfaitement à son teint frais.
Elle frotta le superbe châle mœlleux contre son visage. Sa mère lui dit :
— C’est une étole en cachemire, ton père l’a ramenée de Srinagar au printemps, il l’a choisie spécialement pour toi !
— Elle est magnifique, je l’adore ! Elle la jeta sur ses épaules, les longues franges de laine descendaient jusqu’à ses mollets.
— Quel joli tissu, n’est-ce pas ? interrompit Raymond.
Suzanne offrit une pochette en papier, Émilie s’en empara, l’ouvrit avec empressement. Depuis toujours les cadeaux de sa tante avaient un modernisme d’avant-garde. Elle découvrit un livret d’une auteure qu’elle ne connaissait pas.
Elle lut à haute voix :
— Appel d’une femme au peuple sur l’affranchissement de la femme. Claire Demar.
— Quelles idées allez-vous encore lui fourrer dans la tête ? maugréa Adélaïde.
— N’est-ce pas elle qui s’habillait en bleu, blanc, rouge et mettait son nom sur son plastron ? J’avais lu un article sur elle, c’était une journaliste des années 1830, ajouta Joséphine.
Raymond d’Albiny opina. Son visage restait de marbre et nul ne pouvait y déchiffrer quelconque manifestation d’accord ou de désaccord. C’était comme si cette conversation ne l’intéressait pas. D’ailleurs, il se pencha vers son ami Honoré son verre de champagne à la main :
— À la santé de notre petite Émilie ! N’est-ce pas ? Il se tourna vers son épouse :
— Elle a encore grandi, n’est-ce pas ? Les jumelles avaient déjà dévoré leur part de gâteau. Elles demandèrent discrètement à Yvonne si elles pouvaient aller au jardin. Elles sortirent en riant et se bousculant.
Après avoir remercié Suzanne, Émilie consulta le livre en silence. Soudain, elle lut à haute voix :
— « L’individu social, ce n’est pas l’homme seulement ni la femme seulement. L’individu social, c’est l’homme et la femme. Cependant, nous sommes les esclaves des hommes dont nous sommes les mères, les sœurs et les épouses, mais dont nous ne voulons plus être les très humbles servantes ! »
— De l’hérésie ! ronchonna Adélaïde, depuis que le monde existe, la femme est faite pour être une mère et une épouse, on sait tous cela. Si elle avait été conçue pour devenir ingénieure, journaliste ou cheminote, Dieu lui aurait donné de gros bras et un cerveau plus développé !
— Je vais dire que je n’ai rien entendu, Grand-maman !
répondit Émilie.
Suzanne et Joséphine rirent aux éclats. Honoré se racla la gorge et lança :
— Qui reprendra du café ?
Pour lui, la diversion restait la meilleure solution pour éviter les débordements de sa mère.
L’après-midi s’écoula plus calmement, puis Honoré raccompagna Adélaïde en voiture. Il possédait une Citroën B10 noire qu’il choyait comme son bébé. L’aïeule résidait au centre de Besançon dans un bel immeuble de la Grande rue, au numéro 132, non loin de la maison natale de Victor Hugo, ce dont elle était très fière. Elle n’hésitait pas à préciser, chaque fois qu’elle parlait de son appartement :
« Tout près de là où ce cher Victor Hugo vit le jour ! » De son côté, la famille d’Albiny s’éloigna à pied, elle habitait non loin des Carpentier dans une demeure cossue au bord du Doubs.
Suzanne flâna dans le jardin avec sa nièce poursuivant leur discussion. Émilie avait pris sa décision, elle irait à l’École Normale d’institutrices. Restait à convaincre ses parents, mais elle n’était pas très inquiète, Honoré adorait sa fille et Joséphine regrettait de ne pas avoir fait de longues études.
Elle avait hésité entre l’enseignement, la médecine ou encore les recherches scientifiques. Elle vénérait par ailleurs Marie Curie, si remarquable et si savante. Après tout, elle était la première femme à avoir reçu le prix Nobel de chimie en 1911 !
Elles s’installèrent côte à côte sur le banc. Au loin, Pablo désherbait un carré de pré, sans doute pour y semer quelques légumes.
— Je voulais te confier mon admiration pour une personne hors du commun, commença Suzanne. As-tu lu les articles relatant les exploits d’Alexandra David Néel ? Cela te rappelle quelque chose ?
— Il me semble avoir vu une photo d’elle sur un Figaro de cette année. Attends, elle est journaliste ?
— Elle est, comment dire, exploratrice, féministe, écrivaine, orientaliste, et… mais n’en parle pas à ton père, franc-maçonne !
— Oui, je sais, elle est allée en Inde, en Chine, elle est bouddhiste, non ?
— Plus encore, elle a rencontré le Dalaï-lama et, tiens-toi bien, c’est la première femme à être entrée dans Lhassa !
Elle n’est plus très jeune, il me semble qu’elle approche les soixante ans. Je te trouverai des journaux sur ses exploits !
— Je suis déjà passionnée, il me tarde de lire tout cela !
Elles se levèrent et toujours bavardant, regagnèrent la terrasse où les attendaient Joséphine et Honoré.
— Je dois vous quitter, dit Suzanne, je vais retrouver une amie, nous avons rendez-vous pour une réunion de… elle bafouilla, et se reprenant, ajouta, de militantes !
— De féministes, tu veux dire, l’interrompit Joséphine.
— C’est cela, grande sœur. C’est une conférence d’une Anglaise qui soutient le droit des femmes, elle défend particulièrement les ouvrières. Elle s’appelle Annie Besant.
Comme elle ne fait qu’une seule tournée en province, nous avons l’opportunité de la voir aujourd’hui.
— Oh, j’aimerais venir avec toi, comme ce doit être passionnant ! s’écria Émilie.
— Désolée ma cocotte, je n’ai pas de place pour toi, mais rassure-toi, il y en aura d’autres. Je pense que nous aurons la chance de rencontrer l’aventurière marcheuse Alexandra David Néel !
— Si elle revient en France…
Suzanne les quitta, le soleil était déjà très bas à l’horizon.
Émilie pénétra dans la grande maison et, se précipitant dans l’office, demanda à Jeanine la cuisinière s’il restait du gâteau.
Elle le mit sur un plat, le couvrit d’un torchon et sortit. Elle traversa le jardin, dépassa les buis, longea le banc, arriva vers le bassin. Une grenouille, surprise, plongea au cœur des nénuphars. La jeune fille déboucha devant la chaumière des Gomez. Elle frappa, Carmen ouvrit la porte, un sourire rayonnant barrait son beau visage bronzé.
— Émilie, quelle joie de te recevoir ! Entre, je te prie. Les garçons viennent de terminer leur travail.
Elle appela :
— Pablo, descends ! Nous avons de la visite !
Alvaro apparut, il s’était rafraîchi, sa figure était encore humide. Il s’excusa, mais Émilie se leva et posa un baiser sur sa joue rugueuse. Au moment où elle se retourna, Pablo faisait irruption dans la pièce. Elle l’embrassa aussitôt, il rougit légèrement. Carmen montra le plat de gâteau :
— Nous sommes gâtés, quel bon dessert pour notre souper !
Alvaro, sors donc le vin doux de Malaga, nous allons fêter les dix-huit ans de cette demoiselle ! Pablo, apporte les verres à pied de Tia Adélina !
Pablo avait soufflé ses seize bougies en mars. C’était un grand gaillard, il avait de beaux yeux noirs, des cheveux bruns bouclés et abondants comme ceux de Carmen. Il avait interrompu ses études pour venir seconder son père. Il regrettait un peu d’avoir arrêté le collège, il était bon élève et aurait aimé devenir ingénieur dans les automobiles.
Cependant, la perspective de travailler dans les parages d’Émilie avait compensé son dépit. Depuis sa plus tendre enfance, il l’adorait. Il la trouvait différente des autres filles, plus modérée, plus intelligente aussi.
Émilie annonça son souhait d’entrer à l’École Normale d’institutrices, ici à Besançon.
— Tu deviendras une maîtresse, c’est bien, c’est une énorme responsabilité, dit Alvaro avec son fort accent espagnol.
Alvaro avait beaucoup vieilli ces dernières années. Il toussait beaucoup, Carmen avait craint pour lui, mais le médecin l’avait rassurée. Son mari avait trop fumé, il lui faudrait des mois pour éliminer tout le goudron de ses poumons.
Le vin de Malaga était délicieux, Émilie appréciait les moments passés avec le jardinier et sa famille. Il racontait les déboires de leur roi Alphonse XIII, la pauvreté généralisée dans la province de Teruel. Alvaro narrait son franchissement des Pyrénées, seul, à pied, la peur au ventre, sans victuailles et avec des chaussures trouées. Carmen le réprimandait :
— Ya lo has dicho diez veces ! (Tu l’as déjà dit dix fois)
L’homme se taisait et buvait doucement son nectar.
Émilie se leva, la nuit tombait, elle devait rentrer à présent.
Carmen ordonna à Pablo de raccompagner la jeune fille.
Après les « au revoir », ils sortirent tous les deux. Ils traversèrent le pré en silence et longèrent la mare. Arrivés au niveau des buis, Émilie se tourna vers le garçon et lui dit qu’il pouvait s’en retourner, elle n’était plus très loin. Il se pencha, l’embrassa sur la joue et fit rapidement demi-tour.
Honoré accueillit sa fille, il attendait derrière la porte.
— Ils vont bien nos amis ?
— Oui, très bien, tu connais Alvaro, il commence à raconter, encore et encore, je n’ose pas l’interrompre.
Carmen, lui a dit un truc en espagnol, il s’est arrêté aussitôt !
Ils rirent.
Jeanine fit irruption, l’air furibond, elle regarda Honoré :
— Vous voulez manger à quelle heure ? C’est un peu compliqué aujourd’hui, ça va, ça vient, je ne sais plus ce que je dois cuisiner ! Il est déjà dix-neuf heures trente !
Joséphine sortit du salon, en souriant, elle répondit calmement :
— Ne vous énervez pas, Jeanine, on dinera comme à l’accoutumée, à vingt heures. Un potage serait le bienvenu.
C’était très bon, le déjeuner, merci beaucoup !
Le ton de la cuisinière s’adoucit d’un coup :
— Ah, une soupe, vingt heures, ce sera fait. Courgettes, carottes, pommes de terre, cela vous convient-il ?
— Parfait, c’est parfait, merci !
Émilie ajouta :
— Le gâteau était formidable, un délice, tout le monde l’a apprécié, merci Jeanine !
— Ah ! Ça me fait plaisir, au fait, bon anniversaire, mademoiselle Émilie !
— Juste, Émilie, pas mademoiselle !
— Ah ! J’ai du mal.
Jeanine pivota et fila en direction de l’office.
Honoré rit, puis il s’empara d’une boîte à cigares, en sortit un Joya du Nicaragua offert par un ami commerçant. Émilie observa le rituel de son père. C’était un véritable cérémonial qui la fascinait depuis sa plus tendre enfance. Petite, elle restait là, sur une chaise, subjuguée et silencieuse. Elle ne perdait aucun des gestes savants et rigoureux de son père. Il se munit d’un coupe-cigare chromé, ses mouvements étaient lents et précis, il trancha délicatement, mais franchement l’extrémité, puis l’alluma à l’aide d’un magnifique briquet recouvert de cuir. Il chauffa doucement le pied du cigare, l’amena à ses lèvres et tira quelques bouffées tout en maintenant la flamme. La fumée s’éleva alors, odorante et bleuâtre. Honoré se recula dans le creux du fauteuil et ferma les yeux. Les deux femmes n’osaient plus bouger de peur de perturber son plaisir, son instant de grâce. Elles se regardaient en souriant. Après quelques minutes, il les observa :
— Ce fut une belle journée, n’est-ce pas ma fille ?
— Oui, nous avons passé de bons moments, je suis heureuse d’avoir revu tante Suzanne !
— Ma sœur est un phénomène ! ajouta Joséphine.
Puis, se tournant vers Émilie :
— J’ai bien compris que tu veux enseigner, comme elle ?
— Ça me plairait beaucoup. Je rentre à l’École Normale en septembre…
— Tu as fait toutes les démarches sans rien nous dire ?
— C’est-à-dire… Ça s’est enchaîné avec les résultats des baccalauréats.
— C’est très bien, très bien Mimi ! ajouta le père en rallumant le reste de son cigare.
Chapitre 2
Assise sur le banc de pierre, Émilie était en grande conversation avec sa cousine Marie-Louise.
Elles avaient toutes deux le même âge. Émilie venait de fêter ses vingt-deux ans, Marie-Louise allait les avoir en septembre. Elles étaient très ressemblantes, si ce n’était la couleur des cheveux. Émilie était blonde, elle avait une coupe au carré assez raide, Marie-Louise, brune et ronde de visage, portait une superbe toison frisée jusque sur les épaules.
Elles ne s’étaient pas vues depuis l’entrée à l’École Normale d’Émilie. Et aujourd’hui, son diplôme d’institutrice en poche, elle avait décidé de ne pas enseigner.
Avant d’annoncer ses nouvelles intentions à ses parents, elle voulait en discuter avec sa cousine.
— Je ne sais pas comment va réagir mon père. Il m’a toujours un peu couvée…
— Certes, mais il t’adore et acceptera tes choix, ajouta Marie-Louise.
— J’ai parlé à Suzanne, elle pense que mon projet me correspond parfaitement. Elle a de nombreuses adresses à Paris, je ne serai pas seule. Depuis que j’ai lu cette revue, je me dis que ma place est là, dans cette rédaction ! Et même si je dois juste balayer les bureaux pour commencer !
Elles rirent. Marie-Louise observait Émilie et imitant Adélaïde, répliqua :
— Tu vas monter à Paris ? Mais quelle horreur, c’est une ville de perdition, tu vas devenir comme ces mauvaises filles, celles qui fument et revêtent des pantalons, une gourgandine !
Elles s’esclaffèrent.
— Sais-tu, chère cousine, que j’ai consenti, à contrecœur bien sûr, à rencontrer deux garçons envoyés par ma grand-maman ?
— Ah, pauvres de nous, moi aussi. Vas-y, raconte !
— Gaspard Falot, il porte bien son nom, celui-là, crois-moi ! Une chiffe molle, maigre comme un clou. Il m’avait emmenée au cinéma voir Loulou, le film avec Louise Brooks. J’étais ravie de ce choix, ce film est formidable.
Pendant la séance, il malaxait mon genou, triturait ma jupe et, imagine, il a même essayé de m’embrasser à la fin !
Adieu Gaspard Falot ! Et toi, quel beau ténébreux grand-maman t’a-t-elle offert ?
— J’ai vu Victor Rougeaud, lui aussi est le bien nommé.
Visage rubicond, il respire fort, mais quelle haleine détestable ! Il fume sans arrêt des cigarettes qui dégagent une odeur pestilentielle. Sa moustache est décolorée par le tabac. Il m’a invitée à boire un thé au centre-ville. Une fois assise en face de lui, j’eus droit à son pied sur le mien. Il me donna des coups de genoux et sa main moite et boudinée qui cherchait la mienne sans relâche, enfin un festival de maladresses grossières. Je ne l’ai pas revu. Alors, tu as parlé de deux gars, qui est le second ?
— Tu vas mourir de rire, un certain Victor Rougeaud !
Même comportement, pot de colle à souhait. Pauvre grand-maman !
— Elle n’est pas de ce siècle, c’est compliqué pour elle !
Raconte-moi des choses sur ce journal qui t’attend, ou pas, à Paris.
— J’ai eu connaissance, par cette chère Suzanne, que la rédaction de La Fronde cherchait de la main-d’œuvre, féminine, évidemment. Le quotidien a beaucoup de difficultés depuis la guerre. C’est un hebdomadaire qui a été fondé en 1897. Au début, il ne paraissait qu’une fois par mois.
— Revue féministe ?
— Bien entendu ! Et le personnel au grand complet est composé de femmes, que des femmes, des vieilles, des jeunes ! Même à l’atelier, ce sont des femmes, typographes, imprimeuses, colporteuses, partout, des femmes !
— Génial ! Crois-tu qu’il y aurait de la place pour moi ? Je rêve de tout quitter et je t’accompagnerais volontiers à la capitale ! Après tout, j’ai en poche un diplôme de secrétaire et je ne me plais guère dans l’entreprise de meubles de mon oncle Romuald.
— Euh, et ta mère ? Et notre grand-maman ? Émilie se jeta dans les bras de Marie-Louise et hurla : nous partirons ensemble pour Paris !
Au fond du jardin, Pablo taillait les rosiers, il se retourna en entendant les cris et se rapprocha. À vingt ans, il s’était métamorphosé en un superbe jeune homme. Il rit et demanda :
— Tout va bien, les cousines ?
— Tout va très bien, Pablo. Marie-Louise et moi projetons d’aller travailler à Paris dès cet automne. Et je suis ravie qu’elle m’accompagne !
Le sourire quitta le visage de Pablo, il devint livide.
— Émilie, tu as l’intention de partir ? Et l’enseignement ?
Et ton diplôme ? Que vas-tu faire à Paris ?
— Je… enfin… nous allons entrer dans une rédaction de journal. Mon rêve est d’être reporter !
— Et ce n’est pas n’importe quelle revue, c’est un hebdomadaire féministe ! renchérit Marie-Louise.
— Je ne te comprends pas, tu es bien ici, à Besançon…
— J’ai envie d’autre chose, Pablo, j’ai besoin de participer à l’éveil du monde, contribuer à changer le regard de l’homme sur la femme. Je désire être, moi aussi, porte-parole de tous les partis philogynes. La Fronde, c’est le nom du journal, mais rassure-toi, il ne se veut pas pamphlet contre les hommes, juste anti-tyrans !
— D’accord. Mais tu n’as pas peur d’aller dans cette grande ville ? Paris n’est pas Besançon !
— Je serai avec Marie-Louise ! Suzanne nous a déjà communiqué des adresses pour se loger.
— Tes parents, ou plutôt, vos parents sont au courant ?
— Ça ne va pas tarder, Pablo !
Il s’éloigna sans se retourner et sans même les saluer.
Marie-Louise observa sa cousine, puis elle dit doucement :
— Tu as rendu Pablo très malheureux, il est amoureux de toi, ça se voit !
— Tu plaisantes ! Nous sommes amis d’enfance et de jeux.
Non, il n’est pas épris de moi !
— On en reparlera, il est parti très triste, je l’ai senti !
— Bah, il s’en remettra. Sais-tu que j’ai deux paires de pantalons dans ma garde-robe ? Je les ai fabriqués avec l’aide de Jeanine. Il a fallu que je la bouscule un peu, elle ne voulait pas me prêter la machine à coudre. Elle n’y a consenti que parce que j’en ai discuté avec maman.
— Tante Joséphine adorerait en porter, j’imagine !
— Elle les a essayés, ça lui va à ravir. Mais papa n’est pas encore mûr. Cela viendra, j’en suis certaine, d’ici quelque temps, il lui en offrira une paire, ajouta-t-elle en riant.
La discussion avec Honoré et Joséphine fut toutefois un peu houleuse, ils ne comprenaient pas cet engouement soudain de leur fille pour le journalisme. Les arguments d’Émilie finirent cependant par les convaincre, Marie-Louise l’accompagnerait dans cette aventure, cela les rassurait. Il était vingt-trois heures, la conversation avait duré plus de deux heures. Honoré s’empara de son précieux coffret à cigares, signe que le débat était clos, il prit un Monte Cristo de La Havane, il venait d’en recevoir une pleine boîte de son ami Eusébio Yumara. Son cérémonial commença. Calé au fond du fauteuil, il ferma les yeux. Ne voulant perturber ce moment de sérénité, Joséphine chuchota qu’elle allait se coucher et Émilie sortit observer les étoiles, elle avait besoin de réfléchir. Elle avait écrit au journal deux semaines auparavant et espérait avoir convaincu la directrice Marguerite Durand de l’embaucher.
Elle ouvrit la porte-fenêtre, il soufflait un vent frais pour une fin d’été, elle attrapa l’étole en cachemire restée sur un siège de la terrasse et la jeta sur ses épaules frissonnantes.
La nuit était claire, la lune pleine brillait au-dessus des arbres. Elle marcha dans la pénombre jusqu’à son banc préféré sous le chèvrefeuille. Elle s’assit et leva le nez en direction de la voute céleste. L’inquiétude grandissait, ce futur inconnu qui l’attendait lui causait des angoisses malgré l’excitation. Son attitude confiante des heures précédentes avait totalement disparu. Elle respirait fort en se répétant, j’ai fait le bon choix, tout va bien aller. Je vais rencontrer des femmes exceptionnelles ! Un bruit dans les fourrés la fit sursauter, le cœur battant elle scruta les taillis vers la mare et vit une silhouette qui approchait.
Pablo parla doucement :
— N’aie pas peur Émilie, c’est moi. Puis-je m’asseoir près de toi ?
— Viens. Pourquoi n’es-tu pas encore couché ?
— Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Je pensais à ce que tu as dit tantôt… Je ne peux croire que tu vas quitter la maison. Tes parents ont accepté ?
— Oui, la décision fut douloureusement entérinée. Nous partirons sans doute en septembre, j’attends une réponse du journal. Tu sais, Pablo, il s’agit de mon avenir, mes convictions tu les connais. Tu te doutais que je ne resterais pas ici.
— C’est vrai. J’avoue que je n’avais pas envie que cela change. On… on s’entend bien toi et moi.
— Je reviendrai. En train, le voyage n’est pas si terrible !
Ils bavardèrent tranquillement pendant une heure. Émilie se leva et posa un rapide baiser sur la joue de son ami. Il s’éloigna à son tour et regagna la chaumière au fond du parc.
Les jours suivants, Émilie guetta le passage du facteur. Ce mercredi, Jeannine poussa la porte de la grille et discuta quelques minutes avec lui. Il confia une grande enveloppe, en pénétrant dans la maison, elle appela :
— Émilie, il y a une lettre de Paris pour vous !
La jeune fille se précipita et courut s’asseoir au salon avec le précieux courrier. Joséphine la rejoignit et patienta. Elle scrutait son visage. Soudain, Émilie sourit, la regarda et s’écria :
— Maman, je suis prise à la Fronde ! Marie-Louise aussi, la rédaction a besoin d’une secrétaire ! Nous sommes attendues le lundi 21 septembre à 9 heures ! C’est une lettre signée de Marguerite Durand et de la journaliste Caroline Rémy.
— C’est bien, vous aurez le temps de préparer vos bagages.
À présent, il vous faut un logement. Ton père pourra t’aider pour cela, il a de nombreuses connaissances à Paris. Dismoi, où se situe la rédaction de La Fronde ?
— C’est au… elle consulta le courrier, au 14 de la rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. Maman, puis-je utiliser le téléphone ? Je dois appeler Marie-Louise.
— Honoré est dans son bureau, va frapper à la porte.
Marie-Louise hurla de joie, elle cria tellement dans l’appareil qu’Émilie fut obligée de l’éloigner de son oreille.
Elles décidèrent de se retrouver le jour même afin de discuter de leur projet.
L’après-midi, elle lut le courrier à voix haute, sa cousine l’écoutait attentivement. Il était précisé que les deux jeunes femmes remplaceraient des journalistes devant quitter la rédaction pour de plus importantes responsabilités.
Madame Durand expliquait que la revue avait été créée en décembre 1897. Autour de 1900, certains numéros furent vendus jusqu’à 50 000 exemplaires, mais depuis la fin de la guerre, le féminisme n’était plus très à la mode, de quotidien, le périodique était alors devenu mensuel. Malgré cela, elle faisait face à de grandes difficultés financières.
Elle comptait beaucoup sur ces jeunes personnes pour redynamiser la rédaction et en relancer la diffusion. Elle conclut en ajoutant : « Nous lutterons pour la femme écrivaine, rédactrice qui veut placer sa copie, pour l’ouvrière qui veut un salaire égal à celui de l’homme, pour la femme qui veut avoir des possibilités d’être épouse et mère. Il faut donner une idée de l’importance du travail produit par les femmes dans notre chère patrie où on ne parle que de la grâce, du charme, des séductions et autres mièvreries. »
— Cette fois, Émilie, nous devenons des grandes filles.
Regarde la liste de celles qui ont façonné cette revue depuis 1897 ! Elle énuméra, Jeanne Caruchet, morte en 1906, professeure de lettres, elle a écrit sur l’avortement ! Jeanne Chauvin, elle défend le droit des femmes d’exercer la profession d’avocat. Tiens, Alexandra David Néel, ton héroïne, journaliste, anarchiste, exploratrice… Clotilde Dissard se battait pour la protection de leur travail. Jeanne Loiseau, celle qui se faisait appeler Daniel Lesueur. Oh, écoute, elle fut la seule à intervenir à la tribune de séances plénières du congrès international du commerce et de l’industrie au moment de l’exposition universelle de 1900 !
Madeleine Pelletier…
— Je connais ce nom, ma tante Suzanne m’en a déjà parlé, j’en suis sûre.
Honoré entra dans la pièce et les interrompit :
— C’était la première femme médecin diplômée en psychiatrie. Elle était pauvre, contrairement à beaucoup de féministes du début du siècle. Je sais qu’elle était partie en Russie juste avant la fin de la guerre, elle croyait dur comme fer à l’idéal communiste. Elle pratiqua son métier tout en faisant des conférences et en participant à ce journal. Vous allez sans doute la rencontrer. Ce n’est pas n’importe qui. Il me semble avoir lu quelque part qu’elle est née en 1874.
— Comme toi, papa ! Mais comment a-t-elle pu fréquenter la faculté de médecine si sa famille était pauvre ? demanda Émilie.
— Le docteur qui s’occupait de sa mère gravement malade a senti le potentiel intellectuel de Madeleine. C’est lui qui a financé ses études, elle a pu devenir praticienne. En 1902, il y eut des manifestations de soutien des féministes érudites, car elle avait voulu s’inscrire aux épreuves des internats des asiles, mais on lui avait refusé au prétexte que le concours était réservé aux personnes jouissant de leurs privilèges politiques, englobant, évidemment, le droit de vote. Voilà, le droit de vote des femmes n’est pas encore pour demain. Et je le regrette.
— Nous allons essayer de changer tout cela, mon oncle !
— Vous ne l’avez pas connue, mais une Vosgienne fut la première à obtenir le baccalauréat en 1861, elle avait trente- sept ans ! Elle avait fréquenté la Sorbonne alors que ce n’était pas autorisé aux filles.
— Comment se fait-il qu’elle l’ait eu à cet âge ? demanda Marie-Louise.
— On lui refusait, elle a réclamé pendant plus de dix ans, on lui répondait que les femmes n’avaient pas besoin de ça !
Je crois que c’est l’impératrice Eugénie qui est intervenue, et enfin, elle a reçu son diplôme ! Elle était saint-simonienne, comme beaucoup de ses contemporaines. Je vous la cite parce qu’elle fut journaliste et militante du droit des femmes !
— Quelle personne merveilleuse ! J’admire nos sœurs ainées qui ont ouvert des portes et bousculé les hommes.
Dans quelle revue travaillait-elle ?
— Je ne sais pas trop, elle était très pieuse, elle parlait beaucoup de l’enseignement des jeunes filles. Ah, je crois qu’elle avait écrit des articles dans « La Presse ». Tout ça, c’était avant 1900. Elle est décédée avant ses soixante ans.
Marie-Louise démissionna de son emploi chez son oncle Romuald. Il était le frère ainé d’Honoré, il avait soixante-deux ans et possédait l’entreprise de leur père. À la mort de ce dernier, Adélaïde n’avait pas laissé le choix à son grand.
Il allait reprendre l’ébénisterie. Romuald était doué pour les affaires, il s’était entouré d’ouvriers d’excellence et l’avait fait prospérer. Quand la fille de sa sœur Caroline avait frappé à sa porte, il avait accepté de l’engager, elle seconderait l’actuelle secrétaire. Il avait néanmoins bien compris que sa nièce ne resterait pas dans les meubles toute sa vie, aussi, lorsqu’elle lui confia son envie de « voir ailleurs », il l’encouragea.
Émilie et Marie-Louise se retrouvaient au Manoir tous les matins afin d’organiser au mieux les préparatifs de leur nouveau départ.
Adélaïde débarqua un après-midi où toutes deux écrivaient la liste des choses indispensables à emmener. La grand-mère bouscula Joséphine en hurlant qu’elle voulait s’entretenir sur-le-champ avec son fils. Honoré sortit de son bureau alerté par le boucan. Il eut à peine le temps de prononcer un bonjour qu’elle s’écria :
— De quel droit vous permettez-vous de bafouer mon autorité ? J’apprends que mes deux petites filles vont aller se dévergonder à Paris, cette ville de perdition ! Joséphine, il me semblait que vous étiez pleine de bon sens, vous vous égarez ! Et Caroline, comment peut-elle laisser Marie-Louise suivre Émilie ?
Émilie s’approcha et parla doucement :
— Grand-maman, restez calme, nous aurons un travail sérieux à Paris. Il ne s’agit pas d’une entreprise louche.
Papa a vérifié, nous y serons bien et nous avons trouvé un logement dans une pension de famille respectable. Ne soyez pas inquiète, nous vous écrirons très souvent, n’est-ce pas, Marie-Louise ?
La jeune fille était au bord des larmes, sa grand-mère l’avait toujours impressionnée. Elle acquiesça d’un hochement de tête, incapable de prononcer un mot. En ce qui concernait l’autorité, Marie-Louise comptait sur Émilie, elle se reconnaissait plus fragile. Jamais elle ne serait partie à Paris de son propre chef, mais se sentir dans l’ombre de sa cousine, si déterminée, la rassurait.
Adélaïde se calma rapidement. Elle voulut tout connaître, savoir où elles allaient habiter, le nom de la propriétaire de la maison, l’adresse précise.
— Et ce travail, Émilie, en quoi consiste-t-il exactement ?
— Je vais être rédactrice, je pense, mais peut-être pourrais-je devenir journaliste. Ça me plairait d’être au cœur des enquêtes et des interviews.
— Je ne vous comprends pas, après cette horrible guerre qui a tué des millions d’hommes, on vous propose une vie calme, un bon mariage…
— Les temps ont changé, grand-maman.
— Je sais, je ne suis plus du tout dans le coup. Passez à la maison toutes les deux, avant de partir, bien sûr. J’ai quelque chose pour vous !
Afin de bien repérer les lieux et de s’installer, les deux jeunes filles décidèrent de prendre le train de dix heures le jeudi 17 septembre. La veille, les valises étaient bouclées.
Marie-Louise était venue dormir auprès de sa cousine, sa mère lui avait promis de l’accompagner sur le quai de la gare. Caroline avait perdu son mari, il avait été tué à la dernière guerre, elle en portait encore le deuil. Il avait succombé à de graves blessures lors de l’explosion d’un obus à Verdun.
Elles étaient passées toutes deux chez Adélaïde qui leur avait servi le thé, puis elle avait ouvert une boîte posée sur le guéridon. Émilie reçut un bracelet maillé en or, elle fut émue aux larmes lorsque Adélaïde lui dit :
— Je l’ai eu de ton grand-père Adrien à la naissance d’Honoré.
Elle sortit ensuite un médaillon et sa chaîne, en or aussi, elle l’offrit à Marie-Louise. Celle-ci embrassa la vieille dame avec effusion.
— Ce médaillon, c’est encore de votre aïeul. Il me l’a donné quand j’ai accouché de Caroline, ta mère.
Elles la remercièrent, bouleversées et larmoyantes.
Adélaïde se leva du sofa et quitta la pièce. Les cousines s’interrogèrent du regard, elle réapparut, des billets de banque dans la main droite.
— Et voici de l’argent, vous en aurez besoin, il vous faudra manger, payer le tramway, le loyer…
— Merci grand-maman ! s’écrièrent-elles en chœur.