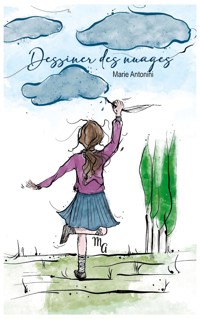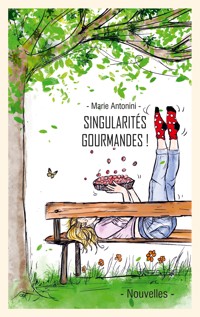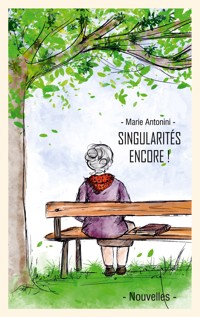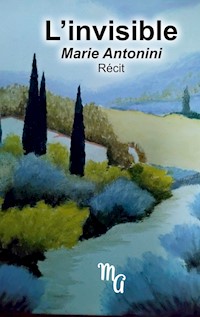Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mon grand-père fut engagé volontaire dans l'artillerie en juillet 1915, il avait dix-neuf ans. Nous disposons du courrier qu'il envoyait à ses parents sous forme de cartes lettres qu'ils recevaient ouvertes, car elles étaient lues par ses supérieurs. Il y raconte son quotidien en se censurant afin de ne pas inquiéter sa famille. Je me suis inspirée de tous ces écrits, ainsi que du carnet dans lequel il notait tous ses déplacements, de divers livres et documents en ma possession, de cartes postales anciennes, de renseignements aimablement donnés par des connaissances ainsi que d'autres archives dont vous trouverez la liste en fin d'ouvrage. J'ai fait aussi de nombreuses recherches dans les médiathèques. Les lieux sont partiellement existants, mais j'ai pris quelques libertés ! Vous allez faire connaissance de Charles, natif d'un village de Haute-Saône. Vous rencontrerez sa famille, ses amis et vous suivrez ses périples, d'abord sur le front, puis à bord de son avion. Je dédie ce roman à ce valeureux grand-père que j'ai peu connu, mais qui à mes yeux, fait figure de héros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Les personnages étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite, certains lieux ont existé, mais la plupart ont été librement inventés. »
« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants causes, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. »
Sommaire
Avant-propos
Préface
À toute ma famille, fière de ce grand-père !
Faverney: Début juillet 1915
Bourges: Juillet 1915
Faverney: Juillet et août 1915
23 Septembre 1915: Discours du Général Joffre, général en chef des armées :
Bourges et Dijon: Automne et fin 1915
Dijon: Mars 1916
Faverney: Printemps-été 1916
Front de la Somme: Automne-hiver 1916
Printemps 1917
Faverney: Début 1917
Chartres: Juillet 1917
Faverney: Fin août 1917
École d’Avord: Septembre 1917
Faverney: Décembre 1917
SFA Étampes: Décembre 1917 (Service de fabrication de l’aviation)
Faverney: Janvier 1918
SFA Étampes-Mondésir: Janvier-février 1918
Faverney: Début 1918
Étampes: Avril 1918
Faverney: Avril-Mai 1918
Étampes: Mai-début juin 1918
Faverney: Fin juin 1918
Étampes SFA: Juillet-Août 1918
Faverney: Juillet-août 1918
Étampes, puis division Breguet: Septembre/octobre 1918
Faverney: Septembre/octobre 1918
Escadrille: Fin octobre/Novembre 1918
Faverney: Novembre/décembre 1918
Division Breguet, puis Escadrille 104: Janvier/février/mars 1919
Faverney: Premier trimestre 1919
Escadrille 104: Avril 1919
Faverney: Avril 1919
Escadrille 104: Mai-juin 1919
Faverney: Mai-juin 1919
Escadrille 104: Juillet-août 1919
Faverney: Août 1919
Faverney: Septembre 1919
Escadrille 104: Septembre 1919
Postface
Remerciements
Documents consultés
Marie Antonini Auteure :
Avant-propos
Comment a débuté la Première Guerre mondiale ?
Le 28 juin 1914, un attentat entraîne une crise majeure en Europe. L’archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne de l’Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo par un étudiant serbe de Bosnie. Ce dernier militait pour le rattachement de la Bosnie à la Serbie. Cela donne ainsi une bonne excuse à l’Empire austro-hongrois pour attaquer la Serbie le 28 juillet 1914. Les Serbes voulaient en effet réunir tous les Slaves des Balkans dans un seul et même royaume et récupérer la Bosnie, annexée par les austro-hongrois, afin d’avoir un accès à la mer Adriatique. Cet évènement met en marche un jeu d’alliances politiques vers la Première Guerre mondiale. Dès le 30 juillet, la Russie se mobilise pour la Serbie. L’Allemagne qui soutient l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Le Royaume-Uni s’engage alors aux côtés de la France. Le 4 août 1914, l’Allemagne entre en Belgique, s’ensuit la bataille des Ardennes.
Pour comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, il faut se pencher sur une carte du monde du début de l’année 1914. L’Empire austro-hongrois abrite une multitude de peuples (autrichiens, hongrois, tchèques, roumains, polonais, serbes…). La Pologne est partagée entre l’Empire russe, la Prusse et l’Autriche-Hongrie. Tandis que la Turquie constitue alors l’Empire ottoman. La France, à qui l’Allemagne a pris l’Alsace et une partie de la Lorraine à l’issue de la guerre de 1870-1871, veut les récupérer et se venger. Les autres pays et empires se disputent également des territoires, aggravant les tensions diplomatiques.
Sources : Wikipédia + la première guerre mondiale de J.M. Winter
Préface
Mon père, ce héros !
Par la plume alerte et précise de Marie, il est devenu Charles.
Charles, c’est un jeune gars de la France profonde, bien ancré dans cette terre là, au début du XXe siècle, une histoire qui s’inscrit dans la grande Histoire.
Un jeune gars dans l’énergie de ses 20 ans, avec le goût de l’aventure, la bravoure, l’inconscience de la jeunesse, et une confiance en lui qui ne se démentira pas dans les pires moments de la guerre.
Un jeune gars pragmatique qui cultive l’amitié, la solidarité, qui décrit la dureté du quotidien, sans épanchements, sans pathos et même avec humour, avec la pudeur de celui qui fait face, tout en protégeant ceux qu’il aime.
A l’orée de sa vie d’adulte, il s’engage avec enthousiasme, la fleur au fusil, prêt à en découdre :
« Il faut que je m’en mêle si on veut que ça finisse ! »
Il découvrira l’horreur des tranchées, le froid, la faim, les poux, le fracas des bombes, les copains qui meurent à ses côtés…
Marie nous emmène avec lui sur ce chemin, elle nous fait ressentir ce que la guerre fait aux corps et aux cœurs, comment elle les brise, comment elle fait pleurer les mères et les amoureuses.
Charles est sans cesse relié à sa famille, à ses proches, à sa terre natale, qui fait face à la guerre de son mieux en l’absence des hommes, grâce au travail des femmes qui ensemencent, cultivent, moissonnent, font tourner le moulin, fabriquent le pain et font les lessives.
C’est une déambulation qui nous fait rencontrer au fil des saisons et des années, les enfants, les vieillards, le maire et le curé, les notables et les domestiques.
Marie aime cette petite bourgade au fil de la Lanterne, elle aime les gens, elle sait nous les rendre proches.
Faverney, c’est le pays de mon enfance, celui que j’ai quitté, mais auquel j’appartiens.
Un village franc-comtois, terre de bocages, de pâtures et de vergers, terre industrieuse entre moulin, tannerie et tissage, où l’on cultive l’entraide et la solidarité, à l’ombre de l’abbaye et ses deux clochers.
Marie a su trouver le ton juste pour exprimer le caractère des gens de mon pays, pudiques, au plus près du réel, gourmands de nourritures simples et pleins d’humour.
Elle nous fait ressentir la rudesse des hivers, le dur labeur de la terre, la joie des récoltes et le bonheur des retrouvailles.
Il s’appelait Joseph, Charles, Edmond, il était tout cela, c’était mon père.
On l’appelait « Papa Edmond »
Il est là, en filigrane, à chaque page du roman de Marie qui a si bien su le faire revivre.
Quand elle était petite, la troisième et la première fille parmi ses petits-enfants, il lui chantait :
« T’en fais pas la Marie, t’es jolie ! »
Quel bel hommage lui a-t-elle rendu, et comme nous lui savons gré de ce magnifique et documenté travail de mémoire !
Le philosophe et historien Michel SERRES lors d’un échange télévisé, peu de temps avant sa mort en 2019, disait :
« Quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace et je me dis : Michel, nous sommes en paix ! »
Aujourd’hui, en 2024, les bruits de bottes résonnent de partout, des humains se déchirent, des enfants meurent… ça ne finira donc jamais ?
Colette Patru
À toute ma famille, fière de ce grand-père !
Certaines expressions sont en italique. Il s’agit de termes glanés dans les notes de mon aïeul et qui pourraient choquer le lecteur. Il faut se replonger dans le contexte de cette époque sanglante et difficile. Ce conflit tua 18,6 millions de personnes, 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils.
Il dura du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, le traité de Paix fut signé le 28 juin 1919 à Versailles.
Faverney
Début juillet 1915
Le ciel bleu d’azur était traversé de nuages cotonneux. Charles marchait, les mains dans les poches. Il descendait la rue Catinat, saluait les femmes sur le seuil des maisons. Elles morigénaient un gamin qui se faufilait entre leurs jambes et reprenaient leur ouvrage de raccommodage. La guerre avait commencé depuis plusieurs mois, les hommes avaient dû abandonner le village. L’avis de mobilisation avait fait verser beaucoup de larmes. Ce jour-là, le 2 août 1914, seul Émilien avait quitté la ferme pour aller combattre, au grand dam de Charles, qui désirait l’accompagner. Il n’avait pas encore l’âge de la conscription et dut patienter presque un an.
Le vieux Duprés passa tout près de lui à le frôler, il poussait une carriole chargée de foin pour les lapins. Des enfants couraient en donnant des coups de galoche dans un caillou. Ils riaient et se bousculaient, insouciants des évènements. Le jeune garçon sourit, il n’y avait pas si longtemps qu’il s’amusait ainsi avec ses camarades. Il ralentit devant l’échoppe du cordonnier, puis longea l’atelier de ferronnerie du père Mayer. Celui-ci lui fit signe. Il ne parlait plus depuis son retour de guerre en 1870. Personne ne savait ce qu’il avait alors subi, il était rentré muet, bossu, aigri. Il vivait avec sa très vieille mère et maintenait l’entreprise paternelle tant bien que mal.
Charles sifflotait tout en se demandant quelle serait la réaction de Léonie à l’annonce de son engagement. Jusqu’à présent elle n’était que la sœur de ses camarades Armand et Marcel, les jumeaux Daval, mais depuis quelques mois, il s’était aperçu que sa présence faisait battre son cœur. Il faut dire qu’elle était jolie Léonie…
Il arrivait en direction de la rivière, des vieillards s’activaient dans les jardins longeant la route. Charles se fit la remarque que tous ces hommes avaient déjà combattu pendant l’autre guerre. Le père Gallois et Fernand Sage avaient été blessés à Belfort, le premier avait une jambe de bois et le second une grande balafre au visage. Au niveau des abattoirs, il s’écarta, l’odeur puissante qui émanait du bâtiment l’incommodait. Il jeta un coup d’œil du côté de la cour de chargement. Deux tombereaux attelés attendaient devant la large porte, les cris des animaux parvinrent jusqu’à lui, il frissonna. Son père et lui avaient livré deux veaux le matin même, à cette heure, ils devaient être débités en morceaux.
Il traversa la route et s’assit sur l’herbe au bord de l’eau. Il adorait cet endroit. L’onde glissait doucement, presque silencieusement sous le ciel de juillet. Sur l’autre rive, des vaches mâchouillaient en l’observant de leurs grands yeux étonnés. Il se dit que tout était calme, on ne pouvait imaginer qu’ailleurs, pas loin, des hommes se battaient et mouraient. Le pont du train, c’est ainsi qu’il l’appelait depuis son enfance, se reflétait sur l’eau miroitante de la Lanterne. Le nez en l’air, son regard se noya dans les paréidolies des nuages. Il y devinait des animaux, des oiseaux géants éphémères qui se déformaient rapidement. Soudain, il sursauta, un monstre gris, un cumulonimbus comme un soldat armé le fit revenir à la réalité. Il se redressa en murmurant cette phrase : je vais aller combattre l’ennemi. Mais plus le moment de partir approchait et plus l’appréhension le gagnait. Surtout depuis hier, quand il avait appris la mort d’un jeune du village. Raymond, il le connaissait bien, c’était un camarade de son frère Émilien. Le maire était passé devant la ferme paternelle et s’était dirigé vers la maison des Balland. Marguerite, la mère de Charles avait attendu sa sortie et s’était précipitée chez sa voisine pour la consoler de sa détresse. Elle était restée toute la soirée à sécher les larmes de son amie.
Il reprit son parcours, croisa des femmes qui quittaient le bateau-lavoir. C’était une construction de bois posée sur l’eau, amarrée par de solides cordes, elles-mêmes attachées à de gros pieux piqués dans la rive et qui permettait à huit personnes de venir faire les lessives. Un toit en tôle les protégeait des intempéries. C’était un cœur palpitant où se mêlaient informations et commérages. Quiconque passait sur le chemin à côté, pouvait écouter les éclats de rire, les hurlements ou les chuchotements plus confidentiels. Rosa, une vieille fille du village, le salua gentiment, elle poussait une charrette sur laquelle deux énormes lessiveuses débordaient de linge mouillé. Déjà, le bruit répétitif des engrenages du moulin se faisait entendre, ainsi que le son de l’eau coulant à travers le barrage.
Il espérait voir Léonie, ne serait-ce qu’un instant, respirer son parfum sucré et enregistrer dans sa mémoire l’intensité de son regard bleu.
Des hommes s’activaient autour de la minoterie. Charles les guetta, il y avait Albert Bertin, Marcellin Chognart et un jeune arpète, Gaston Frémis. Les deux premiers étaient trop âgés pour être mobilisés et Gaston était encore un gosse. Il attendit en priant pour que le passage soit désert à son arrivée. Il se cacha quelques instants derrière un saule pleureur. De cet endroit, il apercevait un morceau de la façade du séminaire. Les lieux étaient quasiment vides des hommes qui logeaient là. Tous les étudiants étaient sur le front. Seuls l’abbé Boulay, le vieil aumônier et Arsène le jardinier, essayaient de maintenir un peu de vie dans l’immense bâtisse.
Charles guettait les allées et venues du moulin, puis, ne voyant plus âme qui vive, avança et se cala contre un poteau du porche de pierres. Il jeta un rapide coup d’œil à la montre gousset de son père, elle marquait seize heures. Léonie allait sans doute sortir pour effectuer quelques livraisons de farine. Il patienta cinq minutes, un peu tendu et épiant le moindre mouvement. Le bruit des machines était assourdissant. Une ombre apparut. Elle sursauta au moment où le jeune homme surgit de sa cachette.
— Bonjour Léonie !
— Oh, Charles, tu m’as fait peur ! Que fais-tu ici ?
— Heu, je suis venu te voir, Léonie et te dire que je pars après-demain… Je prends le train pour Bourges, je vais m’engager !
— Ah, toi aussi… Tu as appris pour Raymond Balland ? C’est horrible, il était fiancé à la Marie, celle qui vend des fleurs…
— Oui… Encore un.
— Et tu t’engages tout de même, tu pourrais attendre que l’on t’appelle ! Mes frères sont partis, tout le monde s’en va… Tu aurais pu repousser d’un an, et qui sait, peut-être que la guerre sera terminée d’ici là…
— J’ai décidé d’y aller. Et si je veux que le combat finisse, il faut que je m’en mêle, je vais chasser les boches ! ajouta Charles en souriant.
— Et… et si tu ne reviens pas ?
— Je rentrerai, Léonie, je te le promets, et je ne vais pas me battre demain, je dois faire mes classes !
Elle était belle avec ses cheveux blonds frisés attachés haut sur la nuque, sa blouse fleurie et sa longue jupe grise. Elle leva son visage vers lui. Il n’osait pas la toucher, mais il la dévorait des yeux. Il s’écarta, ne voulant pas la retenir, elle devait faire ses livraisons. Il n’avait pas envie qu’on le voie ici. Il s’éloigna, puis revint sur ses pas :
— À mon retour de la guerre, tu seras d’accord pour m’épouser, Léonie ?
— Oui. Alors, ne te fais pas tuer, s’il te plaît ! Ne meurs pas, ne meurs pas Charles Oudot !
Il quitta le moulin et décida de remonter par le passage d’Enfer. Parvenu en haut, il dépassa la gendarmerie-école, longea la rue, salua les commères qui filaient devant leur porte, puis tourna à droite en direction du cimetière. Des enfants s’amusaient en bordure du chemin. Ils braillaient et riaient en sautant dans tous les sens. Charles les observa un moment. Les gamins jouaient à la guerre, des bâtons faisaient office de fusils et ils criaient « À bas les boches ! »
Parvenu devant le grand mur soutenant les caveaux, il bifurqua à gauche, croisant des charrettes chargées de foin que tiraient de robustes chevaux comtois. Il arriva à la ferme familiale. Jules, son père était trop âgé pour aller combattre, mais son frère Émilien était parti dès le premier jour de mobilisation. Les parents recevaient de temps à autre des lettres, des nouvelles du front que l’aîné écrivait.
Sa sœur Louise était en train de traire une vache quand Charles pénétra dans l’étable.
— Papa te cherchait ! Où étais-tu passé ? Il faut vite faucher le verger avant l’orage !
— C’est bon, j’y vais tout de suite !
Il caressa la croupe de Demoiselle, une bête brune et blanche qui attendait sagement son tour.
Il regarda lentement la cour de la ferme. Les poules, imperturbables, picoraient les grains le long de la grange et des clapiers que sa mère et la benjamine, Marie affectionnaient particulièrement. Il enregistrait les détails, les couleurs et les formes afin de s’en souvenir plus tard.
Son père sortit de la maison, il boitait depuis des années, depuis le jour où la jument Béline lui avait donné un méchant coup de sabot dans le tibia.
Charles alla quérir la faux. Il traversa le chemin pierreux et grimpa au verger.
De gros nuages noirs s’amoncelaient dans le ciel et la chaleur devenait de plus en plus étouffante. L’orage n’était pas loin. Remontant les manches de sa chemise, il respirait en scrutant les alentours. Il savait d’ores et déjà que cet endroit allait lui manquer.
Deux jours après, le père avait attelé Phœbus à la carriole et, accompagnés de Louise, Marie et de Marguerite, ils étaient partis à la gare. Après quelques kilomètres, ils avaient aperçu Gustave Déprés qui marchait au bord de la route, il portait un gros sac de toile et suait à grosses gouttes. Charles l’aida à monter près d’eux. Gustave Déprés se rendait aussi à la station. Tout comme lui, il avait décidé de s’engager et de combattre l’ennemi. Louise avait les yeux rouges, elle ne voulait pas que son frère aille se faire tuer sur le champ de bataille. Marie, la plus jeune, elle venait de fêter ses treize ans, pleurait avec sa sœur. Marguerite avait les lèvres pincées. Un deuxième fils au front, c’était un peu trop pour elle. Charles sentait bien qu’elle se retenait de parler parce que si elle ouvrait la bouche, ce serait des sanglots qui en sortiraient. Le garçon posa sa main sur celle de sa mère, elle lui broya les phalanges en le regardant attentivement.
— Pour l’instant, je me rends à Bourges, tout ira bien, murmura-t-il.
Le père quant à lui, préférait rester muet, mais ses yeux étaient emplis de larmes.
Le quai de gare était animé, un grand nombre de soldats en uniforme circulaient en tous sens. Ceux qui arrivaient, les permissions étaient rares, croisaient ceux qui partaient pour le front ou en caserne. Deux cheminées de train crachaient cette grosse vapeur blanche qui masquait le ciel bleu. Des cris fusaient de partout, des femmes se pendaient au cou de leur mari, de leur fiancé, de leur fils, les étreintes étaient fougueuses ou désespérées. Charles et Gustave attendaient, plantés au bord du quai, qu’un officier les appelle et les guide pour la suite. Un homme grand et mince apparut. Il portait un pantalon et une veste longue gris-bleu, des guêtres sur des brodequins. Il était accompagné de son ordonnance, un jeune gars qui paraissait gêné d’être là. Le visage sévère du gradé était intimidant. Il sortit de sa poche une feuille de papier et, d’une voix puissante pour un type si maigre, convoqua les engagés les uns après les autres.
Charles se dit que c’était parti pour l’artillerie, son sort était jeté. Il se tourna vers ses parents, les serra dans ses bras, embrassa Louise et Marie qui continuaient de pleurer. Il fit un pas en direction de l’officier, attendant son nom.
— Hyacinthe Barras ; Jean Courant ; Gustave Déprés ; Firmin Grosso ; Gaston Hébrard ; Raoul Henry ; Jules Joyeux ; Jean Lafont ; Ambroise Monnot ; Charles Monnin ; Charles Oudot et Victor Perrin, voiture huit.
Charles monta les marches du wagon, se retourna une dernière fois, l’estomac noué. Il regarda intensément sa maman, son père, si frêle, Louise et la petite Marie échevelée, le visage ravagé par les larmes. Allait-il la revoir, sa famille tant aimée ?
À l’intérieur du compartiment, il s’installa à côté de Gustave. C’était un gars de son âge d’un village près de Faverney. Aucun membre de chez lui n’avait pu l’accompagner, son père était décédé l’hiver précédent d’une pneumonie et sa mère travaillait au château. Il avait trois frères beaucoup plus jeunes qui aidaient les voisins aux champs. Il avait décidé de s’engager et peut-être de faire carrière dans l’armée. Il ne voulait pas finir pauvre comme les siens. Charles l’écoutait attentivement. Sa famille non plus n’était pas riche, mais ils mangeaient tous à leur faim et Marguerite savait aussi bien cuisiner la soupe de pain que coudre des robes dans de vieux sacs. Il estimait qu’il était chanceux. Vers les années 1900, Charles était enfant, mais il s’en souvenait parfaitement, ses parents avaient perdu une petite fille. Elle avait trois mois et était morte une nuit, dans son berceau. Marguerite avait mis du temps à se consoler du décès d’Augustine, puis deux ans plus tard, naquit Marie avec sa bouille rose et son appétit de vivre.
Le train s’ébranla dans un grand fracas de ferraille. Des cris montaient du quai, certains étaient enjoués, d’autres remplis de chagrin. Des femmes s’époumonaient dans de derniers adieux à leurs époux.
L’ambiance à l’intérieur du wagon était plutôt chaleureuse, ses compagnons de voyage semblaient être des drilles rieurs. Jules Joyeux portait bien son nom, il avait un visage rouge, jovial et criblé de taches de rousseur. Des cheveux fauves assez hirsutes auréolaient son crâne et de sa bouche fusaient des blagues qui amusaient ses voisins. Charles appréciait cette proximité gaie et fanfaronne, il se disait que le trajet s’annonçait agréable. Vers midi trente, l’un des garçons sortit de son sac une miche dorée et un bocal de pâté. Le dénommé Firmin, un personnage rond, déballa de son côté une énorme saucisse et un récipient en grès rempli de cancoillotte. Le premier, Hyacinthe précisa :
— Servez-vous les gars, on aura plusieurs repas ensemble, alors ne dépaquetez pas toutes vos réserves. Commençons par la terrine de ma grand-mère, c’est un régal !
Le groupe des douze se resserra et chacun put manger à sa faim. Charles, de son côté, offrit un peu de vin à la cantonade. Il s’agissait de la piquette que buvait son père chaque soir en rentrant du travail des champs. Le breuvage n’était pas exquis, mais il réchauffait le cœur. Le train s’arrêtait de temps en temps dans des gares, le même brouhaha, les mêmes cris, parfois les mêmes pleurs, des militaires montaient, d’autres jeunes gens aussi. La locomotive hurlait et les voitures s’ébranlaient.
Par moment, l’un d’eux s’assoupissait pendant un instant, puis au moment où il émergeait, reprenait le cours de la conversation. Des photos circulaient de mains en mains, ponctuées de sifflements admiratifs. Le jour s’enfuyait, l’obscurité les envahissait peu à peu et le convoi stoppa. L’officier grand et maigre fit irruption dans le compartiment, il leur annonça qu’ils allaient passer la nuit à la station de Chagny. Aucun des garçons n’osa protester. Ils sortirent silencieusement et décidèrent, d’un commun accord, de se reposer sur le quai. Ils mangèrent des provisions partagées et s’installèrent tant bien que mal sur leur sac. La température était clémente et après quelques vannes de Jules Joyeux, ils s’endormirent à la belle étoile.
Au petit matin, après une timbale d’eau tiède, les douze engagés réintégrèrent leur compartiment.
La journée dans le train n’en fut pas moins sympathique, moult blagues et devinettes furent échangées, ce qui leur permit de ne pas trouver le temps trop long. Les haltes du Creusot et de Nevers furent brèves et vers dix-huit heures, Bourges fit son apparition.
Après un moment de flottement, ils furent dirigés vers la caserne d’artillerie en camion bâché. Ils étaient épuisés, Charles s’écroula sur son lit au milieu de ses camarades. Il y avait ses compagnons de voyage, et une douzaine d’autres gars qui venaient de tous les coins de France.
Bourges
Juillet 1915
Il avait reçu son équipement en même temps que Jules. La plupart des vêtements étaient déjà usés, mais il était très heureux de porter enfin des habits militaires. Il plia dans son casier, un pantalon et un dolman (un manteau épais), des pantalons de treillis, deux bourgerons (chemises en grosse toile), deux paires de godillots, un képi, deux caleçons, deux chemises, deux cravates, des bandes molletières, deux mouchoirs, une serviette de toilette. Après avoir vérifié l’ensemble plusieurs fois, il s’aperçut qu’il n’avait pas de chaussettes. Il ne comprenait pas pourquoi, ses amis non plus. Ils portèrent et lavèrent pendant quelque temps celles leur appartenant.
Après une journée pendant laquelle il s’ennuya un peu, il décida d’écrire à sa famille.
« Chers parents,
L’ambiance n’est pas désagréable, nous avons des gamelles épatantes, dimanche, nous avons visité la cathédrale. Demain, nous serons vaccinés. Il y a beaucoup de gars de la Haute-Saône avec moi, c’est sympathique, on parle du pays. Je crois que l’on va commencer les entraînements bientôt. On sait déjà que le lever aura lieu à quatre heures et demie et l’appel à cinq heures ! Il paraît qu’on va monter à cheval. Je vous adresserai d’autres nouvelles dans quelques jours, envoyez-moi des chaussettes. Bons baisers à vous tous. Donnez-moi des informations sur Émilien. »
Les semaines qui suivirent furent très chargées. Certains des garçons eurent des complications après leurs vaccins, ils restèrent alités, fiévreux et nauséeux. Charles et Firmin ne ressentirent aucune séquelle, ils s’adaptaient à ce rythme militaire. Levés aux aurores, dès quatre heures trente, l’appel en tenue à cinq heures, le temps de boire un genre de café, de défaire la couchette et de balayer la carrée. À sept heures, sonnait un nouveau rassemblement et marche jusqu’à dix. Charles ne souffrait pas de ces occupations sportives, le travail des champs et à la ferme l’avait préparé à cela. Ils avalaient rapidement une soupe vers onze heures, retournaient au dortoir tirer les lits. Ils replaçaient couvertures et traversins. L’heure de repos qui suivait leur permettait de fumer tranquillement ou de jouer aux cartes pour certains. Après ce temps calme, le rassemblement pour l’instruction jusqu’à dix-sept heures, arrivait le moment du repas. Parfois, Charles sortait en ville avec l’un ou l’autre de ses compagnons de chambrée, mais ils en avaient assez de mettre la main au képi à chaque rencontre d’officiers. Ils rentraient pour vingt et une heures et gare aux retardataires. L’extinction des feux était à vingt heures, et les gars s’écroulaient sur leur matelas sans protester.
Charles, après avoir passé une semaine à panser et étriller les chevaux, eut la chance de monter un magnifique alezan. Ils sympathisèrent et en quelques jours il put s’essayer au trot. Ses fesses en pâtirent, il subit des talures qui le firent souffrir plusieurs nuits, ce qui ne l’empêchait pas de chahuter le soir dans la carrée.
Les nouvelles de la guerre parvenaient à la caserne le vendredi à midi. Souvent, un officier débarquait avec un magazine ou des missives militaires. Il informait alors les jeunes recrues et il n’était pas rare que les appelés de la classe seize soient demandés comme volontaires pour aller combattre. À chaque départ, Charles frissonnait en se disant que bientôt, ce serait son tour.
Faverney
Juillet et août 1915
Au village comme partout ailleurs, la guerre avait entraîné la mobilisation de nombreux hommes, laissant les femmes isolées pour faire face aux tâches quotidiennes et aux responsabilités familiales.
La ferme Oudot avait encore son patron, Jules, le père de Charles. Bien que diminué et âgé, il parvenait avec l’aide de ses filles, à gérer les bêtes et les champs. Marguerite et Jules recevaient régulièrement des nouvelles de leurs deux fils. Charles écrivait plus souvent qu’Émilien, ce que le foyer comprenait. L’un était à la caserne, l’autre dans les tranchées.
Début août, les parents Oudot durent parlementer avec Louise qui s’était mise en tête de faire la formation accélérée d’infirmière pour pouvoir aller au front. Marguerite s’était même fâchée devant l’inconscience de sa fille.
— Mes deux fils sont déjà au combat, ou presque, il est donc hors de question que tu risques ta vie aussi !
Et Jules de renchérir :
— On ne sait pas combien de temps va durer ce conflit, imagine qu’il m’arrive quelque chose, que vont devenir ta mère et ta sœur ? Les bombardements peuvent se rapprocher et mettre en danger les habitants. Les femmes doivent protéger leurs enfants et leurs foyers, tout en s’adaptant à la réalité de la guerre, c’est ainsi, ma fille. Reste ici, tu es d’une grande aide à la ferme. Regarde Léonie Daval, elle demeure au moulin et bosse comme un homme !
Louise baissa les yeux et même si elle comprenait les arguments de ses parents, elle se serait volontiers vue en héroïne de bataille. Sauver des soldats, panser des plaies et pourquoi pas, des cœurs ? Elle avait appris que sa lointaine cousine Suzanne travaillait dans une usine de munitions. Elle trouvait ça moins romantique que de secourir les blessés, mais au moins, elle était indépendante.
Cette fin de journée, elle décida d’aller donner des nouvelles de Charles à Léonie au moulin. Elle descendit par la rue de l’Official, salua le vieux père Gallois qui montait en clopinant, un mégot jaunâtre au bord des lèvres. Elle entendit un long sifflement. Elle faillit se retourner et se souvint que l’Arsène, le jardinier du séminaire, passait de longs moments en faction derrière la porte de bois. Il était un peu simplet Arsène, c’était un gars de Breurey, le neuvième enfant d’une famille modeste et qui ne pouvait pas le nourrir, l’armée n’en avait pas voulu. L’abbé Boulay, l’aumônier du séminaire, l’avait alors pris sous son aile et lui confiait de menus travaux d’entretien. Comme si le coup de sifflet n’avait pas suffi, elle perçut un « coucou » chuchoté timidement. Elle se retourna :
— Je sais que c’est toi, Arsène, cesse un peu, sinon, j’appelle le père abbé !
Elle sourit, elle ne ferait jamais une telle chose, mais cet argument l’arrêta. Le garçon quitta son poste de guet.
Louise approchait du moulin, elle vit son amie charger la charrette de sacs de farine et de grains.
— Léonie ! Tu as quelques minutes ?
— Oh, Louise ! Viens, allons nous asseoir au bord de la rivière, il fait encore chaud aujourd’hui ! As-tu des nouvelles de tes frères ?
— C’est pour cela que je suis là. Charles va bien, il est toujours à Bourges, et il a commencé à monter à cheval. Il dit qu’il y aura bientôt une photo, je te la montrerai. Elle sourit. Il nous a écrit : vous verrez, j’ai une belle poire, je dégote en artiflot !
— Ah, et qu’est-ce que cela signifie ?
— Oh, Léonie ! Ça veut dire, je suis beau en artilleur !
Elles rirent toutes les deux. Soudain, leur explosion de joie fut interrompue par un vol de trois aéroplanes allemands.
— Oh, mon Dieu, où vont-ils jeter leurs bombes ? Ici, tu crois ?
— Non, j’espère, mais papa m’a dit qu’ils en avaient déjà balancé sur Vesoul…
— Je vais rentrer, Léonie, je reviendrai te parler des lettres.
Mais, il pourrait t’écrire ?
— Non, je ne préfère pas, mon père…
— Oui, je comprends. À bientôt, je file vite pour la traite.
En remontant, elle croisa Joséphine Balland, la mère de Raymond qui venait de mourir au front. La pauvre veuve passait la moitié de ses journées au cimetière. Pour l’instant, la dépouille n’était pas revenue, l’armée lui avait seulement rendu la plaque matricule en métal que le maire lui avait apportée. Elle alla sur la tombe de ses parents et pleura toutes les larmes de son corps. Louise eut envie de lui dire un mot de consolation, mais la femme en noir regardait obstinément le sol. La jeune fille continua son chemin, la gorge serrée.
Les habitants de Faverney, comme beaucoup de monde à cette époque, attendaient les informations nationales. Ils avaient été bouleversés par la bataille d’Artois. Blanche et Joseph Daval, les parents de Léonie, étaient très inquiets, car leurs deux fils, Armand et Marcel se trouvaient au front depuis le début de la guerre. Bien sûr, ils recevaient quelques nouvelles, mais récemment, Armand avait échappé de peu à un tir d’obus qui avait massacré deux de ses compagnons d’armes. Leurs deux filles, Léonie et Lucienne, de leur côté, tentaient de rassurer la famille entière. Et puis, le travail ne manquait pas au moulin, même si le rationnement en grains se faisait sentir, les broyeuses tournaient inlassablement. Les dernières soirées d’août furent très chaudes. Les deux jeunes Daval allèrent se baigner aux Iles, un endroit un peu isolé et assez peu fréquenté en cette période de guerre. Auparavant, c’était là que les garçons et les filles se retrouvaient pour chahuter et nager. Pour s’y rendre, il fallait longer les bâtiments de la tannerie, continuer à travers champs jusqu’à déboucher sur une petite plage de sable et cailloux. Léonie avait d’ailleurs remarqué Charles ici même. Elle l’avait trouvé si beau avec ses yeux foncés et son sourire moqueur.
Tout à l’heure en quittant son amie Louise, elle avait eu un instant de tristesse. En ce moment, Charles n’était pas au combat, mais c’était inéluctable, elle le savait, le sentait, ce conflit allait durer…
Dans certaines villes, les ravitaillements devenaient de plus en plus difficiles. Une tante de Vesoul était venue en charrette, elle pleurait quelques kilogrammes de farine pour faire du pain. Joseph avait eu pitié. En douce et avec beaucoup de recommandations, il avait glissé plusieurs sacs de gruau de blé et de maïs à sa sœur. Celle-ci, reconnaissante, lui laissa une tablette de chocolat sortie de ses maigres réserves. Une fois que son cheval se fut restauré et abreuvé, elle reprit la route en prévoyant de passer la nuit à Provenchère, chez une lointaine cousine. C’était la guerre, il convenait de se rendre service.
À la campagne, chacun se débrouillait pour cultiver des choux-raves, des topinambours, des carottes, et des rutabagas qui poussaient bien dans la terre de la région. Marguerite faisait des conserves, aidée de Louise et Marie. Elle installait sa lessiveuse sur le grand feu de la chaudière dans l’appentis. Les bocaux remplis de légumes ou de fruits ramassés au verger, elle montait doucement en cuisson et laissait ainsi une heure trente. Elle se disait qu’au moins, ils auraient de quoi se nourrir pendant l’hiver qui s’annonçait. Elle avait enseigné à ses filles l’art de faire un plat avec des restes ou surtout avec peu… Sa panade n’était pas si mauvaise, Charles lui faisait des compliments chaque fois qu’il en mangeait. Avec modestie, elle répondait que c’était surtout la dose d’amour qui donnait bon goût !
Récemment, elle avait offert sa recette à une voisine, la couturière du village.
— C’est simple, avait-elle dit à Baptistine, je prends un litre de lait et j’y coule un demi-verre d’eau, je coupe mes croûtons et je les laisse gonfler dans le liquide. Je porte ma casserole sur le feu, je touille. Quand j’avais du poivre, j’en mettais un peu, à présent, avec le rationnement, on n’en trouve plus. À la fin, lorsque tout est bien mélangé, j’ajoute un œuf battu et une noix de beurre. Voilà, c’est la panade de la guerre, on fait avec ce qu’on a, mais ça cale bien les estomacs !