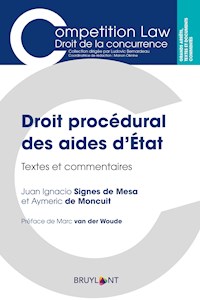
119,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Competition Law/Droit de la concurrence
- Sprache: Französisch
Dans cet ouvrage de la série « Grands arrêts, textes et documents commentés » de la collection « Competition Law/Droit de la concurrence », les auteurs présentent et commentent minutieusement l’ensemble des textes consacrés aux aspects procéduraux des aides d’État en droit de l’Union européenne, en s’attachant aux fondements législatifs, à la pratique décisionnelle et aux apports des juridictions de l’Union, notamment quant à l’interprétation et quant à la sanction des notions en cause.
L’ouvrage décrit clairement et précisément la procédure administrative devant la Commission européenne et les procédures juridictionnelles devant le juge de l’Union et le juge national.
Par le biais d’une approche didactique abordant les principes directeurs, l’évolution et la pratique du droit des aides d’État, ce recueil de textes commentés a pour vocation d’examiner l’état actuel de cette branche du droit de l’Union telle qu’elle est interprétée et pratiquée par ses institutions.
Les textes cités recouvrent les règlements et directives de l’Union, les actes administratifs des autorités compétentes tels que les lignes directrices et communications de la Commission, la pratique décisionnelle des autorités compétentes ainsi que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.
Accompagnés des explications et commentaires des auteurs, enseignants et praticiens spécialisés en la matière, les extraits cités permettront au lecteur d’appréhender les problématiques liées à ce thème et les réponses formulées tant par le législateur que par le juge.
L’ouvrage sera particulièrement utile aux praticiens spécialisés en droit de la concurrence. Il répondra avec certitude à leurs questions posées dans cette matière complexe et évolutive qu’est le droit des aides d’État.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Les opinions exprimées par les auteurs dans le présent ouvrage sont purement personnelles et n'engagent aucunement la Cour de Justice de l'Union européenne.
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le «photoco-pillage» menace l’avenir du livre.
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larcier.com.
© Lefebvre Sarrut Belgium s.a., 2019
Éditions BruylantRue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles
978-2-8027-6599-8
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour ELS Belgium. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
COMPETITION LAW/DROIT DE LA CONCURRENCE
La collection « Droit de la concurrence » rassemble des ouvrages consacrés à cette matière particulièrement évolutive et concrète, à la croisée de plusieurs disciplines, qu’est le droit de la concurrence, en langue française et anglaise.
Cette collection a pour vocation d’accueillir différents types d’ouvrages : des collectifs issus des meilleurs « Actes de colloque » dans la matière, des travaux de recherche impactant la pratique, tels que des « Thèses », des « Monographies » sur des thèmes précis à finalité professionnelle, des
« Manuels » spécialisés, des « Essais » issus de la vie du droit et des recueils de « Grands arrêts, textes et documents commentés ».
Collection dirigée par Ludovic Bernardeau • Coordinatrice de rédaction : Manon Oiknine
The «Competition Law» collection gathers publications, in French and in English, dedicated to the particularly dynamic and concrete area of studying that is competition law, deeply intertwined with several fields.
This collection aims at assembling different types of publications: collective works from the best “Conference proceedings” in the area, research works influencing the legal practice – such as “Thesis” –, “Monographs” on targeted topics for professional purposes, specialized “Textbooks”, “Essays” relating to ongoing debates and compilations of “Major cases, texts, and documents commented”.
Collection directed by Ludovic Bernardeau • Writing coordinator: Manon Oiknine
Précédemment parus dans la collection - Previously published in the collection :
New frontiers of antitrust 2011, edited by Frédéric Jenny, Laurence Idot and Nicolas Charbit, 2012.
Abus de position dominante et secteur public. L’application par les autorités de concurrence du droit des abus de position dominante aux opérateurs publics, Claire Mongouachon, 2012.
Reviewing vertical restraints in Europe. Reform, key issues and national enforcement, edited by Jean-François Bellis and José Maria Beneyto, 2012.
Droit de la concurrence et droits de propriété intellectuelle. Les nouveaux monopoles de la société de l’information, Jérôme Gstalter, 2012.
L’action collective en droit des pratiques anticoncurrentielles. Perspectives nationale, européenne et internationale, Silvia Pietrini, 2012.
New frontiers of antitrust 2012, edited by Joaquin Almunia, Eric Barbier de La Serre, Olivier Bethell, François Brunet, Guy Canivet, Henk Don, Nicholas Forwood, Laurence Idot, Bruno Lasserre, Christophe Lemaire, Cecilio Madero Villarejo, Andreas Mundt, Siun O’Keeffe, Mark Powell, Martim Valente and Richard Wish, 2013.
New frontiers of antitrust 2010, edited by Joaquìn Almunia, Mark Armstrong, Nadia Calvino, John M. Connor, Henry Ergas, Allan Fels, John Fingleton, Ian Forrester, Peter Freeman, Laurence Idot, Frédéric Jenny, Bruno Lasserre, Douglas Miller, Jorge Padilla, Nicolas Petit, Christine Varney, Bo Vesterdorf, Wouter Wils and Antoine Winckler, 2013.
New frontiers of antitrust 2013, sous la coordination de Nicolas Charbit, 2013.
Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles, Rafaël Amaro, 2014.
Day-to-Day Competition Law. A practical Guide for Businesses, edited by Patrick Hubert, Marie Leppard and Olivier Lécroart, 2014.
Pratiques anticoncurrentielles et brevets. Étude en faveur de la promotion européenne de l’innovation, Lauren Leblond, 2014.
New frontiers of antitrust 2014, edited by Joaquín Almunia, Chris Fonteijn, Peter Freeman, Douglas Ginsburg, Thomas Graf, Benoît Hamon, Nathalie Homobono, Laurence Idot, Alexander Italianer, Frédéric Jenny, William Kovacic, Bruno Lasserre, George Milton, Andreas Mundt, Anne Perrot, Matthew Readings, Howard A. Shelanski, Mélanie Thill-Tayara, Wouter Wils and Joshua Wright, 2014.
The Fight against Hard Core Cartels in Europe. Trends, Challenges and Best International Practices, Eric Van Ginderachter, José Maria Beneyto, Jerónimo Maillo, 2016.
Droit européen de la concurrence, Jean-François Bellis, 2e édition, 2017.
La récidive en droits de la concurrence, Ludovic Bernardeau, 2017.
Droit européen des concentrations, Georges Vallindas, 2017.
Droit européen des aides d’État, Michaël Karpenschif, 2e édition, 2017.
L’innovation prédatrice en droit de la concurrence, Thibault Schrepel, 2018.
Juan Ignacio Signes de Mesa est référendaire au Tribunal de l’Union européenne. Docteur en droit de l’Universidad Complutense de Madrid, il est également diplômé du Collège d’Europe (Campus Bruges) et de la Harvard Law School. Avant de rejoindre le Tribunal, il a exercé en tant qu’avocat spécialisé en droit de la concurrence et en droit des sociétés. Il enseigne à l’Universidad Pontificia Comillas-ICADE, à la Fondation pour le droit continental et à l’Academia de Práctica Jurídica Europea (APJE), qu’il préside depuis sa création. Il est membre des barreaux de Madrid et de New York, ainsi qu’académicien correspondant de l’Académie royale de jurisprudence et de législation de l’Espagne. [Titre 1]
Aymeric de Moncuit est référendaire au Tribunal de l’Union européenne et « Non Governmental Advisor » auprès de l’International Competition Network. Avant de rejoindre le Tribunal, il a été avocat spécialisé en droit de la concurrence et rapporteur permanent à l’Autorité française de la concurrence. Il enseigne le droit de la concurrence à l’Université Paris II Panthéon-Assas où il codirige le D.U. Juriste Concurrence-Distribution. [Titre 2]
SOMMAIRE
Une table des matières détaillée figure à la fin de l
PRÉFACE
INTRODUCTION
TITRE 1 – PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE 1 – QUESTIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 – DES AIDES NOUVELLES
CHAPITRE 3 – DES AIDES ILLÉGALES
CHAPITRE 4 – DES RÉGIMES D’AIDES EXISTANTES
TITRE 2 – PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
CHAPITRE 1 – DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’UNION
CHAPITRE 2 – DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES
TABLE CHRONOLOGIQUE DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES
INDEX ALPHABÉTIQUE
PRÉFACE
Chaque année, le Tribunal rend de très nombreuses décisions en matière d’aides d’État, plus qu’en matière d’ententes ou de positions dominantes. Pourtant, peu étudiées à l’université et moins présentes dans la littérature juridique, les aides d’États ont pendant longtemps constitué le parent pauvre du droit de la concurrence.
Une telle situation est paradoxale dans la mesure où les aides d’État sont une matière, par nature, européenne. Aujourd’hui, à regarder en arrière, c’est plus de 50 ans d’application des articles 107 TFUE et suivants (et de leurs prédécesseurs) qui se dressent devant nous. Au fur et à mesure des années, le champ de ces articles a été étendu à travers de nouveaux règlements, des lignes directrices et la pratique décisionnelle de la Commission. La Cour de justice de l’Union européenne a, pour sa part, joué un rôle assez tôt dans l’édification de la matière en formalisant certains concepts comme l’investisseur privé en économie de marché. Les enjeux liés aux aides d’État ont, par ailleurs, pris de l’ampleur, comme en témoignent les cas pendants de « tax rulings » où sont en jeu plusieurs milliards d’euros.
Le présent ouvrage rend justice aux aides d’État. C’est avec un certain intérêt, à tout le moins du point de vue du juriste de tradition continentale que je suis, que l’ouvrage emprunte à la forme anglo-saxonne du textbook en recensant les principaux textes et arrêts sur chaque sujet intéressant la procédure en matière d’aides d’État. L’idée est simple, elle consiste à expliquer le droit des aides d’État en extrayant la substantifique moelle des arrêts de nos juridictions et des textes de la Commission. Les auteurs ne se contentent toutefois pas de reproduire le droit positif mais consacrent de très nombreux développements à son éclairage. Ces développements, par leur caractère synthétique et articulé, rappellent les précis de droit français. L’ouvrage tend ainsi à réunir le meilleur des traditions juridiques. Le métissage est réussi, l’ouvrage est clair et précis et fourmille de références jurisprudentielles de première main.
La première partie décrit la procédure administrative devant la Commission européenne et permettra aux praticiens comme aux étudiants de bien comprendre les différentes étapes encadrant la procédure, de la notification de l’aide à son examen par la Commission européenne. L’ouvrage distingue, notamment, de façon pédagogique, la procédure en matière d’aides nouvelles, de la procédure en matière d’aides illégales et de régimes d’aides existants. Cette distinction entre les différents types d’aides d’État est cruciale aux fins de déterminer le régime de contrôle applicable. Pour leur analyse, les auteurs ont recours aux nombreux instruments normatifs qui visent à établir un système cohérent et adapté spécifiquement aux problèmes particuliers soulevés par les aides étatiques, et à définir les obligations procédurales qui incombent, d’une part, à la Commission, en tant qu’institution de l’Union chargée de l’examen permanent et du contrôle des aides d’État et, d’autre part, aux parties intéressées, à savoir les États membres et les particuliers.
La seconde partie sur les procédures juridictionnelles devant le juge de l’Union et le juge national est également éclairante en ce qu’elle synthétise la procédure devant le juge de l’Union en matière d’aides d’État, relative à chacune des voies de recours prévus par le Traité (recours en annulation, en carence, en manquement, en responsabilité extracontractuelle, en référé) et aux renvois préjudiciels. Elle sera notamment utile aux plaideurs souhaitant se frayer un chemin jusqu’au juge européen. Elle couvre également, de façon plus inédite, la procédure devant le juge national, sujet rarement exposé dans la littérature sur les aides. Les auteurs expliquent, notamment, dans quelles conditions le juge national peut être compétent en matière d’aides d’État, quelle peut être l’étendue de cette compétence et comment ladite compétence s’exerce concrètement. Ces éléments pourraient s’avérer utiles à l’avenir si le private enforcement était amené à se développer, permettant aux concurrents léser par l’octroi d’aides illicites d’obtenir réparation devant les juridictions civiles.
Le récent arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Montessori (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori c/Commission, Commission c/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission c/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU : C : 2018:873), déjà largement commenté dans les milieux spécialisés, pourrait initier une ouverture graduelle et proportionnée du prétoire européen dans la matière abordée dans cet ouvrage. À mon sens, cette tendance doit d’ailleurs dépasser le seul domaine du contrôle des aides étatiques, pour toucher des domaines clés de la vie de nos contemporains, en particulier le climat et l’environnement au sens large. Le Tribunal y est prêt. La réforme décidée par le législateur dans le cadre du règlement 2015/2422 et dont la dernière phase s’est achevée le 26 septembre 2019 lui donne les moyens de cette ambition. Fort de deux juges par États membres et d’un arsenal procédural adapté, le Tribunal 2.0 doit maintenant prendre toute sa place dans la nouvelle architecture juridictionnelle de l’Union.
Marc VAN DER WOUDEPrésident du Tribunal de l’Union européenne
INTRODUCTION
Bibliographie générale – K. BACON (éd.), European Union Law of State Aid, Oxford, OUP, 2017 ; M. DONYM, F. RENARD et C. SMITS (coll.), Contrôle des aides d’État, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2007 ; M. HEIDENHAIN (éd.), European State Aid Law, Munich/Oxford, Beck/Hart Publishing, 2010 ; L. IDOT, Grands arrêts du droit de la concurrence, vol. II, Concentrations et aides d’État, Concurrences, 2016 ; M. KARPENSCHIF, Droit européen des aides d’État, Bruxelles, Bruylant, 2017 ; J.-P. KEPPENNE, Guide des aides d’État en droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1999 ; PESARERIet al. (éd.), EU Competition Law, vol. IV, State Aid, 2e éd., Louvain, Claeys & Casteels, 2016 ; A. de MONCUIT et V. NOËL, « Admissibility of Appeals Lodged by Competitors after the Montessori Judgment - La possibilité d’une île », Concurrences, 2019 ; C. QUIGLEY, European State Aid Law and Policy, Oxford, Hart Publishing, 2015 ; L. VOGEL, European State Aid Law, Bruxelles, Bruylant, 2017, Liber Amicorum Francisco Santaolalla Gadea, Austin/Boston/Chicago, Wolters Kluwer Law & Business, 2008 ; A. BIONDI, P. EECKHOUT et J. FLYNN (dir.), The Law of State Aid in the European Union, Oxford, OUP, 2004 ; B. CHEYNEL, « Le contentieux national des aides d’État », in Lamy droit économique, 2019, pp. 880-915 ; M. DONY et C. SMITS (dir.), Aides d’État, Bruxelles Éd. de l’Université de Bruxelles, 2005 ; E. M. SZYSZCZAK (dir.), Research Handbook on European State Aid Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011 ; F. MARIATTE, « Développements récents sur les questions de recevabilité des recours dans le contentieux des aides d’État », in Contentieux de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 260-285.
1.Procédure de contrôle des aides d’État – Le régime des aides d’État établi par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne comporte pas seulement des règles de fond, lesquelles ont fait l’objet d’une étude dans un autre volume de la présente collection. Ce régime contient également des règles de procédure, qui régissent la manière conformément à laquelle la Commission contrôle l’existence des aides d’État au sens du Traité et examine sa compatibilité avec le marché intérieur. Tel que la Cour a eu l’occasion de le remarquer dans sa jurisprudence, les règles de procédure dans le domaine des aides d’État sont aussi essentielles que les règles de fond pour la sauvegarde de la concurrence et du bon fonctionnement du marché intérieur1.
Il y a lieu de rappeler que l’article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que « [s]auf dérogations prévues par le [Traité], sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
L’interdiction de l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’est ni absolue ni inconditionnelle, puisque notamment le paragraphe 3 de cette même disposition accorde à la Commission un large pouvoir d’appréciation en vue d’admettre des aides par dérogation à ladite interdiction. Dans ce cas, l’appréciation de la compatibilité ou de l’incompatibilité avec le marché intérieur d’une aide d’État soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l’appréciation de faits et de circonstances économiques complexes et susceptibles de se modifier dans le temps.
Pour assurer l’efficacité de cette interdiction, ainsi que des dérogations applicables, le Traité impose à la Commission un devoir spécifique de contrôle et, aux États membres, des obligations précises en vue de faciliter cette tâche de la Commission et d’éviter que celle-ci ne soit placée devant un fait accompli. En particulier, l’article 108 TFUE prévoit une procédure organisant l’examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, lequel varie notamment selon que les aides concernées soient existantes ou nouvelles.
En substance, comme cela sera examiné ultérieurement dans cet ouvrage, s’agissant des aides existantes, le Traité donne compétence à la Commission de procéder à leur examen permanent avec les États membres. Dans le cadre dudit examen, la Commission propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. Quant aux aides nouvelles que les États membres auraient l’intention d’instituer, il est établi une procédure sans laquelle aucune aide ne saurait être considérée comme régulièrement instaurée. Une telle procédure exige que l’État membre concerné notifie préalablement à la Commission le projet d’aide qu’il envisage d’adopter et lui interdit de le mettre à exécution jusqu’à l’adoption de la décision finale sur sa compatibilité avec le marché intérieur. L’octroi illégal d’une aide implique, en règle générale, le devoir de la récupérer auprès de son bénéficiaire, y compris les intérêts courus.
Les éléments qui définissent la procédure en matière d’aides d’État sont précisés de même dans une série de normes du droit de l’Union, dont des règlements et des communications, qui donnent lieu à un cadre juridique certainement varié, qui, à part les aides existantes et les aides nouvelles, distingue également les aides illégales et les aides appliquées de manière abusive. Ledit cadre juridique régit, entre autres aspects, les étapes qui composent les différents types de procédures qui se déroulent devant la Commission, y compris la procédure simplifiée prévue pour certaines mesures d’aides. En outre, il définit les pouvoirs dont bénéficie cette institution de l’Union lors de l’exercice de sa compétence de contrôle. De plus, il détermine les obligations incombant aux États membres en tant qu’interlocuteurs principaux de la Commission, ainsi que les droits dont eux-mêmes et le reste des parties intéressées bénéficient durant la procédure administrative. Enfin, l’ensemble des normes applicables aux aides d’État sont fondamentales s’agissant des conséquences qui découlent de la violation des obligations imposées dans ce domaine, dont notamment, comme relevé, celle relative à la nécessité de récupérer toute aide octroyée illégalement.
2.Protection judiciaire – Par ailleurs, les institutions de l’Union, les États membres et les particuliers se sont vu reconnaître plusieurs voies judiciaires qui garantissent une protection pleine dans le domaine des aides d’État, tant au niveau national qu’au niveau européen.
D’emblée, il convient de relever que l’intervention des juridictions nationales résulte de l’effet direct reconnu par la Cour à l’interdiction de mise à exécution des projets d’aides édictée par l’article 108 TFUE. Elles ont la tâche de garantir aux justiciables, conformément à leur droit national, que toutes les conséquences d’une violation du Traité en seront tirées, en ordonnant le recouvrement des avantages illégalement octroyés et en adoptant d’éventuelles mesures provisoires. Or, dans le cadre de leur action, les juridictions nationales ne peuvent pas se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec le marché intérieur, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle des tribunaux de l’Union. Par ailleurs, il convient de signaler que, afin d’être à même de déterminer si une mesure étatique instaurée doit ou non être soumise aux obligations de notification et de suspension, une juridiction nationale peut être amenée à interpréter la notion d’aide, visée à l’article 107 TFUE. Si elle éprouve des doutes sur la qualification d’aide d’État des mesures en cause, la juridiction nationale peut demander à la Commission des éclaircissements sur ce point, voire poser une question préjudicielle à la Cour.
Au niveau européen, plusieurs types de recours s’ajoutent à la protection offerte par les juridictions nationales. La répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal est organisée par l’article 256 TFUE. Devant le Tribunal, la voie procédurale la plus fréquente est le recours en annulation, prévu par l’article 263 TFUE et dont la recevabilité est soumise à plusieurs règles, interprétées de manière récurrente par la juridiction européenne elle-même. Les recours en carence, relevant de l’article 265 TFUE, sont plus rares, mais également existants dans le passé, notamment en rapport avec l’obligation de la Commission de se prononcer à la suite d’une notification reçue de la part d’un État membre. Pour sa part, la Cour peut être saisie, en plus des pourvois introduits contre des arrêts du Tribunal statuant sur des recours en annulation ou en carence, de recours en manquement, prévus aux articles 258 à 260 TFUE et, comme noté ci-dessus, de renvois préjudiciels sur la base de l’article 267 TFUE, tant en interprétation comme en appréciation de la validité.
3.Plan de l’ouvrage – Le présent ouvrage, divisé en deux titres, examine les éléments principaux qui caractérisent, respectivement, la procédure administrative de contrôle devant la Commission (titre I), ainsi que les voies de recours juridictionnels, tant devant le Tribunal et la Cour que devant les juridictions nationales (titre II). Il se fonde sur la citation par extraits des textes normatifs pertinents ainsi que sur celle des arrêts interprétant les règles procédurales qui s’appliquent dans le domaine des aides d’État, tant sur le plan administratif que judiciaire.
1. Ordonnance du 20 septembre 1983, Commission c/France, 171/83 R, EU:C:1983:230, pt 12.
TITRE 1 — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE 1
Questions générales
4.Introduction – Avant d’examiner les éléments concrets qui caractérisent la procédure administrative de contrôle en matière d’aides d’État devant la Commission, il convient en premier lieu d’aborder toute une série de questions liminaires destinées à exposer tant les normes qui composent le cadre juridique applicable à cette procédure (section 1), que la compétence qui incombe aux différentes instances – européennes ou nationales – impliquées dans le contrôle des aides d’État (section 2). Il convient également de définir et de distinguer, entre autres, les notions d’« aide nouvelle », d’« aide illégale » et d’« aide existante » (section 3), chacune étant rattachée à une procédure différente.
Section 1
Cadre juridique
5.Régime procédural – Les normes qui s’appliquent à la procédure de contrôle des aides d’État ressortent notamment de l’article 108 TFUE. Cette disposition se trouve, à l’instar des règles substantielles dans ce domaine, au titre VII du Traité, sous la section 2 du chapitre 1 relatif aux « règles de concurrence ». À l’article 108 TFUE s’ajoutent d’autres règlements adoptés tant par le Conseil que par la Commission, dont le règlement 2015/1589, du 13 juillet 20152, et le règlement no 794/2004, du 21 avril 20043, qui ont pour but de mettre en œuvre le contenu de la disposition de droit primaire. Tous ces instruments, en plus d’autres qui seront examinés ci-dessous, visent à établir un système cohérent de normes adaptées spécifiquement aux problèmes particuliers soulevés par les aides étatiques4, et à définir les obligations procédurales qui incombent, d’une part, à la Commission, en tant qu’institution de l’Union chargée de l’examen permanent et du contrôle des aides d’État et, d’autre part, aux parties intéressées, à savoir les États membres et les particuliers.
6.Article 108 TFUE – La disposition principale du système de contrôle des aides d’État est l’article 108 TFUE, qui est rédigé dans les termes suivants.
Article 108 TFUE
« 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existants dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. »
L’article 108 TFUE établit une distinction cardinale aux fins de la procédure devant la Commission entre, d’un côté, les aides d’État existantes, visées par son premier paragraphe, et, de l’autre, les aides d’État nouvelles, visées par son troisième paragraphe.
S’agissant des aides existantes, celles-ci peuvent être régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité5. À cet effet, les États membres sont soumis à une obligation d’examen et de rapport permanents. Lorsque la Commission constate qu’une aide existante n’est plus compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107 TFUE, elle peut proposer des mesures visant à l’adapter aux besoins du développement et du fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures peuvent aller jusqu’à la suppression de l’aide existante, interdisant son octroi pour l’avenir (incompatibilité ex nunc)6, mais n’imposent pas le recouvrement des sommes déjà versées.
En revanche, en ce qui concerne les aides nouvelles, les États membres sont soumis à une obligation de notification préalable lorsqu’ils ont l’intention de mettre en œuvre ou de modifier une aide, ainsi qu’à une obligation de suspension de celle-ci. En effet, il ressort de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE que la Commission doit être informée, en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si, après un premier examen, la Commission estime qu’un projet pourrait être incompatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle doit ouvrir sans délai la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE. Durant toute cette procédure, l’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission n’ait abouti à une décision finale. La procédure préalable d’autorisation ainsi organisée vise à ce que seules des aides compatibles soient mises à exécution par les États membres. Afin de réaliser cet objectif, la mise en œuvre d’un projet d’aide est différée jusqu’à ce que le doute sur sa compatibilité soit levé par la décision finale de la Commission7.
7.Règlement de procédure et règlement d’application – Le contenu de l’article 108 TFUE est complété par d’autres normes de droit dérivé, dont le règlement 2015/1589, adopté sur le fondement de l’article 109 TFUE. Cette dernière disposition établit une procédure législative spéciale, attribuant au Conseil la compétence pour adopter des actes sur proposition de la Commission et avis pris du Parlement, afin de mettre en œuvre les articles 107 et 108 TFUE.
Article 109 TFUE
« Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. »
Le règlement 2015/1589, qui a remplacé le règlement nº 659/1999 du 22 mars 19998, codifie et étaye la pratique de la Commission en matière d’examen des aides d’État9, en conformité avec la jurisprudence de la Cour10. Ce règlement a été adopté notamment en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des procédures prévues à l’article 108 TFUE, et d’accroître la transparence et la sécurité juridique dans leur application. Il s’agit, en outre, d’un règlement de nature procédurale, qui s’applique, eu égard à la jurisprudence de la Cour, à toutes les procédures administratives en matière d’aides d’État pendantes devant la Commission au moment où le règlement est entré en vigueur11. En tant qu’acte de droit dérivé adopté pour l’application des articles 107 et 108 TFUE, il ne réduit pas la portée desdits articles et ce d’autant plus que la Commission détient ses pouvoirs directement de ceux-ci12.
Le règlement 2015/1589 reprend la différentiation opérée par l’article 108 TFUE entre aides existantes et aides nouvelles, bien qu’il la complète, en distinguant, aux fins de la procédure devant la Commission, entre aides existantes, aides nouvelles, aides illégales et aides appliquées de manière abusive. Le règlement 2015/1589 ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales, lesquels restent régis par les dispositions du Traité, telles qu’interprétées par la Cour13.
Le règlement nº 659/1999 – remplacé actuellement par le règlement 2015/1589 – fut mis en œuvre par le règlement nº 794/2004, du 21 avril 200414, toujours en vigueur tel que modifié15, qui définit les modalités applicables à la forme, à la teneur et à d’autres aspects des notifications et des rapports annuels visés par le règlement d’application. Il contient également des dispositions concernant le calcul des délais applicables dans toutes les procédures en matière d’aides d’État, et le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides illégales. Le règlement nº 794/2004 est applicable aux aides octroyées dans tous les secteurs.
8.Règlement général d’exemption par catégorie – À côté des deux règlements déjà décrits dans les points qui précèdent, il convient de tenir compte de l’importance du règlement général d’exemption par catégorie, qui déclare certaines catégories d’aides d’État compatibles avec le Traité, pour autant qu’elles remplissent des conditions prédéfinies, et pour lesquelles les États membres sont exemptés de l’obligation de notification et d’autorisation préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour toutes les aides nouvelles16. Cela permet aux États membres de mettre en œuvre des mesures d’aides d’État directement, en étant assurés d’une totale sécurité juridique, sans contrôle préalable de la Commission.
Le règlement général d’exemption par catégorie actuellement en vigueur est le règlement no 651/2014, du 17 juin 201417, qui a abrogé le règlement précédent, à savoir le règlement nº 800/200818. Il a été adopté par la Commission en s’appuyant sur l’article 108, paragraphe 4, TFUE, qui, depuis le Traité de Lisbonne, permet à ladite institution d’adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a préalablement déterminées, conformément à l’article 109 TFUE19, comme pouvant être dispensées de la procédure relative aux aides nouvelles.
Le règlement général d’exemption par catégorie s’inscrit dans la volonté de modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État, promue par la Commission, et qui compte, au titre de ses objectifs principaux, la simplification des règles et la favorisation d’une prise de décision plus efficace, sur la base de principes économiques clairs et d’une approche commune20. Les considérants initiaux du règlement général d’exemption par catégorie témoignent de cette volonté et permettent de comprendre l’origine législative et les objectifs principaux de cet acte de droit dérivé.
Règlement no 651/2014
Extraits de l’exposé des motifs
« La Commission européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales, et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit :
(1) Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil habilite la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du traité, que les catégories suivantes d’aides d’État peuvent être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions : les aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), les aides en faveur de la recherche et du développement, les aides en faveur de la protection de l’environnement, les aides en faveur de l’emploi et de la formation, et les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l’octroi des aides à finalité régionale. Sur cette base, la Commission a adopté le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission. Le règlement (CE) no 800/2008 était initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2013, mais il a été par la suite prolongé par le règlement (UE) no 1224/2013 de la Commission, du 29 novembre 2013, modifiant le règlement (CE) no 800/2008 en ce qui concerne sa durée de validité et il expire désormais le 30 juin 2014. Le 22 juillet 2013, le règlement (CE) no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides afin d’habiliter la Commission à étendre l’exemption par catégorie à de nouvelles catégories d’aides pour lesquelles il est possible de définir des critères de compatibilité clairs. Ces nouvelles catégories d’aides bénéficiant d’une exemption par catégorie comprennent les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, les aides en faveur des infrastructures à haut débit, les aides en faveur de l’innovation, les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles. Pour autant qu’elle puisse se constituer une expérience suffisante en matière décisionnelle pour élaborer des critères d’exemption opérationnels garantissant la compatibilité ex ante d’autres catégories d’aides, la Commission a l’intention de revoir le champ d’application du présent règlement afin d’y inclure certains types d’aides relevant de ces domaines. En particulier, la Commission envisage d’établir des critères applicables aux infrastructures portuaires et aéroportuaires d’ici décembre 2015.
(2) La Commission a publié une communication relative à la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État lançant un vaste réexamen des règles applicables aux aides d’État. Cette modernisation poursuit les principaux objectifs suivants : i) parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel tout en contribuant aux efforts déployés par les États membres en vue d’une utilisation plus efficiente des finances publiques ; ii) concentrer l’examen ex ante des mesures d’aide par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État ; et iii) simplifier les règles et favoriser la prise de décisions plus rapides, plus éclairées et plus fiables, sur la base de principes économiques clairs, d’une approche commune et d’obligations précises. La révision du règlement (CE) no 800/2008 constitue un élément central de la modernisation de la politique en matière d’aides d’État.
(3) Le présent règlement doit permettre une meilleure définition des priorités en matière de mise en œuvre des règles relatives aux aides d’État ainsi qu’une simplification accrue, et doit renforcer la transparence, de même que l’efficacité de l’évaluation et le contrôle du respect des règles aux niveaux national et de l’Union, tout en préservant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(4) L’expérience acquise par la Commission dans l’application du règlement (CE) no 800/2008 lui a permis de mieux définir les conditions auxquelles certaines catégories d’aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et d’étendre le champ d’application des exemptions par catégorie. Elle a aussi clairement montré qu’il était nécessaire de donner davantage d’importance à la transparence et au contrôle ainsi qu’à l’évaluation appropriée des régimes de très grande ampleur, eu égard à leurs effets sur la concurrence dans le marché intérieur.
(5) Les conditions générales d’application du présent règlement doivent être définies sur la base d’un ensemble de principes communs garantissant que les aides servent un objectif d’intérêt commun, ont un effet incitatif évident, sont appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu’à une évaluation régulière, et n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(6) Il convient d’exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité les aides qui remplissent l’ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d’aides concernée, établies dans le présent règlement.
(7) Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas concernées par le présent règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n’empêche nullement les États membres de notifier des aides dont les objectifs correspondent à ceux visés par le présent règlement.
[…] »
Les critères énumérés dans le règlement général d’exemption par catégorie déterminent, en particulier, les bénéficiaires admissibles, les intensités d’aide maximales – à savoir la part maximale des coûts admissibles d’un projet pouvant bénéficier d’une aide d’État – et les dépenses admissibles21. Ces critères sont établis sur la base à la fois de l’expérience qu’a la Commission du marché et de sa pratique décisionnelle, bien que la Cour ait signalé que l’habilitation réglementaire donnée par le Conseil ne peut, pour autant, être interprétée comme invitant la Commission à se limiter à une codification pure et simple de sa pratique antérieure et donc à ne pas utiliser son expérience pour fixer de nouveaux critères, même plus stricts que ceux existants22.
De plus, le fait qu’une mesure d’aide ne remplisse pas les critères du règlement général d’exemption par catégorie ne signifie pas qu’elle est nécessairement incompatible avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État, mais simplement que la mesure doit être notifiée à la Commission, qui examinera ensuite, au cas par cas, si elle peut être autorisée sur la base des règles relevant de ce domaine. Il importe de noter que, selon la Cour, les conditions du bénéfice de l’exemption doivent être interprétées strictement23.
Le règlement général d’exemption par catégorie a récemment été modifié afin d’élargir son champ d’application24. Il faut également signaler l’application d’un régime particulier aux aides en faveur des entreprises du secteur agricole, lesquelles peuvent être exemptées en vertu du règlement nº 702/2014, du 25 juin 201425.
9.Règles de minimis – Outre le règlement général d’exemption par catégorie, qui simplifie l’obligation de notification préalable caractéristique du régime européen des aides d’État, il convient de tenir compte des règles de minimis. En effet, par le règlement no 1407/201326, la Commission a établi des montants plafonnés d’aides ne relevant pas du contrôle européen des aides d’État, et qui ne doivent donc pas être notifiés à la Commission pour autorisation avant d’être mis en œuvre. Les mesures qui remplissent les critères fixés par ce règlement, notamment à son article 3, ne constituent pas des « aides d’État », car elles sont considérées comme n’ayant aucune incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Les principaux critères établis par le règlement exemptent de l’obligation de notification les aides d’un montant maximal de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans.
Règlement no 1407/2013Article 3
Aides de minimis
« 1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.
Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces aides de minimis ne peuvent servir à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.
3. Si une entreprise exerce des activités de transport de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que d’autres activités auxquelles s’applique le plafond de 200 000 EUR, ce plafond lui est applicable, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les aides octroyées pour les activités de transport de marchandises par route n’excèdent pas 100 000 EUR et à ce qu’aucune aide de minimis ne serve à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.
4. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.
5. Les plafonds fixés au paragraphe 2 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
6. Aux fins de l’application des plafonds fixés au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
7. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable fixé au paragraphe 2, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.
8. Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.
9. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission. »
Il convient de relever que, bien que les États membres ne doivent pas notifier les aides de minimis, ils sont tout de même tenus soit de créer un registre central de ce type d’aides, soit de conserver et compiler toutes les informations concernant l’application du règlement no 1407/201327. Les dossiers établis doivent ainsi contenir toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du règlement ont été respectées. Les informations doivent être conservées par les autorités nationales, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant dix ans.
10.Code de bonnes pratiques – La Commission a adopté en 2018 un nouveau code de bonnes pratiques en matière de contrôle des aides d’État28. Ce code fournit à la Commission, aux États membres, aux entreprises et à d’autres parties prenantes des orientations sur la conduite quotidienne des procédures relatives aux aides d’État, visant à améliorer l’efficacité, la transparence et la prévisibilité de ces procédures. Il décrit également les modalités de mise en œuvre des procédures d’aides d’État prévus dans le règlement 2015/1589 et expose les mesures que la Commission prend pour accélérer les procédures et en accroître la transparence et la prévisibilité. Le code a remplacé la Communication relative à un code de bonnes pratiques adoptée en 200929 et intègre la Communication relative à une procédure simplifiée de cette même année30.
11.Communication sur la récupération – Aux fins d’exposer sa politique en matière d’exécution des décisions de récupération, la Commission a publié en 2007 une communication concernant la mise en œuvre des décisions enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État qui ont été octroyées de manière illégale, c’est-à-dire, en violation des obligations de notification et de suspension préalables prévues à l’article 108, paragraphe 3, TFUE31. La communication fournit aux États membres des orientations sur les moyens de parvenir à une exécution immédiate et plus effective des décisions de récupération. En ce sens, elle rappelle la finalité de la récupération des aides et les principes fondamentaux sur lesquels repose la mise en œuvre des décisions de récupération. Enfin, la communication présente les implications pratiques de ces principes fondamentaux pour chacun des acteurs du processus de récupération32.
Section 2
Répartition des compétences
12.Cadre institutionnel – Le système de contrôle des aides d’État dépeint par le Traité reconnaît un rôle prépondérant à la Commission, en ce qu’elle est en charge de veiller à l’examen permanent et à la vérification de la compatibilité des aides publiques avec le marché intérieur. Toutefois, le Conseil conserve des compétences considérables dans ce domaine, à l’instar des juridictions nationales, qui occupent également un rôle fondamental en ce qui concerne le recouvrement des aides octroyées illégalement, conséquence de l’effet direct reconnu par la jurisprudence de la Cour à l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE.
SOUS-SECTION 1 — AUNIVEAUDEL’UNION
13.Commission européenne – Conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, la Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existants dans ces États. En effet, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des rapports annuels sur toutes les aides existantes qui ne sont pas soumises à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle33. Par ailleurs, la Commission doit être informée, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Elle a la compétence exclusive pour apprécier la compatibilité d’une aide notifiée avec le marché intérieur, sous le contrôle du juge de l’Union34. Dans l’exercice de cette compétence exclusive, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation35, bien que soumise au contrôle du juge européen.
Selon la jurisprudence de la Cour, la compétence exclusive de la Commission trouve sa limite là où commence celle des tribunaux nationaux, qui ont, pour leur part, compétence exclusive pour ordonner, lorsque la procédure administrative devant la Commission n’a pas encore été clôturée, le recouvrement d’une aide octroyée sans respecter les obligations de notification préalable et de suspension prescrites par l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
Arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a.,C-39/94, EU:C:1996:285
« 28. Des considérations qui précèdent, il découle par ailleurs que l’argument tiré d’un prétendu détournement de procédure doit également être rejeté. Par sa première question, la juridiction de renvoi ne demande pas à la Cour d’empiéter sur la compétence exclusive de la Commission en se prononçant sur la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Elle se borne à demander des éclaircissements sur l’applicabilité de l’article 92, paragraphe 1, du traité à des mesures telles que celles en cause afin d’être à même de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’interdiction de mise en œuvre préalable des projets d’aide prévue par l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité36.
[…]
Sur les questions 5 à 8
31. Par ses questions 5 à 8, la juridiction nationale demande en substance quelle attitude elle doit adopter lorsqu’elle est saisie d’une demande visant à ce qu’elle tire les conséquences de la violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité, alors que la Commission est parallèlement saisie et n’a pas encore statué sur la question de savoir si les mesures étatiques en cause constituent des aides d’État. La juridiction nationale se demande plus précisément si elle doit se déclarer incompétente (question 5) ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu’à ce que la Commission prenne position sur la qualification des mesures en cause (question 6) ou, au contraire, si elle doit se déclarer compétente et sauvegarder les droits des justiciables en cas de violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité par l’État en rendant la décision demandée (question 8). Enfin, la juridiction nationale demande si la circonstance que la Commission est saisie depuis plus de deux ans et que les demanderesses au principal ont démontré l’urgence de la situation a une incidence sur la réponse à apporter à la question précédente (question 7).
32. Selon TAT, lorsque la Commission a été saisie mais doit encore décider si les mesures en cause constituent une aide d’État, la juridiction nationale doit se déclarer incompétente sous peine d’engendrer un risque de divergence entre sa décision et celle de la Commission. Au cas où la Commission déciderait ultérieurement que les mesures ne constituent pas une aide d’État, la procédure nationale tendant au recouvrement de l’aide au titre de l’article 93, paragraphe 3, perdrait, en effet, toute base juridique. À titre subsidiaire, TAT soutient que la juridiction nationale est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Commission décide si les mesures constituent une aide. Enfin, elle fait observer que l’aide, à supposer qu’elle existe, devrait être considérée comme une aide existante en raison du temps anormalement long mis par la Commission pour parvenir à une décision, de sorte qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une restitution, mais seulement être supprimée ou modifiée pour l’avenir.
33. Ces arguments ne sauraient être accueillis.
[…]
39. L’intervention des juridictions nationales, quant à elle, résulte de l’effet direct reconnu à l’interdiction de mise à exécution des projets d’aide édictée par l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase. À cet égard, la Cour a précisé que le caractère immédiatement applicable de l’interdiction de mise à exécution visée par cet article s’étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et que, en cas de notification, il se produit pendant la phase préliminaire et, si la Commission engage la procédure contradictoire, jusqu’à la décision finale (arrêts Lorenz, précité, point 8, et du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, Rec., p. I-5505, point 11, ci-après l’“arrêt FNCE”).
40. Les juridictions nationales doivent garantir aux justiciables que toutes les conséquences d’une violation de l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité en seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d’exécution que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires (voir arrêt FNCE, précité, point 12).
41. Dans le cadre du contrôle du respect par les États membres des obligations mises à leur charge par les articles 92 et 93 du traité, les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires et distincts.
42. Lorsqu’elles tirent les conséquences d’une violation de l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, les juridictions nationales ne peuvent pas se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aide avec le marché commun, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour (voir arrêt FNCE, précité, point 14).
43. Quant à la Commission, elle ne peut, contrairement aux juridictions nationales, ordonner la restitution d’une aide d’État au seul motif qu’elle n’a pas été notifiée conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité (voir arrêts Boussac, précité, points 19 à 22, et du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec., p. I-959, points 15 à 20 ; FNCE, précité, point 13). Elle doit d’abord, après avoir mis l’État membre concerné en mesure de s’exprimer à cet égard, enjoindre à celui-ci, par une décision provisoire, en attendant le résultat de l’examen de l’aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu’elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Ce n’est que si l’État membre omet, nonobstant l’injonction de la Commission, de fournir les renseignements sollicités, que celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure, de prendre la décision constatant la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun sur la base des éléments dont elle dispose et, le cas échéant, d’exiger la récupération du montant de l’aide déjà versé (voir arrêt Boussac, précité, points 19 et 21).
44. Dans ces conditions, l’ouverture par la Commission d’une procédure d’examen préliminaire au titre de l’article 93, paragraphe 3, ou de la procédure d’examen contradictoire prévue à l’article 93, paragraphe 2, ne saurait décharger les juridictions nationales de leur obligation de sauvegarder les droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable.
45. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation par les États membres de l’interdiction de mise à exécution des projets d’aide. Étant donné que la Commission ne peut ordonner que la suspension de versements supplémentaires tant qu’elle n’a pas adopté sa décision définitive sur le fond, l’effet utile de l’article 93, paragraphe 3, du traité serait amoindri si la saisine de la Commission devait empêcher les juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de la violation de cette disposition. »
De même, il ressort de la jurisprudence que la Commission ne peut pourtant ordonner la restitution d’une aide versée de manière illégale au seul motif que la procédure de notification n’a pas été respectée. Dans la mesure où l’examen de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur n’est pas clôturé, la Commission n’ordonne, en principe37, que la suspension de versements supplémentaires, après avoir mis l’État en mesure de s’exprimer, et ce sans que la Commission soit tenue d’ordonner cette suspension. Sans préjudice de la compétence qui incombe aux juridictions nationales, la décision de récupération des aides illégales ne peut être effectuée qu’après l’adoption, par la Commission, d’une décision d’incompatibilité.
Arrêt du 18 septembre 1995, SIDE/Commission,T-49/93, EU:T:1995:166
« 83. Il convient de rappeler d’emblée que, selon la jurisprudence de la Cour, l’effet direct de l’interdiction de mise à exécution, visée par la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 93 du traité, s’étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et, en cas de notification, se produit pendant la phase préliminaire et, si la Commission engage la procédure contradictoire, jusqu’à la décision finale (voir l’arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471, point 8, et l’arrêt Transformateurs de saumon, précité, point 11). Toutefois, ainsi qu’il a été relevé par la Commission et par la partie intervenante, cette jurisprudence n’implique pas que la Commission soit tenue d’enjoindre automatiquement à l’État membre concerné de suspendre le versement d’une aide qui n’a pas été notifiée conformément à cet article. La Cour a en effet statué que, lorsque la Commission “constate qu’une aide a été instituée ou modifiée sans avoir été notifiée, (elle) a le pouvoir, après avoir mis l’État membre concerné en mesure de s’exprimer à cet égard, d’enjoindre à celui-ci, par une décision provisoire, en attendant le résultat de l’examen de l’aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu’elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l’aide avec le marché commun” (voir l’arrêt France/Commission, précité, point 19). La Cour a donc reconnu à la Commission le pouvoir d’adopter une telle mesure conservatoire lorsqu’elle entame l’examen d’une aide non notifiée, mais ne lui a nullement imposé une obligation ayant le contenu allégué par la requérante.
84. En outre, s’il est vrai qu’au point 22 de l’arrêt France/Commission, précité, la Cour a également reconnu à la Commission le pouvoir d’exiger la récupération du montant d’aide déjà versé, elle ne lui a pas pour autant reconnu le pouvoir de déclarer des aides illégales au seul motif que l’obligation de notifier n’a pas été respectée par l’État membre concerné et sans que la compatibilité de l’aide en question avec le marché commun soit examinée, notamment au regard de l’article 92, paragraphe 3 (voir les arrêts France/Commission, Belgique/Commission et Transformateurs de saumon, précités). À la lumière de cette jurisprudence, force est de constater que la Commission n’était pas tenue d’exiger le recouvrement du montant de l’aide déjà versée, bien qu’il ait été octroyé par le gouvernement français en violation de l’obligation énoncée à l’article 93, paragraphe 3, du traité.
85. Cette constatation est confirmée par l’arrêt Transformateurs de saumon, précité, dans lequel la Cour a expliqué qu’il y a une différence fondamentale entre “le rôle central et exclusif réservé par les articles 92 et 93 à la Commission” et celui qui incombe aux juridictions nationales. “Alors que la Commission est tenue d’examiner la compatibilité de l’aide […] avec le marché commun, même dans les cas où l’État membre méconnaît l’interdiction de mise à exécution des mesures d’aide, les juridictions nationales, elles, ne font que sauvegarder, jusqu’à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l’interdiction visée à l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité” (voir point 14 de l’arrêt susmentionné). La Cour a, en outre, constaté que, “sous peine de porter atteinte à l’effet direct de l’article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont, comme il a été dit ci-avant, pour mission de préserver, ladite décision finale de la Commission n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction visée par cet article. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, du paragraphe 3, dernière phrase, de cet article et le priverait de son effet utile” (voir point 16).
86. Il s’ensuit que, contrairement à l’argumentation développée par la requérante, lorsque la Commission n’exerce pas son pouvoir d’injonction pour exiger la restitution d’une aide non notifiée, la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 93 du traité n’est pas pour autant privée d’effet utile. Étant donné que la Cour a reconnu l’effet direct de cette disposition, les justiciables peuvent obtenir auprès des juridictions nationales la sauvegarde de leurs droits. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précisé dans l’arrêt Transformateurs de saumon, précité, même au cas où la décision finale de la Commission déclare les aides compatibles avec le marché commun, les juridictions nationales peuvent être appelées à sanctionner l’invalidité des actes d’exécution pris par les autorités étatiques en méconnaissance de la disposition du traité susvisée. »
14.Conseil de l’Union européenne – La compétence exclusive de la Commission pour évaluer la compatibilité de l’aide est limitée aux hypothèses dans lesquelles des « circonstances exceptionnelles » justifient l’intervention du Conseil. En effet, le troisième alinéa de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, attribue au Conseil une compétence spéciale pour se substituer à la Commission. Il est autorisé à considérer comme compatible une aide qui entrerait pourtant dans le champ d’interdiction posé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE38. La simple saisine du Conseil suffit à dessaisir temporairement la Commission. De plus, s’agissant d’une procédure dérogatoire tant sur le plan processuel que substantiel, le Conseil est tenu de statuer à l’unanimité et doit être en mesure de justifier de circonstances exceptionnelles. Il est tenu de statuer dans les trois mois, à défaut de quoi, la Commission récupère sa pleine compétence.
Selon la jurisprudence, le Conseil ne saurait, sur le fondement de ce pouvoir, valablement déclarer compatible avec le marché intérieur une aide ayant pour objet l’attribution, aux bénéficiaires d’une aide illégale antérieurement déclarée incompatible avec ledit marché par une décision de la Commission, d’un montant destiné à compenser les remboursements auxquels ils sont tenus en application de ladite décision39.
15.Cour de justice de l’Union européenne – Le caractère exclusif de la compétence de la Commission pour évaluer la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur est applicable même vis-à-vis de la Cour de justice de l’Union européenne, qui comprend actuellement, conformément à l’article 19 TUE, la Cour et le Tribunal. En effet, selon une jurisprudence constante, même la Cour ne saurait se prononcer sur la compatibilité d’une aide d’État ou d’un régime d’aides avec le marché intérieur dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la juridiction nationale40. Or, la jurisprudence précise également que la compétence exclusive de la Commission et la marge d’appréciation dont elle bénéficie à cet égard sont soumises au contrôle du juge.
Un tel contrôle s’exerce notamment en vertu du recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE. En particulier, il convient de relever que la circonstance qu’un État membre considère qu’une certaine mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur et que la décision contraire de la Commission est entachée de violation des règles du Traité ne peut pas autoriser audit État à passer outre les dispositions de l’article 108 TFUE et à agir comme si la décision de la Commission était inexistante en droit. En effet, afin de prévenir que les États membres ne se fassent justice à eux-mêmes, le traité leur offre le moyen de déférer en justice toute violation du droit de la part des institutions, notamment par les articles 263 TFUE et suivants, de sorte qu’une décision de la Commission jouisse d’une présomption de légalité, et demeure obligatoire dans tous ses éléments pour l’État destinataire, ainsi que le dispose l’article 288 TFUE, jusqu’à décision contraire des tribunaux européens.
Pour autant que les juridictions nationales puissent être saisies afin de constater l’illégalité d’une aide, en protégeant ainsi les droits des particuliers qui reconnaissent l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE, sont récurrentes les questions préjudicielles dans lesquelles, conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est tenue d’intervenir pour notamment interpréter la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que pour examiner la validité, par exemple, des décisions adoptées par la Commission sur la compatibilité ou incompatibilité d’une mesure d’aide.
SOUS-SECTION 2 — AUNIVEAUNATIONAL
16.Juridictions nationales – Comme il a été déjà indiqué, et sans préjudice de l’exposé effectué dans le titre 2 du présent ouvrage, les juridictions nationales ont un rôle très important dans le cadre du contrôle du régime européen des aides d’État, en ce qu’elles ont la compétence exclusive pour ordonner le remboursement de toute aide réputée illégale en raison de la violation des obligations ressortant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En effet, même si, en principe, l’article 108 TFUE ne confère pas des droits individuels, la Cour reconnaît un effet direct à la dernière phrase de son paragraphe 341, qui peut, partant, être invoqué devant les tribunaux nationaux. Ainsi, la restitution des versements déjà réalisés en violation de l’obligation de notification préalable peut être ordonnée par les juridictions nationales avant même l’issue de la procédure d’examen42





























