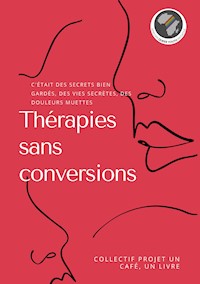Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Qu’est-ce que le désir féminin et comment advient-il ?
C’est d’abord en nous rassemblant pour échanger autour de la question du féminin que nous en sommes venues à l’écriture de ce présent livre : Du féminin à l’ouvrage. Il témoigne d’un chemin, à la fois singulier et collectif, d’élaborations autour de ce que nous, femmes, cliniciennes et psychanalysantes, pouvons en dire et désirons en transmettre.
Ces allers-retours entre singulier et collectif ont fait germer des thématiques dont il nous a semblé qu’elles pouvaient traverser la vie d’une femme. Ici, le désir est tout autant un qu’il est pluriel. Il n’est pas-tout savoir mais une part de ce qui est possible à partir d’une psychanalyse.
Qu’il s’agisse de l’Œdipe, de la rencontre de l’amour, de la découverte de la sexualité et de son développement, de la construction de la maternité, de l’arrivée de la ménopause, de la détresse féminine à la naissance de l’objet rien, la psychanalyse constitue un appui au désir et à son déploiement, ouvrant la voie à la construction par l’être d’une position subjective et féminine.
Les textes présentés vous invitent à la lecture et à la découverte de ce féminin à l’ouvrage.
À PROPOS DES AUTRICES
Dr Chloé Blachère, Sara Dangréaux, Dr Ouarda Ferlicot, Dr Lucille Mihoubi, Léa-Lou Rakotoasitera, Jeanne Simmou et Sophie Vitteaut sont psychothérapeutes ou psychanalystes et reçoivent à leur consultation libérale les êtres en souffrance en psychothérapie ou en psychanalyse.
Elles sont également membres cliniciennes du RPH – École de psychanalyse (Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
RPH - Éditions
ISBN : 978-2-38625-434-5
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Dr Chloé Blachère - Sara DangréauxDr Ouarda Ferlicot - Dr Lucille MihoubiLéa-Lou Rakotoasitera - Jeanne SimmouSophie Vitteaut
Du fémininà l’ouvrage
Table des matières
« L’œuvre c’est un parfum de liberté, une ouverture vers un espace inconnu,passer par delà les barrières que je porte enmoi… Si je fais un pas en avant, je risque de me découvrir autre. La confiance pour une transformation Création, tu me pousses hors des sentiers balisés. Il me faut accepter de sortir des marques habituelles, Devenir ce moi-même que je ne connais pas. »
Jean-Marc dePas1
1 Pas (de), J.-M. (1994-95). Le malléable et sa pétrification, essai poïétique sur une pratique sculpturale (Extraits), Septentrion, Presses universitaires, 1998.
www.lejardindessculptures.comwww.jeanmarcdepas.com
Remerciements
Nous remercions Fernando de Amorim, psychanalyste et président du RPH-École de psychanalyse, pour sa proposition de mise au travail autour de la question du désir féminin.
Nous remercions Édith de Amorim, psychanalyste, d’avoir accepté d’écrire la préface. Elle est notre première lectrice et ses mots comptent.
Nous remercions chacune des membres de ce collectif d’avoir apporté sa créativité, sa singularité mais aussi sa subjectivité pour permettre l’élaboration de cet ouvrage.
Notre gratitude s’adresse également à notre comité de lecture, Édith de Amorim et Laure Baudiment, psychanalystes, et Diane Merakeb, psychothérapeute.
Nous remercions vivement monsieur Jean-Marc de Pas, sculpteur, paysagiste et poète, de nous avoir offert, avec le concours de son épouse madame Stéphanie de Pas, la possibilité d’illustrer notre ouvrage à partir de ses œuvres sculptées et photographiées.
Enfin, nous remercions tous ceux qui ont aidé à l’élaboration et la publication de cet ouvrage.
Préface
Une autre manière de voir la lumière2
Pierre Soulages m’offre le titre de cette préface pour faire avertissement aux lecteurs et lectrices : préparez-vous à lire maintes manières de dire les femmes. Oui, ici, lumière est synonyme de femmes.
Et c’est par le peintre Soulages et son « outrenoir » que j’ai choisi d’en arriver à ce dark continent de la sexualité féminine dont Freud s’est fait l’écho – j’ose dire frustré – dans son ouvrage paru en 1926, La question de l’analyse profane3, en s’inspirant du fameux auteur du non moins célèbre Dr Livingston, I presume ? le dénommé, sous la plume de Freud, J.-R. Stanley, qui se fit appeler Henry Morton Stanley à ses 20 ans car il était né John Rowlands4.
Je vous livre ce point croustillant de l’auteur de Throught the Dark Continent – À travers le continent mystérieux5 – que Sigmund Freud a détourné pour parler de l’impossibilité de faire la lumière sur la sexualité féminine : Stanley-Rowlands, né en 1841, bâtard, fut placé en 1847 dans une sinistre institution où il resta jusqu’à ses 15 ans, expérience dont il conserva toute sa vie la peur de la proximité physique et de la sexualité. Et pour clore en beauté ce point qui donne naissance au livre qui s’offre à votre attention, Stanley a été accusé d’être raciste et puis fut lavé de tout soupçon. Monsieur Stanley, après le continent africain, nous offre à découvrir cette nuance ultime de noir très profond, le Vantablack6, dont il paraît qu’il voile aussi certains parmi les hommes, devrais-je même écrire : les Hommes.
Ce continent noir que serait, aux dires de nombreux psychanalystes et analystes, la sexualité féminine m’a fait, à la lecture des textes qui s’offrent à vous, bien que livrés à l’anonymat par souci des différents transferts qui sont noués avec leurs auteures, m’interroger sur ce noir qui baigne les femmes dans cette vie très intime. Or donc, Soulages dit que le noir reflète la lumière à condition qu’il soit travaillé, strié, et c’est à cette occasion qu’il a déclaré « Par le contraste qu’offre le noir, il crée une autre manière de voir la lumière. »7 C’est donc que pour d’autres le noir ne réfléchit ou n’émet pas de lumière. Et savez-vous que cette couleur n’est pas primaire et ne s’obtient qu’à parts égales d’un mélange entre rouge, jaune et bleu ? Bien sûr s’il y a plus de rouge, le noir se réglisse, si c’est une pointe de bleu qui prime, alors il est Dorian. Déjà, j’entends tout à fait autrement ce noir supposé de la sexualité féminine. J’ajoute que ce noir dit Vantablak dont j’ai parlé plus haut est une création de scientifiques et qui absorbe, rendez-vous compte, 99,995 % du spectre lumineux sans rien réfléchir. Quelque chose me dit que ces scientifiques sont des hommes… pour être à ce point-là intéressés par cette noirceur absolue !
De Freud à Lacan, la sexualité féminine trouve ses droits de cité dans l’énigme renvoyant les femmes à cette responsabilité d’y faire un peu de lumière. Constance de Theis n’avait pas attendu ces messieurs qui en 1797 dans son Epître aux femmes8 apportait cette lumière qui fut absorbée en totalité dans ce noir imaginaire masculin :
« Laissons l’anatomiste, aveugle en sa science,
D’une fibre avec art calculer la puissance,
Et du plus ou du moins inférer sans appel,
Que sa femme lui doit un respect éternel. »
Elle engageait alors les femmes à reprendre « la plume et les pinceaux » ce qu’ont fait nos auteures qui toutes, sans exception, ont dans leur vie personnelle un divan où elles disent le noir tantôt réglisse, tantôt noiraud, tantôt Ébène, tantôt Dorian et tantôt de Jais9 ; cette énonciation n’est pas exhaustive puisque j’ai laissé de côté le noir de fumée et même le noir d’ivoire et d’autres encore. Ce qu’elles déclinent ici, plus bas, après, plus loin, est ce rapport, repérable entre tous, des femmes avec leur manque.
Ce manque qui semble bien être la matière première et princeps qui fait que le médecin Louys de Serres se demande « Pourquoi la plupart des hommes ressentent-ils comme un opprobre la naissance d’une fille » qui lui apporte cette lumière-ci : « Non parce qu’ils détestent une créature à leur image, mais parce qu’ils subissent le poids d’une tradition constante depuis les Anciens, Aristote ou Galien, jusqu’aux Modernes, Rabelais ou Tiraqueau. »10
De ces lumières éparses ne restent que les rais qui sont cependant suffisants à nos auteures pour de ce noir réfléchir cette lumière à la qualité à nulle autre semblable comme le révèle Soulages.
Un homme, encore. Où est le problème ? C’est une des qualités de cette particulière lumière que réfléchit ce noir du monde des femmes à laquelle nous convient les auteures du présent livre, prendre et émettre la lumière d’où qu’elle vienne.
Cette lumière particulière c’est l’ordinaire apanage des femmes liées à cette « impermanence des mots »11 qui fait strie dans ce noir qui, alors, réfléchit. À l’instar d’un monsieur Jourdain, les femmes réfléchissent la lumière de l’autre, de l’Autre – quand bien même il n’est pas barré – mais elles ne le savent pas. Ce livre, si vous en poursuivez la lecture, vous départira de votre ignorance, qui que vous soyez, entendez par-là, que vous soyez lectrice ou lecteur. Car, ces auteures réfléchissent, chacune d’entre elles, les lumières et c’est à chaque fois un effet particulier de matière comme lumière.
L’une met en lumière le poids du père, quand l’autre nous dévoile un Lacan ronsardien en diable avec cette citation de l’amour qui se renverse et nous renverse.
Ce sont des textes qui dépeignent des histoires d’amour sur fond de culture triste, sur scène œdipienne, et qui gravent en nous ce vers du poète William Wordsworth que Freud a relevé pour notre éternité : « L’enfant est le père de l’Homme »12 puisque vous y découvrirez un petit Enzo qui prend la main de sa mère pour la conduire sur le chemin du féminin.
Tout dans ces textes qui vous sont soumis appelle à l’extrême vigilance et à ne pas vous laisser agripper par la facilité et la hâte : ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, ça n’est rien moins que « la fin d’un règne de souffrance », c’est dans le livre mais pas de note de bas de page : un seul mot d’ordre qui vaut : lisez, avec amour.
« Elle » le dit dans le Cantique des Cantiques, psaume 1 : « Noire, je le suis, mais belle, filles de Jérusalem, pareille aux tentes de Qédar, aux tissus de Salma. »13
Édith de Amorim
2 Pierre Soulages. La lumière comme matière, https://www.pierre-soulages.com/document/pierre-soulages-la-lumiere-comme-matiere/, consulté le 4 juin 2024.
3 Freud, S. (1926). La question de l’analyse profane, Paris, PUF, 2012.
4 Wikipédia. Henry Morton Stanley, fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley#cite_ref_bbc_3-8, consulté le 7 juin 2024.
5 Stanley, H.-M. (1878). À travers le continent mystérieux : les sources du Nil, du lac Victoria et du lac Tanganyka, Paris, Hachette BNF, 2012.
6 Adobe. La couleur noire : mystère et démystification, Adobe.com/fr/creativecloud/design/discover/color-guide-black.html#05, consulté le 7 juin 2024.
7 Pierre Soulages. pierre-soulages.com, consulté le 4 juin 2024.
8 Théis (de), M. (1797). Épître aux femmes, https://www.de-plume-en-plume.fr/histoire/epitre-aux-femmes, consulté le 4 juin 2024.
9 Toutes les couleurs. https://www.toutes-les-couleurs.com/couleur-noir.php, consulté le 7 juin 2024.
10 Berriot-Salvadore, E. « Le discours de la médecine et de la science », in Zemon Davis, N. & Farge, A. (Dir). Histoire des femmes en Occident, III. XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 2002, p. 409.
11 Collectif. Du féminin à l’ouvrage, RPH Éditions, Paris, 2024, p. 226.
12 Wordsworth, W. (1807). « L’arc-en-ciel », in Poèmes, Paris, Gallimard, 2001, p. 127.
13 AELF. Cantique des cantiques, https://www.aelf.org/bible/Ct/1, vers 05, consulté le 30 mai 2024.
Introduction
Et si l’histoire nous permettait de mieux lire l’a-venir ? Les femmes sont-elles en train de faire surgir un nouveau discours ?
Aujourd’hui, les femmes étudient, travaillent et accèdent à de hautes responsabilités. Leurs présences émergent dans des secteurs jusque-là réservés aux hommes et l’évolution sociétale les amène, dans des sphères diverses, à prendre la parole, à la porter et, plus encore, à la faire entendre.
Si nous remontons plus avant, depuis l’Antiquité, la parole des femmes a souvent été déconsidérée.
Cantonnées au foyer par leur rôle de mère, d’épouse ou de fille, la plupart des femmes restent au travers des siècles sous la dépendance d’un homme, ainsi écartées de la culture et de leur autonomie.
La mythologie regorge de déesses puissantes, ce qui contraste avec les qualités négatives qui leur sont attribuées et qui poursuivront l’image des femmes au cours des siècles : elles sont dépeintes vengeresses, vindicatives, jalouses, vaniteuses, furieuses, querelleuses et passionnelles.
Si chez Platon14, une femme peut occuper les mêmes fonctions qu’un homme dans la création de sa Cité idéale, elle reste cependant inférieure à lui. Cette infériorité se retrouve chez Aristote, chez qui la femme, si elle a quelque talent, n’excelle jamais et n’a de place que dans l’économie domestique.
L’histoire est traversée par différents mouvements qui tendent à faire évoluer et avancer la cause des femmes. Ils s’illustrent d’abord sur le plan de la pensée et de la littérature. Le mouvement des Précieuses au XVIe siècle en témoigne. Les femmes se réunissent dans les salons littéraires et se retrouvent alors pour réfléchir et s’interroger sur leurs conditions de vie.
Elles poursuivent ensuite leur mouvement par l’action, en se joignant aux hommes pour faire valoir un changement dans la société, comme lors de la Révolution française. Le tableau « La liberté guidant le peuple » (1830) d’Eugène Delacroix illustre ce moment. Il met en scène une femme, héraut de la révolution, alors qu’en coulisse, une fois la déclaration des droits de l’homme rédigée, il n’est plus question des droits des femmes. C’est dans ce contexte qu’Olympe de Gouges rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour laquelle elle sera jugée pour trahison, condamnée et exécutée.
Plus tard, le mouvement des suffragettes (1903), d’abord né au Royaume-Uni pour défendre le droit de vote pour les femmes, est rejoint en France au début du XXe siècle. C’est en 1945 que les femmes pourront voter pour la première fois en France ; leurs voix comptent enfin.
Ces événements historiques témoignent de l’histoire des femmes et de la façon dont la société les accueille et leur permet ou non de s’y inscrire. La famille reste la plus petite cellule de la société et son commencement. Cependant, et cela est tout aussi important, lorsqu’elles arrivent à s’émanciper de leurs conditions et à prendre en main leur destinée, alors elles peuvent être les premières et ouvrir la voie à d’autres15.
Au sein de l’histoire de la psychanalyse, les femmes occupent une position particulière mais non moins importante. La création de la psychanalyse débute avec Sigmund Freud et sa rencontre avec le symptôme hystérique, dont il rend compte en 189216. C’est avec les femmes qu’il donne naissance à la psychanalyse, délaissant progressivement le procédé d’hypnose puis sa thérapeutique par le toucher, hérités de sa formation médicale, au profit de l’écoute des associations libres. Les hystériques quittent ainsi l’enfermement de la Pitié-Salpêtrière et passent, avec lui, du statut de folles au statut de patientes.
Emmy von R. permet à Freud de découvrir la méthode d’association libre. Hélène Deutsch et Ruth Mac Brunswick attirent son attention sur la phase préœdipienne et font avancer la lecture du développement sexuel des femmes. Nous pouvons également citer Sabina Spielrein qui invente la pulsion destructrice, der zerstörerische trieb, et lui consacre une thèse, Die Destruktion als Ursache des Werdens (1912). Freud s’en inspirera pour postuler la pulsion de mort. C’est aussi une femme, Marie Bonaparte, qui lui permet de quitter Vienne et de sauver sa correspondance à Wilhelm Fliess, dont nous pouvons reconnaître, des années plus tard, l’importance qu’elle aura eue dans l’évolution de la pensée de Freud.
Jacques Lacan s’est beaucoup appuyé sur les femmes pour faire avancer la psychanalyse, notamment sur les écrits de l’école anglaise, fondée par Melanie Klein. De la question du sevrage à l’introduction de la bouteille de Klein, Lacan entretiendra un dialogue avec cette figure importante de la psychanalyse anglophone. Dans son Séminaire X consacré à l’Angoisse, la reprise des articles sur le contre-transfert lui permet d’illustrer la question du désir du psychanalyste. Pour autant, il a énoncé que les femmes ne disaient pas tout sur la sexualité féminine17. Qu’en entendait-il ?
Philippe Givre, quant à lui, évoquait du féminin le fait d’être « plusieurs en soi »18. La multiplicité indique, dans le même temps, le manque. L’incomplétude concerne une femme. À partir de là, comment prétendre faire œuvre commune à plusieurs ? Probablement en cessant de vouloir unifier. C’est dans cette démarche que nous nous sommes engagées et par laquelle nous avons tenté de nous situer au plus près de l’intime. Le présent ouvrage est ainsi le fruit de cette expérience.
La construction des textes qui le constituent s’est élaborée progressivement. À travers ces écrits se dévoilent les effets de paroles de femmes, témoignages de multiples facettes du féminin. Bien que le féminin concerne l’homme comme la femme, hommes et femmes restent différents. C’est cette différence qui, nous l’espérons, se fera entendre.
Chaque auteure a travaillé une dimension du féminin telle qu’elle s’est présentée à elle au cours du travail, solitaire et collectif. Puis, partant de l’élan qu’a suscité la lecture des textes, quelques-unes ont écrit ce que nous avons appelé une « évocation » ; ces textes n’ont rien de systématisé et n’ont pas de forme spécifiquement attendue. Nous avons fait le choix d’une écriture libre. Elles sont introduites dans l’ouvrage par la formule « En associant ».
Les textes sont étayés de vignettes cliniques ou de verbatim de patientes et psychanalysantes. Les éléments qui pourraient donner des indications permettant d’identifier les personnes ont été modifiés.
Le choix de l’ordre des articles s’est fait dans l’après-coup. Pour la publication, nous avons suivi le fil qui se dégageait à partir des thématiques ayant émergé :
Œdipe :
Le discours du père dans la construction du féminin
Amour :
L’être de sexe féminin dans la relation amoureuse, une construction possible ?
Sexualité :
La question du plaisir chez les femmes
Maternité :
Féminin et maternité : de l’Œdipe vers le manque
Ménopause :
La créativité : un processus féminin ?
Détresse :
Au diapason du féminin
Rien :
Le féminin : du dépouillement à la construction à partir de l’objet rien
14 Platon. (384 et 377 avant J.-C.). « Livre V », in République, Paris, Éditions Gallimard, 1993.
15 Gazsi, M. & Kestenberg S. Elles ont été les Premières !, Paris, Éditions de La Martinière,2021.
16 Freud, S. (1893-95). « Étude sur l’hystérie », in Œuvres Complètes, Vol. II, Paris, PUF, 2009, pp. 9-347.
17 Lacan, J. (1972-73). Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 54.
18 Givre, P. « Conséquences psychiques induites par “l’effet-mère” ». Adolescence, 2014, n° 323, p. 645.
« Guitariste et Femme assise »
Œdipe
Le discours du père dans la construction du féminin
« Le vrai père c’est celui qui ouvre les chemins par sa parole,
pas celui qui retient dans les filets de sa rancœur. »19
Promenade théorique
« (…) nos collègues les dames analystes, sur la sexualité féminine elles ne nous disent (…) pas tout ! Elles n’ont pas fait avancer d’un bout la question de la sexualité féminine. Il doit y avoir à ça une raison interne liée à la structure de l’appareil de la jouissance (…) Il y a une jouissance à elles à cette elle qui n’existe pas et ne signifie rien. Il y a une jouissance à elle dont peut-être elle-même ne sait rien, sinon qu’elle l’éprouve – ça, elle le sait. Elle le sait, bien sûr, quand ça arrive (…) depuis le temps qu’on les supplie, qu’on les supplie à genoux – je parlais la dernière fois des psychanalystes femmes – d’essayer de nous le dire, eh bien, motus ! On n’a jamais rien pu en tirer. Alors on l’appelle comme on peut, cette jouissance, vaginale. »20
À cet appel de Jacques Lacan dans son XXe séminaire, Encore, tentons une réponse, ou du moins d’en écrire quelques mots.
En tant que femme, psychanalysante et clinicienne, j’apporte le témoignage d’expériences sur ce qu’est la position féminine, la manière dont elle peut se construire et plus particulièrement sous le prisme du discours du père.
En tentant de tenir à distance la littérature psychanalytique sans pour autant mettre de côté la théorisation du féminin, l’intérêt de cet écrit est de pouvoir dire aussi et surtout en quoi la psychanalyse, dans les faits, fait advenir du féminin et permet une construction féminine subjective à travers les cures et les associations libres des femmes qui fréquentent mon divan.
La théorisation du féminin a été en partie initiée par des hommes psychanalystes. Avec l’invitation de Lacan et celle de Fernando de Amorim, il paraît fondamental d’en apprendre des femmes elles-mêmes. Mais qui mieux que les femmes, intimes de leur désir féminin, peut nous enseigner ?
Voici tout d’abord une réflexion personnelle plutôt générale : je remarque que, parmi les psychanalystes et psychothérapeutes, beaucoup sont des femmes. D’ailleurs, j’observe aussi que des êtres qui viennent me rendre visite sont davantage de sexe féminin.
La constitution biologique en creux caractéristique de la femme, cette ouverture, m’évoque l’accueil. L’accueil est ce que nous faisons, nous cliniciennes femmes, tout au long de la journée dans nos consultations. Et pourquoi ces personnes que nous recevons sont-elles majoritairement des femmes ? Cette interprétation n’engage que moi, mais ne serait-ce pas parce que la femme s’ouvre davantage, de par sa constitution ? Bien sûr, la parole ne se délie pas toujours complètement car les résistances participent de la danse clinique, on ne peut – pas tout – dire.
Je crois que l’idée de cet écrit, de cette participation au savoir du féminin, c’est de pouvoir en dire quelque chose de concret avec toutes les difficultés que cela implique. Les apports théoriques ont leur importance mais pourquoi ne pas y apporter une parole plus intime et subjective ? Sigmund Freud nous a offert sur un plateau d’argent ses fantasmes les plus intimes au nom de la science et il y a là quelque chose de très féminin !
Le féminin et la féminité, voici déjà une distinction qui, je m’en rends compte en me mettant au travail, me paraît floue. Je dirais concernant le féminin, en m’étayant sur les apports de Freud21, qu’elle est une position passive, présente chez l’homme et chez la femme. C’est cet intérieur non visible et qui semble non dicible. Pour la féminité, je dirais plutôt qu’elle représente cette mascarade, ces habits, ce maquillage, ces allures, ces postures, bref, elle est ce qui vient se déposer comme apparat sur le corps de la femme, ce qui donne un peu de beau à voir. Ce sont ces petits accessoires séduisants en plus liés au phallus imaginaire.
Le féminin serait donc non dicible et pourtant nous désirons, ici, en dire quelque chose. Et en parlant de désir, qu’est-ce que le désir de l’être de sexe féminin ? Son désir serait d’être elle-même désirée22. Mais est-ce que cela s’arrête vraiment là ?
Être dans une position féminine n’est pas inné, et le désir de l’être de sexe féminin ne peut se résoudre à être simplement désirée. L’être de sexe féminin peut aussi – aller – désirer, dans le sens d’aller vers quelque chose. Cela se construit, mais comment cette construction est-elle rendue possible ?
D’après Donald Woods Winnicott, l’expérience de la construction féminine demanderait moins d’efforts psychiques puisqu’elle s’étayerait sur l’identification primaire à la mère23. Cela ne paraît pas suffisant.
La position féminine ne se transmet pas simplement par la mère. Le père joue un rôle primordial dans la construction de la position féminine. Mais il ne transmet pas une féminité, je dirais qu’il transmet plutôt un message.
Il est d’ailleurs souvent difficile de parler de la femme sans parler de l’homme. La femme a à recourir au tiers pour mettre au travail sa position féminine et par extension son désir. Déjà aux origines, le tiers est là pour que la fille et le garçon se dégagent du rapport à la mère, pour qu’ils se dégagent de la jouissance imaginaire24.
Un proverbe italien dit que la mère aime tendrement et le père sagement.
L’inconscient naît du refoulement originaire instauré par le phallus, signifiant du désir selon Lacan. Mais ce signifiant est absent chez la femme. C’est alors que la métaphore paternelle entre en scène, afin que la femme, ou plutôt la petite fille à cet instant, puisse s’identifier aux insignes du père : « Le père est un signifiant substitué à un autre signifiant »25.
Le père est représentant de la loi et de l’autorité. Il joue un rôle de protection des menaces extérieures et assure une sécurité intérieure. Mais pour incarner ce rôle, le père doit d’abord s’appliquer à lui-même cette loi et l’interdit de l’inceste. Il doit apprendre à composer entre son désir incestueux et cet interdit26.
Même si Freud avait abandonné sa neurotica pour révéler l’importance du fantasme de séduction chez les femmes souffrantes qu’il recevait, il ne faut pas oublier d’examiner tout de même ce qui est parfois manifesté chez certains pères, des attitudes de séduction, ou des attitudes ambivalentes. Didier Lauru dit à ce propos :
« La fille, par sa fantasmatisation, va être à l’affût de la moindre ambivalence dans le regard ou le discours du père. Si ce dernier vient satisfaire cette demande, la fille ne pourra plus renoncer à son père pour se tourner vers un autre homme. Un père doit savoir renoncer à cette exclusivité, à l’amour que la fille lui porte, pour la laisser s’épanouir et devenir une femme féminine. »27
La difficulté d’un père réside dans le fait d’aimer sa fille avec justesse. Il doit pouvoir l’aimer, mais que cet amour ne vienne pas combler de manière imaginaire la demande de sa fille. La déception de la fille vis-à-vis de son père serait nécessaire pour qu’elle puisse plus tard s’en détourner et aller désirer ailleurs.
C’est aussi une déception qui dans un premier temps aura amené la fille à se détourner de sa mère, cette mère qui l’a faite manquante. Chez la petite fille, l’absence de pénis marque une frustration, celle du manque imaginaire d’un objet réel. Mais frustration ne veut pas nécessairement dire castration symbolique. Pour que la castration soit effective, il est indispensable que le manque quitte l’Imaginaire pour s’inscrire dans le champ du Symbolique. C’est ainsi que l’objet imaginaire devient objet symbolique. Dans ce passage, la privation est nécessaire, comme manque réel d’un objet symbolique ; « une privation ne peut être effectivement conçue que pour un être qui articule quelque chose dans le plan symbolique »28.
Il faudrait donc une double déception dans le parcours chez l’enfant fille ; une première qui la détourne de sa mère et une seconde qui la détourne de son père. La première déception aurait lieu pour se dégager de la demande du phallus imaginaire, la seconde tracerait la voie vers un phallus symbolique. Car la fille devra s’appuyer sur le père symbolique pour pouvoir construire sa position féminine.
Comment se présentent ce père symbolique et ses insignes ?
Françoise Dolto dit ceci :
« De nombreuses observations attestent que, pour peu que la fille qui se sait porter le nom du père accolé à son prénom, reçoive une certitude qu’elle a été désirée fille par son père – et, comme telle, à l’image de sa mère, sans pénis – alors elle accepte très rapidement sa caractéristique sexuelle, sa forme vulvaire, « bouton avec un trou », comme une gratification paternelle et une promotion maternelle. »29
Ce qui, dans le discours des parents, n’est pas permis (par exemple : se maquiller, sortir, danser) ne va pas dans le sens d’une subjectivité de la fille devenue adolescente dans sa condition de femme. Le rôle du père est indispensable dans la féminisation de la fille, s’il l’autorise à s’établir socialement à l’extérieur du foyer30.
Selon Freud, la première identification de l’être se fait au père de la préhistoire31. L’identification peut se faire par l’emprunt d’une caractéristique de la figure paternelle jugée comme bonne, mais elle peut à contrario se faire à travers un symptôme comme signe d’un attachement ou bien d’une fixation à cette figure. Dans une revendication phallique imaginaire, la fille peut aussi se mettre en compétition face à ce père32.
L’adolescence, temps des grands remaniements, vient questionner ces repères identificatoires. La figure idéalisée du père s’effrite pour laisser place à la découverte d’un père pas si exceptionnel que cela, voire banal ou même décevant. Le deuil que cette nouvelle rencontre provoque doit pouvoir amener la fille à trouver des référents extérieurs.
L’être adolescent doit construire son propre rapport à la loi et doit se repositionner par rapport à son représentant, le père, pour mettre en place son champ de liberté et son désir. La difficulté est de toujours se référer à cette loi du père qui a cessé d’être prestigieux et en faire une expérience subjective joyeuse33.
Lauru parle du double regard que le père porte à sa fille ; un regard d’amour mais pas de désir, qui définit sa fille en tant que femme, et un regard pensant qui légitimise sa fille en tant que sujet pensant et non pas simplement comme objet de désir. Ce regard posé sur la fille sert de référence à la femme en devenir pour se positionner face aux autres hommes, et ne doit donc ni être trop insistant, ni trop absent34. Il s’agit d’un regard masculin qui désigne l’enfant comme fille35.
Le discours d’un père face à la petite fille doit être juste, tout comme le regard porté sur elle.
« Le rôle du valorisé implicite ou explicite dans les initiatives verbales, sensorielles, corporelles et sensuelles, actives et passives, le rôle de ce qui est permis par la mère phallique, symbole de tout pouvoir et de tout savoir, et par le père, symbole, lui, de toute autorité, est absolument capital pour l’avenir de la sexualité et de la personnalité de la future femme. Si l’enfant est éduquée par une femme qui n’est pas frigide, qui est maternelle et satisfaite sexuellement par un homme au comportement paternel avec l’enfant, alors tout est en place pour la constitution chez la fillette d’un comportement féminin puissant et d’un comportement sexuel futur non frigide. »36
Le message du féminin transmis par le père à sa fille se fait aussi à travers la qualité de la relation entre les deux parents. La construction narcissique de la fille se fait, certes, par le regard de l’autre mais aussi par le regard entre ces deux autres37. Un père qui apporte amour, respect et joie à son épouse vient, d’une certaine manière, dire à sa fille : « Voici comment tu peux être aimée et traitée dans une relation amoureuse, de la bonne manière. »