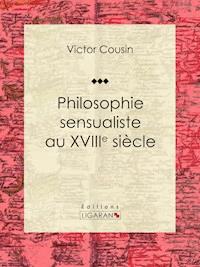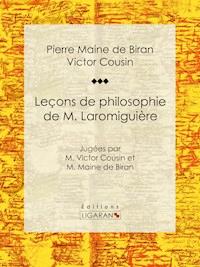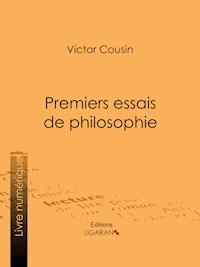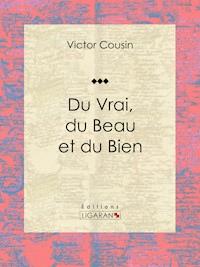
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il semble assez naturel qu'un siècle à ses débuts emprunte sa philosophie au siècle qui le précède. Mais, comme êtres intelligents et libres, nous ne sommes pas nés pour continuer seulement nos devanciers, mais pour accroître leur œuvres et pour faire aussi la nôtre. Nous ne pouvons accepter leur héritage que sous bénéfice d'inventaire."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335035025
©Ligaran 2015
DISCOURS PRONONCÉ À L’OUVERTURE DU COURS,LE 4 DÉCEMBRE 1817.
DE LA PHILOSOPHIE AU XIXe SIÈCLE.
Esprit et principes généraux du cours. – Objet des leçons de cette année : application des principes exposés aux trois problèmes du vrai, du beau et du bien.
Il semble assez naturel qu’un siècle à ses débuts emprunte sa philosophie au siècle qui le précède. Mais, comme êtres intelligents et libres, nous ne sommes pas nés pour continuer seulement nos devanciers, mais pour accroître leur œuvre et pour faire aussi la nôtre. Nous ne pouvons accepter leur héritage que sous bénéfice d’inventaire. Notre premier devoir est donc de nous rendre compte de la philosophie du XVIIIe siècle, de reconnaître son caractère et ses principes, les problèmes qu’elle agitait et les solutions qu’elle en a données, de discerner enfin ce qu’elle nous transmet de vrai et de fécond, et ce qu’elle laisse aussi de stérile et de faux, pour embrasser l’un et rejeter l’autre d’un choix réfléchi. Placés à l’entrée de temps nouveaux, sachons avant tout dans quelles voies nous nous voulons engager. Pourquoi, d’ailleurs, ne le dirions-nous pas ? Après deux années d’un enseignement où le professeur se cherchait en quelque sorte lui-même, on a bien le droit de lui demander quel il est, quels sont ses principes les plus généraux sur toutes les parties essentielles de la science philosophique, quel drapeau enfin, au milieu de partis qui se combattent si violemment, il vous propose de suivre, jeunes gens qui fréquentez cet auditoire, et qui êtes appelés à partager la destinée si incertaine encore et si obscure du XIXe siècle.
Ce n’est pas le patriotisme, c’est le sentiment profond de la vérité et de la justice qui nous fait placer toute la philosophie aujourd’hui répandue dans le monde sous l’invocation du nom de Descartes. Oui, la philosophie moderne tout entière est l’œuvre de ce grand homme : car elle lui doit l’esprit qui l’anime et la méthode qui fait sa puissance.
Après la chute de la scolastique et les déchirements douloureux de XVIe siècle, le premier objet que se proposa le bon sens hardi de Descartes fut de rendre la philosophie une science humaine, comme l’astronomie, la physiologie, la médecine, soumise aux mêmes incertitudes et aux mêmes égarements, mais capable aussi des mêmes progrès.
Descartes rencontra devant lui le scepticisme répandu de tous côtés à la suite de tant de révolutions, des hypothèses ambitieuses, nées du premier usage d’une liberté mal réglée, et les vieilles formules échappées à la ruine de la scolastique. Dans sa passion courageuse de la vérité, il résolut de rejeter, provisoirement au moins, toutes les idées qu’il avait reçues jusque-là sans les contrôler, bien décidé à ne plus admettre que celles qui, après un sérieux examen, lui paraîtraient évidentes. Mais il s’aperçut qu’il y avait une chose qu’il ne pouvait rejeter, même provisoirement, dans son doute universel : cette chose était l’existence même de son doute, c’est-à-dire de sa pensée ; car quand même tout le reste ne serait qu’illusion, ce fait, qu’il pensait, ne pouvait pas être une illusion. Descartes s’arrêta donc à ce fait, d’une évidence irrésistible, comme à la première vérité qu’il pouvait accepter sans crainte. Reconnaissant en même temps que la pensée est le nécessaire instrument de toutes les recherches qu’il pouvait jamais se proposer, ainsi que celui du genre humain dans l’acquisition de ses connaissances naturelles, il s’attacha à l’étude régulière, à l’analyse de la pensée comme à la condition de toute philosophie légitime, et sur ce solide fondement il éleva une doctrine d’un caractère à la fois certain et vivant, capable de résister au scepticisme, exempte d’hypothèses, et affranchie des formules de l’école.
C’est ainsi que l’analyse de la pensée, et de l’esprit qui en est le sujet, c’est-à-dire la psychologie, est devenue le point de départ, le principe le plus général, la grande méthode de la philosophie moderne.
Toutefois, il faut bien l’avouer, la philosophie n’a pas entièrement perdu et elle reprend encore quelquefois, après Descartes et dans Descartes même, ses anciennes habitudes. Il appartient rarement au même homme d’ouvrir et de parcourir la carrière, et d’ordinaire l’inventeur succombe sous le poids de sa propre invention. Ainsi Descartes, après avoir si bien posé le point de départ de toute recherche philosophique, oublie plus d’une fois l’analyse et revient, au moins dans la forme, à l’ancienne philosophie. La vraie méthode s’efface bien plus encore entre les mains de ses premiers successeurs, sous l’influence toujours croissante de la méthode mathématique.
On peut distinguer deux périodes dans l’ère cartésienne : l’une où la méthode, en sa nouveauté, est souvent méconnue ; l’autre où l’on s’efforce au moins de rentrer dans la voie salutaire ouverte par Descartes. À la première appartiennent Malebranche, Spinoza, Leibnitz lui-même ; à la seconde, les philosophes du XVIIIe siècle.
Sans doute Malebranche est, sur quelques points, descendu très avant dans l’observation intérieure ; mais la plupart du temps il se laisse emporter dans un monde imaginaire, et il perd de vue le monde réel. Ce n’est pas une méthode qui manque à Spinoza, mais c’est la bonne. Son tort est d’avoir appliqué à la philosophie la méthode géométrique, qui procède par axiomes, définitions, théorèmes, corollaires ; nul n’a moins pratiqué la méthode psychologique : c’est là le principe et aussi la condamnation de son système. Les Nouveaux Essais sur l’entendement humain montrent Leibnitz opposant observation à observation, analyse à analyse ; mais son génie plane ordinairement sur la science, au lieu de s’y avancer pas à pas : voilà pourquoi les résultats auxquels il arrive ne sont souvent que de brillantes hypothèses, par exemple l’harmonie préétablie, aujourd’hui reléguée parmi les hypothèses analogues des causes occasionnelles et du médiateur plastique. En général, la philosophie du XVIIe siècle, faute d’employer avec assez de rigueur et de fermeté la méthode dont Descartes l’avait armée, n’a guère produit que des systèmes ingénieux sans doute, hardis et profonds, mais souvent aussi téméraires, et qui ne sont pas demeurés dans la science. Il n’y a de durable, en effet, que ce qui est fondé sur une saine méthode ; le temps emporte tout le reste ; le temps, qui recueille, féconde, agrandit les moindres germes de vérité déposés dans les plus humbles analyses, frappe sans pitié, engloutit les hypothèses, même celles du génie. Il fait un pas, et les systèmes arbitraires sont renversés ; les statues de leurs auteurs restent seules debout sur leurs ruines. La tâche de l’ami de la vérité est de rechercher les débris utiles qui en subsistent, et peuvent servir à de nouvelles et plus solides constructions.
La philosophie du XVIIIe siècle ouvre la seconde période de l’ère cartésienne ; elle se proposa surtout d’appliquer la méthode trouvée et trop négligée : elle s’attacha à l’analyse de la pensée. Désabusé de tentatives ambitieuses et stériles, et dédaigneux du passé comme Descartes lui-même, le XVIIIe siècle osa croire que tout était à refaire en philosophie, et que, pour ne pas s’égarer de nouveau, il fallait débuter par l’étude modeste de l’homme. Au lieu donc de bâtir tout d’un coup des systèmes hasardés sur l’universalité des choses, il entreprit d’examiner ce que l’homme sait et ce qu’il peut savoir ; il ramena la philosophie entière à l’étude de nos facultés, comme la physique venait d’être ramenée à l’étude des propriétés des corps : c’était donner à la philosophie, sinon sa fin, du moins son vrai commencement.
Les grandes écoles qui partagent le XVIIIe siècle sont l’école anglaise et française, l’école écossaise, l’école allemande, c’est-à-dire l’école de Locke et de Condillac, celle de Reid, celle de Kant. Il est impossible de méconnaître le principe commun qui les anime, l’unité de leur méthode. Quand on examine avec impartialité la méthode de Locke, on voit qu’elle consiste dans l’analyse de la pensée, et c’est par là que Locke est un disciple, non de Bacon et de Hobbes, mais de notre grand compatriote, de Descartes. Étudier l’entendement humain tel qu’il est en chacun de nous, reconnaître ses forces et aussi ses limites, tel est le problème que le philosophe anglais s’est proposé et qu’il essaye de résoudre. Je ne veux pas juger ici la solution qu’il en donne ; je me borne à bien marquer quel est pour lui le problème fondamental. Condillac, le disciple français de Locke, se fait partout l’apôtre de l’analyse ; et l’analyse, ici, c’est encore ou du moins ce devrait être l’étude de la pensée. Nul philosophe, pas même Spinoza, ne s’est plus éloigné que Condillac de la vraie méthode expérimentale, et ne s’est plus égaré dans la route des abstractions, et même des abstractions verbales ; mais, chose étrange, nul n’est plus sévère à l’endroit des hypothèses, sauf à aboutir à celle de l’homme-statue. L’auteur du Traité des Sensations a très infidèlement pratiqué l’analyse, mais il en parle sans cesse. L’école écossaise combat Locke et Condillac ; elle les combat, mais avec leurs propres armes, avec la même méthode qu’elle prétend appliquer mieux. En Allemagne, Kant veut remettre en lumière et en honneur l’élément supérieur de la connaissance humaine, laissé dans l’ombre et décrié par la philosophie de son temps. Pour cela que fait-il ? il entreprend un examen approfondi de la faculté de connaître ; son principal ouvrage a pour titre : Critique de la raison pure ; c’est une critique, c’est-à-dire encore une analyse : la méthode de Kant n’est donc pas autre que celle de Locke et de Reid. Suivez-la jusque entre les mains de Fichte, le successeur de Kant, mort à peine depuis quelques années : là encore l’analyse de la pensée est donnée comme le fondement de la philosophie. Kant s’était si bien établi dans le sujet de la connaissance qu’il avait eu de la peine à en sortir, et qu’il n’en sortit même jamais légitimement. Fichte s’y enfonça si avant qu’il s’y ensevelit, et absorba dans le moi humain toutes les existences comme toutes les sciences ; triste naufrage de l’analyse, qui en signale à la fois le plus grand effort et l’écueil !
Le même esprit gouverne donc toutes les écoles du XVIIIe siècle : ce siècle dédaigne les formules abstraites ; il a horreur de l’hypothèse ; il s’attache ou prétend s’attacher à l’observation des faits, et particulièrement à l’analyse de la pensée.
Reconnaissons-le avec franchise et avec douleur : le XVIIIe siècle a appliqué l’analyse à toutes choses sans pitié et sans mesure. Il a cité devant son tribunal toutes les doctrines, toutes les sciences ; ni la métaphysique de l’âge précédent avec ses systèmes imposants, ni les arts avec leur prestige, ni les gouvernements avec leur vieille autorité, ni les religions avec leur majesté, rien n’a trouvé grâce devant lui. Quoiqu’il entrevît des abîmes au fond de ce qu’il appelait la philosophie, il s’y est jeté avec un courage qui n’est pas sans grandeur ; car la grandeur de l’homme est de préférer ce qu’il croit la vérité à lui-même. Le XVIIIe siècle a déchaîné les tempêtes. L’humanité n’a plus marché que sur des ruines. Le monde s’agite encore dans cet état de désordre où déjà il a été vu une fois, au déclin des croyances antiques et avant le triomphe du christianisme, quand l’homme errait à travers tous les contraires, sans pouvoir se reposer nulle part, livré à toutes les inquiétudes de l’esprit et à toutes les misères du cœur, fanatique et athée, mystique et incrédule, voluptueux et sanguinaire. Mais si la philosophie du dernier siècle nous a laissé le vide pour héritage, elle nous a laissé aussi un amour énergique et fécond de la vérité. Le XVIIIe siècle a été l’âge de la critique et des destructions ; le XIXe doit être celui des réhabilitations intelligentes. Il lui appartient de trouver dans une analyse plus profonde de la pensée les principes de l’avenir, et avec tant de débris d’élever enfin un édifice que puisse avouer la raison.
Ouvrier faible, mais zélé, je viens apporter ma pierre ; je viens faire ma journée, je viens retirer du milieu des ruines ce qui n’a pas péri, ce qui ne peut pas périr. Ce cours est à la fois un retour sur le passé et un effort vers l’avenir. Je ne me propose ni d’attaquer ni de défendre aucune des trois grandes écoles qui partagent le XVIIIe siècle ; je ne chercherai point à perpétuer et à envenimer la guerre qui les divise, en signalant complaisamment les différences qui les séparent, sans tenir compte de la communauté de méthode qui les unit. Je viens, au contraire, soldat dévoué de la philosophie, ami commun de toutes les écoles qu’elle a produites, offrir à toutes des paroles de paix.
L’unité de la philosophie moderne réside, comme nous l’avons dit, dans sa méthode, c’est-à-dire dans l’analyse de la pensée, méthode supérieure à ses propres résultats, car elle contient en elle le moyen de réparer les erreurs qui lui échappent, et d’ajouter indéfiniment de nouvelles richesses aux richesses acquises. Les sciences physiques elles-mêmes n’ont pas d’autre unité. Les grands physiciens qui ont paru depuis deux siècles, bien qu’unis entre eux par le même point de départ et par le même but publiquement acceptés, n’en ont pas moins marché avec indépendance et dans des voies souvent opposées. Le temps a recueilli dans leurs diverses théories la part de vérité qui les a fait naître et qui les a soutenues ; il a négligé les erreurs auxquelles elles n’ont pu se soustraire, et, rattachant les unes aux autres toutes les découvertes dignes de ce nom, il en a formé peu à peu un ensemble vaste et harmonieux. La philosophie moderne s’est aussi enrichie depuis deux siècles d’une multitude d’observations exactes, de théories solides et profondes, dont elle est redevable à la commune méthode. Que lui a-t-il manqué pour marcher d’un pas égal avec les sciences physiques dont elle est la sœur ? Il lui a manqué d’entendre mieux ses intérêts, de tolérer des diversités inévitables, utiles même, et de mettre à profit les vérités que contiennent toutes les doctrines particulières pour en tirer une doctrine générale, qui s’épure et s’agrandisse successivement et perpétuellement.
Non, certes, que je conseille ce syncrétisme aveugle qui perdit l’école d’Alexandrie, et qui tentait de rapprocher forcément des systèmes contraires ; ce que je recommande, c’est un éclectisme éclairé qui, jugeant avec équité et même avec bienveillance toutes les écoles, leur emprunte ce qu’elles ont de vrai, et néglige ce qu’elles ont de faux. Puisque l’esprit de parti nous a si mal réussi jusqu’à présent, essayons de l’esprit de conciliation. La pensée humaine est immense. Chaque école ne l’a considérée qu’à son point de vue. Ce point de vue n’est pas faux, mais il est incomplet, et, de plus, il est exclusif. Il n’exprime qu’un côté de la vérité, et rejette tous les autres. Il ne s’agit pas aujourd’hui de décrier et de recommencer l’ouvrage de nos devanciers, mais de le perfectionner en réunissant et en fortifiant par cette réunion toutes les vérités éparses dans les différents systèmes que nous a transmis le XVIIIe siècle.
Tel est le principe auquel peu à peu nous ont conduit deux années d’études sur la philosophie moderne depuis Descartes jusqu’à nos jours. Ce principe, mal dégagé d’abord, nous l’avons appliqué une première fois dans les limites les plus étroites et aux seules théories relatives à la question de l’existence personnelle. Nous l’avons ensuite étendu à un plus grand nombre de questions et de théories ; nous avons touché les principaux points de l’ordre intellectuel et de l’ordre moral ; et en même temps que nous poursuivions les recherches de notre illustre prédécesseur, M. Royer-Collard, sur les écoles de France, d’Angleterre et d’Écosse, nous avons commencé l’étude, nouvelle parmi nous, l’étude difficile, mais intéressante et féconde, du philosophe de Kœnigsberg. Nous pouvons donc aujourd’hui embrasser toutes les écoles du XVIIIe siècle et tous les problèmes qu’elles ont agités.
La philosophie, dans tous les temps, roule sur les idées fondamentales du vrai, du beau et du bien. L’idée du vrai, philosophiquement développée, c’est la psychologie, la logique, la métaphysique ; l’idée du bien, c’est la morale privée et publique ; l’idée du beau, c’est cette science qu’en Allemagne on appelle l’esthétique, dont les détails regardent la critique littéraire et la critique des arts, mais dont les principes généraux ont toujours occupé une place plus ou moins considérable dans les recherches et même dans l’enseignement des philosophes, depuis Platon et Aristote jusqu’à Hutcheson et Kant.
Sur ces points essentiels qui composent le domaine entier de la philosophie, nous interrogerons successivement les principales écoles du XVIIIe siècle.
Lorsqu’on les examine toutes avec attention, on les ramène aisément à deux : l’une qui, dans l’analyse de la pensée, sujet commun de tous les travaux, fait à la sensibilité une part excessive ; l’autre qui dans cette même analyse, se jetant à l’extrémité opposée, tire la connaissance presque tout entière d’une faculté différente de la sensibilité, la raison. La première de ces écoles est l’école empirique, dont le père ou plutôt le représentant le plus sage est Locke, et Condillac le représentant extrême ; la seconde est l’école spiritualiste ou rationaliste, comme on voudra l’appeler, qui compte à son tour d’illustres interprètes, Reid, le plus irréprochable, et Kant le plus systématique. Évidemment il y a du vrai dans ces deux écoles, et la vérité est un bien qu’il faut prendre partout où on le rencontre. Nous admettons volontiers avec l’école empirique que les sens ne nous ont pas été donnés en vain ; que cette admirable organisation, qui nous élève au-dessus de tous les êtres animés, est un instrument riche et varié qu’il serait insensé de négliger. Nous sommes convaincu que le spectacle du monde est un foyer permanent d’instruction saine et sublime. Sur ce point, ni Aristote ni Bacon ni Locke ne nous auront pour adversaire, mais pour disciple. Nous avouons ou plutôt nous proclamons que dans l’analyse de la connaissance humaine, il faut faire aux sens une grande part. Mais quand l’école empirique prétend que tout ce qui passe leur portée est une chimère, alors nous l’abandonnons, et nous allons nous joindre à l’école opposée. Nous faisons profession de croire, par exemple, que, sans une impression agréable, jamais nous n’aurions conçu le beau, et que pourtant le beau n’est pas seulement l’agréable ; que, grâce à Dieu, le plaisir ou du moins le bonheur s’ajoute ordinairement à la vertu, mais que l’idée même de la vertu est essentiellement différente de celle du bonheur. Là-dessus nous sommes ouvertement de l’avis de Reid et de Kant. Nous avons aussi établi et nous établirons encore que l’esprit de l’homme est en possession de principes que la sensation précède mais n’explique point, et qui nous sont directement suggérés par la puissance propre de la raison. Nous suivrons Kant jusque-là, mais pas au-delà. Loin de le suivre, nous le combattrons, lorsque, après avoir défendu victorieusement contre l’empirisme les grands principes en tout genre, il les frappe de stérilité, en prétendant qu’ils n’ont aucune valeur au-delà de l’enceinte de la raison qui les aperçoit, condamnant ainsi à l’impuissance cette même raison qu’il vient d’élever si haut, et ouvrant la porte à un scepticisme raffiné et savant qui, après tout, aboutit au même abîme que le scepticisme ordinaire.
Vous le voyez, nous serons tour à tour avec Locke, avec Reid et avec Kant dans cette juste et forte mesure qu’on appelle l’éclectisme.
L’éclectisme est à nos yeux la vraie méthode historique, et il a pour nous toute l’importance de l’histoire de la philosophie ; mais il y a quelque chose que nous mettons encore au-dessus de l’histoire de la philosophie et par conséquent de l’éclectisme : c’est la philosophie elle-même.
L’histoire de la philosophie ne porte pas sa clarté avec elle, et elle n’est point son propre but. Comment l’éclectisme, qui n’a pas d’autre champ que l’histoire, serait-il notre seul, notre premier objet ?
Il est juste sans doute, il est de la plus haute utilité de bien discerner dans chaque système ce qu’il a de vrai d’avec ce qu’il a de faux, d’abord pour bien apprécier ce système, ensuite pour rendre le faux au néant, dégager et recueillir le vrai, et ainsi enrichir et agrandir la philosophie par l’histoire. Mais vous concevez qu’il faut savoir déjà quelle est la vérité, pour la reconnaître quelque part et la distinguer de l’erreur qui y est mêlée ; en sorte que la critique des systèmes exige presque un système, et que l’histoire de la philosophie est contrainte d’emprunter d’abord à la philosophie la lumière qu’elle doit lui rendre un jour avec usure.
Enfin l’histoire de la philosophie n’est qu’une branche ou plutôt un instrument de la science philosophique. Évidemment c’est l’intérêt que nous portons à la philosophie qui seul nous attache à son histoire ; c’est l’amour de la vérité qui nous fait poursuivre partout ses vestiges, et interroger avec une curiosité passionnée ceux qui avant nous ont aimé aussi et cherché la vérité.
Ainsi la philosophie est à la fois l’objet suprême et le flambeau, de l’histoire de la philosophie. À ce double titre, il lui appartient de présider à notre enseignement.
À cet égard, un mot d’explication, je vous prie.
Celui qui porte aujourd’hui la parole devant vous n’est, il est vrai, officiellement chargé que du cours de l’histoire de la philosophie ; là est notre tâche, et là, encore une fois, notre guide sera l’éclectisme. Mais, nous le confessons, si la philosophie n’a pas le droit de se présenter ici en quelque sorte sur le premier plan, si elle n’y paraît que derrière son histoire, en réalité elle y domine, et c’est à elle que se rapportent tous nos vœux comme tous nos efforts. Nous tenons sans doute en très grande estime et Brucker et Tennemann, si savants, si judicieux ; cependant nos modèles, nos véritables maîtres, toujours présents à notre pensée, ce sont dans l’antiquité Platon et Socrate, chez les modernes Descartes, et, n’hésitons pas à le dire, c’est chez nous et dans notre temps l’homme illustre qui a bien voulu nous appeler à cette chaire. M. Royer-Collard n’était aussi qu’un professeur de l’histoire de la philosophie ; mais il prétendait bien avoir une opinion en philosophie : il servait une cause qu’il nous a transmise, et nous la servons à notre tour.
Cette grande cause vous est connue : c’est celle d’une philosophie saine et généreuse, digne de notre siècle par la sévérité de ses méthodes et répondant aux besoins immortels de l’humanité, partant modestement de la psychologie, de l’humble étude de l’esprit humain, pour s’élever aux plus hautes régions et parcourir la métaphysique, l’esthétique, la théodicée, la morale et la politique.
Notre entreprise n’est donc pas seulement de renouveler l’histoire de la philosophie par l’éclectisme ; nous voulons aussi, nous voulons surtout, et l’histoire bien entendue, grâce à l’éclectisme, nous y servira puissamment, faire sortir de l’étude des systèmes, de leurs luttes, de leurs ruines même, un système qui soit à l’épreuve de la critique, et qui puisse être accepté par votre raison et aussi par votre cœur, noble jeunesse du XIXe siècle !
Pour remplir ce grand objet, qui est notre mission véritable, nous oserons cette année, pour la première et pour la dernière fois, franchir les étroites limites qui nous sont imposées. Dans l’histoire de la philosophie du XVIIIe siècle, nous avons résolu de laisser un peu dans l’ombre l’histoire de la philosophie pour faire paraître la philosophie elle-même, et, tout en mettant sous vos yeux les traits distinctifs des principales doctrines du siècle dernier, de vous exposer la doctrine qui semble convenir aux besoins et à l’esprit de notre temps, et encore de vous l’exposer brièvement mais dans toute son étendue, au lieu d’insister sur quelqu’une de ses parties, ainsi que nous l’avons fait jusqu’ici. Avec les années, nous corrigerons, nous tâcherons d’agrandir et d’élever notre œuvre. Aujourd’hui nous vous la présentons bien imparfaite encore, mais établie sur des fondements que nous croyons solides, et déjà marquée d’un caractère qui ne changera point.
Vous verrez donc ici, rassemblés en un court espace, nos principes, nos procédés, nos résultats. Nous souhaitons ardemment vous les persuader, jeunes gens, qui êtes l’espérance de la science aussi bien que de la patrie. Puissions-nous du moins, dans la vaste carrière que nous avons à parcourir, rencontrer en vous la même bienveillance qui jusqu’à présent nous a soutenu !
Deux grands besoins, celui de vérités absolues, et celui de vérités absolues qui ne soient pas des chimères. Satisfaire ces deux besoins est le problème de la philosophie de notre temps. – Des principes universels et nécessaires. – Exemples de tels principes en différents genres. – Distinction des principes universels et nécessaires et des principes généraux. – Que l’expérience est incapable d’expliquer toute seule les principes universels et nécessaires, et aussi de s’en passer même pour arriver à la connaissance du monde sensible. – De la raison comme étant celle de nos facultés qui nous découvre ces principes. – Que l’étude des principes universels et nécessaires nous introduit dans les parties les plus hautes de la philosophie.
Aujourd’hui, comme de tout temps, deux grands besoins se font sentir à l’homme.
Le premier, le plus impérieux, est celui de principes fixes, immuables, qui ne dépendent ni des temps ni des lieux ni des circonstances, et où l’esprit se repose avec une confiance illimitée. Dans toutes les recherches, tant qu’on n’a saisi que des faits isolés, disparates, tant qu’on ne les a pas ramenés à une loi, on possède les matériaux d’une science, mais la science n’est pas encore. La physique elle-même commence seulement là où paraissent des vérités universelles auxquelles on peut rattacher tous les faits du même ordre que l’observation nous découvre dans la nature. Platon l’a dit : il n’y a point de science de ce qui passe.
Voilà notre premier besoin. Mais il en est un autre, non moins légitime, c’est le besoin de ne pas être dupe de principes chimériques, d’abstractions vides, de combinaisons plus ou moins ingénieuses mais artificielles, le besoin de s’appuyer sur la réalité et sur la vie, le besoin de l’expérience. Les sciences physiques et naturelles, dont les conquêtes rapides frappent et éblouissent les plus ignorants, doivent leurs progrès à la méthode expérimentale. De là l’immense popularité de cette méthode, portée à ce point qu’on ne daignerait pas même aujourd’hui prêter la moindre attention à une science à laquelle cette méthode ne semblerait pas présider.
Unir l’observation et la raison, ne pas perdre de vue l’idéal de la science auquel l’homme aspire, et le chercher et le trouver par la route de l’expérience, tel est le problème de la philosophie.
Or nous nous adressons à vos souvenirs des deux dernières années : n’avons-nous pas établi, par la méthode expérimentale la plus sévère, par la réflexion appliquée à l’étude de l’esprit humain, avec la lenteur et la rigueur qu’exigent de pareilles démonstrations, n’avons-nous pas établi qu’il y a dans tous les hommes, sans distinction de savants et d’ignorants, des idées, des notions, des croyances, des principes que le sceptique le plus déterminé peut bien nier du bout des lèvres, mais qui le gouvernent lui-même à son insu et malgré lui dans ses discours et dans sa conduite, qu’on trouve en soi pour peu qu’on s’interroge, et qui, par un contraste frappant avec nos autres connaissances, sont marqués de ce caractère à la fois merveilleux et incontestable qu’ils se rencontrent dans l’expérience la plus vulgaire, et qu’en même temps, au lieu d’être circonscrits dans les limites de cette expérience, ils la surpassent et la dominent, universels au milieu des phénomènes particuliers auxquels ils s’appliquent, nécessaires quoique mêlés à des choses contingentes, infinis et absolus à nos propres yeux, tout en nous apparaissant dans cet être relatif et fini que nous sommes ? Ce n’est pas là un paradoxe inattendu que nous vous présentons ; nous ne faisons qu’exprimer ici le résultat de nombreuses leçons.
Il ne nous a pas été difficile de faire voir qu’il y a des principes universels et nécessaires à la tête de toutes les sciences.
Il est trop évident qu’il n’y a point de mathématiques sans les axiomes et sans les définitions, c’est-à-dire sans principes absolus.
Que deviendrait la logique, ces mathématiques de ta pensée, si vous lui ôtez un certain nombre de principes, un peu barbares peut-être dans leur forme scolastique, mais qui doivent être universels et nécessaires pour présider à tout raisonnement, à toute démonstration ?
Y a-t-il même une physique possible, si tout phénomène qui commence à paraître ne suppose pas et une cause et une loi ?
Sans le principe des causes finales, la physiologie pourrait-elle faire un seul pas, se rendre compte d’un seul organe, déterminer une seule fonction ?
Le principe sur lequel repose toute morale, le principe qui oblige l’homme de bien et fonde la vertu, n’est-il pas de la même nature ? Ne s’étend-il pas à tous les êtres moraux sans distinction de temps et de lieu ? Concevez-vous un être moral qui ne reconnaisse au fond de sa conscience que la raison doit commander à la passion, qu’il faut garder la foi jurée, et, contre l’intérêt le plus pressant, restituer le dépôt qui nous a été confié ?
Et ce ne sont pas là des préjugés métaphysiques et des formules d’école : j’en appelle au sens commun le plus vulgaire.
Si je vous disais qu’un meurtre vient d’avoir lieu, pourriez-vous ne pas me demander quand, où, par qui, pourquoi ? Cela veut dire que votre esprit est dirigé par les principes universels et nécessaires du temps, de l’espace, de la cause et même de la cause finale.
Si je vous disais que c’est l’amour ou l’ambition qui a commis ce meurtre, ne concevriez-vous pas à l’instant même un amant, un ambitieux ? Cela veut dire encore qu’il n’y a pas pour vous d’acte sans agent, de qualité et de phénomène sans une substance, sans un sujet réel.
Si je vous disais que l’accusé prétend que ce n’est pas en lui la même personne qui a conçu, voulu, exécuté ce meurtre, et que, dans les intervalles, sa personne s’est plus d’une fois renouvelée, ne diriez-vous pas qu’il est fou s’il est sincère, et que, si les actes et les accidents ont varié, la personne et l’être sont restés les mêmes ?
Supposé que l’accusé se défende sur ce motif, que le meurtre commis doit servir à son bonheur ; que d’ailleurs la personne tuée était, si malheureuse que la vie lui était un fardeau ; que la patrie n’y perd rien, puisque, au lieu de deux citoyens inutiles, elle en acquiert un qui lui devient utile ; qu’enfin le genre humain ne périra pas faute d’un individu, etc. ; à tous ces raisonnements n’opposerez-vous pas cette réponse bien simple, que ce meurtre, utile peut-être à son auteur, n’en est pas moins injuste, et qu’ainsi sous nul prétexte il n’était permis ?
Le même bon sens qui admet des vérités universelles et nécessaires les distingue aisément de celles qui ne le sont pas, et qui sont seulement générales, c’est-à-dire qui s’appliquent seulement à un plus ou moins grand nombre de cas.
Par exemple, voici une vérité fort générale : le jour succède à la nuit ; mais est-ce une vérité universelle et nécessaire ? S’étend-elle à tous les pays ? Oui, à tous les pays connus. Mais s’étend-elle à tous les pays possibles ? Non ; car il est possible de concevoir des pays plongés dans une nuit éternelle, étant donné un autre système du monde. Les lois du monde sensible sont ce qu’elles sont ; elles ne sont pas nécessaires. Leur auteur aurait pu en choisir d’autres. Avec un autre système du monde on conçoit une autre physique, mais on ne conçoit ni d’autres mathématiques ni une autre morale. Ainsi il est possible de concevoir que le jour et la nuit ne soient plus dans les rapports où nous les voyons ; donc cette vérité, le jour succède à la nuit, est une vérité très générale, peut-être même une vérité universelle, mais non pas une vérité nécessaire.
Montesquieu a dit que la liberté n’est pas un fruit des climats chauds. J’accorde, si l’on veut, que la chaleur énerve l’âme, et que les pays chauds portent difficilement des gouvernements libres ; mais il ne s’ensuit point qu’il n’y ait pas d’exception possible à ce principe : d’ailleurs il y en a eu ; ce n’est donc pas un principe absolument universel, et encore bien moins un principe nécessaire. En pouvez-vous dire autant du principe de la cause ? Pouvez-vous concevoir, quelque part, en quelque temps et en quelque lieu, un phénomène qui commence à paraître sans une cause, physique ou morale ?
Et quand il serait possible de ramener les principes universels et nécessaires à des principes généraux, pour employer et appliquer ces principes même ainsi rabaissés et y appuyer un raisonnement quelconque, il faudrait admettre ce qu’on appelle en logique le principe de contradiction, à savoir qu’une chose ne peut pas à la fois être et n’être pas, afin de maintenir entière chacune des parties du raisonnement, ainsi que le principe de la raison suffisante, qui seul établit leur lien et la légitimité de la conclusion. Or, ces deux principes, sans lesquels il n’y pas de raisonnement, sont eux-mêmes des principes universels et nécessaires ; en sorte que le cercle est manifeste.
Alors même qu’on détruirait par la pensée toutes les existences pour ne laisser sur leurs débris qu’un seul esprit, on serait forcé de placer dans cet esprit-là, pour peu qu’il s’exerçât, et l’esprit n’est tel qu’à la condition qu’il pense, plusieurs principes nécessaires ; on ne saurait au moins le concevoir dépourvu du principe de contradiction et du principe de la raison suffisante.
Combien de fois n’avons-nous pas démontré la vanité des efforts de l’école empirique pour ébranler l’existence ou affaiblir la portée des principes universels et nécessaires ! Écoutez cette école : elle vous dira que le principe de la cause, donné par nous comme universel et nécessaire, n’est, après tout, qu’une habitude de l’esprit qui, voyant dans la nature un fait suivre un autre fait, met entre eux cette connexion que nous avons appelée la relation de l’effet à la cause. Mais cette explication n’est autre chose que la destruction, non pas seulement du principe des causes, mais de la notion même de cause. Les sens me montrent deux boules, l’une qui commence à se mouvoir, l’autre qui se meut après elle. Supposez que cette succession se renouvelle et persiste, ce sera la constance ajoutée à la succession, ce ne sera pas là le moins du monde la connexion d’une puissance causatrice et de son effet, celle par exemple que la conscience nous atteste dans le moindre effort volontaire. Aussi un empiriste conséquent, tel que Hume, prouve aisément qu’aucune expérience sensible ne donne légitimement l’idée de cause.
Ce que nous disons de la notion de cause, nous pourrions le dire de toutes les notions du même genre. Citons au moins celles de substance et d’unité.
Les sens n’aperçoivent que des qualités, des phénomènes. Je touche l’étendue, je vois la couleur, je sens l’odeur ; mais l’être étendu, coloré, odorant, est-ce que nos sens l’atteignent ? Hume plaisante agréablement là-dessus. Il demande sous lequel de nos sens tombe la substance. Qu’est-ce donc, selon lui et dans le système de l’empirisme, que la notion de substance ? Une illusion comme la notion de cause.
Les sens ne donnent pas davantage l’unité ; car l’unité c’est l’identité, c’est la simplicité, et les sens nous montrent tout successif et composé. Les ouvrages de l’art ne possèdent l’unité que parce que l’art, c’est-à-dire l’esprit de l’homme, l’y a mise ; quant à ceux de la nature, si nous l’y apercevons, ce ne sont pas les sens qui la découvrent. L’arrangement des diverses parties d’un objet peut contenir de l’unité, mais c’est une unité d’organisation, une unité idéale et morale que l’esprit seul conçoit et qui échappe aux sens.
Si les sens ne peuvent expliquer de simples notions, ils peuvent bien moins encore expliquer les principes où ces notions se rencontrent, et qui sont universels et nécessaires. En effet, les sens aperçoivent bien tels et tels faits, mais il répugne qu’ils embrassent ce qui est universel ; l’expérience atteste ce qui est, elle n’atteint point à ce qui ne peut pas ne pas être.
Allons plus loin. Non seulement l’empirisme ne peut expliquer les principes universels et nécessaires ; mais nous prétendons que, sans ces principes, l’empirisme ne peut pas même rendre compte de la connaissance du monde sensible.
Ôtez le principe des causes, l’esprit humain est condamné à ne jamais sortir de lui-même et de ses propres modifications. Toutes les sensations de l’ouïe, de l’odorat, du goût, de la vue, du toucher, du tact même, ne vous peuvent apprendre quelle est leur cause ni si elles en ont une. Mais rendez à l’esprit humain le principe des causes, admettez que toute sensation, ainsi que tout phénomène, tout changement, tout évènement, a une cause, comme évidemment nous ne sommes pas la cause de certaines sensations, et qu’il faut bien pourtant que ces sensations en aient une, nous sommes conduits naturellement à reconnaître à ces sensations des causes différentes de nous-mêmes, et voilà la première notion du monde extérieur. C’est le principe universel et nécessaire des causes qui seul la donne et la justifie. D’autres principes du même ordre l’accroissent et la développent.
Dès que vous savez qu’il y a des objets extérieurs, je vous demande si vous ne les concevez pas dans un lieu qui les contient. Pour le nier, il vous faudrait nier que tout corps est dans un lieu, c’est-à-dire rejeter une vérité de physique, qui est aussi un principe de métaphysique en même temps qu’un axiome du sens commun. Mais le lieu qui contient tel corps est souvent lui-même un corps qui seulement est plus compréhensif que le premier. Ce nouveau corps est à son tour dans un lieu. Ce nouveau lieu est-il aussi un corps ? Alors il est contenu dans un autre lieu plus vaste, et ainsi de suite ; en sorte qu’il vous est impossible de concevoir un corps qui ne soit pas dans un lieu ; et vous arrivez à la conception d’un lieu illimité et infini, qui contient tous les lieux limités et tous les corps possibles : ce lieu illimité et infini, c’est l’espace.
Et je ne vous dis rien là qui ne soit très simple. Voyez. Niez-vous que cette eau soit dans un vase ? – Niez-vous que ce vase soit dans cette salle ? – Niez-vous que cette salle soit dans un lieu plus grand, lequel est à son tour dans un autre plus grand encore ? Je puis vous pousser ainsi jusqu’à l’espace infini. Si vous niez une seule de ces propositions, vous les niez toutes, la première comme la dernière ; et si vous admettez la première, la dernière est forcée.
On ne peut supposer que la sensibilité toute seule nous élève à l’idée de l’espace, elle qui ne peut pas même nous donner l’idée première de corps. Il faut donc ici l’intervention d’un principe supérieur.
Comme nous croyons que tout corps est contenu dans un lieu, de même nous croyons que tout évènement arrive dans un temps. Concevez-vous un évènement qui arrive, si ce n’est dans un point quelconque de la durée ? Cette durée s’étend et s’agrandit successivement aux yeux de votre esprit, et vous finissez par la concevoir illimitée comme l’espace. Niez la durée, vous niez toutes les sciences qui la mesurent, vous détruisez toutes les croyances naturelles sur lesquelles repose la vie humaine. Il est à peine besoin d’ajouter que la sensibilité toute seule n’explique pas plus la notion du temps que celle de l’espace, lesquelles sont pourtant toutes deux inhérentes à la connaissance du monde extérieur.
L’empirisme est donc convaincu et de ne pouvoir se passer des principes universels et nécessaires, et de ne pouvoir les expliquer.
Arrêtons-nous : ou tous nos précédents travaux n’ont abouti qu’à des chimères, ou ils nous permettent de considérer comme un point définitivement acquis à la science, qu’il y a dans l’esprit humain, pour quiconque l’interroge sincèrement, des principes réellement empreints du caractère de l’universalité et de la nécessité.
Après avoir établi et défendu l’existence des principes universels et nécessaires, nous pourrions rechercher et poursuivre cette sorte de principes dans toutes les parties des connaissances humaines, et en essayer une classification exacte et rigoureuse. Mais d’illustres exemples nous ont appris à craindre de compromettre des vérités du plus grand prix en y mêlant des conjectures qui, en faisant briller peut-être l’esprit du philosophe, diminuent aux yeux des sages l’autorité de la philosophie. Nous aussi, à l’exemple de Kant, nous avons, l’année dernière, devant vous, tenté une classification, une réduction même des principes universels et nécessaires, et de toutes les notions qui y sont engagées. Ce travail n’a pas perdu pour nous son importance ; mais nous ne le reproduirons point. Dans l’intérêt de la grande cause que nous servons, et ne songeant ici qu’à asseoir sur de solides fondements la doctrine qui convient au génie français du XIXe siècle, nous fuirons avec soin tout ce qui pourrait paraître personnel et hasardé ; et, au lieu d’examiner, de critiquer et de remplacer la classification que le philosophe de Kœnigsberg a donnée des principes universels et nécessaires, nous préférons, nous trouvons bien autrement utile de vous faire pénétrer davantage dans la nature de ces principes, en vous faisant voir quelle est celle de nos facultés qui nous les découvre, et à laquelle ils se rapportent et correspondent.
Le propre de ces principes, c’est qu’à la réflexion chacun de nous reconnaît qu’il les possède mais qu’il n’en est pas l’auteur. Nous les concevons et les appliquons, nous ne les constituons point. Interrogeons notre conscience. Nous rapportons-nous à nous-mêmes, par exemple, les définitions de la géométrie, comme nous le faisons certains mouvements dont nous nous sentons la cause ? Si c’est moi qui fais ces définitions, elles sont donc miennes, je puis donc les défaire, les modifier, les changer, les anéantir même. Il est certain que je ne le puis. Je n’en suis donc pas l’auteur. Il est aussi démontré que les principes dont nous avons parlé ne peuvent dériver de la sensation variable, bornée, incapable de produire et d’autoriser rien d’universel et de nécessaire. J’arrive donc à cette conséquence nécessaire aussi : la vérité est en moi et n’est pas à moi. De même que la sensibilité me met en rapport avec le monde physique, ainsi une autre faculté me met en communication avec des vérités qui ne dépendent ni du monde ni de moi, et cette faculté c’est la raison.
Il y a dans l’homme trois facultés générales qui sont toujours mêlées ensemble et ne s’exercent guère que simultanément, mais que l’analyse divise pour les mieux étudier, sans méconnaître leur jeu réciproque, leur liaison intime, leur unité indivisible. La première de ces facultés est l’activité, l’activité volontaire et libre, où parait surtout la personne humaine, et sans laquelle les autres facultés seraient comme si elles n’étaient pas, puisque nous ne serions pas pour nous-mêmes. Qu’on s’examine au moment où une sensation se produit en nous : on reconnaîtra qu’il n’y a perception qu’autant qu’il y a un degré quelconque d’attention, et que la perception finit au moment où finit notre activité. On ne se rappelle pas ce qu’on a fait dans le sommeil absolu ou dans la défaillance, parce qu’alors on a perdu l’activité, par conséquent la conscience, et par conséquent encore la méritoire. De même, souvent la passion, en nous enlevant la liberté, nous enlève du même coup la conscience de nos actions et de nous-mêmes : alors, pour nous servir d’une expression juste et vulgaire, on ne sait plus, ce qu’on fait. C’est par la liberté que l’homme est véritablement homme, qu’il se possède et se gouverne ; sans, elle il retombe sous le joug de la nature ; il n’en est qu’une partie plus admirable et plus belle. Mais, en même temps que je suis doué d’activité et de liberté, je suis passif aussi par d’autres endroits ; je subis les lois du monde extérieur ; je souffre et je jouis sans être moi-même l’auteur de mes joies et de mes souffrances ; je sens s’élever en moi des besoins, des désirs, des passions que je n’ai point faites, et qui tour à tour remplissent ma vie de bonheur ou de misère, malgré que j’en aie et indépendamment de ma volonté. Enfin, outre la volonté et la sensibilité, l’homme a la faculté de connaître, l’entendement, l’intelligence, la raison, peu importe le nom, au moyen de laquelle il s’élève à des vérités d’ordres différents, et entre autres à des vérités universelles et nécessaires qui supposent dans la raison, attachés à son exercice, des principes entièrement distincts des impressions des sens et des résolutions de la volonté.
L’activité volontaire, la sensibilité, la raison, sont toutes les trois également certaines. La conscience vérifie l’existence des principes nécessaires qui dirigent la raison tout aussi bien que celle des sensations et des volitions. J’appelle réel tout ce qui tombe sous l’observation. Je souffre : ma souffrance est réelle en tant que j’en ai conscience ; il en est de même de la liberté ; il en est de même de la raison et des principes qui la gouvernent. Nous pouvons donc affirmer que l’existence des principes universels et nécessaires repose sur le témoignage de l’observation, et même de l’observation la plus immédiate et la plus sûre, celle de la conscience.
Mais la conscience n’est qu’un témoin : elle fait paraître ce qui est, elle ne le crée pas. Ce n’est pas parce que la conscience vous l’annonce que vous avez produit tel ou tel mouvement, éprouvé telle ou telle impression. Ce n’est pas aussi parce que la conscience nous dit que la raison est contrainte d’admettre telle ou telle vérité, que cette vérité existe, c’est parce qu’elle existe qu’il est impossible à la raison de ne pas l’admettre. Les vérités qu’atteint la raison, à l’aide des principes universels et nécessaires dont elle est pourvue, sont des vérités absolues ; la raison ne les fait point, elle les découvre. La raison n’est pas juge de ses propres principes et n’en peut pas rendre compte, car elle ne juge que par eux, et ils sont ses lois à elle-même. Encore bien moins la conscience ne fait-elle ni ces principes, ni les vérités qu’ils nous révèlent ; car la conscience n’a d’autre office ni d’autre puissance que de servir en quelque sorte de miroir à la raison. Les vérités absolues sont donc indépendantes de l’expérience et de la conscience, et en même temps elles sont attestées par l’expérience et la conscience. D’une part, c’est dans l’expérience que se déclarent ces vérités, et de l’autre nulle expérience ne les explique. Voilà comment diffèrent et s’accordent l’expérience et la raison, et comment, au moyen de l’expérience même, on arrive à trouver quelque chose qui la surpasse.
Ainsi la philosophie que nous enseignons ne repose ni sur des principes hypothétiques ni sur des principes empiriques. C’est l’observation elle-même, mais appliquée à la partie supérieure de nos connaissances, qui nous fournit les principes que nous cherchions, un point de départ à la fois solide et élevé.
Ce point de départ, nous l’avons trouvé, ne l’abandonnons pas. Demeurons-y inébranlablement attachés. L’étude des principes universels et nécessaires, considérés sous leurs divers aspects et dans les grands problèmes qu’ils soulèvent, est presque la philosophie tout entière ; elle la remplit, la mesure, la divise. Si la psychologie est l’étude régulière de l’esprit humain et de ses lois, il est évident que celle des principes universels et nécessaires qui président à l’exercice de la raison est la partie la plus haute de la psychologie, ce qu’on appelle en Allemagne la psychologie rationnelle, bien différente de la psychologie empirique. Puisque la logique est l’examen de la valeur et de la légitimité de nos divers moyens de connaître, elle ne peut pas ne pas faire son plus considérable emploi d’apprécier la valeur et la légitimité de principes qui sont les fondements de nos plus importantes connaissances. Enfin la méditation de ces mêmes principes nous conduit à la théodicée et nous ouvre le sanctuaire de la philosophie, si nous voulons remonter jusqu’à leur véritable source, jusqu’à cette raison souveraine, première et dernière explication de la nôtre.
Résumé de la leçon précédente. Question nouvelle : de l’origine des principes universels et nécessaires. – Danger de cette question et sa nécessité. – Des diverses formes sous lesquelles se présente à nous la vérité, et de l’ordre successif de ces formes : théorie de la spontanéité et de la réflexion. – De la forme primitive des principes ; de l’abstraction qui les en dégage et leur donne leur forme actuelle. – Examen et réfutation de la théorie qui tente d’expliquer l’origine des principes par une induction fondée sur des notions particulières.
Nous pouvons considérer comme une conquête assurée de la méthode expérimentale et de la vraie analyse psychologique l’établissement de principes qui, en même temps qu’ils nous sont donnés par la plus certaine de toutes les expériences, celle de la conscience, ont une portée supérieure à l’expérience, et nous ouvrent des régions inaccessibles à l’empirisme. Nous avons reconnu de tels principes à la tête de presque toutes les sciences ; puis, recherchant parmi nos diverses facultés celle qui pouvait nous les avoir donnés, nous avons trouvé qu’il était impossible de les rapporter à aucune autre faculté qu’à cette faculté de connaître que nous appelons la raison, bien différente du raisonnement auquel elle fournit ses lois.
Voilà où nous en sommes. Mais pouvons-nous nous arrêter là ?
Dans l’intelligence humaine, telle qu’elle est aujourd’hui développée, les principes universels et nécessaires s’offrent à nous sous des formes en quelque sorte consacrées. Le principe des causes, par exemple, s’énonce ainsi : Tout ce qui commence à paraître a nécessairement une cause. Les autres principes ont cette même forme axiomatique. Mais l’ont-ils toujours eue, et sont-ils sortis de l’esprit humain avec cet appareil logique et scolastique, comme Minerve est sortie tout armée de la tête de Jupiter ? Avec quels caractères se sont-ils montrés d’abord, avant d’avoir pris ceux dont ils sont maintenant revêtus et qui ne peuvent guère être leurs caractères primitifs ? En un mot, est-il possible de retrouver l’origine des principes universels et nécessaires, et la route qu’ils ont dû suivre pour arriver à ce qu’ils sont aujourd’hui ? Nouveau problème dont l’importance est facile à sentir ; car si on le peut résoudre, quel jour répandu sur ces principes ! D’un autre côté, quelles difficultés ! comment pénétrer jusqu’à ces sources de la connaissance humaine qui se cachent comme celles du Nil ? N’est-il pas à craindre qu’en s’enfonçant dans ce passé obscur, au lieu de la vérité, on ne rencontre une hypothèse ; que s’attachant ensuite à cette hypothèse, on ne la transporte du passé dans le présent, et que, pour s’être trompé sur l’origine des principes, on ne soit conduit à méconnaître leurs caractères actuels et certains, ou du moins à mutiler ou à affaiblir ceux que n’expliquerait pas aisément l’origine adoptée ? Ce danger est si grand, cet écueil est si célèbre en naufrages, qu’avant de le braver on ne saurait prendre trop de précautions contre les séductions de l’esprit de système. On conçoit même que de grands philosophes, qui pourtant n’étaient pas pusillanimes, aient supprimé le périlleux problème. C’est en effet pour avoir voulu l’emporter d’abord que Locke et Condillac se sont tant égarés, et qu’ils ont, il faut bien le dire, corrompu à sa source toute la philosophie. L’école empirique, qui célèbre si fort la méthode expérimentale, y tourne le dos, pour ainsi parler, lorsqu’au lieu de commencer par l’étude des caractères actuels de nos connaissances, tels qu’ils nous sont attestés par la conscience et par la réflexion, elle se jette sans lumière et sans guide à la poursuite de leur origine. Reid et Kant se sont montrés bien autrement observateurs en se renfermant dans les limites du présent, de peur de se perdre dans les ténèbres du passé. Ils traitent abondamment l’un et l’autre des principes universels et nécessaires dans la forme qu’ils ont aujourd’hui, sans se demander quelle a été leur forme primitive. Nous préférons de beaucoup cette sage circonspection à l’esprit d’aventure de l’école empirique. Cependant, lorsqu’un problème est posé, tant qu’il n’est pas résolu, il trouble, il obsède l’esprit humain. La philosophie ne le doit donc pas éluder, mais son devoir est de ne l’aborder qu’avec une prudence extrême et une méthode sévère.
Nous ne saurions trop le rappeler et pour les autres et pour nous-même : l’état primitif des connaissances humaines est loin de nous ; nous ne pouvons guère le ramener sous nos yeux et le soumettre à l’observation ; l’état actuel au contraire est toujours à notre disposition : il nous suffit de rentrer en nous-mêmes, de puiser par la réflexion dans la conscience et de lui faire rendre ce qu’elle contient. Partant de faits certains, nous serons moins exposés à nous égarer plus tard dans des hypothèses ; ou si, en remontant à l’état primitif, nous tombons dans quelque erreur, nous pourrons et la reconnaître et la réparer à l’aide de la vérité que nous aura donnée une observation impartiale ; toute origine qui n’aboutira pas légitimement au point où nous en sommes est par cela seul convaincue d’être fausse, et méritera d’être écartée.
Vous le savez : une grande partie de l’année dernière a passé sur cette question. Nous avons pris un à un les principes universels et nécessaires soumis à notre examen, pour déterminer l’origine de chacun d’eux, sa forme primitive, et les formes diverses qu’il a successivement revêtues ; ce n’est qu’après avoir ainsi opéré sur un assez grand nombre de principes que nous sommes lentement arrivés à une conclusion générale ; et cette conclusion, nous nous croyons reçus à l’exprimer ici brièvement comme le solide résultat de l’analyse la plus circonspecte et du travail au moins le plus méthodique. Il faut renouveler devant vous ce travail, cette analyse, et par là nous exposer à ne pouvoir parcourir tout entière la longue carrière que nous nous sommes tracée, ou il faut bien nous borner à vous rappeler les traits essentiels de la théorie à laquelle nous sommes parvenus.
Cette théorie d’ailleurs est en elle-même si simple que, sans l’appareil des démonstrations régulières sur lesquelles elle est fondée, son évidence propre l’établira suffisamment. Elle repose tout entière sur la distinction des formes diverses sous lesquelles se présente à nous la vérité. La voici dans sa généralité un peu sèche :
1° On peut apercevoir la vérité de deux manières différentes. Quelquefois on l’aperçoit dans telle ou telle circonstance particulière. Par exemple, en présence de deux pommes ou de deux pierres, et de deux autres objets semblables placés à côté des deux premiers, j’aperçois cette vérité de la plus absolue certitude que ces deux pierres et ces deux autres pierres font quatre pierres : c’est là l’aperception en quelque sorte concrète de la vérité, parce que la vérité nous y est donnée sur des objets réels et déterminés. Quelquefois aussi j’affirme d’une manière générale que deux et deux valent quatre, en faisant abstraction de tout objet déterminé : c’est la conception abstraite de la vérité.
Or, de ces deux manières de connaître la vérité, laquelle précède l’autre dans l’ordre chronologique de la connaissance humaine ? N’est-il pas certain et peut-il ne pas être avoué par tout le monde que le particulier précède le général, que le concret précède l’abstrait, que nous commençons par apercevoir telle ou telle vérité déterminée, dans tel ou tel cas, dans tel ou tel moment, dans tel ou tel lieu, avant de concevoir une vérité générale, indépendamment de toute application et des différentes circonstances de lieu et de temps ?
2° On peut apercevoir la même vérité sans se faire cette question : Pourrais-je ne pas admettre cette vérité ? On l’aperçoit alors par la seule vertu de l’intelligence qui nous a ôté départie et qui entre spontanément en exercice. Ou bien on essaye de mettre en doute la vérité qu’on aperçoit, on essaye de la nier ; on ne le peut, et alors elle se présente à la réflexion comme supérieure à toute négation possible ; elle nous apparaît, non plus seulement comme une vérité, mais comme une vérité nécessaire.
N’est-il pas évident aussi que nous ne débutons pas par la réflexion, que la réflexion suppose une opération antérieure, et que cette opération, pour n’être pas réfléchie et n’en pas supposer encore une autre avant elle, doit être entièrement spontanée ; qu’ainsi l’intuition spontanée et instinctive de la vérité précède sa conception réfléchie et nécessaire ?
La réflexion est un progrès plus ou moins tardif dans l’individu et dans l’espèce. C’est la faculté philosophique par excellence ; elle engendre tantôt le doute et le scepticisme, tantôt des convictions qui, pour être raisonnées, n’en sont que plus profondes. Elle bâtit les systèmes, elle crée la logique artificielle, et toutes ces formules dont nous nous servons aujourd’hui, à force d’habitude, comme si elles nous étaient naturelles. Mais l’intuition spontanée est la vraie logique de la nature. Elle préside à l’acquisition de presque toutes nos connaissances. L’enfant, le peuple, les trois quarts du genre humain ne la dépassent guère, et s’y reposent avec une sécurité illimitée.
La question de l’origine des connaissances humaines est ainsi résolue pour nous de la façon la plus simple : il nous a suffi de déterminer l’opération de l’esprit qui précède toutes les autres, sans laquelle nulle autre ne pourrait avoir lieu, et qui est le premier exercice et la première forme de notre faculté de connaître.
Puisque tout ce qui porte le caractère de la réflexion ne peut être primitif et suppose un état antérieur, il s’ensuit que les principes qui sont le sujet de notre étude n’ont pas pu posséder d’abord le caractère réfléchi et abstrait dont ils sont aujourd’hui marqués, qu’ils ont dû se montrer à l’origine dans quelque circonstance particulière, sous une forme concrète et déterminée, et qu’avec le temps ils s’en sont dégagés pour revêtir leur forme actuelle, abstraite et universelle. Voilà les deux extrémités de la chaîne ; il nous reste à rechercher comment l’esprit humain a été de l’une à l’autre, de l’état primitif à l’état actuel, de l’état concret à l’état abstrait.
Comment va-t-on du concret à l’abstrait ? Évidemment par cette opération bien connue qu’on nomme l’abstraction. Jusqu’ici rien de plus simple. Mais il faut distinguer deux sortes d’abstraction.