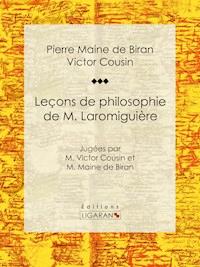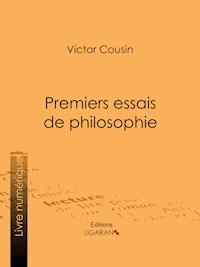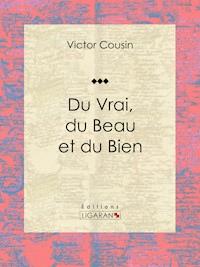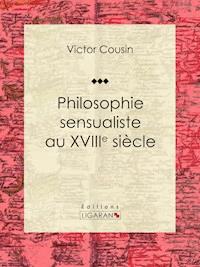
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "La philosophie sensualiste, avec le scepticisme plus ou moins profond qu'elle mène ordinairement à sa suite, se montra en France au début du six-huitième siècle, et s'y soutint même quelque temps, mais elle n'y fit jamais grande figure, et elle disparut assez vite dans les instincts de grandeur de ce siècle incomparable, dans la politique de Richelieu, dans la poésie de Corneille, surtout dans le spiritualisme hardi et sensé de Descartes."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087109
©Ligaran 2015
En 1816 et 1817, nous nous étions bien plus occupé de l’étude des problèmes philosophiques que de l’histoire même des systèmes. En 1818, notre effort avait été de recueillir et de coordonner les résultats de nos précédents travaux, et de constituer dans toutes ses parties la doctrine qui nous paraissait digne d’être offerte à la jeunesse du dix-neuvième siècle. Une fois en possession de cette doctrine, il nous restait à l’éprouver, à la développer et à l’affermir par l’histoire entière de la philosophie, surtout par l’histoire de la philosophie moderne, selon le titre et l’objet de la chaire qui nous était confiée. Voilà comment nous entreprîmes une histoire de la philosophie morale au dix-huitième siècle chez les nations les plus avancées de l’Europe. Le champ était vaste et pourtant circonscrit. Nous avions à faire paraître et à mettre en lumière des systèmes et des personnages célèbres, mais encore fort mal connus, par exemple Reid en Écosse, Kant en Allemagne ; et nous pouvions instituer contre les disciples français de Hobbes et de Locke de sérieuses et régulières polémiques, qui ne pouvaient manquer de porter leurs fruits dans notre jeune et cher auditoire. Nous avions choisi la philosophie morale, parce qu’à nos yeux la morale représente et juge toutes les autres parties de la philosophie, et qu’elle est la grande fin où celle-ci doit tendre pour répondre à son nom et servir l’humanité. Nous avions enfin choisi le dix-huitième siècle, parce que, tout en reconnaissant ce qu’il y a de vrai, de noble même dans les vœux et les tendances générales du siècle d’où nous sortons, nous nous proposions fermement de combattre et d’interrompre la tradition de matérialisme et d’athéisme, de haine aveugle du christianisme, de violence révolutionnaire à la fois et de servilité, qu’il nous a transmise, et qui, au début de la Restauration, pesait encore d’un poids fatal sur les esprits et sur les âmes, et faisait obstacle à l’établissement de la liberté aussi bien qu’à celui de la vraie philosophie.
L’Histoire de la philosophie morale au dix-huitième siècle a rempli deux années. Elle comprenait naturellement deux parties, deux grandes écoles ; l’une qui, en morale comme en métaphysique, ramène tout à la sensation, l’autre qui aspire à un principe plus élevé. Le premier semestre de 1819 fut consacré à l’école sensualiste ; le second semestre de la même année, à la philosophie écossaise ; et toute l’année 1820, à l’exposition et à la critique de la philosophie de Kant. Le présent volume contient le résumé de nos leçons sur la Philosophie sensualiste au dix-huitième siècle.
Dans ce résumé, la vivacité, la chaleur, la variété de l’improvisation ont péri sans doute, mais le fond même et le corps de l’enseignement subsistent. On s’y peut donner le spectacle instructif du mouvement et du progrès naturel de la philosophie sensualiste depuis les premiers éléments de sa métaphysique jusqu’à ses dernières applications morales et politiques. Les idées et leurs représentants, tout marche, tout avance, tout se déduit dans un ordre nécessaire. Dès qu’en métaphysique on n’admet pas d’autre principe de connaissance que la sensation, on est condamné à n’admettre aussi d’autre principe en morale que la fuite de la peine et la recherche du plaisir ; il n’y a plus ni bien ni mal en soi ; point d’obligation ; point de devoir, partant point de droit, excepté celui de l’habileté ou de la force ; et les nations, sans droits et sans dignité, comme les individus, s’agitent en vain à la poursuite de prétentions insensées, roulant sans cesse de l’anarchie au despotisme et du despotisme à l’anarchie. Nous croyons l’avoir démontré : on ne peut rompre un seul anneau de cette chaîne ; et quiconque ne se résigne pas aux désordres de la démagogie ou à la paix du despotisme doit remonter plus haut, et chercher ailleurs la sainte notion du devoir et du droit, la liberté et sa loi immortelle, la vertu, écrite de la main de Dieu dans l’âme humaine, mais que la conscience, et non pas la sensation, nous découvre. Ici les meilleures intentions du monde ne prévalent point contre la logique. Le sage, l’honnête mais trop sceptique Locke amène à sa suite le systématique et téméraire Condillac ; celui-ci, à son tour, fraye la route au fougueux et licencieux Helvétius, à l’élégant et froid Saint-Lambert, auxquels succèdent les théoriciens de l’anarchie et ceux du pouvoir absolu que, pour éviter toute apparence de polémique contemporaine, nous avons personnifiés tous ensemble et pris à tâche de réfuter et de détruire dans leur précurseur et leur modèle du dix-septième siècle, le puissant et conséquent auteur du traité De la nature humaine et du traité Du citoyen.
Nous l’avouons : nous aimons à nous rappeler le sérieux succès des leçons de cette époque, parce que ce succès venait bien moins du mérite du professeur que des favorables dispositions du temps et de l’auditoire. La France alors se relevait noblement des désastres de l’Empire, et elle avait presque retrouvé l’enthousiasme de 1789 pour la nouvelle et vraie liberté, apportée par la Charte. Il y avait dans l’air un souffle généreux qui du gouvernement et de la tribune nationale se communiquait aux écoles. M. Royer-Collard, à la Chambre des députés, guidait encore de sa parole magistrale et soutenait son jeune suppléant. Oui, pourquoi ne le dirions-nous pas nous-même, puisqu’ici nous n’avons guère été qu’un disciple zélé et persévérant ? c’est l’enseignement sévère et animé de ces deux années qui acheva de briser parmi nous le joug de la philosophie sensualiste, sans tomber dans les folies rétrogrades de M. de Bonald, de M. de Maistre et de l’abbé de Lamennais. L’école sensualiste le sait bien : c’est pourquoi ses rares adeptes nous poursuivent encore d’une haine fidèle, ne se doutant pas que leurs injures viennent à propos couronner notre carrière, comme aussi nous ne nous étonnons point d’autres calomnies, parties d’un côté différent. Voilà en effet quarante années que nous marchons à travers deux sortes d’adversaires, qui s’imaginent nous nuire, et qui nous servent, en nous maintenant par leurs accusations opposées dans la ligne droite et la juste mesure, entre les excès d’une liberté extravagante et d’une soumission pusillanime. Nous suivrons donc en paix notre route, les yeux toujours fixés sur le grand but que nous nous sommes proposé de bonne heure ; nous demeurerons ce que nous fûmes, en tâchant de nous perfectionner sans cesse, jusqu’à ce que la force et non la volonté nous abandonne. Les obscures attaques du scepticisme et du matérialisme aux abois ne nous dégoûteront pas de notre vieil attachement à la cause de la liberté de l’esprit humain et des sociétés humaines ; et nous continuerons, n’en déplaise à M. l’évêque de Poitiers, en dépit de ses mandements d’aujourd’hui et de ses mandements d’autrefois, à prêcher l’accord si naturel, si désirable, et qui, grâce à Dieu, se répand chaque jour davantage, du christianisme et de la philosophie.
V. COUSIN.
1er décembre 1853.
Locke est le père de la philosophie française du dix-huitième siècle. – Méthode de Locke. – Mérite de cette méthode. Locke la fausse dans l’application en recherchant l’origine des connaissances avant d’avoir étudié leurs caractères actuels. – Système de Locke sur l’origine des idées. – De la table rase. – Sensation et réflexion. – Que ces deux facultés ne rendent pas compte des principes universels et nécessaires, ni d’un grand nombre d’idées, telles que l’idée d’espace, de durée, d’infini. – Théorie des signes. – Théorie des idées images. – Opinion de Locke sur l’existence de Dieu. – Sur l’âme. – Sur la liberté. – Sur le bien et le mal.
La philosophie sensualiste, avec le scepticisme plus ou moins profond qu’elle mène ordinairement à sa suite, se montra en France au début du dix-septième siècle, et s’y soutint même quelque temps, mais elle n’y fit jamais grande figure, et elle disparut assez vite dans les instincts de grandeur de ce siècle incomparable, dans la politique de Richelieu, dans la poésie de Corneille, surtout dans le spiritualisme hardi et sensé de Descartes. L’épicurisme de Gassendi ne sortit pas d’un très petit cercle, et le cartésianisme entraîna tous les esprits d’élite, depuis les solitaires de Port-Royal jusqu’à madame de Sévigné. Et, comme la France succédait alors à l’Espagne dans la suprématie de l’Europe, par cette raison et par bien d’autres plus intimes et plus profondes, Descartes ne fut pas seulement le précepteur de la France, il le fut de l’Europe entière. La philosophie cartésienne suivit partout l’influence française, et se répandit en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Mais, quand les fautes et les revers de Louis XIV eurent renversé l’ouvrage de Richelieu et de Mazarin et transporté l’ascendant moral à Guillaume III et à l’Angleterre, on vit peu à peu, à la suite de nos désastres et dans la décadence de nos mœurs et de notre génie, une philosophie étrangère pénétrer parmi nous et remplacer la grande philosophie nationale de l’âge précédent. Il faut bien le reconnaître : Locke a été le philosophe du dix-huitième siècle comme Descartes avait été celui du dix-septième. La nouvelle doctrine convenait trop bien à la société nouvelle pour ne pas s’y naturaliser aisément. Elle y prit racine, et s’y développa avec une force toujours croissante, imprimant son caractère à toutes choses, à la morale, aux arts, à la littérature, trop souvent même à la politique. Grâce à une longue domination, elle est si bien entrée dans nos habitudes, qu’elle semble un fruit de l’esprit français, tandis qu’en réalité elle est étrangère. La philosophie spiritualiste de Descartes est née spontanément des entrailles de la France. La philosophie sensualiste du dix-huitième siècle est une plante anglaise acclimatée sous le ciel de la régence et de la cour de Louis XV. Avant donc de suivre cette philosophie dans les développements qu’elle a pris chez nous, il la faut étudier dans son berceau, dans sa patrie véritable, dans cette Angleterre, le pays de l’expérience et du sens réel, qui devait produire, et qui a produit en effet, l’école empirique et sensualiste, et donné Locke à la France et à l’Europe. Cette première leçon sera consacrée tout entière à l’examen du livre célèbre appelé à devenir l’Évangile de la philosophie en France dans tout le cours et jusqu’à la fin du dix-huitième siècle.
Hâtons-nous de le dire à l’honneur de la France et de Descartes : Locke est, jusqu’à un certain point, un élève de notre grand compatriote. Ni Bacon ni Hobbes ne paraissent avoir exercé sur lui aucune influence ; c’est Descartes, Locke lui-même nous l’apprend, qui l’a attiré vers la philosophie ; c’est l’impulsion cartésienne qu’il a suivie, tout en lui donnant une autre direction. Le Discours de la méthode et les Méditations ont produit à la fois, en des sens contraires, Locke et Malebranche, qui sont les deux véritables antagonistes. Le principe cartésien, Je pense, donc je suis, proposé comme l’unique et nécessaire point de départ de toute philosophie, commence ou renouvelle l’ère de la psychologie. Le doute méthodique est déjà une critique de nos facultés. La gloire de Descartes est d’avoir substitué aux principes abstraits de l’école un principe vivant puisé à la source de l’observation la plus intime : pensée profonde qui établit la certitude de l’existence de l’âme et de l’existence de Dieu sur l’irréfragable autorité de la conscience. Les premiers pas de Descartes dans cette voie nouvelle sont admirables, mais il ne s’y soutient pas toujours, et la vieille logique reprend souvent le dessus. Malebranche abonde en observations ingénieuses sur la nature humaine, sur les sens, sur l’imagination, sur les passions, sur l’entendement ; mais toute cette psychologie est disséminée çà et là dans les ouvrages de l’illustre oratorien ; elle n’est point le fondement de son entreprise ; au contraire, la conscience ne lui est qu’une lumière obscure et infidèle. Toute vraie clarté est pour lui dans les idées. De là les brillantes et chimériques hypothèses des causes occasionnelles et de la vision en Dieu. Ces hypothèses, transportées en Angleterre, en choquant le bon sens de Locke, ne contribuèrent pas peu à le jeter dans l’extrémité opposée. Aux exagérations de l’idéalisme il opposa le contrepoids de l’empirisme ; il combattit la vision en Dieu renouvelée par Norris, et sa polémique contre les idées innées a du moins le mérite de rappeler la philosophie à l’expérience.
L’Essai sur l’entendement humain est, à nos yeux, le premier traité régulier de psychologie. Il n’y a pas de livre qui laisse dans l’âme de ses lecteurs de plus salutaires impressions, de plus aimables souvenirs. Où trouver plus de bonne foi dans la recherche de la vérité, plus de sagesse dans les jugements généraux, plus de sagacité et de finesse dans les observations de détail, plus de clarté, de simplicité, de vrai atticisme dans le style, un esprit plus libre au milieu des gènes d’un système, plus de bienveillance et d’aménité jusque dans les plaisanteries qui lui échappent parfois contre ses adversaires ? Et pourtant, comment se fait-il qu’à mesure qu’on réfléchit sur les problèmes psychologiques ce livre si sincère, si lumineux, si bien fait pour gagner les esprits, se couvre d’ombres d’autant plus épaisses qu’on le médite davantage, et qu’il s’obscurcisse au point de devenir le texte des interprétations les plus contradictoires ?
Il y a de cela plusieurs raisons. La première, la plus forte, est que, dans Locke, le philosophe et l’homme sont aux prises. L’homme se montre partout plein de modestie, n’abondant pas dans son sens, et se renfermant volontiers dans les limites de l’observation. Le philosophe est, dès le début de ses recherches, sous le joug d’une théorie étroite et fausse qui lui impose les défauts les plus contraires à sa nature. En outre, ainsi que Locke le reconnaît lui-même, il n’était en état de bien composer son ouvrage que quand il l’eut fini ; mais il n’eut pas le courage de refaire sa première ébauche.
On s’aperçoit aisément que l’Essai sur l’entendement humain, écrit dans les langueurs d’une vie maladive et parmi les orages d’une carrière agitée, ne porte pas le sceau d’une force égale. Il y a tel passage où l’on sent défaillir la main de l’auteur. Il ne faut donc pas s’étonner que, tout en conservant la couleur et l’empreinte habituelle d’un esprit original, très juste et très fin, le livre de Locke manque d’unité et soit rempli d’inconséquences.
Nous n’entreprenons pas d’analyser en détail l’Essai sur l’entendement humain ; notre tâche se bornera à faire connaître sa méthode, ses principes, et les idées morales qui s’en déduisent nécessairement.
Locke trace en peu de mots la méthode qu’il veut suivre. L’analyse des facultés de l’entendement, dans le dessein d’appliquer plus tard ces facultés à la recherche de la vérité, voilà l’objet qu’il se propose : ce n’est pas moins, on le voit, que la psychologie érigée en méthode, et prescrite comme point de départ et comme règle de toute philosophie. Locke, ainsi qu’il le raconte, s’était souvent aperçu que, faute d’avoir reconnu la puissance naturelle des facultés dont on se sert pour atteindre la vérité, on s’engage et on se perd dans des recherches sans issue. Préface : « S’il était à propos de faire ici l’histoire de cet essai, je vous dirais que cinq ou six de mes amis, s’étant assemblés chez moi et venant à discourir sur un sujet fort différent de celui-ci, se trouvèrent bientôt arrêtés par les difficultés qui s’élevèrent de différents côtés. Après nous être fatigués quelque temps, sans nous trouver plus en état de résoudre les doutes qui nous embarrassaient, il me vint dans l’esprit que nous prenions un mauvais chemin, et qu’avant de nous engager dans ces sortes de recherches il était nécessaire d’examiner notre propre capacité et de voir quels objets sont à notre portée ou au-dessus de notre compréhension. » – Et ailleurs : « Si nous en usions de la sorte (c’est-à-dire si nous examinions la nature de l’entendement), nous ne serions peut-être pas si empressés, par un vain désir de connaître toutes choses, à exciter incessamment de nouvelles questions, à nous embarrasser nous-mêmes et à engager les autres dans des disputes sur des sujets qui sont tout à fait disproportionnés à notre entendement, et dont nous ne saurions nous former des idées claires et distinctes, ou même, ce qui n’est peut-être arrivé que trop souvent, dont nous n’avons absolument aucune idée. Si donc nous pouvons découvrir jusqu’où notre entendement peut porter sa vue… nous apprendrons à nous contenter des connaissances auxquelles notre esprit est capable de parvenir, dans l’état où nous nous trouvons dans ce monde. »
Nous ne saurions trop applaudir à une pareille méthode : elle est la vraie méthode philosophique. Mais Locke y est-il resté fidèle ? Après un tel début il se jette dans la question de l’origine des idées, il se demande d’abord comment l’esprit vient à acquérir des idées.
Essai sur l’entendement humain, liv. II, ch. Ier. « Chaque homme étant convaincu en lui-même qu’il pense, et ce qui est dans son esprit, lorsqu’il pense, étant des idées qui l’occupent actuellement, il est hors de doute que les hommes ont plusieurs idées dans l’esprit, comme celles qui sont exprimées par ces mots : blancheur, dureté, douceur, pensée, mouvement, hommes, éléphant, armée, meurtre, et plusieurs autres. Cela posé, la première chose qui se présente à examiner c’est comment l’homme vient à avoir toutes ces idées. »
Mais chercher d’où viennent nos idées, avant de reconnaître quelles elles sont, n’est-ce pas fausser la méthode d’observation ? On pourrait dire à Locke : une théorie quelconque sur l’origine des idées a toujours besoin d’être confirmée par l’analyse même des idées. Puisqu’il faut toujours recourir à l’analyse, n’est-il pas plus simple et plus sûr de commencer par elle ? L’origine que vous assignez aux connaissances humaines doit en rendre compte : pourquoi donc ne les pas étudier telles qu’elles sont aujourd’hui, avant de rechercher ce qu’elles furent au début de l’intelligence ? N’oubliez pas la règle de Descartes qui recommande les dénombrements exacts et complets de faits authentiques avant de songer à aucune théorie ; et, outre cette règle précise, rappelez-vous la maxime générale de Bacon : C’est du plomb et non des ailes qu’il faut donner à l’intelligence.
Une saine psychologie ne descend pas hypothétiquement de l’origine des idées aux idées elles-mêmes ; mais elle remonte des idées à leur origine ; elle ne va pas des facultés de l’esprit aux actes qu’elles produisent, mais des actes réels aux facultés qu’ils supposent invinciblement. La vraie méthode veut qu’on observe l’effet pour en induire la cause, et non pas qu’on suppose la cause pour en déduire l’effet. Ainsi on procède dans les sciences physiques. On ne débute pas par imaginer les lois qui régissent les phénomènes naturels, sauf à vérifier ensuite ces phénomènes ; on observe les phénomènes et on les étudie sous toutes leurs faces, en variant par l’expérimentation les circonstances où ils se produisent ; puis on conclut à l’existence d’une loi ou d’une propriété générale. De même, en histoire naturelle, on n’établit pas d’avance une classification, mais on étudie d’abord les individus ; puis, quand on a bien constaté et décrit leurs caractères extérieurs et intérieurs, on essaye de les classer.
La méthode expérimentale n’est pas seulement la plus simple et la plus naturelle, elle est aussi la plus certaine. Si on pose d’abord une théorie et qu’on s’adresse ensuite aux faits pour la vérifier, il est bien difficile qu’on les considère avec sincérité et impartialité. Tout système préconçu est cher à son auteur ; on interroge les faits avec une certaine disposition à les accommoder au système, à les modifier, à les mutiler s’ils le gênent, à les nier s’ils le détruisent. L’histoire de la philosophie est riche en exemples de ce genre. Locke, malgré toute sa bonne foi, n’a pu échapper aux tentations de l’esprit de système, et s’arrêter sur la pente où le plaçait une méthode vicieuse.
Il commence par rejeter absolument la doctrine des idées innées.
« Il y a des gens, dit-il, qui supposent comme une vérité incontestable qu’il y a certains principes, certaines notions primitives, autrement appelées notions communes, empreintes et gravées pour ainsi dire dans notre âme, qui les reçoit dès le premier moment de son existence et les apporte au monde avec elle. Si j’avais affaire à des lecteurs dégagés de tout préjugé, je n’aurais, pour les convaincre de la fausseté de cette supposition, qu’à leur montrer que les hommes peuvent acquérir toutes les connaissances qu’ils ont par le simple usage de leurs facultés naturelles, sans le secours d’aucune impression innée, et qu’ils peuvent arriver à une entière certitude de certaines choses sans avoir besoin d’aucune de ces notions naturelles ou de ces principes innés ; car tout le monde, à mon avis, doit convenir sans peine qu’il serait ridicule de supposer, par exemple, que les idées des couleurs ont été imprimées dans l’âme d’une créature à qui Dieu a donné la vue et la puissance de recevoir les idées par l’impression que les objets extérieurs feraient sur ses yeux. Il ne serait pas moins absurde d’attribuer à des impressions naturelles et à des caractères innés la connaissance que nous avons de plusieurs vérités, si nous pouvons remarquer en nous-mêmes des facultés propres à nous faire connaître ces vérités avec autant de facilité et de certitude que si elles étaient originairement gravées dans notre âme. » Liv. Ier, chap. Ier.
Jusque-là Locke est dans le vrai. Mais il va beaucoup plus loin : de ce qu’il n’y a point d’idées innées, il en conclut qu’il n’y a rien d’inné, et que l’esprit est une table rase. « Supposons donc qu’au commencement l’âme est ce qu’on appelle une table rase, c’est-à-dire vide de caractères. » ibid.
Ainsi l’esprit est primitivement vide d’idées ; il s’enrichit de toutes les idées qu’il possède aujourd’hui par l’expérience. L’expérience est extérieure et intérieure, à savoir la sensation proprement dite et la réflexion. La réflexion nous suggère les idées des opérations de l’âme ; la sensation est la source de toutes les autres idées.
Le sensualisme n’est-il pas déjà dans cette proposition : « L’esprit est une table rase ; l’esprit est vide ; et c’est la sensation qui le remplit ? » Locke ajoute : « La réflexion ne rend que ce qu’elle a reçu de la sensation. »
Il est bien vrai que l’esprit est primitivement une table rase en ce sens qu’aucun caractère n’y est inscrit avant l’expérience ; mais ce n’est point une table rase en cet autre sens qu’il soit une simple capacité passive, recevant tout du dehors sans rien y mettre du sien, ou même un principe actif dont l’unique fonction soit de réfléchir ce qu’il a pu recevoir de la sensation. L’esprit n’est pas si nu et si pauvre ; antérieurement à toute sensation, il est riche de facultés, d’instincts, de lois, de principes de toute sorte. Tout cela constitue déjà une machine intelligente et puissante. La sensation ne crée pas cette machine ; elle la met en mouvement. Ou il faut aller plus loin que Locke dans la voie qu’il a ouverte, et soutenir que la sensation n’est pas seulement le principe de nos idées, mais celui de nos facultés et par conséquent de l’esprit lui-même ; ou il faut admettre avec Leibnitz l’innéité de l’esprit, celle des facultés et des lois inhérentes à ces facultés, c’est-à-dire une source intérieure d’idées qui jaillit aussitôt que la sensation la sollicite. Leibnitz a dit avec profondeur et avec vérité : « L’esprit n’est point une table rase ; il est tout plein de caractères que la sensation ne peut que découvrir et mettre en lumière au lieu de les y imprimer. Je me suis servi de la comparaison d’une pierre de marbre qui a des veines, plutôt que d’une pierre de marbre tout unie ou de tablettes vides ; car, si l’âme ressemblait à ces tablettes vides, les vérités seraient en nous comme la figure d’Hercule est dans un bloc de marbre, quand il est tout à fait indifférent à recevoir ou cette figure ou quelque autre. Mais, s’il y avait dans la pierre des veines qui marquassent la figure d’Hercule préférablement à d’autres figures, cette pierre y serait plus déterminée, et Hercule y serait comme inné en quelque façon, quoiqu’il fallût du travail pour découvrir ces veines et pour les nettoyer en retranchant ce qui les empêche de paraître. C’est ainsi que les vérités nous sont innées comme des inclinations, des dispositions, des habitudes ou des virtualités naturelles, et non pas comme des actions, quoique ces virtualités soient toujours accompagnées de quelques actions, souvent insensibles, qui y répondent. » Nouveaux essais sur l’entendement.
Locke, en faisant à l’esprit une part trop petite dans l’origine et la formation des idées, est par là forcé ou de nier des idées très réelles, tout à fait incontestables, ou d’en altérer le caractère.
Il est un certain nombre de vérités universelles et nécessaires qui, portant avec elles le caractère de l’évidence, ne se démontrent pas et deviennent au contraire les principes de toute démonstration ; par exemple : tout phénomène suppose une cause, tout moyen suppose une fin, l’homme doit faire ce qu’il croit juste. Eh bien, ces principes dont l’esprit fait un si fréquent usage, Locke les passe sous silence, ou il n’en parle que très vaguement (liv. Ier et liv. IV) ; il finit par les confondre avec les axiomes de la logique, qu’il ne signale que pour les nier ; et, à vrai dire, il ne pouvait faire autrement. En effet, il était impossible d’accepter les axiomes comme universels et nécessaires et de les attribuer à l’expérience. Tout ce qu’il y avait à faire était de les convertir en de pures abstractions verbales, ce qui équivaut à les nier. Ainsi a fait notre auteur ; il trouve que ces axiomes dont on fait tant de bruit sont des formules absolument stériles. « Ces maximes générales, dit-il, sont d’un grand usage dans les disputes pour fermer la bouche aux chicaneurs ; mais elles ne contribuent pas beaucoup à la découverte de la vérité inconnue, ou à fournir à l’esprit le moyen de faire de nouveaux progrès dans la recherche de la vérité. Car quel homme a jamais commencé par prendre pour base de ses connaissances cette proposition générale : Ce qui est, est ; ou : Il est impossible qu’une chose soit et ne soit pas en même temps ? » Et plus loin : « Je voudrais bien savoir quelles vérités ces propositions peuvent nous faire connaître par leur influence, que nous ne connussions pas auparavant ou que nous ne pussions connaître sans leur secours. Tirons-en toutes les conséquences que nous pourrons ; ces conséquences se réduiront toujours à des propositions identiques ; et toute l’influence de ces maximes, si elles en ont aucune, ne tombera que sur ces sortes de propositions. » Liv. IV. chap. VII, § 11.
À cela il faut répondre qu’il ne s’agit pas seulement de l’axiome : Ce qui est, est ; ou de cet autre dont Locke parle ailleurs : Le tout est plus grand que la partie. Ces axiomes ne sont point aussi méprisables que Locke veut bien le dire. Mais il s’agit, avant tout, de ces principes que nous avons mille fois rappelés, par exemple, le principe de causalité ou celui des causes finales. Comment Locke pourrait-il soutenir que ces deux principes sont de peu d’usage ? Sans le principe de causalité, la vie humaine serait bouleversée ; il n’y aurait plus de science, car il n’y aurait plus de recherche ; on s’en tiendrait aux faits sans demander leurs causes. Distinguons bien le principe en lui-même de la forme qu’il revêt dans l’école. Personne, excepté le logicien, ne recherche les causes au nom du principe abstrait de causalité ; mais tous les hommes possèdent ce principe sans s’en rendre compte, encore bien moins sans connaître sa forme logique ; c’est une loi de l’esprit qui le gouverne et qu’il applique naturellement et irrésistiblement. Nulle part Locke ne cite ni le principe de causalité, ni nul autre principe nécessaire, pas même pour les combattre. Ce n’était pas ignorance ; c’était donc cette triste habileté à laquelle est condamné tout faiseur de système à l’égard des faits qui l’embarrassent : il les nie ou les néglige.
Locke écarte les principes universels et nécessaires qui le gênent le plus. Pour d’autres idées qu’il ne peut écarter de même, il les dénature afin de les ramener à l’expérience, par exemple, les idées d’espace, de temps, d’infini.
Voici, selon Locke, l’origine de l’idée d’espace :
« Nous acquérons l’idée d’espace par la vue et l’attouchement ; ce qui est, ce me semble, d’une telle évidence, que… ». Liv. II, chap. XIII, § 2.
« Il est certain que nous avons l’idée du lieu par les mêmes moyens que nous acquérons celle de l’espace, dont le lieu n’est qu’une considération particulière, bornée à certaines parties, je veux dire par la vue et l’attouchement. » Ibid., § 10.
Rien n’est plus clair : les sens, et les sens seuls, nous donnent l’idée d’espace et celle de lieu qui sont entre elles dans le rapport du plus au moins. Pour cela il faut confondre l’idée de l’espace et celle de corps.
« Que si l’on dit que l’univers est quelque part, cela n’emporte dans le fond autre chose, si ce n’est que l’univers existe. »
Ainsi, dire que l’univers est quelque part, et dire qu’il est, c’est la même chose. Donc le lieu qui contient l’univers n’est pas distinct de l’univers lui-même, et l’idée d’espace se réduit à celle de corps.
Mais une telle confusion est inadmissible.
Quand je perçois un corps, je le conçois et ne puis pas ne pas le concevoir dans un lieu : je le distingue donc de ce lieu. Je puis supprimer ce corps par la pensée ; mais, quelque effort que je fasse, je ne puis venir à bout de supprimer l’espace qui le contient. Je conçois un espace vide de corps ; je ne conçois pas un corps qui ne serait nulle part. La notion de corps est une notion relative et contingente ; car, quelque corps que vous me donniez, je puis toujours supposer qu’il n’est pas. La notion d’espace est une notion nécessaire ; car il m’est impossible de la chasser de mon esprit. De plus, je me représente le corps ; je le comprends sous une forme déterminée ; il affecte mes sens, il résiste à ma main, il charme ou il blesse ma vue il résonne à mon oreille. L’espace au contraire est quelque chose d’impalpable et d’invisible ; nulle forme ne me le représente ; quand j’essaye de l’embrasser, il m’échappe sans cesse, et mon imagination ne trouve à sa place qu’un simulacre de corps. Enfin, je conçois le corps comme quelque chose de fini et de divisible, l’espace comme quelque chose d’infini et d’indivisible.
Locke lui-même, par une de ces contradictions si fréquentes dans son ouvrage, distingue ailleurs à merveille le corps et l’espace.
Liv. II, chap XIV, § 5 : « Il y a bien des gens, au nombre desquels je me range, qui croient avoir des idées claires et distinctes du pur espace et de la solidité, et qui s’imaginent pouvoir penser à l’espace sans y concevoir quoi que ce soit qui résiste ou qui soit capable d’être poussé par aucun corps. C’est là, dis-je, l’idée de l’espace pur, qu’ils croient avoir aussi nettement dans l’esprit que l’idée qu’on peut se former de l’étendue du corps ; car l’idée de la distance qui est entre les parties opposées d’une surface concave est tout aussi claire, selon eux, sans l’idée d’aucune partie solide qui soit entre elles, qu’avec celle idée. D’un autre côté, ils se persuadent qu’outre l’idée de l’espace pur, ils en ont une autre tout à fait différente de quelque chose qui remplit cet espace, et qui peut en être chassé par l’impulsion de quelque autre corps ou résister à ce mouvement. Que s’il se trouve d’autres gens qui n’aient pas ces deux idées distinctes, mais qui les confondent et des deux n’en fassent qu’une, je ne vois pas que des personnes qui ont la même idée sous différents noms, ou qui donnent les mêmes noms à des idées différentes, puissent s’entretenir ensemble ; pas plus qu’un homme qui n’est ni aveugle ni sourd, et qui a des idées distinctes de la couleur nommée écarlate et du son de la trompette, ne pourrait discourir de l’écarlate avec l’aveugle dont je parle ailleurs, qui s’était figuré que l’idée de l’écarlate ressemblait au son de la trompette. »
Locke reconnaît donc la différence de l’idée de corps et de l’idée d’espace ; il la reconnaît avec son bon sens dès qu’il ne songe plus à son système ; mais, dès que le système revient, il force Locke de nier cette différence, afin de ramener l’idée d’espace à la même origine que celle de corps, à l’expérience sensible.
Une semblable cause condamne Locke à confondre l’idée de temps et l’idée de succession : « Que la notion que nous avons de la succession et de la durée vienne de cette source, je veux dire de la réflexion que nous faisons sur cette suite d’idées que nous voyons paraître l’une après l’autre dans notre esprit, c’est ce qui me semble suivre évidemment de ce que nous n’avons aucune perception de la durée qu’en considérant cette suite d’idées qui se succèdent les unes aux autres dans notre entendement. En effet, dès que cette succession d’idées vient à cesser, la perception que nous avons de la durée cesse aussi, comme chacun l’éprouve clairement par lui-même lorsqu’il vient à dormir profondément ; car, qu’il dorme une heure, un jour ou même une année, il n’a aucune perception de la durée des choses tandis qu’il dort ou qu’il ne songe à rien. Cette durée est alors tout à fait nulle à son égard, et il lui semble qu’il n’y a aucune différence entre le moment où il a cessé de penser en s’endormant et celui où il commence à penser de nouveau. Et je ne doute pas qu’un homme éveillé n’éprouvât la même chose s’il lui était alors possible de n’avoir qu’une idée dans l’esprit, sans qu’il lui arrivât aucun changement à cette idée et qu’aucune autre vînt à lui succéder. »
Nous pouvons opposer à cette nouvelle confusion les mêmes difficultés qu’à celle de l’espace et du corps.
La succession suppose la durée ; elle n’est point la durée elle-même. Pouvez-vous concevoir la succession de deux idées qui n’aurait pas lieu dans un certain temps ? De même que les corps sont dans l’espace, de même les évènements se succèdent dans le temps ; nous pouvons faire abstraction des évènements comme des corps ; mais nous ne pouvons pas plus supprimer la durée dans laquelle ces évènements se succèdent, que l’espace dans lequel ces corps sont contenus.
La succession est quelque chose de contingent et de fini ; car les choses qui se succèdent passent et cessent d’être. La durée ne passe pas ; elle est toujours la même, et elle n’a pas de bornes.
Si la succession et le temps sont la même chose, la mesure du temps devient le temps lui-même. La succession de nos pensées est plus ou moins rapide, selon l’état de notre esprit ; elle n’est pas la même chez moi que chez vous. Il faudrait en conclure que la durée n’est pas la même pour tous les hommes ; que d’un point déterminé du temps à un autre il ne s’écoule pas pour tous les hommes un même temps, que dans le sommeil nous ne durons pas, que le temps s’arrête et renaît avec l’activité de notre esprit. Telles seraient les conséquences absurdes de la confusion de la succession et de la durée.
Une autre idée que Locke ne dénature pas moins pour la faire entrer forcément dans son système, c’est l’idée de l’infini.
De même qu’il a réduit l’espace au corps, la durée à la succession, Locke réduit l’infini à l’indéfini.
Il accuse d’abord la notion d’infini d’être une notion obscure et vague. Mais peu importe que cette notion soit obscure ou ne le soit pas ; ce qui importe, c’est de savoir si elle est ou si elle n’est pas dans l’esprit de l’homme, sauf à la philosophie à l’éclaircir.
Ensuite il prétend que l’idée de l’infini est une idée négative. Liv. II, c. XVII, § 13 : « Nous n’avons point d’idée positive de l’infini. » § 16 : « Nous n’avons point d’idée positive d’une durée infinie. » § 18 : « Nous n’avons point d’idée positive d’un espace infini. »
Ainsi voilà l’infini réduit à n’être qu’une négation, et une négation du fini. C’est être, en vérité, bien esclave de la forme matérielle du mot. Fénelon relève avec raison cette illusion d’une métaphysique vulgaire. De l’existence de Dieu : « La négation redoublée vaut une affirmation, d’où il s’ensuit que la négation absolue de toute négation est l’expression la plus positive qu’on puisse concevoir et la suprême affirmation ; donc le terme d’infini est infiniment affirmatif par sa signification, quoiqu’il paraisse négatif par de tour grammatical. »
Selon Locke, l’idée d’infini n’est qu’une négation ; et, quand on veut s’en former une idée positive, il faut la résoudre dans l’idée de nombre : « Le nombre nous donne la plus nette idée de l’infini… De toutes les idées qui nous fournissent l’idée de l’infinité telle que nous sommes capables de l’avoir, il n’y en a aucune qui nous en donne une idée plus nette et plus distincte que celle du nombre, comme nous l’avons déjà remarqué ; car, lors même que l’esprit applique l’idée d’infinité à l’espace et à la durée, il se sert d’idées de nombre répété, comme de millions de lieues ou d’années, qui sont autant d’idées distinctes que le nombre empêche de tomber dans un confus entassement où l’esprit ne saurait éviter de se perdre. »
Mais le nombre n’est pas plus l’infini que la succession n’est le temps ni le corps l’espace. Le nombre est quelque chose de toujours inachevé et en même temps de toujours fini. Car le nombre en soi n’est pas : ce qui est c’est tel ou tel nombre. À quelque nombre que vous arrêtiez la série des nombres, vous n’avez jamais qu’un nombre déterminé qui supposera toujours, avant ou après, quelque nombre que vous pouvez y ajouter ou en retrancher. Le fini, en tant qu’on peut toujours le diviser ou multiplier, c’est l’indéfini. L’indéfini se résout donc dans le fini. Mais il n’en est point ainsi de l’infini, qui n’augmente ni ne diminue. L’indéfini est divers et multiple, l’infini est un. L’indéfini est une abstraction ; car rien de ce qui existe véritablement n’est indéterminé. Le fini est déterminé et réel : l’infini l’est aussi : il l’est même en quelque sorte davantage, puisqu’il est la condition du fini. Ôtez l’espace et le temps infini, il n’y a point de corps ni de succession finie possible. Le fini est l’objet des sens ou de la conscience, l’indéfini est celui de l’imagination ; l’infini ne peut être ni senti ni imaginé : il est conçu, il est l’objet de la raison seule.
Il est donc absurde de ramener à une seule et même origine deux notions si différentes.
Nous ne pousserons pas plus loin l’examen de la théorie de Locke sur l’origine de nos idées. Arrêtons-nous maintenant sur quelques points accessoires, mais qui ont pris une grande importance entre les mains des successeurs du philosophe anglais : je veux parler de ses deux théories du langage et des idées représentatives.
Locke, comme toute l’école sensualiste, s’occupe beaucoup du langage, et la partie de son livre qu’il y a consacrée est sans contredit une des meilleures, avec celle où, d’une manière aussi sûre qu’originale, il trace la ligne de démarcation qui sépare les qualités premières et les qualités secondes, et prouve que le tact seul fait connaître l’étendue. Il faut lui savoir gré d’une foule d’observations justes et ingénieuses sur la signification des mots, sur leurs rapports avec la pensée, sur l’utilité des termes généraux, et aussi sur leurs abus. Le langage a deux effets : il communique la pensée, et par là il est le lien de la société et l’instrument de ses progrès ; de plus, il analyse naturellement la pensée ; il lui donne à la fois de la succession et de la fixité ; il la rend plus présente, plus précise et plus claire. À l’aide des signes, nous arrivons à nous rendre compte des éléments derniers de nos idées et de nos sentiments ; nous pouvons séparer et mieux connaître ce que la réalité offre ensemble et confusément, ou nous orienter dans cette infinité d’individus qui nous environnent, en les réunissant, suivant leur ressemblance, sous des noms généraux. L’importance du langage se prouve autant par ses abus que par ses heureux effets. Si le mot soutient la pensée, quelquefois aussi il la masque et trompe celui qui s’en sert et croit posséder une idée quand souvent il joue avec un mot. Le mot ne correspond pas toujours dans tous les hommes à la même idée ; de là ces consentements apparents de tous à une même idée, qui ne sont autre chose que des consentements à un terme reçu et que nul ne définit ; de là ces préjugés qui viennent de mots appris dès l’enfance ou puisés dans les écoles ; enfin, toutes ces querelles qui se termineraient d’un coup, si chacun, fidèle à la règle de Pascal, commençait par bien expliquer le sens des mots qu’il emploie.
Au milieu des conseils les plus sages, relevons deux exagérations, deux erreurs longtemps célébrées comme de grandes découvertes.
Locke, comme son devancier Hobbes et son disciple Condillac, est positivement nominaliste : « Ce qu’on appelle général ou universel, dit-il, n’appartient pas à l’existence réelle des choses ; mais c’est un ouvrage de l’entendement qu’il fait pour son propre usage, et qui se rapporte uniquement aux signes. » Si Locke ne veut parler que de ces idées générales que nous appelons collectives, et qui ne sont que des abstractions, il a raison, après mille autres, de ne pas vouloir accepter cette foule d’entités verbales dont certains réalistes du Moyen Âge encombraient la nature. Il n’y a point de couleur en soi, d’arbre en soi ; il y a des couleurs diverses, des arbres divers. Ces arbres, ces couleurs, ont des qualités communes sans contredit ; autrement il serait absurde de les ranger dans une même classe ; mais ces qualités sont individuelles : elles ont tel ou tel caractère dans chaque être particulier ; elles ne constituent pas un type, une essence distincte, un être réel. Mais, quand Locke prétend qu’il n’y a point d’autres idées générales que celles-là, il se trompe profondément ; il y a des idées universelles et nécessaires qui ne sont pas l’ouvrage arbitraire de l’esprit, et qui ne se rapportent pas seulement à des signes, mais à des choses. L’espace et la durée, par exemple, ne sont pas de pures abstractions, de purs noms. Il n’y a pas seulement sous ces noms tels espaces particuliers, telles durées particulières ; l’espace et le temps ne sont pas la simple réunion par l’esprit de tout ce qu’il y a de commun dans les différents espaces ou les différentes durées. Non, le temps et l’espace contiennent tous les espaces particuliers et toutes les durées particulières. Parlons mieux : l’espace et le temps sont les vraies réalités, et les espaces et les temps particuliers n’en sont que des divisions qui leur empruntent ce qu’elles ont de réel, et répondent, non pas à la vérité des choses, mais aux besoins de nos sens et de notre esprit. Le vrai est ici précisément l’opposé des préjugés du nominalisme.
La seconde exagération de Loche est d’avoir presque réduit toutes les erreurs à des erreurs de mots. Pour que cela fût vrai, il faudrait que nulle pensée ne pût avoir lieu sans le secours du langage, ce qui n’est point. Je ne prendrai qu’un exemple entre mille. Est-ce à l’aide du mot moi ou du mot existence que je sens que j’existe ? Ai-je été ici du mot à la chose ? La supposition seule est absurde. La conscience perçoit directement ses phénomènes par la vertu qui est en elle, et non par celle des mots : les mots la servent puissamment, ils ne la constituent point ; ils ne constituent ni les sentiments simples et primitifs, ni les jugements primitifs, ni la plupart de nos opérations primitives. Il y a entre la pensée et le langage une influence réciproque. Un ensemble de signes bien précis, bien déterminés, est d’un grand secours pour penser avec netteté et précision ; mais ces signes eux-mêmes supposent déjà une pensée nette et précise qui les a faits, sans quoi ils ne seraient pas. Il y a des erreurs qui viennent des mots ; mais il y en a d’autres qui viennent de l’esprit même, de la précipitation, de la témérité, de la passion, de l’imagination. L’esprit humain, malheureusement, n’a pas besoin du langage pour se pouvoir tromper : il porte en lui des sources d’erreur plus profondes, plus difficiles à tarir.
Après avoir considéré les idées dans la sensation et la réflexion qui les produisent et dans les signes qui les manifestent, Locke les étudie dans leur rapport avec les objets.
Ici intervient une théorie devenue célèbre par les conséquences qu’en ont tirées Berkeley et Hume, et par la polémique de l’école écossaise, à savoir la théorie des idées images. Suivant Locke, la vérité est la conformité de l’idée avec son objet. « L’esprit, dit-il, ne connaît pas les choses immédiatement, mais par les idées qu’il en a ; et, par conséquent, notre connaissance n’est vraie qu’autant qu’il y a de la conformité entre nos idées et leurs objets. » Liv. IV, chap. IV, § 3. Nous ne citons que ce texte ; il y en a beaucoup d’autres qui prouvent que la mesure de la vérité pour Locke est la ressemblance des idées à leurs objets. Or là est le principe du scepticisme idéaliste de Berkeley. Il n’est pas malaisé de se convaincre que nos idées de la matière ne ressemblent en aucune façon à la matière même. En quoi les idées ou les sensations d’odeur, de chaleur, sont-elles conformes aux qualités qui produisent en nous ces sensations et ces idées ? L’idée de la solidité est-elle solide ? l’idée de l’étendue est-elle étendue ? D’autre part, il n’est pas plus difficile de démontrer, avec Hume, qu’une idée ne peut pas davantage être semblable à un être spirituel, à l’âme ou à Dieu. Supposons d’ailleurs cette conformité possible entre les choses et nos idées, comment s’assurer qu’elle existe ? Nous ne possédons que nos idées, et nous ne connaissons pas les choses en elles-mêmes ; mais alors, d’où pouvons-nous savoir si nos idées sont des images fidèles, puisque, ne connaissant les originaux que par ces images, nous ne pouvons confronter les images aux originaux ? Il y a là un obstacle invincible, et par conséquent une raison invincible de douter. Locke n’aperçut pas tout cela. Son bon sens l’arrêta, ici comme partout, sur la pente de sa propre théorie. Mais Hume et Berkeley la suivirent dans toutes ses conséquences, et Reid a fait voir que, tout absurdes qu’elles soient, elles sont légitimes et rigoureusement renfermées dans les principes du maître.
Ne quittons pas Locke sans l’interroger encore sur quelques problèmes dont la solution caractérise toute philosophie, les problèmes de l’existence de Dieu, de la spiritualité de l’âme, de la liberté, du bien et du mal, ce qui nous rapprochera du sujet de ces leçons, la philosophie morale.
L’opinion de Locke sur l’existence de Dieu est tout entière dans le morceau suivant :
Liv. VI, ch. X.« Je crois être en droit de dire que ce n’est pas un fort bon moyen d’établir l’existence de Dieu et de fermer la bouche aux athées, que de faire porter tout le fort d’un article aussi important que celui-là sur ce seul pivot, et de prendre pour seule preuve de l’existence de Dieu l’idée que quelques personnes ont de ce souverain être. Je dis quelques personnes : car il est évident qu’il y a des gens qui n’ont aucune idée de Dieu, qu’il y en a d’autres qui en ont une telle idée qu’il vaudrait mieux qu’ils n’en eussent pas du tout, et qui, la grande partie, en ont une idée telle quelle, si j’ose me servir de cette expression. C’est, dis-je, une méchante méthode que de s’attacher trop fortement à cette découverte favorite, jusqu’à rejeter les autres démonstrations de l’existence de Dieu, ou du moins de tâcher de les affaiblir et d’empêcher qu’on ne les emploie, comme si elles étaient faibles ou fausses, quoique dans le fond ce soient des preuves qui nous font voir si clairement et d’une manière si convaincante l’existence de ce souverain être par la considération de notre propre existence et des parties sensibles de l’univers, que je ne pense pas qu’un homme sage puisse y résister ; car il n’y a point, à ce que je crois, de vérité plus certaine et plus évidente que celle-ci, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont devenues visibles depuis la création du monde, par la connaissance que nous en donnent ses ouvrages. »
Il suit de là deux choses : que Locke croit fermement à l’existence de Dieu sur la foi de la nature et du monde, et qu’il n’approuve pas la preuve cartésienne, qui se fonde uniquement sur l’idée de Dieu, c’est-à-dire sur l’idée du parfait et de l’infini.
En revendiquant l’autorité des preuves tirées de la nature contre les cartésiens qui les négligeaient trop, Locke a été fidèle à son rôle d’homme de bon sens. Il y a là, en effet, un éclatant exemple du secours que l’expérience et même l’expérience sensible prête à la raison et aux vérités les plus hautes. Il importe que l’on tienne grand compte de la démonstration de l’existence de Dieu que fournit le spectacle de la nature ; car cette démonstration est à la fois frappante et solide. Pour être populaire, elle n’en est pas moins, ou plutôt elle en est d’autant plus philosophique. Dieu se manifeste partout dans le monde, dans l’aile d’un papillon comme dans le système planétaire, dans le génie d’Homère ou de Platon, dans la vertu de Socrate. Rien de plus vrai, assurément ; et cette preuve de l’existence de Dieu est d’une force inébranlable à ces deux conditions : 1° qu’on l’assoie sur son vrai principe ; 2° qu’on l’achève en la liant à une autre preuve, également nécessaire et également insuffisante.
La preuve de l’existence de Dieu par l’existence du monde suppose qu’on admet, comme un principe incontestable et nécessaire, le principe de causalité ; sans quoi le monde nous suffit, il ne nous élève point à sa cause, et il peut n’en point avoir. Or nulle part Locke ne parle du principe de causalité. Il ne le nie pas, il le néglige ; mais par là il ôte lui-même le fondement de sa preuve, et il en détruit le caractère. Cette preuve n’est universelle que parce que son principe est universel ; elle n’emporte forcément la conviction que parce que son principe est nécessaire. Mais il n’y a point pour Locke de principes universels et nécessaires, car que dévient alors son système sur l’origine de toute connaissance par la réflexion et la sensation ? De plus, la preuve de l’existence de Dieu par la nature, prise absolument seule, est incomplète. Locke reproche aux cartésiens leur démonstration de l’existence de Dieu par l’idée de l’infini, et il ne voit pas que sans l’idée de l’infini on ne peut avoir une vraie et achevée connaissance de Dieu. Si vous ne partez que de l’observation de la nature, bien entendu en vous appuyant sur le principe de causalité, vous aboutirez à une cause différente de la nature, car la nature n’est pas sa cause à elle-même ; mais quelle sera cette cause ? Elle sera puissante, sans contredit ; car la production du monde suppose une cause très puissante ; elle sera intelligente, car il y a de l’intelligence dans le monde et dans l’homme ; elle aura toutes les qualités que nous reconnaissons dans la nature, car il ne peut pas y avoir plus dans l’effet que dans la cause, et même il doit y avoir plus dans la cause que dans l’effet ; mais cette puissance, mais cette intelligence, à quel degré la cause du monde les possédera-t-elle ? C’est ce qu’il est impossible de déterminer. La cause du monde est supérieure au monde, voilà tout ce que l’on peut affirmer. Mais est-elle parfaite ? L’observation seule du monde ne nous le dit pas, et même elle semble dire quelquefois le contraire. Je le demande : si vous n’aviez pas déjà en vous l’idée d’un être parfait et infini, cette idée pourra-t-elle vous être suggérée par la vue du monde, où le mal est souvent mêlé au bien, et le désordre à l’ordre ? La seule induction légitime que permette l’observation du monde, est celle d’une cause qui n’est ni parfaitement puissante ni parfaitement sage, puisqu’il y a dans le monde et dans l’homme qui en fait partie tant d’imperfections. Le doute au moins semble permis ou même commandé.
Dans le système de Locke, l’infini n’est qu’une négation sans caractère déterminé : Dieu n’est donc qu’une puissance vague et mystérieuse, dont nous n’apercevons pas les limites et qui n’en a pas plus que n’en a le nombre qui se perd dans l’indéfini. Mais telle n’est point la vraie idée de Dieu. Dieu est pour nous un être réel dont l’essence est d’être parfait. Ce n’est pas quelque chose où l’imagination se perd en voulant l’étendre indéfiniment. En Dieu l’imagination n’a rien à voir : la raison seule le conçoit, mais elle le conçoit clairement. Dieu c’est l’être complet, à qui rien ne manque de ce qui est une perfection : c’est l’être, la puissance, l’intelligence, comme aussi la justice et la bonté, dans leur plénitude. Une telle idée ne peut être donnée par l’expérience : car l’expérience ne nous atteste hors de nous et en nous que le fini et l’imparfait ; mais à l’occasion de l’expérience, à l’occasion de l’imparfait et du fini, nous ne pouvons pas ne pas concevoir l’idée de l’infini et du parfait. Locke, en rejetant cette idée, parce qu’il ne la trouve pas dans l’expérience, ôte le fondement de la preuve directe de Dieu, en tant qu’être parfait ; il croit sans doute à l’existence de Dieu, mais il n’y croit pas sur des principes rigoureux et d’une manière philosophique.
Si Locke chancelle sur Dieu, il s’égare entièrement sur l’âme.
Liv. IV. ch. III.§ 6 : « Peut-être ne serons-nous jamais capables de connaître si un être purement matériel pense ou non, par la raison qu’il nous est impossible de découvrir par la contemplation de nos propres idées, sans révélation, si Dieu n’a point donné à quelques systèmes de parties matérielles, disposées convenablement, la faculté d’apercevoir et de penser, ou s’il a joint et uni à la matière ainsi disposée une substance immatérielle qui pense… Car comment peut-on être sûrs que quelques perceptions, comme le plaisir et la douleur, ne sauraient se rencontrer dans certains corps modifiés et mus d’une certaine manière, aussi bien que dans une substance immatérielle, en conséquence du mouvement des parties du corps ? »
Ce doute de Locke est devenu le lieu commun de toute l’école sensualiste au dix-huitième siècle. De ce doute au matérialisme lui-même il n’y a qu’un pas. Car, si nulle raison solide n’empêche de croire que la matière peut penser, il n’est pas raisonnable de recourir à une hypothèse, à l’intervention d’un principe inconnu, quand le corps que nous connaissons et dont l’existence est incontestable peut résoudre le problème. Mais le doute de Locke est absolument inadmissible. Locke prétend que nous ne pouvons nous assurer par la contemplation de nos propres idées que la matière ne peut pas penser ; au contraire, c’est dans la contemplation même de nos idées que nous apercevons clairement que la pensée et la matière sont incompatibles. Qu’est-ce que penser ? N’est-ce pas réunir un certain nombre d’idées sous une certaine unité ? La plus simple pensée, le plus simple jugement suppose plusieurs termes réunis indivisiblement en un sujet un et identique qui est moi. Ce moi identique est impliqué dans tout acte réel de connaissance. On a démontré à satiété que la comparaison exige un centre indivisible qui comprenne les différents termes de la comparaison. Prenez-vous la mémoire ? Il n’y a point de mémoire possible sans la persistance d’un même sujet qui rapporte à soi-même les différentes modifications dont il a été successivement affecté. Enfin la conscience, cette condition indispensable de l’intelligence, n’est-elle pas le sentiment d’un être unique ? C’est pourquoi chaque homme ne peut penser sans dire moi, sans s’affirmer comme le sujet identique et un de ses pensées. Je suis moi, et toujours moi, comme vous êtes toujours vous-mêmes, dans les actes les plus divers de notre vie. Vous n’êtes pas plus vous aujourd’hui qu’hier, et vous ne l’êtes pas moins. Cette identité et cette unité indivisible du moi, inséparable de la moindre pensée, c’est là ce qu’on appelle sa spiritualité, en opposition avec les caractères évidents et nécessaires de la matière. Par quoi en effet connaissez-vous la matière ? C’est surtout par la forme, par l’étendue, par quelque chose de solide qui vous arrête, qui vous résiste sur divers points de l’espace. Mais un solide n’est-il pas essentiellement divisible ? Prenez les fluides les plus subtils. Pouvez-vous ne pas les concevoir susceptibles de division, de plus et de moins ? Toute pensée a des éléments divers comme la matière, mais elle a de plus une indivisible unité dans le sujet pensant, et, ce sujet ôté, qui est un, le phénomène total n’est plus. Loin de là, le sujet inconnu auquel vous rattachez les phénomènes matériels est divisible, et divisible à l’infini : il ne peut cesser d’être divisible sans cesser d’être. Voilà quelles idées nous avons, d’un côté de la pensée, de l’autre, de la matière. La pensée suppose un sujet essentiellement un : la matière est divisible à l’infini. Qu’est-il besoin d’aller plus loin ? Si une conclusion est légitime, c’est celle qui distingue l’être pensant et la matière. Dieu peut très bien les faire coexister ensemble, et leur coexistence est un fait certain ; mais il ne peut les confondre. Dieu peut réunir la pensée et la matière, il ne peut pas faire que la matière pense.
Locke n’est pas plus ferme sur la liberté que sur la spiritualité de l’âme. Quelquefois il a une idée juste et vraie de la liberté, le plus souvent il la dénature.
« Notre idée de la liberté s’étend aussi loin que la puissance d’agir ou de s’empêcher d’agir, mais elle ne va point au-delà ; car, toutes les fois que quelque obstacle arrête cette puissance d’agir ou de ne pas agir, ou que quelque force vient à détruire l’indifférence de cette puissance, il n’y a plus de liberté, et la notion que nous en avons disparaît tout à fait. » – « La volition est visiblement un acte de l’esprit exerçant avec connaissance l’empire qu’il suppose avoir sur quelque partie de l’homme, pour l’appliquer à quelque action particulière, ou pour l’en détourner. »