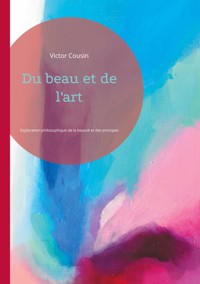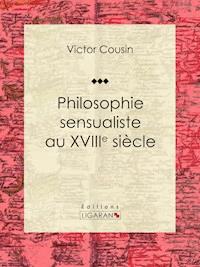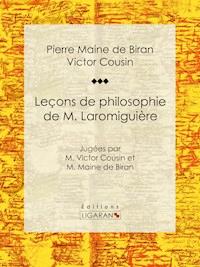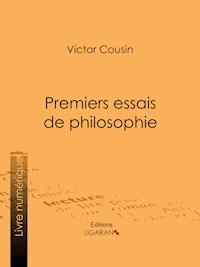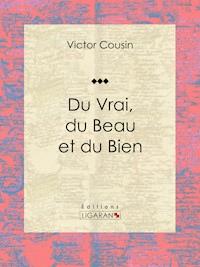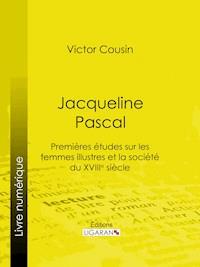
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans un grand siècle, tout est grand. Lorsque, par le concours de causes différentes, un siècle est une fois monté au ton de la grandeur, l'esprit dominant pénètre partout : des hommes peu à peu il arrive jusqu'aux femmes ; et, dès que celles-ci en sont touchées, elles le réfléchissent avec force et le répandent par toutes les voies dont elles disposent, incomparables, dans leur vive nature, pour exprimer et propager les qualités à la mode ; sérieuses ou..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous présentons de nouveau à l’indulgent public qui veut bien suivre nos humbles travaux, telles à peu près qu’elles ont paru il y a une douzaine d’années, ces premières études sur les mœurs et la société du XVIIe siècle. C’est là que, pour la première fois, laissant enfin paraître des goûts cultivés dans l’ombre et longtemps contenus par d’impérieux devoirs, nous avons osé mettre le lecteur dans la confidence de nos prédilections littéraires, et tracé le plan d’une galerie des femmes illustres du XVIIe siècle, à l’imitation de celle que Perrault a consacrée aux grands hommes du même temps ; aussi riche, aussi variée, et admettant tous les genres de talent et de gloire, mais, s’il nous est permis de le dire, un peu mieux ordonnée, suivant pas à pas le siècle, l’exprimant fidèlement par tous ses grands côtés et dans ses générations successives, à partir de ses heureux commencements jusqu’à son majestueux et sombre déclin. Puis, après avoir donné une ébauche de toute la galerie, nous avons entrepris d’y placer nous-même un premier portrait, celui d’une femme bien peu connue, quoiqu’elle porte un nom célèbre, qui avait reçu du ciel de rares facultés et les a volontairement négligées pour un objet plus grand que toute la gloire humaine, qui jeta quelque temps dans le monde un très vif éclat, et alla de bonne heure ensevelir dans un cloître les agréments de son esprit et de sa personne : cette femme est la sœur cadette de Pascal, Jacqueline, sœur Sainte-Euphémie.
À vrai dire, ce sujet sortait naturellement pour nous du long et assidu travail qui nous occupa tout entier pendant près de deux années. Dans le commerce intime que nous entretenions avec Pascal, nous ne pouvions pas ne pas rencontrer sa famille, son père Étienne, ses deux sœurs, Gilberte et Jacqueline, toutes deux belles et spirituelles ; et dès lors nous exprimions publiquement le regret qu’on n’eût pas rassemblé ce qui reste de ces deux personnes diversement distinguées. « Leurs écrits et leurs lettres, réunis à quelques pages de leur père, composeraient une suite naturelle aux œuvres de Blaise Pascal, et feraient mieux connaître cette admirable famille que Richelieu avait devinée dès la première vue, et dont il avait dit qu’il voulait faire quelque chose de grand. » Nous parlions ainsi en 1842. Personne ne se présentant pour accomplir cette tâche modeste, nous avons mis nous-même la main à l’œuvre, et essayé de faire connaître au moins Jacqueline Pascal.
Cet écrit était donc à nos yeux comme un appendice de nos ÉTUDES SUR PASCAL. Si le frère intéresse tant et à si bon droit, nous nous sommes flatté qu’un peu de cet intérêt se répandrait sur la sœur : car la biographie de l’une éclaire et achève la biographie de l’autre.
Mais, si Jacqueline nous touche déjà comme la sœur bien-aimée de l’un des personnages les plus extraordinaires du XVIIe siècle, nous n’hésitons pas à dire qu’elle ne nous importe pas moins par elle-même, à deux titres qui se rencontrent excellemment en elle. D’abord elle nous représente les femmes de la première moitié du siècle, ces contemporaines de Richelieu, de Descartes et de Corneille, qui n’étaient point des femmes auteurs, mais qui avaient infiniment d’esprit, avec la force et la grandeur partout répandues ; qui, sans savoir écrire et sans jamais l’avoir appris comme celles qui les suivirent, lorsque par nécessité elles prenaient la plume, trouvaient dans leur esprit et dans leur cœur des traits admirables et souvent des pages entières que leur envieraient les plus grands écrivains. Jacqueline Pascal est au premier rang de ces femmes pour lesquelles nous ne dissimulons pas toutes nos préférences. Mais c’est par un autre endroit encore qu’elle nous est chère, et que nous lui faisons une place éminente dans notre galerie : elle y représente ce qu’au XVIIe siècle nous n’admirons guère moins que la philosophie de Descartes, la poésie de Corneille, le pinceau de Lesueur et de Poussin, la politique de Richelieu et de Mazarin, le génie militaire de Condé, l’éloquence de Bossuet, nous voulons dire Port-Royal.
Nous avons assez relevé et combattu les erreurs théologiques et philosophiques du jansénisme, et particulièrement celle qui lui a été le principe de toutes les autres, cette conception exagérée du péché originel qui le conduisait nécessairement à une conception tout aussi exagérée de la grâce, qui le poussa sur le bord du calvinisme et l’y eût précipité, si Port-Royal n’eût été retenu par toutes ses autres croyances et par une fidélité peu conséquente, mais inviolable, à l’unité de l’Église. On peut le dire aujourd’hui, sans craindre de passer pour le complice du père Annat et du père Le Tellier : c’étaient les Jésuites alors qui défendaient la bonne cause, celle de la liberté humaine et du mérite des œuvres, en la rendant presque odieuse par une persécution lâche et cruelle qui tombait sur les plus grands esprits et les plus grands cœurs, sur des saints et des saintes, sur de véritables anges égarés par saint Augustin lui-même. Mais la grâce gratuite et invincible a depuis longtemps perdu ses dangers, tandis que l’exemple de l’intrépidité et du dévouement donné par ces illustres victimes nous demeure une leçon immortelle.
M. Royer-Collard avait coutume de dire : « Qui ne connaît pas Port-Royal ne connaît pas toute la nature humaine. » Et nous aussi nous répétons, avec une entière conviction, ce que nous avons dit autrefois : Port-Royal est peut-être « le lieu du monde qui a renfermé dans le plus petit espace le plus de vertu et de génie, tant d’hommes admirables et de femmes dignes d’eux. » Ce sont même les femmes qui nous frappent surtout à Port-Royal. Il est fort naturel qu’elles aient pris les idées de leurs directeurs, des directeurs tels que Saint-Cyran, Arnauld, Saci. On leur pardonne bien plus aisément quelques erreurs de théologie, et chez elles tant de fermeté, de constance, d’héroïsme, étonne et saisit davantage. Elles se proposaient un idéal sublime, l’imitation de Jésus-Christ, et il nous semble qu’elles en ont approché autant qu’il est permis à la faiblesse humaine.
Trois congrégations de femmes au XVIIe siècle se partagent en quelque sorte ce divin modèle. Les Carmélites ont dérobé quelque chose de sa pureté ineffable, de sa suavité, de sa tendresse. Les filles de saint Vincent de Paul en expriment la charité, l’infatigable dévouement à la race infortunée des hommes. Les disciples de la mère Angélique semblent posséder la force merveilleuse qui animait le Sauveur du monde, qui lui fit entreprendre la plus sainte, mais la plus difficile des révolutions, la conversion des esprits et des âmes, qui soutint son humanité dans les terribles épreuves qu’il rencontra et dans le suprême combat de cette nuit où toutes les séductions furent essayées sur le cœur du Juste, et toutes les grandeurs et les voluptés de la terre sacrifiées à la vérité. Port-Royal touche moins que le Carmel et Saint-Lazare ; mais il lui a été particulièrement donné d’élever les âmes ; il les prépare aux luttes de la vie ; il enseigne à résister à l’oppression ou à la supporter avec courage, à tout braver pour la justice, non seulement les persécutions de la puissance, la violence, la prison, l’exil, mais les ruses de la calomnie et les égarements ou les abattements de l’opinion. Le Carmel se cache, souffre et prie ; Saint-Lazare se dévoue ; Port-Royal combat, et il apprend à combattre. Peut-être le don céleste de l’humilité lui a-t-il un peu manqué, et a-t-il porté le courage jusqu’à l’opiniâtreté et la passion. Mais ne savons-nous pas que toutes les grandes choses ont leur excès, en religion comme en politique, comme en philosophie, et même dans les lettres et dans les arts ? Telle est l’inévitable condition de ce qu’il y a de meilleur sur la terre. C’est le plus sage, le plus modéré des politiques qui a écrit ces lignes : « Les dieux ont attaché à la liberté presque autant de malheurs qu’à la servitude ; mais, quel que doive être le prix de cette noble liberté, il faut bien le payer aux dieux. ». Nous payons donc volontiers à Port-Royal le prix de ses grandes qualités, comme dans nos jours de lassitude et d’affaissement nous sommes prêts à nous incliner de grand cœur devant tout ce qui pourrait rendre un peu de dignité et d’élévation aux esprits et aux caractères.
Jacqueline Pascal, c’est Port-Royal tout entier avec ses qualités et avec ses défauts. Jeune, spirituelle, fort recherchée, et déjà l’idole des plus brillantes compagnies, elle a tout quitté, même son vieux père et son frère malade, pour se donner à Dieu ; elle est entrée en religion à vingt-six ans, et elle est morte à trente-six, de douleur et de remords d’avoir signé un formulaire équivoque par pure déférence à l’autorité de ses supérieurs.
Sa haute vertu, son inflexible attachement à ce qu’elle croyait la vérité, sa sincérité courageuse, son mépris de toutes les douceurs de la vie, paraissent assez dans les nombreuses lettres confidentielles rassemblées ici pour la première fois. On y rencontre aussi des traits aimables et involontaires d’affection humaine pour sa sœur Gilberte, sa fidèle, comme elle l’appelle, et pour son frère Blaise ; on y sent partout un esprit charmant prêt à éclater en mille saillies, si l’austérité janséniste ne le retenait. Quant à ses talents, nous ne voulons pas les exagérer, mais il est certain que peu de femmes au XVIIe siècle, et parmi les plus illustres, ont été mieux douées. Elle avait quelque chose de la trempe du génie de Pascal, sa naïveté, sa vivacité, sa finesse, sa gravité, son énergie. Comme lui elle était capable de la plus sérieuse attention et d’un long travail, et dans la société forte et polie où elle était appelée à vivre, chez Mme de Sablé, entre Mme de Hautefort et Mme de La Fayette, sous les yeux et avec les conseils de son frère, elle était faite pour s’élever bien haut. Tout le siècle a vanté ses heureuses dispositions pour la poésie. Il ne faut pas voir seulement son extrême facilité à tout mettre en vers et à improviser sans cesse des sonnets, des quatrains, des stances de toute espèce, signe pourtant d’un tour d’esprit particulier et d’une vocation naturelle. Non : Jacqueline avait reçu du ciel l’inspiration et la puissance poétique. Nous demandons si ces deux ou trois stances du petit poème sur le miracle de la sainte Épine ne semblent pas appartenir à l’IMITATION de Corneille :
I.
II.
XX.
Polissez un peu la rudesse cornélienne de ces vers, sans toucher à la forte sève qui les anime ; ajoutez l’art à cet admirable naturel, et vous aurez un poète de plus au XVIIe siècle. Mais, quoique depuis sa conversion Jacqueline eût consacré son talent aux sujets les plus saints, elle conçut des scrupules, et consulta la mère Agnès ; celle-ci consulta M. Singlin, alors directeur de Port-Royal, et il fut décidé que la sœur Sainte-Euphémie renoncerait à la poésie, parce que ce n’était pas là la grâce dont Jésus-Christ lui devait demander compte.
La prose de Jacqueline-Pascal est de la meilleure qualité, saine, naturelle, ingénieuse, agréable. Dans le ton ordinaire, elle est un peu négligée, et n’offre rien de bien saillant, en gardant toujours une distinction secrète qui se sent plus qu’elle ne se peut définir. Mais que la passion vienne à souffler sur l’âme de Jacqueline et sur sa plume, elle supplée l’art, emporte les négligences et les langueurs, élève et soutient le langage, et alors on entend comme un écho de la voix mâle et pathétique de Pascal. Pour toute preuve, il suffit de rappeler la lettre sur la signature du formulaire imposé aux religieuses de Port-Royal.
Ce formulaire attribuait à Jansénius des fameuses propositions condamnées par la Sorbonne et l’assemblée des évêques, et semblait attaquer la grâce de saint Augustin. Sortons de notre temps et transportons-nous au milieu du XVIIe siècle : les questions religieuses y remuaient les esprits et les âmes autant que de nos jours les questions politiques. D’un bout de la France à l’autre, on était alors passionnément janséniste, ou moliniste, ou catholique modéré, comme depuis on a été et on est encore pour le pouvoir absolu, ou la république, ou la monarchie constitutionnelle. Le formulaire agita le clergé, les corps religieux, les universités, les parlements ; il divisa le jansénisme lui-même, et Port-Royal eut aussi ses guerres civiles. Les docteurs les plus renommés du parti, Arnauld, Nicole, Singlin, le neveu même de Saint-Cyran, donnèrent aux religieuses de Port-Royal le conseil de signer le formulaire, par respect pour l’Église, d’adhérer à la doctrine qu’ils reconnaissaient à l’Église le droit d’imposer, en se récusant sur le point de fait, à savoir si les propositions condamnées étaient ou n’étaient pas dans l’Augustinus que les religieuses déclaraient n’avoir pas lu. Au contraire, Pascal et Domat n’étaient pas seulement inflexibles sur la question de fait comme n’étant point du ressort de l’Église, mais ils soutenaient que la doctrine même à laquelle il s’agissait d’adhérer était conçue en des termes qui mettaient en péril la grâce véritable. L’autorité d’Arnauld entraîna Port-Royal, mais un grand nombre de religieuses pensèrent comme Pascal et Domat ; elles ne virent dans la signature du formulaire qu’un effort médiocrement généreux pour sauver Port-Royal aux dépens de la sincérité chrétienne ; elles résistèrent longtemps, et à la fin ne signèrent qu’avec les plus fortes réserves, et encore avec une douleur profonde. Jacqueline Pascal, alors simple sous-prieure à Port-Royal-des-Champs, ne craignit pas de tenir tête à Arnauld lui-même, et elle écrivit, pour lui être communiquée, une lettre de protestation qui souvent s’élève jusqu’à l’éloquence. En voici quelques passages que nous soumettons volontiers aux juges les plus délicats et les plus sévères :
« Je ne puis plus dissimuler la douleur qui me perce jusques au fond du cœur de voir que les seules personnes à qui il semblait que Dieu eût confié sa vérité lui soient si infidèles, si j’ose le dire, que de n’avoir pas le courage de s’exposer à souffrir, quand ce devrait être la mort, pour la confesser hautement. Je sais le respect qui est dû aux premières puissances de l’Église ; je mourrais d’aussi bon cœur pour le conserver inviolable comme je suis prête à mourir, avec l’aide de Dieu, pour la confession de ma foi dans les affaires présentes ; mais je ne vois rien de plus aisé que d’allier l’une à l’autre. Qui empêche tous les ecclésiastiques qui connaissent la vérité, lorsqu’on leur présente le formulaire à signer, de répondre : Je sais le respect que je dois à messieurs les évêques ; mais ma conscience ne me permet pas de signer qu’une chose est dans un livre où je ne l’ai pas vue ; et après cela attendre en patience ce qui en arrivera ? Que craignons-nous ? le bannissement pour les séculiers, la dispersion pour les religieuses, la saisie du temporel, la prison, et la mort si vous voulez ! Mais n’est-ce pas notre gloire et ne doit-ce pas être notre joie ? Renonçons à l’Évangile ou suivons les maximes de l’Évangile, et estimons-nous heureux de souffrir quelque chose pour la justice.
Mais peut-être on nous retranchera de l’Église ? Mais qui ne sait que personne n’en peut être retranché malgré soi, et que l’esprit de Jésus-Christ étant le seul qui unit ses membres à lui et entre eux, nous pouvons bien être privés des marques, mais non jamais de l’effet de cette union, tant que nous conserverons la charité, sans laquelle nul n’est un membre vivant de ce saint corps ? Et ainsi ne voit-on pas que tant que nous n’élèverons pas autel contre autel, et que nous demeurerons dans les termes d’un simple gémissement et de la douceur avec laquelle nous porterons notre persécution, la charité qui nous fera embrasser nos ennemis nous attachera inviolablement à l’Église, et qu’il n’y aura qu’eux qui en seront séparés, en rompant, par la division qu’ils voudront faire, le lien de la charité qui les unissait à Jésus-Christ et les rendait membres de son corps !
Hélas ! que nous devrions avoir de joie si nous avions mérité de souffrir quelque notable confusion pour Jésus-Christ ! Mais on a donné trop bon ordre à l’empêcher, lorsqu’on déguise tellement la vérité que les plus habiles ont peine à la reconnaître. J’admire la subtilité de l’esprit, et je vous avoue qu’il n’y a rien de mieux fait que le mandement. Je louerais très fort un hérétique, en la manière que le père de famille louait son dépensier, s’il s’était aussi finement échappé de la condamnation ; mais des fidèles, des gens qui connaissent et qui soutiennent la vérité et l’Église catholique, user de déguisement et biaiser, je ne crois pas que cela se soit jamais vu dans les siècles passés, et je prie Dieu de nous faire tous mourir aujourd’hui plutôt que d’introduire une telle conduite dans son Église ! En vérité, j’ai bien de la peine à croire que cette sagesse vienne du père des lumières ; mais plutôt je crois que c’est une révélation de la chair et du sang. Pardonnez-moi, je vous en supplie ; je parle dans l’excès d’une douleur à quoi je sens bien qu’il faudra que je succombe, si je n’ai la consolation de voir au moins quelques personnes se rendre volontairement victimes de la vérité, et protester par une vraie fermeté ou par une fuite de bonne grâce contre tout ce que les autres feront.
… Je sais bien qu’on dit que ce n’est pas à des filles à défendre la vérité, quoiqu’on pût dire, par une triste rencontre du temps et du renversement où nous sommes, que puisque les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d’évêques. Mais si ce n’est pas à nous à défendre la vérité, c’est à nous à mourir pour la vérité.
… Chacun sait, comme M. de Saint-Cyran le dit souvent, que la moindre vérité de la foi doit être défendue avec autant de fidélité que Jésus-Christ. Qui est le fidèle qui n’aurait point horreur de soi-même, s’il se pouvait faire qu’il se fût trouvé présent au conseil de Pilate, où il aurait été question de condamner Jésus-Christ à la mort, s’il se fût contenté d’une manière d’opiner ambigüe par laquelle on eût pu croire qu’il était de l’avis de ceux qui le condamnaient, quoiqu’en sa conscience et selon son sens ses paroles tendissent à le délivrer ? Poussez la comparaison jusqu’au bout.
Prions Dieu qu’il nous humilie et nous fortifie, puisque l’humilité sans force et la force sans humilité sont aussi préjudiciables l’une que l’autre. C’est ici plus que jamais le temps de se souvenir que les timides sont mis au même rang que les parjures et les exécrables…
Si l’on s’en contente (de la déclaration sans équivoque qu’elle proposait), à la bonne heure : pour moi, si la chose dépend de moi, je ne ferai jamais autre chose. Du reste arrive ce qui pourra, la prison, la mort, la dispersion et la pauvreté ; tout cela ne me semble rien en comparaison de l’angoisse où je passerais le reste de mes jours, si j’avais été si malheureuse que de faire alliance avec la mort en une si belle occasion de rendre à Dieu les vœux de fidélité que mes lèvres ont prononcés. »
Y a-t-il dans la langue et la littérature française beaucoup de pages sorties de la main d’une femme qui pour la force et l’énergie surpassent celles que nous venons de citer ! À ces accents qui partent du cœur, à cette véhémence intérieure, à cette austérité passionnée, ne reconnaît-on pas la digne sœur de l’auteur des Provinciales ? Et quand Jacqueline dit qu’elle parle dans l’excès d’une douleur où elle sent bien qu’il faudra qu’elle succombe, ce n’est point là un mouvement oratoire, c’est un cri de désespoir, un tragique pressentiment : car trois mois après cette lettre écrite et le fatal formulaire signé par obéissance, Jacqueline expirait à Port-Royal-des-Champs, le 4 octobre 1661, à l’âge de trente-six ans.
Quiconque n’a pas perdu le sentiment de la beauté des convictions désintéressées, de la dignité du caractère, de la constance portée jusqu’à l’héroïsme, qu’il soit janséniste, jésuite ou philosophe, doit considérer Jacqueline Pascal comme une grande âme et un rare esprit, dont les moindres reliques doivent être recueillies avec un soin religieux.
Nous sommes donc bien loin de nous repentir d’avoir donné à Jacqueline Pascal la première place dans notre galerie des femmes illustres du XVIIe siècle ; mais nous demandons grâce pour la façon dont nous l’avons représentée. Le temps nous a manqué, en 1844, pour la peindre comme nous l’aurions voulu, et en tracer une biographie régulière. Entre les travaux de la Chambre des pairs et ceux du Conseil de l’instruction publique, nous pouvions à peine dérober quelques heures pour rechercher et rassembler des lettres inédites et les lier par quelques mots de récit. Aujourd’hui que la politique nous a fait du loisir, et que nous pouvons nous consacrer tout entier à nos deux études chéries, la philosophie et les lettres, nous traiterions Jacqueline Pascal comme depuis nous avons fait plusieurs de ses grandes contemporaines : nous essaierions d’en être l’historien ; alors il fallait bien nous contenter de lui servir en quelque sorte d’éditeur. En effet, ce n’est guère ici qu’un recueil d’écrits dispersés dans les collections jansénistes, et de lettres inédites, mises les unes après les autres, sans autre ordre que celui des dates, et accompagnées de fort peu de réflexions. Jacqueline y paraît toute seule. Nous nous bornons à l’introduire sur la scène ; elle agit et elle parle elle-même ; elle expose elle-même ses sentiments d’un si sombre, mais si noble caractère ; et c’est à peine si, à la fin de cette courte tragédie, nous reprenons un moment la parole, comme sur le tombeau de l’héroïne, pour lui adresser un dernier adieu, et exprimer, avec une liberté respectueuse, les pensées d’un homme du XIXe siècle sur la vraie manière de comprendre et de résoudre le problème de la destinée humaine.
Le lecteur reconnaîtra aisément que nous avons consulté bien des manuscrits et recherché avec soin les moindres vestiges qui subsistent de Jacqueline. Nous avons marqué scrupuleusement les sources auxquelles nous avons puisé. Nous avions promis une juste et publique reconnaissance à qui voudrait bien nous signaler quelque pièce nouvelle échappée à notre zèle et à nos investigations. Mais nous avons le regret d’annoncer que, depuis 1844, on n’a pas pu découvrir d’autres lettres de Jacqueline, rien de nouveau, si ce n’est quelques vers de sa première jeunesse qui ne méritent point d’être remarqués. La seule lettre autographe qui nous rappelle sa main est encore celle dont nous avons donné le fac-similé. En revanche, on a mis au jour un assez bon nombre de variantes qui nous ont servi à confirmer ou à rectifier les leçons des manuscrits dont nous avons fait usage, dans l’impuissance de remonter aux originaux, qui pourtant ne peuvent avoir péri, et très probablement sont encore ensevelis dans la poussière de quelque bibliothèque janséniste, à Clermont, à Utrecht ou à Paris.
V. COUSIN.
20 octobre 1856
DES FEMMES ILLUSTRES DU XVIIe SIÈCLE.
Dans un grand siècle, tout est grand. Lorsque, par le concours de causes différentes, un siècle est une fois monté au ton de la grandeur, l’esprit dominant pénètre partout : des hommes peu à peu il arrive jusqu’aux femmes ; et, dès que celles-ci en sont touchées, elles le réfléchissent avec force et le répandent par toutes les voies dont elles disposent, incomparables, dans leur vive nature, pour exprimer et propager les qualités à la mode ; sérieuses ou frivoles ; vertueuses ou dépravées, mais jamais rien à demi, et toujours extrêmes en bien ou en mal, selon le vent qui souffle autour d’elles. Ainsi, au XVIIe siècle, dans cette immortelle époque de la grandeur française, les femmes ne nous paraissent pas moins admirables que les hommes. Charles Perrault a fait un livre sur les hommes illustres de son temps, où des portraits gravés par Édelinck relèvent de courtes et exactes notices. Si nous étions plus jeune, ou si nous avions plus de loisir, si nous pouvions dérober quelques heures à d’austères études, nous trouverions un plaisir inexprimable à composer un recueil qui servît de pendant à celui de Perrault, et que nous intitulerions à notre tour les Femmes illustres du dix-septième siècle. Nous voudrions en faire un livre où il n’y aurait presque rien de nous et où nous mettrions toute notre âme. Si nous valons quelque chose, c’est par l’admiration de ce qui est beau ; et cette tendre et profonde admiration pour ce qu’il y a de plus beau au monde après un grand homme, c’est-à-dire une femme digne d’avoir une place à côté de lui, nous voudrions la rendre, s’il était possible, contagieuse, par toutes les ressources de l’art et d’une érudition sobre et choisie. L’art ici, ce serait la typographie et la gravure, et nullement la rhétorique, qui serait assez peu de mise devant ces graves ou charmantes figures. Le beau format in-folio, des portraits authentiques, retracés sous nos yeux par un burin fidèle, des biographies aussi exactes et tout aussi brèves que celles de Perrault, à peine un modeste avant-propos sur les sources où nous aurions puisé : voilà tout l’ouvrage.
Comme Perrault, nous ne ferions aucune classification ; nous mettrions ce qui est beau à côté de ce qui est beau, sans rechercher si toutes ces beautés se ressemblent. Il n’y aurait pas d’autre ordre que celui de la chronologie. Le mouvement, le progrès et le déclin insensible du siècle, y paraîtraient par la succession de ces différentes figures, d’abord si sévères et si grandes, de plus en plus délicates et gracieuses. On y verrait, bien mieux que dans Perrault, la différence profonde qui sépare le siècle de Richelieu de celui de Louis XIV.
Les femmes qui se sont distinguées par leurs écrits auraient aussi leur place dans cette galerie, mais on y ferait une grande différence de la femme d’esprit et de la femme auteur. Nous honorons infiniment l’une et nous avons peu de goût pour l’autre. Ce n’est pas que nous soyons de l’école de Molière sur les femmes. L’homme et la femme ont la même âme, la même destinée morale ; un même compte leur sera demandé de l’emploi de leurs facultés, et c’est à l’homme une barbarie et à la femme un opprobre de dégrader ou de laisser dégrader en elle les dons que Dieu lui a faits. Les femmes ne doivent-elles pas savoir leur religion, si elles veulent la suivre et la pratiquer comme des êtres intelligents et libres ? Et dès que l’instruction religieuse leur est non pas permise, mais commandée, quel genre d’instruction, je vous prie, pourra paraître trop relevé pour elles ? Encore une fois, ou la femme n’est pas faite pour être la compagne de l’homme, ou c’est une contradiction inique et absurde de lui interdire les connaissances qui lui permettent d’entrer en commerce spirituel avec celui dont elle doit partager la destinée, comprendre au moins les travaux, ressentir les luttes et les souffrances pour les soulager. Laissons-la donc cultiver son esprit et son âme par toute sorte de belles connaissances et de nobles études, pourvu que soit inviolablement gardée la loi suprême de son sexe, la pudeur qui fait la grâce.
La femme est un être domestique, comme l’homme est un personnage public. Celui-ci, né pour l’action, agit encore en écrivant ; il peut poursuivre une carrière publique avec sa plume aussi bien qu’avec la parole ou avec l’épée. Un homme sérieux n’écrit que par nécessité et parce que autrement il ne peut atteindre son but. Cela est si vrai qu’il n’écrit bien qu’à cette condition ; et ce n’est pas une remarque de petite conséquence que les plus grands écrivains n’ont pas été des auteurs de profession. Descartes, Pascal et Bossuet sont-ils des gens de lettres ? pas le moins du monde. Ils n’écrivent point pour faire montre de leur esprit, mais pour défendre une noble cause confiée à leur courage et à leur génie. Ôtez la persécution odieuse exercée sur Port-Royal, et vous n’auriez jamais eu les Provinciales. Ce n’était pas là pour leur auteur un divertissement, une parade, un tournoi oratoire : c’était une lutte sérieuse et tragique, pleine d’exils et de lettres de cachet, derrière laquelle on entrevoyait la Bastille de M. de Saci ou le donjon de Vincennes de M. de Saint-Cyran, avec les interrogatoires de Lescot et de Laubardemont, ou la fuite du grand Arnauld et son dernier soupir exhalé sur la terre étrangère. Pascal combattait dans les Provinciales pour la morale éternelle, comme Démosthènes avait combattu deux mille ans auparavant à la tribune d’Athènes pour la liberté de sa patrie, comme Bossuet le faisait dans la chaire chrétienne pour l’autorité de la foi, et Descartes, dans sa retraite de Hollande, pour l’indépendance de la pensée et le bill des droits de la philosophie. Ces combats-là sont-ils moins sérieux, sont-ils moins mémorables que ceux de Salamine et d’Arbelles, de Rocroi ou d’Arcole ? Au lieu des philosophes, des orateurs et des moralistes, voulez-vous prendre les historiens ? Mézeray est un homme instruit qui, pouvant écrire sur beaucoup d’autres sujets, et par là se faire une position convenable, a été conduit, par diverses circonstances et par sa charge d’historiographe, à écrire sur l’histoire de France ; et là-dessus il a composé un ouvrage que nous trouvons excellent et bien au-dessus de sa réputation ; mais qu’a de commun ce travail estimable avec les histoires de Thucydide et de Polybe, de Machiavel et de Guichardin, et les Mémoires de Comines et de Richelieu, hommes d’État et guerriers qui écrivaient dans un but politique et pour continuer devant la postérité le rôle sérieux qu’ils avaient joué auprès de leurs contemporains ? Et remarquez que nous vous faisons grâce de César et de Napoléon. Dès qu’un homme écrit pour écrire, pour briller ou pour faire fortune, il écrit mal, ou du moins il écrit sans grandeur, parce que la vraie grandeur ne peut sortir que d’une âme naturellement grande qui s’émeut pour une grande cause. Hors de là, tout se réduit à une industrie intellectuelle habilement exercée, à des succès qui en Chine font monter un mandarin d’une classe à une autre, et en France nous envoient à l’Académie. L’homme de lettres est un artiste qui contribue aux plaisirs publics, mérite et obtient une juste considération, et a droit à tout, par exemple, à la pairie, telle que nous l’avons faite, à tout, disons-nous, excepté à la gloire. La gloire est à un autre prix : elle est le cri de la reconnaissance du genre humain, et le genre humain ne prodigue pas sa reconnaissance : il la lui faut arracher par d’éclatants services.
Si nous parlons ainsi du lettré, que dirons-nous de la femme auteur ? Quoi ! la femme qui, grâce à Dieu, n’a pas de cause publique à défendre, s’élance sur la place publique, et sa pudeur ne se révolte point à l’idée de découvrir à tous les yeux, de mettre en vente au plus offrant, d’exposer à l’examen et comme à la marque du libraire, du lecteur et du journaliste, ses beautés les plus secrètes, ses charmes les plus mystérieux et les plus touchants, son âme, ses sentiments, ses souffrances, ses luttes intérieures ! Voilà ce que nous avons beau voir tous les jours, et dans les femmes les plus honnêtes, et ce qu’il nous sera éternellement impossible de comprendre. Si quelqu’un venait nous dire et prétendait nous prouver que Mme de Sévigné destinait au public et à être insérées dans les journaux du temps ces lettres où elle épanche en mille piquantes saillies les flots de sa tendresse maternelle et de sa verve inépuisable, nous répondrions sans hésiter : D’abord vous nous gâtez Mme de Sévigné : c’était une mère passionnée et pleine de génie, vous nous en faites un pur bel esprit. Ensuite vous vous trompez : quand on écrit pour être imprimé, on écrit bien différemment ; on peut écrire encore très agréablement, mais non pas avec ce naturel, avec cette grâce involontaire et ces airs charmants que le cœur seul inspire, et que la plus habile coquette ne trouve pas devant son miroir. Toute femme qui écrit sur ses sentiments pour le public entreprend de le tromper ; elle fait un personnage, et partant elle le fait assez mal ; elle écrit avec plus ou moins de chaleur et de feu extérieur, mais sans âme, car, si l’âme l’inspirait, elle la retiendrait aussi. Bien entendu qu’il ne s’agit point ici des poètes, hommes ou femmes, enfants aimables ou sublimes, qui ne savent ni ce qu’ils disent ni ce qu’ils font, chantent ou écrivent, comme l’enseigne Platon, sous l’empire d’un démon qui leur souffle tout ce qu’ils disent. Le poète est un être sacré ; et quand, dans ce délire qu’on appelle l’inspiration, égaré et hors de lui-même, il se montre nu à la foule, c’est un corps transfiguré qu’il expose à la vue, et les saintes bandelettes ne le quittent jamais aux yeux de ses vrais adorateurs. Mais la prose est une muse sobre ; elle sait ce qu’elle fait, et elle en est responsable. Quand donc une femme écrit en prose, elle est de sang-froid, et si elle parle d’elle-même, selon nous, elle fait une faute. Nous ne connaissons à la condition de femme auteur que deux excuses : un grand talent ou la pauvreté, et nous nous inclinons avec bien plus de respect encore devant celle-ci que devant celui-là.
Quelle que soit notre admiration pour la Princesse de Clèves, et bien que nous la mettions à peine au-dessous de Bérénice, le métier de femme auteur que faisait sans nécessité Mme de La Fayette nous rappelle malgré nous qu’elle avait donné ses dernières affections à un bien triste personnage, grand seigneur intrigant, bel esprit morose, qui osa mettre sa vie en maximes, l’amant sans cœur, l’amant ingrat de l’infortunée duchesse de Longueville.
Après Mme de La Fayette, nous n’apercevons plus guère au XVIIe siècle que trois femmes de lettres distinguées, si on veut bien nous passer cette expression : Mlle de Scudéry, Mme Deshoulières, et Mlle Lefèvre, depuis Mme Dacier ; et en vérité, si nous avions à choisir pour notre sœur ou notre mère entre ces trois dames, nous choisirions Mme Dacier, femme excellente, pleine d’instruction, qui a très peu parlé d’elle, et n’a guère fait que des traductions qui dureront plus que bien des ouvrages prétendus originaux. La traduction de l’Iliade, par Mme Dacier, est encore aujourd’hui la seule version qui se puisse lire de l’antique et naïve épopée. Il y a par-ci par-là quelques contresens : on y chercherait en vain notre exactitude littérale ; la grâce non plus n’y est pas ; mais la simplicité, mais l’abondance, mais l’énergie et le mouvement n’y manquent point, et l’impression générale qu’elle fait sur l’esprit du lecteur ne diffère pas trop de celle que produit le vieil Homère. Nous avouons que les bergères de Mme Deshoulières nous surpassent et ne sont pas faites pour nous, pas plus que celles de Racan, de Ségrais et de Fontenelle, pastorales de boudoir, jeux d’esprit qui ne divertissent pas le moins du monde, industrie innocente, mais futile, à laquelle il y a très peu d’industries honnêtes que nous ne préférions, celles, par exemple, qui mettent dans notre cellule un chaud tapis, des meubles solides et une bonne cheminée. Mlle de Scudéry était, comme on disait alors, une fille de beaucoup d’esprit qui a composé d’ennuyeux romans et quelques jolis vers, parmi lesquels on a retenu le quatrain sur les œillets du grand Condé. Elle vaut mieux sans doute que monsieur son frère, le bienheureux Scudéry de Balzac et de Boileau. Celui-là s’est vraiment trompé de siècle : il devait vivre de notre temps. Avec ses airs de matamore, son style éventé et sa fécondité inépuisable, il eût été un des lions de la littérature facile. Mais dans la famille il y a une personne qui, sans avoir écrit pour le public, est bien supérieure à l’auteur d’Alaric : c’est la femme même de Scudéry, qui, laissée veuve à trente-six ans, aimable et spirituelle, vécut dans la meilleure compagnie, recherchée, quoique pauvre, et considérée malgré le ridicule de son nom. Elle a du sens, un certain goût poli et discret, et ses lettres agréables et bien tournées se soutiennent à côté de celles de Bussy.
Nous n’aurions pas l’injustice et le mauvais goût de bannir de notre galerie les femmes auteurs ; mais nos préférences, et pour ainsi dire les places d’honneur, seraient pour ces femmes éminentes qui ont montré une intelligence ou une âme d’élite sans avoir rien écrit, ou du moins sans avoir écrit pour le public, selon la vraie destinée et le plus haut emploi du génie de la femme. C’est sur les femmes illustres de cette trempe que nous voudrions rassembler les documents les plus authentiques, y choisissant les traits les plus frappants pour en former des biographies sobres et fidèles. Nous y joindrions les pages les plus caractéristiques échappées à leur plume, soit dans des lettres confidentielles, soit dans des Mémoires posthumes. Enfin, selon le goût de notre temps, qui est aussi le nôtre, chaque notice serait accompagnée d’un autographe comme d’un portrait. Chacune de ces dames serait ainsi peinte au physique et au moral avec sa physionomie particulière et avec le costume du temps. Nous nous efforcerions aussi de marquer avec soin le rapport des personnages de cette galerie à ceux de la galerie de Perrault, du moins pour l’esprit et le caractère ; en sorte que le lecteur de ces deux ouvrages suivrait de biographies en biographies et de portraits en portraits le cours du siècle depuis la mort de Henri IV jusqu’à celle de Louis XIV, et traverserait cette grande époque en cette aimable et glorieuse compagnie.
On y verrait d’abord les hautes et sérieuses figures des contemporaines de Sully, de Richelieu, de Descartes, de Corneille. Au premier rang seraient deux femmes diversement admirables : ici la bienheureuse Mme de Chantal, digne élève de saint François de Sales, fondatrice de l’ordre charitable de la Visitation, née comme sainte Thérèse pour souffrir et aimer, consoler et soulager ; là celle qu’il nous est impossible de ne pas appeler la grande Mme Angélique, faite pour commander comme la première pour aimer et servir, la vraie sœur aînée du grand Arnauld, qui, s’étant éveillée abbesse à quatorze ans, entreprit à seize ans de réformer et son monastère et tous ceux du même ordre, et par là de contribuer à la réforme générale des ordres religieux et de l’Église de France ; qui, commençant courageusement la réforme des autres par celle d’elle-même, dit adieu au monde, à sa famille, à ce père qui l’adorait, dévora son cœur en silence et ne lui permit de battre que pour Dieu ; capable des plus grandes choses, et n’en trouvant pas de plus grande que de se dompter elle-même, naturellement altière et volontairement humble, patiente et douce à force d’énergie, trompant sa nature ardente et passionnée en la transportant jusque dans le renoncement à soi-même, attirant par un ascendant irrésistible tout ce qui l’approchait à sa sainte entreprise, relevant ou plutôt fondant de nouveau Port-Royal, en faisant une école de science et de vertu, de foi solide et de vraie sagesse, jusqu’au jour où cette grande âme, déjà par elle-même hardie et extrême, rencontra une autre âme plus extrême encore, l’énergique et outré Saint-Cyran, homme fatal qui introduisit dans Port-Royal une doctrine particulière, imprima à une œuvre simple et grande le caractère étroit de l’esprit de parti, et fit presque d’une réunion de solitaires une faction. Avec quel respect et quelle émotion nous nous plairions à recueillir les plus beaux passages de la mère Angélique ! Elle a beau s’anéantir dans le mépris d’elle-même et dans la fuite de toute vanité, ses plus simples entretiens, ses lettres les plus familières, révèlent de loin en loin le fond de son âme, et contiennent çà et là des traits admirables de candeur, de fierté, de pathétique. Mais qu’on ne s’y trompe pas : tout ce qu’on a imprimé d’elle, longtemps après sa mort, a subi les corrections d’éditeurs inhabiles qui ont effacé, pour le polir, son style inculte et négligé, et font parler, de 1630 à 1660, Mme Angélique Arnauld, comme ils parlaient eux-mêmes à Utrecht ou dans quelque coin du faubourg Saint-Marceau, vers le milieu du XVIIIe siècle. Nous avons eu sous les yeux, nous avons copié, et nous pourrions faire connaître des lettres autographes de cette Cornélie chrétienne, où son âme se montre à découvert dans sa grandeur naïve, sans avoir passé par la censure janséniste.
En avançant un peu dans le siècle, à la suite et à côté de la famille des Arnauld, nous trouverions celle des Pascal Dans ce recueil, composé à notre guise, nous ferions une place aux deux sœurs de l’auteur des Provinciales et des Pensées, Jacqueline et Gilberte, toutes deux parfaitement belles, ce qu’il est permis de ne pas mépriser,
Gratior et pulchro veniens in corpore virtus,
l’une spirituelle, passionnée et obstinée comme son frère, morte de chagrin à trente-six ans pour avoir signé le formulaire contre sa conscience ; l’autre vive aussi, mais moins extrême, ayant gardé au sein d’une dévotion profonde les affections de sœur, de femme et de mère ; l’une et l’autre écrivant sans art, mais toujours d’une façon distinguée et avec une élévation naturelle.
Sous la Fronde, nous aurions une ample moisson à faire de beautés et de grâces d’un ordre bien différent. Viendraient alors les grandes dames avec leurs intrigues de cour, leurs amours légères, leurs dures pénitences, leur style négligé et de haut parage ; à côté de Condé et de Turenne, Mme de Longueville, la grande Mademoiselle et la Princesse Palatine ; entre Mazarin et Retz, Mme de Chevreuse ; avec Beaufort et Rancé, Mme de Montbazon, et l’orgueilleuse Guymené avec l’infortuné de Thou.
Avançons encore, voici le siècle de Louis. XIV. C’en est fait de la mâle vigueur du temps de Richelieu ; c’en est fait de la libre allure de la Fronde ; Louis XIV a mis à l’ordre du jour la politesse, la dignité tempérée par le bon goût. Heureux les génies qui auront été trempés dans la vigueur et dans la liberté de l’âge précédent, et qui auront assez vécu pour recevoir leur dernière perfection des mains de la politesse nouvelle ! C’est le privilège de Mme de Sévigné, comme de Molière et de Bossuet. Mme de Sévigné serait la reine de cette galerie. Elle y donnerait la main à son amie Mme de La Fayette. Il y aurait une place aussi pour Mme de Grignan, et à cause de sa mère, et à cause de son père Descartes, et pour elle-même qui joignait à une âme noble, plus hardie que celle de la prudente marquise, une raison libre et ferme, un esprit original et un style accompli dans sa sobre gravité. Nous admettrions bien volontiers Mme de Rambouillet et sa fille la fameuse Julie. Il n’y a guère moyen de séparer Mlle Paulet de Voiture, et la duchesse de Mazarin, la brillante et folle Hortense, de son vieux cavalier servant, Saint-Évremond.
Voyez comme déjà le siècle en avançant décline ; mais qu’il est beau encore avec Mlle de La Vallière, devenue Louise de la Miséricorde ! Nous en pourrions donner plus d’une lettre inédite où se révèle une âme charmante. Son heureuse et superbe rivale, Mme de Montespan, figurerait avec sa docte sœur, Mme de Rochechouart, abbesse de Fontevrault, qui traduisait le Banquet, y compris le discours d’Alcibiade, et avec sa nièce, la spirituelle et belle marquise de Castries, que Huet surprit un jour lisant en cachette le Criton. Puis viendrait ce génie égaré qui égare un autre génie, cette âme si tendre qui séduisit et entraîna l’âme tendre de Fénelon, alluma au feu de l’amour divin la plus ténébreuse querelle, mit aux prises l’aigle de Meaux et le cygne de Cambrai, et jusque dans ses plus grandes erreurs se fit tout pardonner à force d’humilité, de sincérité, de dévouement.
Mais insensiblement le grand siècle s’écoule. Sa forte sève épuisée ne renouvelle plus les grandes générations. L’élégance a remplacé la force, et le goût le génie. La dernière figure de notre galerie, froide et composée, mais belle encore, serait celle de Mme de Maintenon. Nous tâcherions de la peindre fidèlement, sans ressentir aucune sympathie pour celle qui jamais ne consulta ni le devoir ni son cœur, mais l’opinion, ne poursuivit qu’un seul et bien misérable objet, la considération, feignant de prendre le plaisir d’un roi pour la volonté de Dieu, sans vertu à la fois et sans amour, victime volontaire et par conséquent peu intéressante de ce tyran vulgaire qu’on appelle les convenances du monde. Oh ! que nous sommes loin de Mme Angélique Arnauld ! Que le siècle finit autrement qu’il a commencé ! Ici l’édit de Nantes, là sa révocation ; d’abord Port-Royal et l’Oratoire, maintenant le règne de jésuites de cour et bientôt la régence ; au lieu de Sully, de Richelieu, de Mazarin, de Colbert, un conseil de commis sans patriotisme et sans ambition, n’ayant d’autre dessein que de ne pas déplaire au maître et de garder leurs portefeuilles. Le XVIIe siècle a fait son temps ; un autre monde est près d’éclore ; un nouvel esprit, de nouvelles mœurs, d’autres hommes, d’autres femmes vont paraître. Voltaire va succéder à Descartes, et le cardinal de Fleury au cardinal de Richelieu. Voici venir les Parabère et les Pompadour, en attendant les Du Barry ; comme femmes auteurs ou présidentes de coteries littéraires, les Du Deffant, les Graffigny, les Geoffrin, les Duchâtelet, c’est-à-dire, si vous exceptez la noble Mlle Aïssé, et peut-être encore cette pauvre insensée Mlle de Lespinasse, pas une femme véritable, un peu de savoir en mathématiques et en physique, quelque bel esprit, aucun génie, nulle âme, nulle conviction, nul grand dessein ni sur soi-même ni sur les autres telles sont les femmes du XVIIIe siècle. Ce n’est pas nous qui nous proposons de leur servir d’historien.
Accomplirons-nous jamais cette idée d’une galerie des femmes illustres du XVIIe siècle ? c’est du moins un rêve qui sert de délassement à nos travaux, de charme à notre solitude. Guidé par le P. Lelong, nous avons recherché avec persévérance et nous sommes parvenu à rassembler un grand nombre de portraits authentiques de ces femmes incomparables, gravés sur les originaux de Ferdinand, de Beaubrun, de Juste, de Champagne, de Mignard, de Rigaud, par Mellan, Morin, Michel Lasne, Daret, Poilly, Masson, Grégoire Huret, Van Schuppen, Nanteuil, Edelinck. Nous y avons joint quelques médailles de Dupré et de Varin, et surtout d’assez précieux autographes, des lambeaux de correspondances inédites ou de mémoires manuscrits qui éclairent à nos yeux et marquent plus distinctement les traits de telle figure qui nous est chère. Déjà nous avons publié des lettres nouvelles de Mme de Longueville, cette créature ravissante, pleine à la fois de hauteur et de langueur, aux yeux bleus, aux blonds cheveux, avec le front du grand Condé, si remuante dans le monde, si dévouée en amour, sans aucun entraînement des sens et par le seul mouvement de l’âme, puis tout à coup si repentante, si humble et si tremblante à Port-Royal et aux Carmélites. Aujourd’hui nous voulons présenter au lecteur, mais sans parure aucune, et telle que nous la trouvons parmi nos manuscrits, une figure toute différente, celle d’une enfant pleine de génie, qui, avec un peu plus de culture, eût pu devenir une des personnes les plus éminentes de son siècle ; naturellement belle et enjouée, d’un esprit sérieux et gracieux tout ensemble, d’une merveilleuse aptitude à la poésie ; née pour faire les délices de la famille et le charme d’une société d’élite, mais qui, tout à coup saisie d’un accès de dévotion outrée, renonça au monde, s’appliqua à étouffer tous les dons qu’elle avait reçus, entra en religion à vingt-six ans, et mourut à trente-six dans les angoisses d’une conscience troublée : nous voulons parler de Jacqueline Pascal.
Quelle famille que celle des Pascal ! Elle n’est pas, elle ne peut pas être supérieure à celle des Arnauld, mais elle en est l’égale par la qualité, sinon par le nombre. Dès que Richelieu, de son regard d’aigle, aperçut Étienne Pascal accompagné de son fils Blaise, qui avait alors une quinzaine d’années, et de ses deux filles Gilberte et Jacqueline, il demeura frappé de la beauté de ces enfants, et au lieu de laisser le père les lui recommander, c’est lui qui les recommanda à ses soins en lui disant : J’en veux faire quelque chose de grand ! Étienne Pascal était un homme de beaucoup de mérite. Outre sa capacité comme intendant de province, il était très instruit, et même savant. Il recevait chez lui des mathématiciens et des physiciens ; il participait à leurs travaux, et on a de lui une lettre au jésuite Noël, où il l’engage, d’un ton moitié sérieux, moitié plaisant, à ne pas trop se commettre avec son fils Blaise Pascal à l’endroit de la pesanteur de l’air, l’avertissant qu’il aurait affaire à un rude adversaire. Il avait donné à cet enfant une éducation un peu systématique, qui ne fut pas sans influence sur la tournure de son esprit. Ses deux filles avaient aussi reçu une instruction très forte. L’aînée s’appelait Gilberte. Marguerite Périer, sa fille, dans ses Mémoires inédits sur sa famille, nous parle ainsi de sa mère : « Elle était née le 7 janvier 1620, à Clermont. Mon grand-père se retira à Paris en 1630 pour y élever ses enfants. Ma mère, qui était l’aînée, avait dix ans ; elle se maria à vingt et un ans (quand M. Pascal le père était intendant en Normandie), et elle resta à Rouen. Quand elle fut ici (à Clermont), elle se mit dans le grand monde comme toutes les personnes de son âge et de sa condition. Elle avait tout ce qu’il fallait pour y être agréablement, étant belle et bien faite. Elle avait beaucoup d’esprit. Elle avait été élevée par mon grand-père qui, dès sa plus tendre jeunesse, avait pris plaisir à lui apprendre les mathématiques, la philosophie et l’histoire. En 1646, ma mère étant allée à Rouen chez mon grand-père, trouva toute sa famille à Dieu, qui lui fit la grâce et à mon père d’entrer dans les mêmes sentiments. Elle quitta donc le monde et tous les agréments qu’elle y pouvait avoir, à l’âge de vingt-six ans, et elle a toujours vécu dans cette séparation jusqu’à sa mort. »
Ne croyez pas que ce portrait soit embelli ; l’austère Marguerite ne flatte personne, et si une janséniste comme elle remarque que sa mère était belle, il faut que celle-ci l’ait été beaucoup.
Nous savons de divers endroits que c’est Gilberte qui, pendant la fuite de son père accusé d’avoir pris part à une sédition, placée toute jeune à la tête de la maison et de la famille, ayant reçu l’invitation de laisser jouer la comédie à sa petite sœur Jacqueline sur le théâtre de M. le cardinal, fit cette réponse à la Corneille : « M. le cardinal ne nous fait pas assez de plaisir pour que nous prenions soin de lui en faire. » Les écrits et surtout les manuscrits jansénistes sont pleins de lettres de Gilberte, devenue madame Périer ; mais ce qui la recommande à la postérité est la vie si connue de son frère Pascal. Cette vie est admirable ; elle fait aimer Pascal, et c’est sa sœur qui lui a rendu ce pieux office. Elle s’efface le plus qu’elle peut, et ne laisse paraître que son frère. Elle l’aimait tendrement, et s’affligeait, sans oser le lui dire, de ses froideurs apparentes. Malheureusement, nous soupçonnons cette biographie d’avoir été plus ou moins altérée par messieurs de Port-Royal.
Jacqueline est une personne bien plus étonnante encore que Gilberte. Le ciel lui avait accordé tous les dons du génie avec les grâces de la femme. Elle n’était inférieure à son frère Pascal ni par l’esprit ni par le caractère, et on ne sait où elle ne serait point parvenue si elle eût fait cas de la gloire, si elle eût pris soin des facultés qu’elle avait reçues. Dirons-nous toute notre pensée ? À Port-Royal, les femmes sont peut-être plus extraordinaires, et assurément tout aussi grandes que les hommes. La mère Angélique n’est-elle pas l’égale d’Arnauld par l’intrépidité de l’âme et la hauteur de la pensée ? Nicole est-il fort au-dessus de la mère Agnès ? Elle a plus de force avec autant de douceur. Et leur nièce, la mère Angélique de Saint-Jean, n’a-t-elle pas consumé dans le gouvernement de Port-Royal une prudence, une habileté, un courage, qu’eût pu lui envier son frère le ministre ? Parmi les hommes, qui a plus osé, plus lutté, plus et mieux souffert que toutes ces femmes ? Elles aussi, elles ont connu et elles ont bravé la persécution, la calomnie, l’exil, la prison. Quand elles ont écrit, elles l’ont fait avec une simplicité mêlée de grandeur. Il est impossible de ne pas reconnaître en elles des âmes et des esprits d’une trempe tout autrement rare que les dames qui brillaient le plus alors dans les cercles à la mode. À ces âmes et à ces esprits-là donnez un peu de culture, et il en sortira des chefs-d’œuvre ? Qu’est-ce en effet que le style ? l’expression de la pensée et du caractère. Quiconque pense petitement et sept mollement n’aura jamais de style. Quiconque au contraire a l’intelligence élevée, occupée d’idées grandes et fortes, et l’âme à l’unisson de cette intelligence, celui-là ne peut pas ne pas écrire de temps en temps des lignes admirables ; et si à la nature il ajoute la réflexion et l’étude il a en lui de quoi devenir un grand écrivain. La mère Agnès et la mère Angélique ont beaucoup écrit ; que leur a-t-il manqué, ainsi qu’à leur frère Antoine Arnauld, pour laisser des modèles ? l’art difficile d’égaler les paroles au sentiment et à la pensée. Elles auraient dédaigné cet art, ou plutôt elles l’auraient repoussé comme un soin coupable. Loin de faire paraître leur génie, elles se sont appliquées à l’étouffer dans l’humilité, le silence, l’entier renoncement au monde et à soi-même. Elles n’écrivaient, comme elles ne parlaient, que par pure nécessité. De loin pu loin il leur échappe quelques belles phrases à leur insu et par la seule puissance des grands sentiments. Mais comme l’art est absent, dans les intervalles de la passion, leur style inculte et négligé tombe dans la diffusion, la langueur, la sécheresse. Impérieuse condition de la perfection en tout genre ! Pour l’atteindre, il la faut poursuivre avec ardeur et avec constance. Pour obtenir la gloire, il la faut aimer, et le génie a besoin d’une forte culture pour porter tous ses fruits. Après tout, il en est ainsi de la vertu elle-même : la plus heureuse nature et même des instincts héroïques n’y suffisent point ; la volonté, la règle, une vigilance infatigable s’y doivent ajouter pour prévenir les égarements, maintenir et développer les nobles penchants et les convertir en habitudes. Les femmes de Port-Royal se proposaient un grand objet, leur salut par la perfection religieuse ; et pour approcher de l’idéal qu’elles s’étaient formé, elles s’épuisaient en efforts continuels, en méditations assidues, en pratiques austères. La moitié de semblables soins donnés à leur esprit en eussent fait des écrivains du plus haut rang. Disciple de la mère Angélique et de la mère Agnès, comme elles intelligente et passionnée, Jacqueline Pascal s’est fait comme elles un devoir d’éteindre de bonne heure, ou plutôt de détourner ailleurs, tout ce qu’elle avait en elle d’ardeur et de génie. Elle a donc atteint la perfection à laquelle elle a aspiré, et elle a manqué celle qu’elle a méprisée. Nous l’avouons : il n’y a rien d’accompli dans les écrits de Jacqueline Pascal, mais tout y respire le plus beau naturel. On a d’elle plusieurs morceaux en prose et en vers dispersés çà et là dans les collections jansénistes. Nous les rassemblerons en y joignant un assez grand nombre de pièces inédites, particulièrement des lettres adressées à sa sœur Gilberte et à son frère Pascal. Il ne faut rien négliger de ce qui peut faire connaître cette admirable famille, et Jacqueline aussi mérite bien d’être étudiée pour elle-même.
Commençons par deux documents authentiques, inédits ou peu connus : d’abord une biographie composée par Gilberte et qui conduit Jacqueline depuis sa première enfance jusqu’au moment où elle entre à Port-Royal ; ensuite, dans les Mémoires de Marguerite Périer, plusieurs paragraphes consacrés à sa tante, qui développent et achèvent la première biographie.
Ainsi Gilberte Pascal ne s’est pas contentée d’écrire la vie de son frère, elle a aussi voulu conserver pour elle et pour sa famille la mémoire de sa sœur chérie. C’est le même style, la même simplicité et le même agrément que dans la vie de Pascal. Mais, comme on devait s’y attendre, les éditeurs ont partout altéré le style naïf de Mme Périer. Ils ont divisé les phrases trop longues et substitué des mots plus modernes à ceux qui leur ont paru vieillis. Nous rétablissons ici le vrai texte d’après deux excellents manuscrits, l’un de la Bibliothèque royale de Paris, l’autre de la Bibliothèque de Troyes. Le manuscrit de la Bibliothèque de Paris avertit que « cette relation vient de Port-Royal. »
« Ma sœur naquit à Clermont le 5 octobre de l’année 1625 ; et, comme j’avais six ans plus qu’elle, je me souviens que dès qu’elle commença à parler, elle donna de grandes marques d’esprit. Elle était outre cela parfaitement belle, et d’une humeur douce et gaie, et la plus agréable du monde ; de sorte qu’elle était autant aimée et caressée qu’un enfant peut l’être. Mon père se retira à Paris en novembre 1631, et nous y mena tous. Ma sœur avait lors six ans, toujours fort belle et tout à fait agréable par la gentillesse de son esprit et de son humeur. Ces qualités la faisaient souhaiter partout, de sorte qu’elle ne demeurait presque point chez nous.