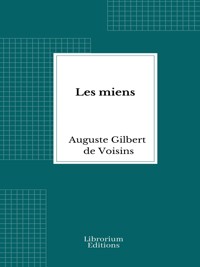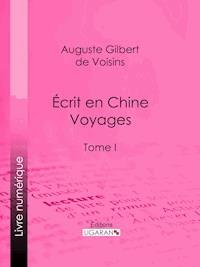
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Mon ami Jacques B. ne laisse pas d'être un homme singulier. J'ai causé avec plus d'un explorateur. Je connais plusieurs types du genre : l'explorateur qui n'a rien fait et décrit abondamment les contrées qu'il croit avoir parcouru ; celui qui dédaigne les dangers, les accidents dont il fait le compte, mais qui ne vous permettra pas d'en ignorer le plus petit détail ; celui, enfin, que les aventures ont grisé et qui chante son Odyssée suer le mode hyperbolique."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mon ami Victor Segalen,compagnon de voyage parfait, ensouvenir de nos étapes chinoises.
G.V.
Août 1913.
Paris.
28 mai 1909.
« Et vous comptez partir bientôt, cher ami ?
– Je pars ce soir même. Demain matin, je serai à Marseille et mon paquebot lèvera l’ancre vers quatre heures.
– Épargnez-moi !
– Qu’y a-t-il ?
– Il y a que le pire des supplices est d’entendre parler du Paradis en sachant que jamais on n’y entrera. C’est la peine que souffre l’homme affamé qui regarde, par un jour de pluie, des pains à croûte d’or dont le sépare une vitre bien transparente. Vous me parlez de votre prochain voyage au Tibet comme l’on parle d’aller à Saint-Cloud. Vous me décrivez les plaisirs que l’Asie centrale vous réserve avec ce calme particulier qui, souvent, m’exaspère chez vous. Il semble que tout soit parfaitement simple et que la voie où vous vous engagez reste ouverte à tous ».
Mon ami Jacques B. ne laisse pas d’être un homme singulier. J’ai causé avec plus d’un explorateur. Je connais plusieurs types du genre : l’explorateur qui n’a rien fait et décrit abondamment les contrées qu’il croit avoir parcourues ; celui qui dédaigne les dangers, les accidents dont il fait le compte, mais qui ne vous permettra pas d’en ignorer le plus petit détail ; celui, enfin, que les aventures ont grisé et qui chante son Odyssée sur le mode hyperbolique. Les autres variétés d’explorateurs se ramènent presque toutes à l’un de ces trois types. Ainsi, l’homme qui s’est promené à travers le monde, autrement qu’en chemin de fer ou par les soins des messageries maritimes, garde un orgueil magnifique de son action et se défend peu de vous la présenter comme une action d’éclat. C’est une des raisons pour lesquelles je prise si fort mon ami Jacques, homme exceptionnel qui, de son plein gré, ne vous dira rien des voyages qu’il fit et, si vous le forcez à parler, vous donnera d’eux un compte rendu mesuré, facile, exact… pour tout dire, parfait. Sa voix est douce, un peu basse (il n’aime le bruit ni chez lui-même, ni chez les autres), enfin, le seul défaut de narrateur que je lui connaisse est d’attribuer souvent à autrui une aventure dont il fut le personnage principal, quand l’aventure décrite est trop colorée ou lui ferait trop d’honneur.
Ce jour où il vint me dire adieu avant de repartir pour l’Asie, je me trouvais dans l’état mélancolique où vous met une pluie de printemps que le soleil ne traverse pas ; il s’en fallut de peu que je ne lui en voulusse de m’avoir surpris en plein marécage, lui qui devait, quelques mois plus tard, se promener dans les neiges et le vent pur.
« Le paradis dont vous parlez, me dit-il, est ouvert à tous les hommes de bonne volonté. Je ne vous conseillerais pas de me rejoindre au Tibet ; la contrée semble un peu dure, un peu sévère peut-être, à qui s’y engage sans préparation ; mais pourquoi n’iriez-vous pas en Extrême-Orient ? Les régions au-delà de Singapour vous séduisent d’avance, comme toute l’Asie, d’ailleurs. Souvenez-vous de l’émotion qui vous surprit en voyant le Tibétain que j’amenai à Marseille, lors de mon second voyage. Vous vous rappelez bien Adjroup Gumbo, ce soir où vous le vîtes débarquer au pays de France, tenant en laisse son grand chien de montagne, l’âme émue dans sa poitrine, comme il disait, et remerciant le Ciel de l’avoir conduit sain et sauf de l’autre côté de la mer ! »
Certes, je me rappelais !
Jacques se tut quelques instants, le regard posé au loin. Il revoyait l’ancien compagnon de voyage qui mourut en rentrant dans sa ville de Patong, l’homme dévoué, l’homme vaillant avec lequel il aurait, plus tard, gagné ce pays inconnu, ce canton secret de l’Asie dont si souvent il m’avait parlé, cette Terre du Sud « où l’on ne peut aller », la Terre Promise des légendes tibétaines.
« Pourquoi, dit-il soudain, ne vous rendez-vous pas à Péking ? Notre ami Ségalen s’y trouve : ensemble, vous feriez une belle promenade ».
Jacques B. me quitta sur ces paroles. Tristement, je songeai qu’avant deux ans, pour le moins, je ne le reverrais pas. Or le hasard, qui parfois nous console par de petites bénédictions dont l’octroi fait prendre la vie en patience, me remit, par les mains du facteur, une lettre timbrée de Péking. Ségalen s’y était installé pour deux mois ; il me contait ses enivrantes randonnées, ses courses, ses flâneries, les longues heures qu’il passait dans des boutiques nonpareilles où l’on découvrait un bracelet de jade à côté d’une bouteille de champagne vide et des pipes d’ivoire près d’un fer à friser. Jamais une journée ne lui semblait assez longue ; son seul souci : préparer le voyage dont je l’entretenais dans mes lettres.
« Venez ! écrivait-il, venez vite. Je ne sache pas que la vieille Europe ait des charmes suffisants pour vous retenir auprès d’elle ! Galopons de conserve à travers la plus vieille Chine ; il me plairait de voir en votre compagnie des paysages savoureux. Fermez le livre que vous lisiez ce soir. Les fiacres et les omnibus font un bruit odieux ; venez écouter des musiques plus belles ! La pièce que vous iriez entendre est la copie de celle qui, la semaine dernière, vous ennuya ; entrez dans un nouveau théâtre : la porte en est ouverte, les acteurs sont prêts. Vous laisserez chez vous votre dernier chagrin ; il mourra de solitude ; à votre retour, vous ne trouverez rien de lui qu’un petit cadavre tout sec, à repousser du pied. Prenez une décision sans balancer ou, mieux encore, n’usez d’incertitude qu’au moment où vous serez monté dans le train qui, sans trop d’ennuis, vous transportera de Paris à Tien-Tsin. Je vous attendrai là, sur le quai de la gare, les deux mains tendues, le sourire aux lèvres. Venez ! Venez ! Venez, cher ami ! »
Il convient d’accepter parfois les avances de la fortune. Quand elles sont aussi directes, on ne résiste guère.
Je partis quinze jours après.
Paris.
2 juillet 1910.
J’écrivais ces lignes il y a quelque treize mois ; voici maintenant qui, pour le reste, servira de préavis, ou d’excuse, si l’on aime mieux.
J’ai suivi des routes chinoises, pistes irrégulières, jaunies par la poudre impalpable du loess, j’ai franchi plus d’une montagne où la neige entravait nos pas, je me suis laissé emporter par le cours aventureux de beaux fleuves dont l’eau folle nous secouait au point de laisser croire à l’approche d’un sérieux danger, mais, pour fatigantes que fussent nos étapes, elles ne composeraient pas un récit d’exploration.
Promenade pénible, tout au plus, voyage accidenté. Jamais nous ne risquâmes le moindre égorgement, et le visage de la mort ne nous apparut guère qu’en des minutes où quelque petit geste d’acrobatie, tant soit peu de décision et ce sourire que les pires traverses devraient toujours faire naître, l’éloignaient aussitôt.
On ne trouvera donc ici nulle horrible chose, ni de quoi frémir. Des notes, de simples notes, écrites, le soir, à la veillée, sous l’influence d’un paysage ou d’une pensée, tandis que nos porteurs fumaient dans un coin, qu’une corneille revêche et rauque, attardée plus que de raison, croassait devant la porte sur une branche basse, et que les souris grignotaient leur poutre familière, sous le papier pansu du plafond. Heures exquises où l’on pouvait rêver, heures violettes où le plus beau songe, le plus pittoresque, le plus inattendu se présentait toujours.
L’ai-je rendu sensible en ces pages ? C’est une autre affaire ! Les songes ont coutume de se décolorer si vite ! Les ailes, avec leur duvet, perdent la raison même de ce chatoiement qui nous séduisit, la plus vivante fleur se résume en un petit rien de poussière, le plus miraculeux mirage en une phrase sans « au-delà », et l’émotion la plus neuve en un paragraphe académique. – Tant pis. – Je n’ai point le dessein ridicule de rendre toutes les merveilles qui nous surprirent sur la route chinoise, mais si, ne fût-ce qu’un instant, je donne à ceux qui me liront ce désir « du lieu où ils ne sont pas » dont parle Baudelaire, je me déclarerai satisfait.
Alexandrowno.
19 juin 1909.
N’ayant jamais vu un champ de bataille, j’imaginais mal son émouvant aspect. Pour décrire le soir d’une défaite, les morts sous la lune blême, les cris des blessés, les pièces d’artillerie prisonnières et tout le sang répandu, sans doute m’eût-il fallu compulser de gros livres et beaucoup inventer ; maintenant, je n’aurai qu’à rappeler un souvenir.
On m’avait déjà parlé des douanes russes, mais les paroles ne sont rien ; si persuasifs qu’on les imagine, les beaux discours ne peuvent rendre certains excès de l’horreur, et la dévastation ne souffre pas d’être décrite. Oh ! sur ce quai mal éclairé de la gare frontière d’Alexandrowno, par une nuit à peine tiède, le lamentable aspect, l’aspect vaincu de ces jeunes femmes prises en faute ! Debout et groupées de façon pathétique, elles implorent, avec des gestes de tragédie, comme les vierges d’un chœur antique, l’ennemi tout-puissant, mais la prière reste vaine et le geste n’est d’aucun secours. À leurs pieds gisent des mètres de dentelles précieuses qu’elles avaient si soigneusement roulés dans des coiffes de chapeaux. Celle-ci, comme Andromaque le cadavre d’Hector, regarde d’un œil lugubre sa robe morte. Cette robe qui devait bientôt vivre sur elle, encadrer sa gorge, cambrer sa taille, indiquer la ligne pure de ses hanches, la voilà toute flasque, toute froissée, toute répandue sur le sol malpropre, vraie dépouille humaine dont la triste apparence ferait monter des larmes aux yeux les moins sensibles. Voilà une jeune femme qui sanglote dans son mouchoir, celle-ci proteste, celle-là va s’évanouir, cette autre reste impassible, car des puissances supérieures la protègent et les douaniers ne lui poseront nulle question. – À quelques pas, voici le chœur des hommes : d’importants messieurs à panse qui regardent avec mélancolie la jonchée des boîtes de cigares qu’ils espéraient passer en fraude. Ceux-là paraissent ridicules, mais le chœur des femmes est vraiment pitoyable.
Et voici, pour finir, une épaisse matrone, splendide par son embonpoint. Certes, on ne l’inquiètera pas ! elle est trop majestueuse, elle représente trop de chair en un seul corps ; elle le sait, elle marche sans peur, tout droit ; elle traverse la salle des douanes, sa main tourne déjà le bouton de la porte, mais une employée s’approche qui, d’un geste discret, respectueux encore, tâte les hanches rebondies. – Hélas ! cette dame est matelassée de dentelles ; supposée, sa belle prestance ! frauduleuse, son obésité ! On l’arrête. Brusquement, elle s’assied sur un banc, elle éclate en sanglots, elle s’effondre. – Elle se consolera, je pense.
Transsibérien.
25 juin.
On trouve, un jour, que la vie est trop lourde. On part, on cherche cet « ailleurs » qui semble un lieu fixe, situé au loin et que l’on atteindra bientôt.
On part. On connaît le roulement continu des trains, le balancement des bateaux, le déhanchement d’une caravane, le bruit parfois joyeux des diligences. – On fait halte. On quitte l’endroit où l’on se reposa. On fait halte encore. On remonte en selle. – L’aube est toute parfumée ; l’horizon promet mille délices.
Et même si la route paraît longue, même si sa poussière aveugle, même si le soleil éblouit cruellement, on espère que l’on pourra toucher enfin cette oasis rêvée où toute source est fraîche, où toute palme frémit au souffle d’une brise incessante, – on espère ce chant glacé des sources, on espère cette chanson de palmes, et jamais on ne les atteint.
On arrive au but proposé : village, fleuve ou bord de mer. On se recueille. On songe. Sans doute n’est-on plus le même ? Ah ! de si peu ! Et si l’on veut se considérer justement, sans détours ni faux-semblants, quelles tristes découvertes l’on fait en soi !
Tu veux voyager, mon ami ? Inscris donc sur tes tablettes ces deux fragments de prose, celui-ci d’abord, que je cueille dans le vingt-septième chapitre de l’Imitation.
« Nul lieu n’est un sûr refuge… Vous changerez et ne serez pas mieux. Car, entraîné par l’occasion qui naîtra, vous trouverez ce que vous aurez fui, et pis encore ».
Et cet autre qui achève le roman de Benjamin Constant :
« On change de situation ; mais on transporte dans chacune le tourment dont on espérait se délivrer ; et comme on ne se corrige pas en se déplaçant, l’on se trouve seulement avoir ajouté des remords aux regrets et des fautes aux souffrances ».
Être ailleurs !… Oh ! la plaisante vanité ! Constant le dit, quelques lignes plus haut :
« On ne saurait briser avec soi-même ».
Le beau viatique pour un long voyage !
Transsibérien.
27 juin.
Vivre dans un wagon de chemin de fer est une habitude que l’on prend aisément. Se sentir bousculé d’une aube à l’autre peut émouvoir, quelques heures, mais l’on s’y fait et, calmé, ce trouble profond que les palais de Moscou, ses toits vert clair, ses dômes dorés, ses clochers en forme d’oignons, ses icônes, ses souvenirs de l’Homme du Destin, les passants de ses rues et toute sa splendeur orientale m’ont fait ressentir, je me compose, dans ma boîte mouvante, une existence à la fois cénobitique et variée. C’est la retraite du moine que tente le démon. À la fenêtre de la cellule, l’Esprit Mauvais déroule les splendeurs du monde : vallons, coteaux, vergers, fleuves lourds qui rampent vers la mer, ruisseaux dessinant des arabesques, orages et ciels bleus, forêts que le vent secoue, villes entrevues, plaines grasses, aubes vertes, soleils couchants.
Je suis un moine indigne : je ne cesse de mettre le nez à la portière.
Avec le soir, le paysage devient d’une admirable et puissante mélancolie. Mon lieu d’élection pour le contempler est, à l’arrière du train, une cabine vitrée où je me trouve presque toujours seul, mes compagnons de voyage passant la plupart de leurs heures de veille (entre les repas) à jouer aux cartes. Vers le crépuscule, la vue toujours égale, noble et monotone, toujours plate, couronnée d’un ciel encore vaguement rose, est d’une prenante séduction. De temps à autre, un étang salé miroite sous la lune ronde et, sur ses bords, de longues taches livides luisent, un moment. Puis, de nouveau, c’est l’ombre noire des buissons ou celle plus claire de l’herbe. Le ciel prend des tons délicieux : safran, vert pomme, bleu de roi, et des arbres isolés se découpent si durement à l’horizon, en profils si noirs, que l’œil ne sait où les situer.
Quelques jours plus tard, le décor change, devient accidenté, se couvre d’une forêt dont les tons semblent de tapisserie. Certains aspects en sont d’un effet prodigieux : le tronc blanc de chaux des bouleaux se détache sur le tronc pourpre des sapins et tout le feuillage reste immobile dans l’air calme du soir, ainsi qu’une forêt peinte. Ces arbres graves me donnent l’impression magnifique, paisible et pure de certains poèmes d’Henri de Régnier.
Enfin dans ma cage vitrée, à l’arrière du dernier fourgon, je passe de longs instants à regarder les deux rails de la voie unique : ils filent droit, tout droit, puis vont se perdre, au loin, dans la brume. On dirait qu’ils naissent sous moi. Je ne puis en détacher mes yeux ; cela force le regard. Ces deux rails d’argent mat, qui vont, qui se hâtent, qui ne finissent pas de fuir, deviennent hallucinants ! Je ne vois plus qu’eux seuls. Oh ! double ruban clair, double ruban d’argent, ruban bleuâtre et déroulé qui me rattache, là-bas, à mon pays, à mes ennuis, à ma douleur !
Transsibérien.
29 juin.
J’ai causé plusieurs heures avec une de mes compagnes de voyage, institutrice française d’un jeune Russe qui vit en Sibérie et qu’elle va rejoindre, après avoir pris quinze jours de vacances à Moscou. Elle a vingt-cinq ans, un regard farouche, de belles mains qui tremblent un peu. Parisienne, elle n’est plus rentrée en France depuis cinq ans.
« Oh ! quel plaisir de causer avec un Français ! Voyez-vous, Monsieur, lorsque je cause avec un Russe, il me semble toujours, même quand il a de notre langue un long usage, que j’entends et que je prononce des mots étrangers, des mots étranges ».
D’une voix éteinte, avec de pauvres paroles poussiéreuses qui n’ont plus servi depuis longtemps, qui, dirait-on, sont restées enfermées, elle me raconte, longuement, la sinistre existence qu’elle mène, l’hiver, dans cette grande maison de bois, loin de tout, en pleine Sibérie, à vingt kilomètres du chemin de fer.
« Parlez-moi de Paris, dit-elle, parlez-moi du bruit de Paris, des couleurs de Paris, des gens qui passent, qui ont l’air gai, qui ont l’air content de vivre, parlez-moi des fiacres, de l’Auteuil-Madeleine, des Ternes-Filles du Calvaire, parlez-moi du soleil de Paris et des fleurs, parlez-moi de la Seine, toute petite avec ses petits ponts et ses petits bateaux, parlez-moi d’un fleuve qui ne gèle pas, qui coule toujours, et parlez-moi des théâtres et des lumières… »
Je lui ai parlé de tout cela. Elle pleurait et j’allais pleurer aussi, quand le garçon, en venant annoncer le déjeuner, coupa court.
Elle est descendue ce soir. Son élève, un adolescent imberbe, l’attendait à la gare et l’a emmenée en carriole. Il a la figure d’un jeune sot de belle taille.
Transsibérien.
1er juillet.
J’ai assisté, il y a quelques heures, à un spectacle proprement sublime. Nous venions de nous arrêter dans cette plaine tragique de Mandchourie qui n’en finit pas avec ses ondulations vertes, et le soleil balayait l’herbe, découpant en ombres des troupeaux de chameaux et de chevaux, quand une centaine de soldats qui retournaient en Sibérie descendirent de leurs wagons et se mirent en rang le long de la voie pour faire leur prière du soir. Le chœur se déroula noblement, ainsi qu’en une église, fervent, calme et pur. On sentait là une piété, une noblesse que les flammes immobiles du soleil couchant magnifiaient encore. De toute la plaine herbeuse, des vapeurs se levaient comme monte un encens, et l’hymne de ces merveilleuses voix semblait l’hymne de la nature qui rend grâces à Dieu de la douceur du soir et du repos que la nuit apportera.
Dans ce hameau perdu de Mandchourie, oh ! ces soldats qui chantaient ! Avant de rompre les rangs, ils chantèrent encore le « Bojé tsaria krani », puis ils regagnèrent leurs wagons.
Et comme l’on sentait bien qu’ils avaient chanté pour eux-mêmes, pas pour nous ! pour eux-mêmes, sans nul souci des passants qui les écoutaient ! pour eux-mêmes, à quelques kilomètres de leurs champs de bataille, près des lieux nourris du sang de leurs frères, où ce Dieu qu’ils imploraient n’avait pas protégé la Russie, où ce Dieu qu’ils imploraient n’avait pas protégé le tsar.
Kharbine.
2 juillet.
À Mandchouria, hier soir, nous avons traversé la frontière. Nous voici à Kharbine. Il fait très chaud ; il fait terriblement chaud. Dans la nuit assez bleue, chacun se met à la recherche d’une chambre et je trouve à me loger au Grand-Hôtel.
Je suis à Kharbine ! Cette ville me semblait figurer un but extrême, un aboutissement, la fin de tout ; elle n’est, en somme, que le terme d’une ligne de chemin de fer et le point de départ d’une autre ligne. Pour y passer la nuit, je m’attendais à une auberge. Je dormirai au Grand-Hôtel. Son architecture indigente et pénitentiaire n’offre rien d’exotique, hélas ! Pas le moindre dragon tordu au coin du toit, pas de banderoles au balcon, pas de lanternes à la porte ! De ces déconvenues, je reste tout ahuri. Sans doute, la Chine sera-t-elle pour demain soir.
Que voulez-vous ! les plus belles choses sont ainsi ! On se les promet à soi-même, on les promet aux autres… pour demain soir ; toujours demain soir, et, le lendemain, la promesse est la même : pour demain soir.
À cette heure, il faut donc que je me contente d’être à Kharbine… et je vais souper. On nous mène dans une grande salle dont le centre est occupé par une table à douze couverts. Là sont assis des gens bizarres : deux en habit, huit en veston, le onzième en redingote, le douzième en blouse noire, – ivres tous les douze, magnifiquement. Dans un coin, le semblant d’un piano résonne comme ferait une plaque de tôle. La « Valse bleue » alterne avec « la Veuve Joyeuse ». Le tapeur s’est adjoint, afin d’augmenter le bruit, un violoniste incertain mais très aigre, dont la noire chevelure s’ébouriffe dans le haut et pend sur les côtés.
Soudain, l’un des convives se lève. Son habit porte sur l’épaule une large tache d’huile, des traces de doigts sales zèbrent de noir son plastron. Il vacille un peu, puis commence un discours en français. Il déplore le prochain départ de l’homme éminent qui préside cette fête, le départ de la femme de cet homme éminent, de sa fille, de son gendre, du délicieux enfant de trois ans, son petit-fils, l’incomparable Walter. Il a déjà des larmes dans la voix. Il parle de la si lointaine Europe ; il s’arrête pour boire ; il parle de la civilisation, du progrès, de l’union des peuples ; il va pleurer ; il parle de l’avenir des chemins de fer, mais s’étouffe bientôt et se rassied.
L’homme éminent veut répondre. Son gilet d’habit est largement déboutonné. N’ayant plus la force de réparer ce désordre, il se croise les mains sur le ventre. Il ouvre la bouche, il la ferme, ses lèvres palpitent, son éloquence est toute prête, mais ne peut s’exprimer. Il fait de grands efforts, il ne parvient qu’à pousser un grognement ; il se rassied, ou plutôt il retombe assis. – Alors, chacun crie « Hurrah ! Bravo ! Hoch ! » suivant sa nationalité… et l’on remplit les verres.
La salle devient toute vibrante d’une forte gaieté. Le chant métallique du piano est cou vert. Des garçons vêtus de robes chinoises, d’autres en habit, vont de-ci, de-là, se hâtent, se bousculent, se querellent. Par les cinq fenêtres ouvertes, de nouveaux bruits se joignent au tumulte et l’amplifient : des hurlements de cochers, un nombreux aboi de chiens, la plainte incessante d’une locomotive qui, dans la gare toute proche, essaye son sifflet.