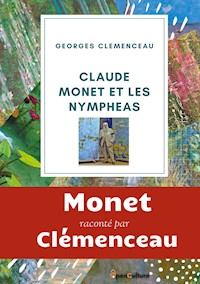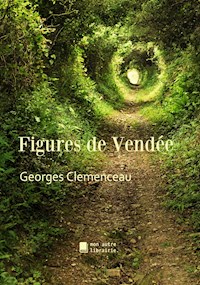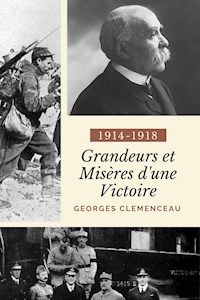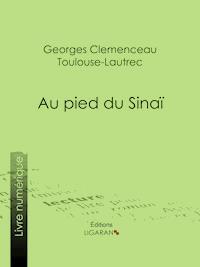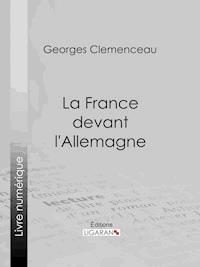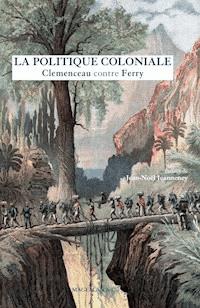7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
En 1909, le gouvernement du Président du conseil Georges Clemenceau est renversé. Le futur » Tigre » de la grande guerre est contraint au » repos « , ce dont il profite pour retrouver les joies de l’écriture journalistique – les premières amours du fondateur de L’Aurore -, et répondre à quelques sollicitations comme celles de venir donner des conférences lors d’une tournée en Amérique du Sud : Argentine, Uruguay et Brésil.
Les notes de voyage prises en Argentine, écrites après-coup à la demande de L’Illustration, sont passionnantes et témoignent des qualités d’observation d’un naturaliste soucieux de ne pas endosser le rôle du donneur de leçon en visite dans un pays neuf. Il ne prend pas la peine de mentionner ses propres conférences sur la démocratie, préférant consacrer toute son énergie et son talent d’écrivain à la description d’un pays alors en plein essor et qui fête en 1910 le centenaire de son indépendance : » Notre infatuation n’admet pas volontiers que nous ayons quelque chose à apprendre de jeunes sociétés dont il nous arrive de parler avec trop de détachement.
Nous ne saurions nier pourtant que leur tentative soit belle, et qu’elle s’achemine d’un pas résolu vers le succès. Les gens et les lieux, les gouvernants et les Indiens, l’architecture et la pampa, l’économie et les espèces sauvages… tout concourt à satisfaire sa curiosité, et la nôtre après lui.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Couverture
Page de titre
PRÉFACE
« À travers les yeux du Tigre… »
Notes de voyages de Clemenceau en Argentine
En juillet 1909, Georges Clemenceau (1841-1929), âgé de soixante-huit ans, figure majeure du paysage politique français et Président du conseil depuis près de trois ans, est contraint, suite à ce que l’un de ses biographes décrivit comme la « chute accidentelle » de son gouvernement, d’interrompre pour quelques brèves années sa tumultueuse carrière politique.
Cette vacance inattendue ne demeurera pas inféconde.
Clemenceau, déjà malade, se repose quelques mois avant de consacrer ce temps soudain libre aux voyages et à l’écriture journalistique, premières amours auxquelles il n’avait jamais complètement renoncé. C’est vers l’Amérique du Sud que le mène ce nouveau voyage, effectué à l’occasion d’une série de conférences que le grand homme est invité à réaliser. S’il accepte sans doute l’invitation tout autant par goût de la découverte de terres nouvelles que par intérêt pécuniaire ‒ comme il le confie dans février 1910 ‒ nul doute que les notes de voyage ici présentées témoignent avant tout de son insatiable curiosité pour l’inconnu.
Rédigé à son retour, à la demande de L’Illustration, ce récit donne ainsi à voir l’Argentine « à travers le regard » de Georges Clemenceau, qui, tout à la joie d’avoir été affranchi de l’immense charge du pouvoir, donne libre cours à ses dons d’observateur et à son talent d’écriture.
De fait, c’est bien en journaliste expérimenté et en voyageur averti que le vieil homme découvre et décrit l’Amérique du Sud. Sa carrière de journaliste ne peut ici être résumée, sinon d’un mot, L’Aurore, journal qu’il fonde en 1897 et qui publiera notamment le célèbre « J’accuse » de Zola. Quant aux voyages, c’est très jeune que ce natif de Vendée regarde vers l’outre-mer. Il passe ainsi, jeune docteur en médecine, près de quatre ans aux États-Unis, où il commence également sa carrière journalistique en relayant les événements qui ont ébranlé le pays.
S’il ne prend pas même la peine de mentionner ses propres conférences sur la démocratie, Clemenceau évoque, dans ses notes, littéralement tous les aspects du pays visité, décrivant avec la même minutie ‒ et la même élégance ‒ les splendeurs du jardin botanique, le statut singulier des Indiens d’Argentine, où le « rite universel » du maté. Après Buenos Aires et les « excès » de son architecture italienne, mais également son port et ses asiles de fous, Clemenceau entreprend d’explorer l’intérieur du pays : les provinces de Rosario et de Tucuman, la Pampa et la marqué pour la nature ; il consacre nombre de ses notes à l’exploitation des richesses naturelles, ainsi qu’à la protection des espèces sauvages.
Néanmoins, ces notes de voyages, écrites après coup, manifestent également une observation minutieuse ‒ et parfois critique ‒ des aspects sociaux et politiques de ce nouveau monde métissé : Clemenceau se penche ainsi sur le mode de gestion des grands propriétaires terriens, mais également sur le gouvernement argentin et sur la vie démocratique du pays, notant à cet égard, à propos des risques de dérives autoritaires, « qu’en aucun pays les institutions ne fonctionnent selon leur pure théorie », et ajoutant, toujours soucieux de conserver un regard critique envers la France et de n’endosser jamais le rôle du donneur de leçons : « Avant de jeter la pierre à l’Argentine, commençons par faire la toilette de notre propre jardin. »
Naturaliste amateur ou fin observateur des caractéristiques politiques et sociales du pays visité, Clemenceau ne se départit jamais d’une posture d’ouverture qui constitue, à nos yeux, une grande part de la valeur et de l’agrément de ces notes de voyage : ce n’est pas en Occidental assuré de sa supériorité que Clemenceau parcourt l’Amérique, et ce à une époque où l’idéologie coloniale et l’ethnocentrisme étaient loin d’être de vains mots mais dominaient les mentalités. Il reste ici fidèle à ses convictions et ne semble pas oublier qu’il fut, en 1885, tombeur du ministère Ferry, précisément sur la question coloniale : « Notre infatuation n’admet pas volontiers que nous ayons quelque chose à parler avec trop de détachement. Nous ne saurions nier pourtant que leur tentative soit belle, et qu’elle s’achemine d’un pas résolu vers le succès. » Bien plus, Clemenceau s’efforce sincèrement de comprendre l’Argentine, fasciné notamment par le phénomène d’« argentinisation » qui permet à cette jeune nation, composée de vagues successives d’immigrants, de conférer aux nouveaux venus un fort sentiment d’appartenance à leur terre d’accueil ‒ concept qui lui donne d’ailleurs l’occasion d’un jeu de mot savoureux et représentatif de sa plume vive, profonde et malicieuse : « Ce qui semble attester, en effet, la puissance régénératrice de cette jeune terre, c’est qu’elle agit de même, en coup de foudre, sur les nouveaux venus d’origine différente. L’Italien, en particulier, s’argentinise bien avant d’être argenté. »
Ces notes, outre l’éclairage qu’elles apportent sur leur prestigieux rédacteur, présentent donc un tableau détaillé et intelligent de l’Argentine en 1910. Enrichies de parallèles passionnants avec les États-Unis ou l’Europe, ces descriptions nous plongent dans le passé d’un pays alors en plein essor qui, à l’occasion du centenaire de son indépendance et de l’exposition universelle organisée à Buenos Aires, a fait appel à des architectes et des urbanistes de toute l’Europe pour doter la ville d’une splendeur égale à celle des capitales de l’Ancien Monde.
Avec une curiosité réjouissante, une ouverture d’esprit et une humilité qui ne sauraient être feintes, Clemenceau explore ainsi « son » Amérique. La fraîcheur de son regard et la justesse de son écriture le pas, et à visiter sur ses traces cette Argentine toujours à (re)découvrir.
Lucie TAÏEB
AVANT-PROPOS
L’Illustration me demande mes notes dans l’Amérique du Sud1. Je ne les ai pas plutôt promises qu’une difficulté se présente : je n’ai point de notes de voyage et je serais bien fâché d’en avoir, car c’est un grand ennui de coucher ses impressions noir sur blanc ‒ toujours pour une manifestation d’impuissance ‒ au moment précis où l’on sent le plus vivement. Je ne dis rien des heures indifférentes où la sagesse est de rester coi.
Ce qui facilita la tâche de Christophe Colomb, c’est que l’Amérique était là, immobile au milieu de la mer, attendant que quelqu’un se donnât la peine de la heurter au passage. Encore ai-je trouvé au Brésil un éminent sénateur de l’État de Saint-Paul, M. Almeida Nogueira, pour soutenir que le principal événement du vendredi 12 octobre 1492 fut la découverte de l’Europe, en la personne du grand Génois, par les Américains d’origine, et qui avaient sur lui l’avantage de ne s’être pas dérangés.
Le plus fort étant fait, que vais-je découvrir à mon tour, au risque de me trouver moi-même découvert ? Des contrées inconnues ? des peuples inédits ? des civilisations vierges ? ou simplement des points de comparaison pour des jugements nouveaux sur moi-volontiers que nous ayons quelque chose à apprendre de jeunes sociétés dont il nous arrive de parler avec trop de détachement. Nous ne saurions nier pourtant que leur tentative soit belle, et qu’elle s’achemine d’un pas résolu vers le succès.
D’un tel résultat, les moins clairvoyants d’entre nous ne peuvent pas se désintéresser. La facilité des communications multipliant les points de contact entre les hommes de tous les pays, l’un de nos premiers besoins se trouve être de rectifier des connaissances imprécises ou fausses sur les divers groupements d’humanité que notre boule planétaire emporte, en des tumultes de joies et de misères, vers des destinées inconnues.
Parce qu’ils échappaient à toute contradiction, les voyageurs des temps anciens pouvaient donner libre carrière à la plus fougueuse imagination. Un proverbe même consacrait leur droit au mensonge, et, quand le bon Hérodote racontait que l’armée de Xerxès, sur son passage, mettait les fleuves à sec, les Athéniens peut-être ne s’étonnaient pas.
Christophe Colomb lui-même mourut dans l’ignorance du continent où il aborda, convaincu qu’il avait rencontré la côte orientale de l’Asie. Aujourd’hui, c’est une autre affaire. Des pôles à la zone torride, d’innombrables investigateurs sont à l’œuvre, qui n’arrivent à reculer péniblement quelque borne de l’Inconnu qu’à la condition de se contrôler sévèrement les uns les autres. Les incidents qui accompagnèrent la découverte approximative du pôle Nord par le commandant Peary ont montré le danger des affirmations hasardeuses, des phoques ou des ours blancs.
Je jouis heureusement du grand avantage de n’avoir rien découvert. Et comme j’ai moins l’ambition d’étonner mes contemporains que de leur suggérer simplement des réflexions au passage, peut-être éviterai-je de froisser cette espèce redoutable de savants qui, ayant des doctrines sur toutes choses, ont tout vu de leur cabinet. Que les statisticiens se détournent de moi ! Je n’enrichirai pas leur littérature. Ne me trouvant tenté d’aucune théorie, je ne saurais céder à quelque propension d’accommoder les faits selon les besoins d’une idée préconçue. Par la grâce de mes ignorances, mon bagage ne s’embarrasse d’aucune démonstration préalablement établie. Et s’il est vrai, comme le dit Voltaire, que la plus fâcheuse inconnaissance soit celle du critique, je confesserai sans peine que ma critique générale des vieilles civilisations me porte à l’indulgence envers ceux qui essaient, loin de l’Europe, de s’engager en d’autres voies.
Je suis de mon temps, de mon pays, et mon temps et mon pays m’ont fait, à la fin d’une carrière déjà longue, des opinions d’où procéderont, comme il convient, des jugements que je soumets à l’appréciation du public en toute tranquillité d’esprit. Rien qui me soit plus étranger que les préjugés courants de Paris sur cette étrange sorte de créatures humaines qui se permettent d’habiter des territoires situés au-delà de Villiers-sur-Marne ou de Saint-Cloud.
Nos journaux satiriques, comme nos comédies, ont fait assez cruellement expier ce crime aux Américains du que l’heure soit venue de les regarder tout simplement, non plus pour nous procurer à bon compte une idée avantageuse de nous-mêmes en dépréciant autrui, mais pour connaître au moins des peuples qui, plus que tous autres, procèdent de notre pensée, et pour nous demander s’ils ne pourraient pas nous être parfois d’un bon enseignement ?
Ce n’est pas en trois mois de séjour qu’on peut recueillir les éléments de formules définitives sur l’avenir de ces vastes territoires où des entreprises de civilisation se poursuivent, et par lesquelles l’équilibre politique et social de la planète ‒ aujourd’hui encore tout européen ‒ sera fatalement déplacé. L’effort est assez grand de dire simplement ce qu’on a vu, car il y a un art de voir comme de dire. Sans avoir la prétention d’y atteindre, je puis concevoir l’espérance qu’une suite de remarques sincèrement consignées attestera la bonne volonté de l’observation et ne demeurera pas absolument inutile pour le lecteur.
Les villes de l’Amérique méridionale, dont quelques-unes fort belles et bien aménagées, ne peuvent, en raison d’une jeune histoire, s’enorgueillir de monuments comparables aux nôtres2. Elles empruntent le plus souvent leur intérêt à la disposition, aux particularités des lieux qui les entourent, et ne nous offrent, en leurs plus brillants étalages, que ce dont l’Europe se plaît à les approvisionner surabondamment. Il reste la terre et forces inexploitées, sollicite de toutes parts des énergies nouvelles. Et comme elle ne vaudra que par le labeur humain, c’est à la valeur d’action résidant en l’homme que tout nous ramène, puisque, dans la profondeur de l’âme nouvelle, à la fois ingénue et complexe, sont inscrits tous les mystères du passé, tous les secrets de l’avenir.
S’il est vrai que la civilisation américaine est d’origine récente, les peuples dits américains, loin d’être en mal de jeunesse, ainsi qu’on se plaît trop souvent à le dire, sont composés d’hommes anciens transplantés, fléchissant, comme nous, sous le poids d’une lourde histoire de gloires et de misères, pénétrés de toutes nos traditions bonnes ou mauvaises, voués à toutes les difficultés qui nous assiègent, mais manifestant leur puissance de vie dans un cadre mieux disposé pour l’essor des énergies nouvelles. Aussi bien, ne manquons-nous pas de distinguer entre l’Amérique latine du Sud et l’Amérique anglo-saxonne du Nord, ainsi que de demander au développement parallèle des deux ordres de civilisation des inductions parfois hasardeuses sur les chances futures des vieilles races historiques dont le sort, aux heures sombres, peut paraître incertain.
Je n’envisagerai que l’Amérique latine, mais sans jamais perdre de vue la grande république du Nord, où j’ai vécu près de quatre années. La pensée que Jefferson, pas plus que Washington, ne purent certainement prévoir l’évolution économique qui, en un peu plus de cent ans, fit de leur innocente république une machine d’humanité formidable, me rendra modeste en mes du « matérialisme historique » de Karl Marx l’intérêt mercantile n’est pas le seul facteur de civilisation, si je recueille de la bouche d’un éminent écrivain du Brésil, M. Arinos de Mello, cette information curieuse qu’en 1780, à mille quatre cents kilomètres de la côte, chez son arrière-grand-père qui n’avait jamais vu l’Océan, une troupe de société jouait les tragédies de Voltaire, j’en arriverai volontiers à conclure que l’influence de l’idée, telle que nous l’avons trouvée dans notre héritage, n’est peut-être ni moins sûre ni moins durable que la puissance même du trafic, créateur des relations humaines. Cela, non pour déprécier l’importance du trafic qui fut, dans ce cas même, le véhicule de l’idée ‒ aussi bien par le bon voilier qui transporta, de Rotterdam à Pernambouc, Mérope ou Mahomet ‒, que par le convoi de mules qui, en une suite de mois, acheva le parcours, mais pour nous rappeler opportunément que l’influence morale n’est pas inférieure en résultats, même à l’intérêt pécuniaire.
Sur trop de points du monde, nous nous sommes laissé devancer dans l’ordre économique. En dépit de nos fautes, notre XVIIIe siècle, et la Révolution qui en fut l’aboutissement légitime, nous ont constitué un patrimoine d’autorité morale que nous devons avoir à cœur non seulement de conserver mais, s’il se peut, d’élargir.
Georges CLEMENCEAU
1. Les Notes de Voyage ont été publiées dans L’Illustration. (N.d.É.) Toutes les notes, sauf indication (N.d.É.), sont de Clemenceau.
2. Il n’est pas rare de s’entendre adresser des propos comme celui-ci : « Avez-vous vu là-bas cette vieille église ? Elle a au moins quarante ou cinquante ans ! »
CHAPITRE I
LA TRAVERSÉE : le départ. — La vie de paquebot. — La télégraphie sans fil. — Escale à Saint-Vincent. — Les poissons volants. — À la lueur des étoiles.
LA TRAVERSÉE
Gênes, 30 juin. Une heure de l’après-midi.
La Regina-Elena est à quai. Un grand bateau blanc qui vomit par ses deux cheminées des tourbillons de fumée noire, cependant que la sirène fait retentir le mugissement familier de l’adieu. Deux passerelles, où malles et passagers s’entrechoquent désespérément, offrent le spectacle disparate des foules en départ. Sous le dais d’ombrelles multicolores, les grands chapeaux des belles Génoises viennent apporter leurs bons souhaits aux petites toques voilées des voyageuses. On s’arrête au plus étroit du passage pour rire et pleurer tout ensemble. Le flot humain endigué s’efforce vainement de rompre l’obstacle, et, selon la violence du courant, le tumulte de plumes et de rubans se voit ramener au quai ou refouler jusqu’au pont, où il achève, dans un brouhaha de gestes et de cris, d’arrêter toute circulation.
Non loin de là, l’émigrant silencieux, pesamment chargé d’indescriptibles fardeaux, fait son chemin vers l’entrepont, traînant après lui vieux parents ou jeune famille. Ne voyez point dans l’émigrant d’Italie en Argentine le fâcheux spécimen d’humanité misérable qui nous est communément représenté. Ce n’est ni plus ni moins qu’un travailleur en déplacement d’hémisphère. Nous le retrouverons tout à l’heure à bord. Très familial, sa particularité est simplement de se déplacer avec femme et progéniture. La différence des saisons lui permet, après avoir couché le blé de la pampa sous sa faux, de revenir faire la moisson en Italie. Souvent il se fixera en Argentine dans des conditions dont je parlerai plus tard et fera souche vivace d’Argentins. Souvent aussi l’amour du pays parle plus haut que l’esprit d’aventures, et les compagnies de navigation s’accommodent volontiers du double voyage.
La sirène a lancé pour la dernière fois son hurlement autoritaire. Les derniers visiteurs ont regagné la terre ferme. Le monstre énorme a glissé doucement. Ce ne sont que mouchoirs agités, exclamations suprêmes qui s’entrecroisent. Nous sommes partis. Adieu !
Le noble amphithéâtre de marbre blanc et de pierres brûlées au soleil se découvre lentement à nos yeux éblouis de chaude lumière. Mais déjà c’est vers la plaine liquide que s’orientent la curiosité, l’espérance de nos regards. Est-ce nous qui fuyons l’Europe ? Est-ce l’Europe qui nous abandonne ? Dès ce moment nous attendons l’Amérique qui doit surgir par-delà l’horizon au jour marqué par la composante des hélices et des vents propices ou contraires.
La première inspection du bateau est éminemment favorable. Excellente installation. Propreté absolue. Service empressé. L’accueil le plus aimable du commandant De Benedetti, galantuomo achevé, qui ne nous cache point ses sympathies françaises dont témoigne notre drapeau au haut du mât. Quinze jours d’une belle prison mouvante, avec des torrents d’air salé pour s’emplir les poumons, et les merveilleux spectacles du ciel et de la mer assaillis d’un tumulte de flèches lumineuses. Les promenades sont de prisonniers condamnés à tourner en rond. Mais aussi longtemps que la terre est en vue, le regard s’oublie aux crêtes bleues qui disent le pays dont, malgré les tours d’hélice, le cœur ne se déprendra pas.
Les côtes de Ligurie dominées des cimes alpestres, la Provence chargée de souvenirs, montagnes bleues qu’assombrit le jour finissant, taches grises qui sont Toulon et Marseille. Par ses petites lames courtes et dures, qui semblent venir du fond, le golfe du Lion éprouve la sensibilité nerveuse du beau sexe, jusque-là fort épanoui. On se retire dans les cabines, d’où quelques bruits sinistres… Passons. Le soleil de demain éclairera la joyeuse hospitalité de Barcelone.
Barcelone. ‒ Jamais je n’avais trouvé tant de charme à la terre. J’ai huit fois traversé l’Atlantique sans jamais éprouver cette sorte de regret anticipé du vieux continent. La jeunesse aspire à l’inconnu que l’âge apprend à redouter.
Déjeuner de passagers en rupture de bateau. Visite à la Rambla déserte et triste sous un ciel gris. On s’attarde à des lettres de première escale, qui ne sont pas encore du voyage et ne sont déjà plus de l’adieu. Un fiacre nous promène au hasard, nous montre des maisons modern style qui sont un outrage odieux à l’Espagne comme à toute l’humanité vivante, ainsi que des façades de couvents où la dernière révolution mit le feu. Enfin nous sommes ramenés au quai où, depuis le matin, des marchands de fruits, pittoresquement accoutrés de rouge et de jaune, ne cessent d’alimenter nos émigrants à qui le règlement interdit de descendre aux escales. En des filets pansus attachés au bout d’une perche, des provisions de victuailles arrivent à la portée des voyageurs de l’entrepont, mais se tiennent à respectueuse distance aussi longtemps que le prix, bruyamment débattu, n’est pas tombé dans le tablier tendu. Mais le signal est donné. La foire grouillante prend fin, et, sans plus de cérémonies, nous reprenons le chemin de l’Océan. Au jour tombant, nous saluons les cimes blanches de la Sierra Nevada, à l’ombre desquelles s’abritent Grenade et l’Alhambra. Nous passerons Gibraltar dans la nuit, et demain au réveil nous n’aurons plus de toutes parts que la monotonie bleue de la mer infinie.
Cinq jours de navigation jusqu’à Saint-Vincent des îles du Cap-Vert. Les passagers se tassent, s’agglomèrent suivant les affinités nationales ou de profession. Allongées en des fauteuils démesurés qui obligent les promeneurs à des exercices de steeple chase, et profondément indifférentes à la commodité d’autrui, les belles dames, drapées de châles et de gazes, essaient de lire et ne réussissent qu’à bâiller. Elles parlent vaguement sans réussir à causer. Les cris des enfants sont une distraction. Un chien mal élevé est un sujet précieux d’entretien. Les hommes s’attablent au bridge, ou vont fumer d’interminables pipes dans le salon d’hiver. Je cueille au passage des bribes de conversations d’affaires.
Les plus hardis se hasardent au footing, mais leur audace choque les douces voyageuses qui prennent leurs aises sur l’unique piste offerte à nos ébats. Bientôt, sous couleur de rafraîchissements ou de five o’clock, des piles d’assiettes, des verres, des carafes, avec des tabourets compliqués et des couvertures pleines de pièges, encombrent le passage, et comme le doux roulement du navire procure à ces objets de soudains glissements, le vieux ou jeune « marcheur » se voit à tout moment en péril de se casser la jambe ‒ ce dont l’insouciance féminine ne paraît point s’inquiéter. Le piano souffre cruellement des coups secs que lui administrent les doigts noueux de l’adolescence. Une Italienne chante. Une Française dessine un groupe d’émigrants.
Ceux-ci ont achevé leurs très primitives installations. Ils paraissent heureux. Très attentif aux siens, le père de famille promène les enfants, joue avec eux ou même leur administre une taloche occasionnelle pour leur montrer le droit chemin. La mère allaite le dernier venu ou lave des linges indescriptibles. Le commissaire me dit qu’il n’y a pas moins de vingt-six nourrices à bord sur six cents passagers de troisième classe. De tout ce grouillement d’Italie, émergent des groupes colorés de Syriens. Les femmes tatouées, fardées, drapées d’étoffes claires, parfois chargées de bijoux d’argent, trouvent d’une grâce naturelle les nobles et graves attitudes d’Orient. Quelques-unes sont vraiment belles en des poses de sensualité passive. On me dit que les Syriens sont les colporteurs attitrés de la pampa. Je visite l’entrepont. Bonne aération, propreté suffisante par le jeu continu de la pompe et du balai. Infirmerie bien tenue. Des femmes attendent un bébé avant le passage de l’équateur. La nourriture est abondante et saine. Le gouvernement italien, par le moyen d’une inspection permanente dont l’agent officiel est indépendant des autorités du bord, veille à ce que toutes les lois sur la sécurité et l’hygiène de cette catégorie de passagers soient rigoureusement observées. D’effroyables abus, jadis, ont nécessité ces mesures dont l’heureuse efficacité est absolue.
Nous attendons l’escale de Saint-Vincent, qui doit couper l’insipide uniformité des jours. Il faut noter cependant que, grâce à la télégraphie sans fil, nous ne sommes plus séparés du monde sur ce radeau de civilisation perfectionnée qui balance notre vie, de jour en jour, entre le ciel et l’eau. On ne peut même se défendre d’un mouvement de surprise lorsqu’on se trouve soudainement en présence d’une enveloppe dûment cachetée en tête de laquelle s’étalent ces mots : Dépêche télégraphique. C’est un souhait de bon voyage qui arrive de France par Dakar. Ce sont des passagers d’un navire que nous rencontrerons demain et qui, gracieusement, nous envoient un coup de chapeau anticipé. À plusieurs reprises, j’ai eu le régal de ces messages qui sont les incidents de la journée. De temps à autre, nous pouvons lire les dépêches des agences affichées au salon. Je laisse à penser si, dans le désœuvrement général, on manque de les commenter. De Saint-Vincent à l’île de Fernando Noronha, poste avancé du Brésil, je ne crois pas, exception faite des bateaux rencontrés, que nous soyons demeurés plus de trois jours hors de la portée des ondes parlantes. Quand la télégraphie sans fil sera obligatoire à bord, l’effroyable catastrophe des collisions en mer sera pour jamais évitée.
Je vais rendre visite au poste télégraphique situé à l’avant sur le pont supérieur. C’est une petite cabine où un aimable employé s’occupe tout le jour à faire jaillir de sa machine des étincelles qui lui arrivent de tous les points de l’horizon dans un bruit strident comme d’une mitrailleuse lointaine. Il ne s’agit point ici de se laisser distraire, fût-ce par la spirale bleue d’une cigarette. Pour avoir fait un faux geste, notre infortuné télégraphiste se trouva avoir annoncé à Montevideo (sans le savoir) que nous étions en danger. Moyennant quoi, à notre arrivée, les journaux nous annoncèrent que le gouvernement envoyait un bateau de l’État à notre secours. Nous connûmes ainsi la douce sensation des périls courus sans peur, tandis que l’employé, coupable d’avoir perdu le fil d’une télégraphie qui n’en avait pas, éprouva du même coup l’ennui d’être déplacé.
Nous ne jouirons pas de l’escale de Saint-Vincent, car nous arriverons dans la nuit. On a beau nous dire que les îles du Cap-Vert sont des rochers arides déplorablement jaunes ; que Saint-Vincent n’offre à la vue que de banales maisons ou cases, accompagnées de l’inévitable cocotier ; que la « ville » est uniquement le séjour de nègres vivant des navires qui viennent charbonner, tandis que les Anglais, importateurs de charbon, véritables maîtres de cette possession portugaise, sont installés dans la montagne, nous ne nous lamentons pas moins sur le contretemps qui nous prive d’une promenade vers je ne sais quel bouquet de verdure planté tout exprès, apparemment pour justifier après coup l’engageante appellation du cap le moins propice à la végétation.
Chemin faisant, nous avons rencontré des roches dénudées qu’on nous a dit être les Canaries. Saint-Vincent, paraît-il, est la répétition « en plus stérile » des Canaries. Je n’ai pas de peine à le croire lorsque, la nuit tombée, la Regina-Elena stoppe au fond d’un grand trou noir piqué de lumières lointaines, dont quelques-unes à l’avant de petites barques ou de remorqueurs traînant les allèges de charbon arrivent en dansant jusqu’à nous.
Soudainement, comme au troisième acte de L’Africaine, sous les ordres d’un invisible Nelusko, nous sommes envahis de bâbord et de tribord par une double ruée de sauvages. Ce sont d’affreux humains noirs, grimaçants, à peine habillés de poussière charbonneuse, qui grimpent comme des singes aux cordages et se laissent tomber sur le pont avec des rires de cannibales. On nous assure toutefois qu’ils n’en veulent pas à notre vie. Et, de fait, ils ne sont pas plutôt parmi nous que, pris soudain d’une timidité inexplicable, ils nous offrent à voix basse, dans une langue où l’anglais et le français font très mauvais ménage, un assortiment de noix de coco, de bananes et de réticules tissés en pépins de citrouille auxquels ils paraissent attacher un grand prix.
Cependant, sur les allèges, déjà leurs camarades sont à l’œuvre, et les sacs de charbon tombent en pluie dans les soutes au milieu d’un ouragan de fine poudre noire qui, malgré portes et hublots fermés, va s’infiltrer jusqu’au fond des réduits les plus secrets des cabines et des bagages.
Demain, il ne faudra guère moins d’un jour pour rendre à la Regina-Elena, sous les pompes, sa primitive blancheur. Que dire de nos vêtements et de ce qu’ils recouvrent ? La mer y passerait sans laver la souillure…
Nous revenons à la vie courante du bord, dont la grande affaire est de connaître le point du midi qui donne la distance parcourue, et permet de raisonner sur la vitesse du bateau comme sur les circonstances qui la favorisent ou la contrarient. Dans la traversée de New York, les Américains du Nord font volontiers de ce chiffre l’objet de paris quotidiens. Je note que l’Américain du Sud se montre moins prompt à ce sport. Ma première impression des familles argentines avec qui je suis nécessairement en contact à toute heure est éminemment favorable. Simplicité, dignité, bonne grâce. Rien des fantaisies de la légende. Sur un seul point, la critique pourrait être justifiée : je crains que les enfants ne soient déplorablement libres de tout dire et de tout faire.
La conversation, désormais, est de la date à laquelle nous franchirons l’équateur.
La Regina-Elena, qui jauge dix mille tonnes, a fait dix-sept nœuds aux essais. Quand elle en donne quatorze et quinze, nous sommes contents. La mer est bien tranquille. Pas d’estomac protestataire. Dans ces parages, les violences de l’Atlantique du Nord sont inconnues. En quinze ou seize jours, nous aurons fait le trajet de Barcelone à Buenos Aires. Une longue tranquillité reposante pour qui sort ou marche à la rencontre d’une vie agitée.
On s’amuse aux ébats des bandes de dauphins qui sont de divines créatures passant des jouissances de l’air aux voluptés de la mer en bandes d’une grâce heureuse. Que de légendes sur ce mammifère, ami du marin dès la plus haute Antiquité ! Il sauve les naufragés, il se rend au charme de la musique. Selon l’hymne homérique, Apollon lui emprunte sa forme pour conduire les pêcheurs crétois aux rives de Delphes où va s’élever son temple. Quelle vérité de souplesse onduleuse en ces admirables bas-reliefs du monument chorégique de Lysicrate où les pirates tyrrhéniens, transformés en dauphins, s’élancent dans l’Océan, comme fiévreux d’une vie nouvelle ! Je laisse parler tous ces vieux souvenirs quand une voix brusquement :
« Il faut tuer toutes ces sales bêtes à la dynamite, car elles ne font que déchirer les filets du pêcheur. »3
Fin des poétiques légendes ! L’amitié de l’homme et du dauphin s’achevant en massacres utilitaires !
La civilisation ne fait pas encore le procès des poissons volants. C’est pourquoi nous pouvons nous ébahir au vol de ces grandes sauterelles de la mer qui s’élancent en troupe pour fuir dans l’atmosphère leurs voraces compatriotes de l’Océan et tachent la grande plaine bleue d’une blancheur ailée. Cela me remet en mémoire l’aventure du navigateur qui obtenait facilement créance lorsqu’il racontait avoir trouvé au fond de la mer Rouge l’un des fers de la cavalerie de Pharaon engloutie après le passage des Hébreux sous la conduite de Moïse, tandis que la rencontre de poissons volants n’obtenait que des exclamations d’incrédulité ! Les hommes ont toujours raconté tant de choses qu’il n’est pas toujours aisé de bien placer son émerveillement.