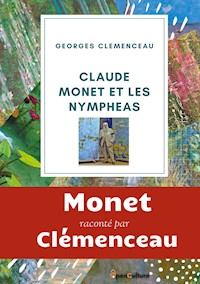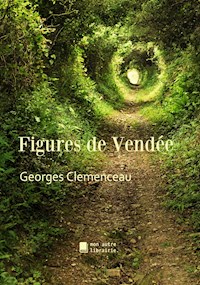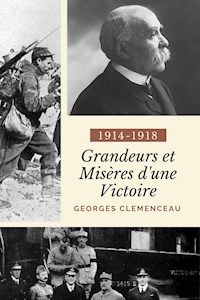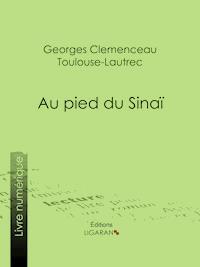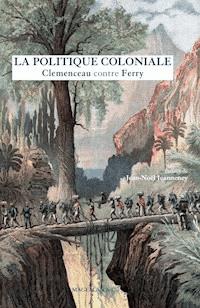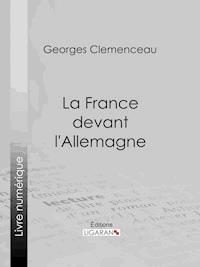
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Scheurer-Kestner fut de toutes les batailles contre le régime impérial. En combattant pour la République, il luttait manifestement pour la patrie elle-même, puisque la France eût été sauvée de Sedan par la chute anticipée du pouvoir absolu."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016437
©Ligaran 2015
La France devant l’Allemagne ! Mes amis Louis Lumet et Jean Martet ont réuni, sous ce titre, une suite de discours et d’articles – quelquefois fragmentés, pour éviter les digressions – aussi bien sur les origines de la présente guerre que sur le développement des hostilités.
Il n’est que trop aisé de noter, au passage, les sentiments, les pensées, que peut susciter d’un patriote français le cours des sanglantes rencontres où le droit, l’honneur historique, la vie même de la patrie sont irréparablement engagés. N’est-ce point présomption d’assiéger le public, en ces terribles jours, d’écrits qui ne furent point destinés à survivre et n’arrêtèrent l’attention que par l’expression authentique d’une sincérité ? Je me suis laissé persuader qu’il pouvait y avoir encore des parties d’intérêt, par la grandeur et l’universalité des causes aussi bien que des résultats du conflit.
Ainsi, j’ai l’audace d’offrir au lecteur une suite d’appréciations discontinues du rôle de la France et de l’Allemagne dans cet énorme choc des vies humaines. Des insuffisances de coordination, en un tel cas, ne peuvent être évitées. Le lecteur pourra facilement rétablir le fil d’une inspiration générale entre des jugements qui doivent finalement concorder par la fatalité d’un même point de vue.
La France devant l’Allemagne ! Ce ne serait pas trop d’une étude approfondie pour camper l’une devant l’autre ces deux personnes « morales » – supposé que cette épithète puisse, en ce moment, s’appliquer à la Germanie. Et voici que, bien loin d’une étude approfondie, je ne saurais offrir au lecteur, en ces fragments divers, que des mouvements de passion combative qui ne sont et ne peuvent être que des parties discontinues de jugements dépourvus d’objectivité.
Il est certain que je ne suis pas désintéressé dans la matière et je serais même bien fâché qu’on le pût croire. J’accepte qu’on n’attende pas de moi la sentence d’un juge en son hermine de parade, ou simplement le doctoral arrêt d’un pédagogue de La Haye. Si les simples d’esprit, trop enclins à se contenter des apparences, s’avisaient de chercher au-delà de ce qu’on leur montre, ils découvriraient bientôt que le juge, sur son siège d’apparat, n’arrive qu’à formuler des décrets de justice imprécise dont toute la substance se fait des jugements vulgaires rendus, au hasard des rencontres, par des passants qui puisent leur autorité dans la libre impulsion d’une conscience indépendante.
Qu’il me soit donc permis d’être un de ces passants : c’est mon titre à être écouté. J’ai l’orgueil de le trouver suffisant, puisque nul, à y regarder de près, n’en peut exciper d’autre. Je suis homme, et je pense. En fasse autant qui peut, et que la vie prononce. Limités mes moyens de savoir, mes facultés de comprendre, mes étalons de valeur. Il faut que je m’en contente, puisque sur les chances d’un arbitrage supérieur, je n’aperçois que des siècles de contestations.
Que cherchons-nous ici-bas ? Le meilleur emploi d’un passage d’existence. Où le trouver, sinon dans un équilibre d’énergies, en nous et autour de nous, qui suppose des pondérations d’activités du dedans et du dehors. Une règle ? Des limites de libertés par des conventions, dites de droit, spécifiant des parts de prérogatives uniformément dévolues à chacun. En dehors, les fatalités de l’homme et de la nature. Heureuses fatalités : l’homme se sacrifie à ses semblables. Malheureuses : il tente de sacrifier d’autrui tout ce qu’il peut, à son avantage.
Toutes les tentatives de bonté, toutes les violences d’égoïsme tour à tour se déploient en une longue échelle de dévouement et d’abus qui vont de l’aide vulgaire au plus beau sacrifice, de la plus spécieuse indélicatesse à la plus atroce brutalité.
Dans le cadre social, il y a, pour le rétablissement d’une apparence d’ordre, des formes de récompenses et des châtiments de fait à fixer selon le dire d’arbitres officiels plus ou moins qualifiés. Ils le font ou prétendent le faire, par le moyen d’une sanction de la force, qui est l’ultime raison des choses. Dans le cercle autrement vaste des nations, – l’homme demeurant le même de quelque point de vue qu’on l’envisage, et le domaine du droit se trouvant, ici, beaucoup moins nettement précisé – il éclate, parfois, d’une frontière à l’autre, des crises de forces brutales que l’idéalisme le plus idéaliste a vainement, jusqu’à ce jour, prétendu réprimer ou, même, simplement réglementer.
C’est ce qu’on appelle la guerre, c’est-à-dire de sanglantes rencontres où des peuples s’engagent, sous des prétextes divers, dont la cause profonde est généralement de s’agrandir aux dépens du prochain. Antiques ou modernes, toutes les guerres sont de même essence, de mêmes impulsions natives, de mêmes procédures sommaires pour remplacer un ordre appréciable de vie par une dévastation de la terre, par un effroyable anéantissement de l’humanité dans une convulsion de mort. Car l’homme n’aura divinisé sa « Création » que pour détruire tout ce qu’il en pourra du suprême couronnement.
De l’innocent anthropophage des premiers jours aux quatre-vingt-treize intellectuelles de Guillaume II, il n’y a qu’une excuse de degré, dans le besoin d’accroître certaines vies aux dépens des autres. Suprême argument du grand fauve contre le petit. Seulement l’homme, petit ou grand, est une sorte de fauve qui, pour le mal ou pour le bien, s’ingénie à accoître ses moyens d’attaque et de défense. C’est la philosophie de ce qu’on appelle la civilisation – une évolution générale de tous les égoïsmes ou efforts d’accommodation. Je ne cherche pas où le phénomène nous conduit, puisque, à cette heure même, la question se débat sur les plus grands champs de bataille où les hommes se soient jamais rencontrés. Étonnant paroxysme des soubressauts d’humanité, qui marque peut-être une crise d’où pourraient jaillir des âmes autrement disposées.
Restons dans le moment actuel où nous voyons mûrir les fruits d’un labeur de l’esprit humain au cours de quelques milliers d’années. Ce qui me frappe, surtout, dans l’aventure énorme de ces jours, c’est que, trompés par les mots, nous avons été, et sommes, probablement encore, les premières dupes d’un verbalisme de civilisation qui nous fait vivre d’une phraséologie humanitaire, en cruel désaccord avec la réalité.
Comment dire le temps où la guerre se distingua de la paix, où l’homme en vint à discerner l’impulsion de violence d’un état de sécurité plus ou moins durable, dont les conditions ne furent que confusément démêlées ? La paix ne fut, d’abord, qu’un entracte de belligérance, tandis qu’il nous semble aujourd’hui que la guerre ne soit plus qu’un intermède entre deux paix. On conçoit que l’idéologie ait été ainsi conduite à rêver d’une suppression de l’emploi de la force entre les sociétés humaines, sans s’arrêter devant l’abîme qui sépare l’homme parlant de l’homme vivant.
L’homme parlant, il est vrai, fait résonner le mot droit, formule magique d’un idéal d’équité dont rien ne lui fournit le spectacle sur la terre, mais où chacun, par cela même, peut installer son rêve d’absolu à la mesure de ses besoins de théologie. L’homme vivant conçut une grande fierté du verbe, mais n’en sut pas plus faire usage qu’un enfant d’un instrument de labeur au-dessus de ses moyens. Ainsi le droit prit rang dans le cortège de nos divinités inaccessibles. Quand le Dr Le Bon a dit que le droit n’est qu’une force qui dure, il a cruellement disséqué l’un de nos derniers Dieux. Sacrilège, d’analyser sa Divinité ? Les Dieux ont passé, porteurs de bien et de mal, selon ce que peut tirer de leurs oracles l’intelligence, plus ou moins compréhensive, du Fidèle. Les plus grands ont marqué des étapes d’histoires, belles quand les principes furent dits, sombres quand il fallut les appliquer.
La religion du droit n’a pas eu, jusqu’à ce jour, d’autre destinée. Elle a partout des autels. Chacun s’offre en sanctuaire, si profondément empreint de la suprématie de son droit qu’il lui arrive d’oublier celui des autres. Renouvellement de mots plutôt que d’objectivités. Les hommes, tous, ont séculairement dépensé des trésors d’idéalisme verbal à traduire en massacres des aspirations de bonté, parce qu’il n’y avait pas, à leurs yeux, de plus grand crime que des contestations d’idéologie. Socrate, sage, disait son Dieu sans essayer de le prouver. Dans la libre Hellade, il n’en paya pas moins cette présomption de sa vie. On sait assez ce que l’Évangile d’amour nous apporta de sang répandu.
De tant de libertés de conscience sauvagement méconnues le sang généreux d’innombrables martyrs a fait naître une moisson de Droit universel, extérieur aux croyances, aux facultés de raison elles-mêmes, c’est-à-dire une égalité de conception humanitaire dans la naturelle inégalité des individus. Ce Droit de la Créature à venir, n’est-ce pas le Dieu de l’Évangile moderne que M. Gustave Le Bon ne fait que ramener à la source même de toutes les Divinités de la terre, en l’identifiant avec la force permanente des choses, d’où découle toute subordination des êtres ? Pas plus dans la doctrine nouvelle qu’en les autres théologies, on n’a pu déterminer l’indéterminable, toucher du doigt l’intangible, atteindre et fixer ce qui fuit. Comment que les hommes aient dénommé la force universelle, et de quelques rites qu’ils aient obscurci la décevante image, cela ne les en a pas rapprochés. Peut-on donc faire entrer, dans les déformations de l’existence objective, les plus hautes conceptions de notre esprit ? Dieu, ou « Droit non écrit », comme dit l’Antigone de Sophocle, manifeste des états de conscience en quête d’un point d’appui, comme la mythologie grecque avait besoin d’Atlas pour supporter « le monde ». Suspendue dans l’espace, sans soutien apparent, notre planète n’en est pas moins conduite par un jeu de forces passagèrement équilibrées qui lui procurent l’orgueil d’une tâche d’un jour dans l’Infini. Ainsi de nous-mêmes, produits d’activités contradictoires, suspendus entre l’être et le non-être par des puissances d’opposition dont nous cherchons vainement le secret, en des mots qui nous procurent l’illusion d’une raison d’être.
Le Droit est le dernier venu de ces Dieux invisibles, celui dont la règle d’universelle équité ne s’arrête à aucune distinction d’idéologie dans les groupements de l’Espèce humaine. Il n’y a point de Schibboleth pour son sacré pouvoir. C’est une grande supériorité. La réalité en est dans notre esprit, comme disait Abélard. Cela vraiment peut nous suffire, puisqu’il s’oppose à la force, et ne se l’assimile que pour la réglementer.
Il en reste pourtant ce phénomène humain, que le rite cultuel, comme dans le cas des Divinités d’autrefois, l’emporte trop aisément sur l’acceptation des contraintes de la règle. Combien n’est-il pas plus aisé de prendre part aux cérémonies que de pratiquer ce simple texte : Aimez-vous. Dans l’assentiment universel à cette haute maxime se rejoignent les plus hautes intelligences et l’instinct spontané des masses obscures. Dans l’ardu passage de l’idée à l’action, des énergies se dépensent en brillantes bulles de mots que tout contact de réalité crève. Les prédications du Christianisme ont annoncé la grande paix humaine. L’homme profond, inchangé, a maintenu la guerre et la haine, accrues encore de querelles sectaires, et la Révolution française, elle-même, du même coup, dressa l’autel de la Liberté et les échafauds. Trop profondes chutes après des ascensions trop hautes ! L’honneur et la misère de l’homme sont de ne pouvoir renoncer aux sommets.
Toutes les religions sont belles, considérées comme des explosions d’espérances de plus en plus hautes, à mesure que le développement de l’esprit accroît le champ des visées. Une petite association de croyants, comme jadis en Galilée, même cherchant à fondre les hommes, n’aboutira qu’à les diviser, tandis que le culte du Droit unissant tout l’ensemble des créatures humaines, sans aucune distinction de foi ou de pensée, doit apparaître, d’abord, comme un suprême élargissement d’horizon. Qui dit espérance, dit déchets. Cependant, de tant d’espérances successives dont le flot incessant a balayé la terre, des formations concrètes d’hommes meilleurs ont partout émergé. D’où le plus sûr de notre vie, d’où le plus beau de ses extravagances d’idéal, d’où le plus sage, aussi, de ses entreprises de raison.
Aujourd’hui nous savons qu’il n’y a pas de formule sociale du bonheur, nous savons que des règles de justice générale et particulière, si efficaces qu’elles soient, ne font que nous créer de plus équitables conditions de luttes, ce qui n’en est pas moins un avantage à rechercher. Nous savons que la paix universelle ne s’est encore montrée que dans des discours, tandis que, sans relâche, les tumultes sanglants de la guerre déchirent l’humanité. Nous avons vu bâtir des temples à la Déesse Paix, pour des rites d’adoration qui seraient innocents s’il n’y avait toujours une source d’erreurs dans les déformations de la réalité. Nous n’avons point de mal à dire de l’arbitrage du Droit entre les Nations. Mais il faut croire que la foi dans ce souverain bien n’est, pas débordante, puisque les civilisations du Droit, les plus ferventes à l’oracle de La Haye, n’ont cessé de rivaliser dans la fabrication des engins de guerre dont nous avons, nous-mêmes, présentement, un assez bel emploi.
Qu’est-il donc arrivé ? Mais, ce qui est toujours arrivé depuis que l’homme a paru sur la terre, à savoir que, sous le régime du Droit verbalement institué, comme parmi les rites du tous les autres cultes, des entreprises de violences se sont préparées, organisées, déchaînées dans un éternel renouveau de fureur. Où l’Évangile avait failli, le code, qui ne recommanda le Droit que sous la menace d’en réprimer la violation, n’a jamais abouti qu’à des sanctions plus ou moins chanceuses. En l’absence d’un code des Nations, dont la sanction ne pourrait être que de contrainte armée, il ne reste à chacun – Droit international ou non – que la sagesse de se garder. C’est le régime sous lequel nous vivions depuis que les deux premiers fils d’Adam eurent des difficultés.
Tandis que, tout à la métaphysique des théories, les internationalistes du pacisfime universel négligeaient la précaution élémentaire de proportionner les moyens de la résistance aux moyens de l’éventuelle offensive, un peuple d’Europe, « christianisé », « civilisé », célébré par quelques-uns comme une des plus hautes personnifications d’idéalisme, se cristallisa dans le rêve non plus seulement de conquérir, selon la tradition universelle, de conquérir des parties plus ou moins grandes de territoires, mais de s’approprier, avec le sol, tous les éléments de vie indépendante des peuples, proches ou lointains, dont une aberration féroce d’égoïsme pouvait s’accommoder. Renouveau d’appétits monstrueux depuis que la terre a des annales. Alexandre, César, Pyrrhus, Napoléon, eurent des heures de ce délire – promptement éveillés aux résistances de la nature et des peuples, dont la loi est d’une compensation de forces sous la règle des fatalités supérieures d’où notre Droit n’est pas exclus.
Modestement Frédéric II se bornait à croire que tout lui était permis. En dégénérescence d’une hypertrophie de brutalité, Guillaume II en vint ingénument à dire que tout lui était recommandé, imposé même, par je ne sais quel vieux fétiche allemand de la Barbarie. Dans son vertige, il ne vit que la race jaune pour l’arrêter, et ne put se tenir de lui adresser, à ce sujet, quelques malédictions. À l’égard de la race blanche elle-même, pour laquelle il ne pouvait se défendre d’une considération, puisqu’elle participait déjà de la noblesse germanique par son asservissement anticipé, tout au plus pouvait-il consentir à distinguer. Le Latin l’amuserait, le Slave recevrait de lui des méthodes de sentir, de classer des actes « organisés » ; l’Anglais pourrait offrir à l’exploitation allemande un assez beau lot d’énergies ; le « vieux Dieu » de la Germanie, par Bagdad, cousinerait avec Mahomet, Bouddha, Vichnou. Convenablement martelé par le fameux « poing de fer », l’homme jaune lui-même finirait par se soumettre à sa destinée. Sans armée, l’Amérique pourrait être cueillie au retour. Et les temps seraient accomplis, l’insuffisance des moyens de communication ne permettant pas encore d’étendre les bienfaits du pangermanisme au-delà de notre atmosphère. L’instrument de cette conquête universelle ? Le peuple allemand tout pénétré de l’esprit de servitude volontaire pour la féerique domination de ses maîtres dont des profits lui seraient laissés.
Le moyen ? La restauration du culte de la force brutale, unifiée, concentrée en une race de violence sans contrepoids de droit d’humanité. Il y fallait une reprise d’absolutisme et de servage efficacement coordonnés, une reconstitution de toutes les brutalités instinctives, soutenues de toutes les lâchetés « civilisées » pour l’installation de la loi suprême du fer contre le Droit terrassé.
Et tout cela fut dit, avoué, proclamé, et tout cela serait, si la force brutale pouvait tout accomplir des destinées de l’homme, par l’implacable décret de la victoire allemande arrogamment prédite, mais non réalisée.
Ainsi se déchaîna la plus grande et la plus furieuse bataille des hommes sous le soleil. Tout un peuple ignoblement dressé à ne rien comprendre, à ne rien aimer que la force sauvage dont il acceptait de demeurer la victime, pour la joie d’en être l’instrument contre autrui, fut lâché sur l’Europe, comme une irrésistible machinerie de mort à tout dévaster.
Rendons-lui cet hommage qu’il accomplit sa fonction à souhait. Les villes, avec leurs plus beaux monuments de l’histoire, leurs plus précieux trésors de science ou d’art, ont flambé sous sa torche de culture ensanglantée. Destruction du plus humble foyer aussi bien que des plus nobles demeures, pillage, vols, assassinats, massacres en masse après d’innommables supplices de barbarie raffinée, les pires outrages à la créature humaine, les plus révoltantes ignominies de la fête en délire : tel est en deux lignes le bilan de ces brutes en œuvre de Germanisation « intellectualisée ». N’ont-ils pas tailladé, martyrisé des femmes, des enfants ? N’ont-ils pas nargué de leurs hoquets d’immonde gouaillerie les passagers du Lusitania, sombrant sous la torpille de leur piraterie ? À leur compte il ne manquera aucun avilissement de dégradation.
Comment comprendraient-ils lorsqu’on leur reproche d’avoir violé la neutralité du territoire belge ou du Luxembourg, lorsqu’on essaye de leur expliquer que sans le respect des traités, sans l’observai ion de la foi jurée, il n’y a plus de Droit entre les Nations, plus d’ordre humain de dignité. Ils ne pourraient trouver qu’une réponse : « Nous étions les plus forts. » Brutes qui ne savent même pas que la force brutale elle-même a des retours, ainsi que nous sommes en voie de le leur démontrer.
Quel autre argument leur faire entendre que celui d’une opposition de force contraire ? Il faut bien accepter la contradiction dans la seule force où elle puisse forcer l’accès de ces « intelligences » figées dès la règle primitive de force effrénée où l’homme des bois est, seul, excusable de s’être fixé. L’opposition d’une puissance du Droit en armes, à la suprématie sauvage de la massue.
Cette force opposante, la géographie, et l’histoire en ont assigné le rôle à la France en qui des rencontres de races acculées à la mer sont venues fondre le robuste empirisme du Nord et les impulsions d’idéalisme du Midi. Les Alpes, le Rhin, l’Océan, bords ravinés d’une grande cuve fleurie, où s’est accomplie une fusion d’humanité dont un peuple d’esprit clair est sorti. Une histoire auguste en fit, aux temps anciens, le soldat de Dieu, puis le champion des Droits de l’Homme : ce que la survivante barbarie ne lui a pas encore pardonné. Tout l’offrait aux chocs des organisations de basse violence vouées à la destruction du droit humanitaire en quête de ses voies.
Seulement, désormais, de grands alliés lui sont venus – apaisés, après tant de guerres fratricides, par de hautes communautés d’intérêts que domine un suprême besoin d’indépendance, de dignité. Ainsi la France devant l’Allemagne, ce fut le raccourci d’une rencontre d’humanité si compréhensive que la formule exprime désormais la révolte de l’Europe, de la civilisation – de l’Europe, mère de tous les bienfaits profonds de la vie, qui se dresse devant l’achèvement d’une technicité de sauvagerie. La plus grande bataille des hommes, la plus grande bataille par le nombre des combattants, par l’effroyable puissance de leurs armes, par le raffinement d’atrocités et de dévastation, où se complut « une culture » de barbarie doctrinant son mépris des droits des individus et des peuples, la plus grande bataille enfin par l’enjeu du combat : l’exaltation ou l’avilissement de l’espèce humaine. N’est-ce pas ce que résume vraiment ce mot : la France devant l’Allemagne, c’est-à-dire, aux deux pôles de l’histoire, l’affrontement des deux nations représentatives du bien et du mal.
La tragédie sanglante a suivi son cours. En un temps où nos pères croyaient avoir chèrement conquis la douceur d’espérer qu’une généralisation suffisante du commun droit de tous assurerait désormais l’évolution des peuples dans un ordre d’indépendance, l’Allemagne a décidé qu’elle jouerait d’un seul coup non pas contre nous seuls, mais contre tous les peuples de la terre les chances du non-droit tout entier. Avec le succès dû à la technique de ses préparations, elle a incendié, ravagé, pillé, détruit tous les foyers de civilisation offerts, par la fortune, à son génie dévastateur. Elle a bestialement violenté, massacré, supplicié des créatures de faiblesse, sans que jamais sa fureur pût être assouvie. Elle a renié le texte écrit de sa foi, déchiré le pacte d’honneur où elle avait apposé sa signature, dans la pensée que la force du fer devait tout absoudre, et terrorisé les neutres jusqu’à leur imposer parfois un silence dont plus tard ils pourront rougir.
Par une dérision suprême, voici que des hommes de « science » – c’est le nom qu’ils se donnent – ayant conquis, par le labeur, un prestige d’autorité, nous font une doctrine de philosophie, à l’usage du banditisme supérieur, pour nous expliquer que, dans l’ordre nécessaire des choses, la brutalité bestiale n’est qu’une manifestation d’une suprême harmonie. Ils annoncent, en des formes de raisonnement, que, par la vertu d’une lame ensanglantée, le droit humain doit aller dormir, maintenant, au cercueil des antiquités. Car une pitié germanique les meut à se montrer impitoyable, pour abréger les misères de l’homme dont ils décrètent le massacre en vue d’abolie, sans délai, rattachement des âmes à ce Droit pour lequel tant de fous se sont fait gloire de vivre et de mourir.
Tout cela est écrit, enregistré en des actes que nul ne peut reprendre, et, pour un suprême élan de carnage humanitaire, l’Allemagne a trouvé la somme d’énergie continue qui lui a permis de conduire, après un demi-siècle de préparations, la plus grande entreprise d’abaissement humain sous le couvert d’une suprématie « d’intellectualité ». Les vieux despotismes de l’Asie avaient, au moins, l’excuse des commencements. Celui-ci prétend achever l’œuvre douloureuse des lentes émancipations de l’esprit par une régression féroce aux bestialités de la sauvagerie.
L’homme ne serait sorti de l’inconscience des choses que pour l’affreuse sensation d’un effort de noblesse couronné d’un abaissement nouveau dans l’échelle des dégradations. Tant de siècles d’obscurs supplices et de glorieuses misères, dans l’espoir incertain des hauteurs, pour se voir rejeter, il un seul coup, au plus bas des gouffres sans fond. L’insolente sommation nous est adressée de recevoir, de solliciter en bienfait, le stigmate d’une abjection suprême pour nous et pour ceux qui viendront. Abdiquer toute aspiration de beauté, de grandeur, d’espérance ? Nous n’avons pas consenti : il faut donc que, de l’Allemand ou de nous, l’un des combattants soit réduit à baisser la tête. La nôtre n’est pas faite pour le joug.
S’il ne s’agissait ici que de recueillir des manifestations de colère à l’égard d’un peuple contre qui la France est en bataille, cela ne suffirait peut-être pas à tenter le lecteur, même au plus fort de nos misères. Mais quoique la véhémence de ma passion française n’ait point à s’excuser, peut-être voudra-t-on bien reconnaître que j’ai tenu, tout en restant de ma patrie, à ne me point détacher des vues qui sont d’un citoyen de l’humanité. Je suis et je demeurerai, quoi qu’il arrive, humanitaire, puisque je suis Français – comme l’Allemand, quoi qu’il dise, se figera, longtemps encore, dans le culte d’un fétichisme de violence primitive, le seul culte par lequel la bassesse de son ambition l’ait encore préparé.
C’est du point de vue français que je juge l’Allemagne. C’est de ma conscience d’homme que lui vient sa condamnation, car, selon le mot de Pascal, qui veut se mettre « au-dessus de tout » se met au-dessous. Qui donc, entre les peuples, s’arrogera le privilège d’établir une hiérarchie sur d’autres fondements que ceux des services rendus à l’universalité de la grande famille humaine ? La France se présente en assez bonne place, à ce concours. Quel sauvage, s’arrogeant la primauté des Nations, voudra, pourra l’éliminer, la rayer de la liste des peuples, c’est-à-dire de l’histoire future, pour une insuffisance d’histoire passée ?
Il serait curieux d’entendre la digne progéniture de l’ancien électeur de Brandebourg – qui ne compta pas, que je sache, parmi les lumières de son temps – venir soulever cette question à Rome, à Londres, à Pétrograd, à Paris. L’Allemagne présente alléguerait-elle que la venue de Bismarck l’a transformée ? Le « transformateur » à rebours n’est-il pas, au contraire, en la légitime descendance de Frédéric II, avec de moindres ouvertures ? On ne nous trouvera certainement pas dans le cours de cette lignée. Des rôles différents, pour des esprits divers. Nous n’avons besoin de supprimer aucun peuple de la planète. Il nous suffit pour marquer, pour garder notre place, de n’être pas supprimés. C’est tout le droit que nous réclamons, mais nous le voulons tout, dans la plénitude de l’indépendance nationale, dans l’achèvement des droits qui font la dignité.
J’ai vu, depuis un demi-siècle, se dresser devant nous la menace du peuple meurtrier. Je l’ai dénoncée sans relâche aux imprévoyants qui, jusqu’à la dernière heure, n’ont pas voulu savoir, et qui, de par l’autorité que leur a conquise cette imprévoyance, me refusent le droit de montrer la continuation des fautes d’hier dans les fautes d’aujourd’hui. Et quand le peuple meurtrier est devenu le peuple assassin, le peuple violateur de tous les droits de la nature humaine, j’ai poursuivi ma tâche, j’ai parlé, j’ai crié. Le cri de la victime est la première attestation du crime, le jugement, la condamnation de l’homme encore rouge du sang versé.
On m’assassine dans ce que j’ai de plus cher, dans ma patrie de terre, de sentiments, de pensées. On m’assassine dans le culte d’une beauté nationale d’être et de manifester, dans la fierté d’une vie commune, un légitime orgueil de consciences diverses fondues en l’unité.
On m’assassine dans mon droit de vivre, dans la vertu de mon sang, dans l’irrépressible besoin de me développer, au cours des âges, selon les traditions et les mœurs d’une histoire à laquelle, par les miens, j’ai participé – non la moins noble partie, peut-être, des gestes de la race humaine.
On m’assassine, dans le plus beau des espérances qui guident l’homme aux détours périlleux d’une destinée dont l’énigme est peut-être de n’être que ce qu’elle est – plus précieuse, pourtant, en ma folle tentative de l’honorer.
On m’assassine, et je me défends au déplaisir de quelques faux neutres qui dissertent sur la manière la plus congrue de me laisser assassiner.
La France se défend, et d’autres, avec elle : tous ceux qui ont été des guides, des soutiens, des porteurs de pensées, tous ceux qui, parce qu’ils sont dignes de vivre au plus haut de la vie, ne peuvent pas mourir d’une mort qui, par le prochain écrasement des neutres, serait celle de l’homme civilisé.
G.Clemenceai
… Scheurer-Kestner fut de toutes les batailles contre le régime impérial. En combattant pour la République, il luttait manifestement pour la patrie elle-même, puisque la France eût été sauvée de Sedan par la chute anticipée du pouvoir absolu.
… C’était le temps des jeunes enthousiasmes. En nos cœurs se levait l’espérance radieuse des grands jours qui par nous devaient renaître. Par nous, la France, redevenue la patrie des droits de l’homme, allait retrouver, aux applaudissements des peuples fraternels, la grandeur morale des anciens jours.
Aux invocations ingénues de ce beau rêve, ce fut la guerre qui répondit. La guerre et l’écrasante défaite, la guerre et le démembrement.
Dès le lendemain de Sedan, Scheurer-Kestner était aux côtés de Gambetta, et jusqu’à la chute de Paris il consacra toutes ses forces au développement de la fabrication des munitions de guerre.
L’armistice conclu, l’Alsace, en sa suprême manifestation de vie française, élut Scheurer-Kestner pour l’un de ses représentants à l’Assemblée nationale. Je le revis à Bordeaux quand sonna l’heure affreuse du grand déchirement. Français d’Alsace, il tenait par toutes les fibres de son être à cette terre aimée où se heurtent flux d’Orient et reflux d’Occident, avec des fortunes changeantes. Il sentit donc avec un particulier raffinement de douleur l’atroce misère de la mutilation. Il ne pouvait se détacher de la France…
À quelques mois de là, je le retrouvais à Thann frappé en plein cœur, mais toujours doucement stoïque et confiant dans l’avenir. Nous évoquions le souvenir de la paisible vie d’Alsace aux anciens jours, quand, le soir, j’accompagnais la famille, dans le silence de la neige, aux répétitions des sociétés chorales, dans ce pays traditionnel de l’art du chant. Là, ouvriers et patrons, amicalement réunis, échangeaient leurs sensations d’art, confondaient sentiments et pensées dans l’amour de la commune patrie.
D’autres temps étaient venus. Je fis avec Scheurer-Kestner le dur pèlerinage de Belfort, de Strasbourg, ravagés par l’ouragan de fer et de feu. En proie à quels sentiments ? Interrogez vos cœurs.
Et pourtant, sur ces ruines fumantes, Scheurer-Kestner disait bien haut son invincible espoir en l’avenir. Il voyait la France retrouvant, multipliant ses forces dans une paix de travail, dans le patient effort de chaque heure, obstinément tendue vers la réparation des maux, de tous les maux, par l’organisation, par le développement d’une démocratie de justice et de fraternité.
… Messieurs, je n’ai pas craint d’évoquer la mémoire de ce passé sanglant. Soucieux de la responsabilité qui s’attache à ma fonction , j’ai pu parler sans contrainte d’évènements qui sont entrés dans l’histoire et proclamer des sentiments que nous ne pourrions répudier, ni même dissimuler, sans nous avilir. Quand nous rendons hommage à un noble Alsacien qui a honoré la France, quels hommes serions-nous si nous étions capables d’ignorer l’Alsace de l’histoire ? Cela, nul n’a le droit de nous le demander.
Sans doute, on a dit que le silence, en un tel cas, reste la meilleure sauvegarde d’une ombrageuse dignité. Il me semble plutôt que notre dignité ne serait vraiment atteinte que si l’on nous voyait bâillonnés de nos propres mains, quand nous pouvons, sans crainte d’une interprétation malveillante, donner libre cours aux sentiments que cette journée nous suggère.
Tous les peuples ont connu, tour à tour, l’orgueil des victoires et l’humiliation des défaites, et, dans le malheur, plus encore que dans les triomphes, s’est créé, par le rapprochement, par la fusion des âmes, le meilleur peut-être de la commune patrie. Si le péril de la victoire est dans la tentation d’abuser, c’est dans la résistance aux coups de la fortune que se trempent les courages, que se bandent les ressorts de la vie. À chacun de se maintenir dans l’intégralité de ses énergies, pour la grande lutte de prééminence morale où forts et faibles d’un jour trouveront ample matière au développement de leurs plus hautes facultés.
En ce noble concours, dont la condition première est la paix, nous apportons les bonnes volontés d’un peuple et d’un gouvernement soucieux de mener à bien une entreprise ardue : l’établissement d’une démocratie organisée. Tous, pour cette œuvre immense, qui exige la plus difficile concentration d’énergies méthodiques, ont le même besoin de paix. Et parce qu’ils sont au plus fort du labeur, les gouvernements démocratiques se trouvent nécessairement moins enclins que tous autres aux coups d’aventure d’où la guerre pourrait sortir.
On s’accorde à reconnaître que la politique française est exempte de menaces et de provocations. C’est qu’elle s’appuie sur le fondement solide d’une juste réciprocité. Comme nous réclamons le respect des traités à notre égard, nous entendons donner nous-mêmes l’exemple d’observer loyalement les stipulations qui nous engagent.
Nous avons reçu la France au sortir d’une effroyable épreuve. Pour la refaire dans sa légitime puissance d’expansion, comme dans sa dignité de haute personne morale, nous n’avons besoin ni de haïr ni de mentir : pas même de récriminer. Nos regards vont à l’avenir. Fils d’une grande histoire, jaloux des belles impulsions natives où se forma la vertu civilisatrice de la France, nous pouvons regarder dans la quiétude de notre âme les descendants des fortes races qui se sont mesurées, depuis des siècles, avec les hommes de notre terre, sur des champs de bataille dont on ne peut faire le compte. Deux grands peuples rivaux, pour l’honneur même de leur rivalité, ont le même intérêt à garder le respect l’un de l’autre.
Quelle diminution dans notre propre estime, comme dans celle d’autrui, si nous n’osions donner libre cours aux sentiments qui font irruption en nos cœurs, quand nous nous heurtons, devant cette pierre, aux souvenirs d’une glorieuse histoire de deux cents ans, où nos pères ont inscrit l’immortelle épopée de la Révolution française ! Deux cents ans de vie commune au point culminant de la civilisation ont autrement fondu mœurs, sentiments, pensées, tout ce qui détermine un solide amalgame d’humanité, qu’aux âges où l’esprit moderne était à peine en voie de formation. Nous avons reçu. Nous avons donné. Communes furent les joies et les douleurs, communes les gloires et les misères d’où le magnifique mouvement de la civilisation moderne a surgi.
L’héroïque effort de la grande libération humanitaire, où se caractérisa si remarquablement l’esprit français, et l’épique chevauchée de guerre, qui en fut le contrecoup, ont magnifiquement forgé dans l’enthousiasme et dans le sang toutes ces âmes enfiévrées.
En tous les domaines de notre activité nationale, l’Alsace et la Lorraine avaient conquis une place éminente. Dans la guerre surtout, car de tout temps les hommes des marches furent prompts aux combats. L’Alsace enfanta jusqu’à des marins, comme l’atteste encore la statue de l’amiral Bruat sur la place publique de Colmar. Metz nous a donné Fabert, aussi grand soldat que grand citoyen. Sous le marbre de Pigalle, Strasbourg a gardé le vainqueur de Fontenoy, le plus remarquable exemple de naturalisation française spontanée.
Mais aux guerres de la République et de l’Empire où s’affirma la France moderne et une incomparable suite de faits d’armes, il était réservé de nous offrir une rare floraison de guerriers d’Alsace et de Lorraine. Beaucoup de premier rang, dont les noms sont inscrits sur l’Arc de triomphe. Quarante généraux, tout un peuple aux champs de bataille !
Grands cœurs, qui, de leur sang, nous ont fait la patrie !
Que ne puis-je les citer tous ?
Kellermann (de Strasbourg) en mourant veut que son cœur soit déposé sous l’obélisque de Valmy, avec cette inscription : « Ici sont morts les braves qui ont sauvé la France au 20 septembre 1792. »
Westermann (de Molsheim), traduit avec Danton devant le tribunal révolutionnaire, s’écrie : « Attendez au moins, pour m’envoyer à l’échafaud, que mes sept blessures, reçues toutes par-devant, soient cicatrisées. »
Ihler (de Thann) fait l’admiration de ses chefs à l’attaque des lignes de Wissembourg : glorieux ancêtre du jeune capitaine récemment mort à l’ennemi sous le drapeau français.
Bouchotte (de Metz), ministre de la guerre, seconde puissamment le comité de salut public dans l’organisation des armées.
Lefebvre (de Rouffach) décide de la victoire à Fleurus.
Kléber, héros de l’antiquité, dort à Strasbourg sur la place d’Armes avec l’ordre de suprême audace qui allait forcer la victoire.
Le fils de Kellermann (de Metz) s’illustre par la charge de Marengo.
Wagram voit tomber Lasalle (de Metz) à trente-quatre ans, chargé de gloire.
Eblé (de Rohrbach) sauve l’armée à la Bérésina.
Ney, enfin, Ney (de Sarrelouis), laissé Français en 1814 par la délimitation de la nouvelle frontière, se trouva rejeté du côté allemand par les traités de 1815. Si bien que lorsqu’il comparaît devant la Chambre des pairs, son défenseur, Dupin, sans l’avoir consulté, peut arguer que la nationalité changée l’arrache à la juridiction de la Haute Cour. Mais l’homme de la Moskowa, tremblant d’émotion, se lève et d’un cri : « Non, messieurs, je suis Français ! Je demande à mourir en Français. » D’ici, nous pouvons voir sa statue, sœur de celle que Metz a gardée.
… Avec eux, que Scheurer-Kestner soit donc glorifié à son tour ! Il n’est pas tombé sur le champ de bataille dans un de ses élans d’héroïsme qui, par le plein sacrifice de soi pour un précieux patrimoine d’idées, demeureront l’honneur d’une élite glorieuse. Héros du courage civil, c’est hors l’excitation des combats meurtriers, dans le silence angoissent des amitiés qui se dérobent et des inimitiés qui s’avisent, sans regret, sans une plainte, pour le droit, pour la justice, pour le bon renom de la France, qu’il a donné goutte à goutte tout le sang d’une belle vie.
… La Révolution française avait gravé sur la pierre la reconnaissance de la patrie envers ses bons serviteurs. Notre République a repris la belle tradition. Aux murs du Panthéon, parmi tant de noms glorieux d’Alsace et de Lorraine, nous inscrivons, en fière gratitude, le nom de Scheurer-Kestner.
… Quelle est la que-si ion qui se pose ? Pour moi, c’est celle de savoir si le traité du 4 novembre est un instrument de paix, et un instrument de paix durable ; si oui, je suis disposé à faire fléchir certaines critiques. Si l’on m’apporte la preuve qu’en dépit de négociations très fâcheuses, les clauses nous en assurent une vie normale, durable, possible, entre les deux nations française et allemande, peut-être mon opposition sera-t-elle disposée à faire les concessions que vous demandez.
Seulement, messieurs, il y a une chose dont personne ne parle et qui est le fond même du débat. Ce traité qu’on nous dit être une affaire, n’est pas une affaire entre deux trafiquants qui cherchent à se voler l’un l’autre et à se réserver un gain plus ou moins bien acquis. Non, les deux partis contractantes sont deux peuples, deux gouvernements, deux nations, elles ont derrière elles une longue histoire, qui les met en mouvement, qui les pousse, qui les engage dans des voies déterminées par la fatalité historique et qui les oblige, en vertu de la mentalité que l’histoire leur a faite, à agir dans un sens déterminé. (Très bien ! très bien !)
Voilà une vérité qu’il faut comprendre.
M. le ministre de la guerre, récemment, quand il n’était que député, disait : « Le traité sera ce que nous le ferons. » Je lui demande la permission de lui dire, comme l’avait fait déjà le président du Conseil : il faut être deux pour une pareille œuvre.
Nous ferons, je le crois, tous nos efforts pour donner de nouvelles preuves de notre bonne volonté – nous en avons donné déjà assez depuis, quarante ans – pour que les conséquences de ce traité se développent dans des conditions de dignité honorables pour les deux peuples ; mais il faut savoir où en est l’autre partie, quelles sont ses intentions, ce qu’elle pense, ce qu’elle dit, ce qu’elle se propose de faire et quelles marques de bonne volonté elle a données. Voilà la question qu’il faut avoir le courage de se poser.
Cette question, messieurs, je l’aborde, et je l’aborde à mes risques et périls, sans d’ailleurs être autrement inquiet de ce que je vais dire, parce qu’il n’y a point de sentiment mauvais dans mon cœur, pas de haine, pour employer le mot propre, à l’égard du peuple allemand. Je ne veux point de provocation ; autant je suis fermement résolu à ne rien faire pour perdre une partie, si minime qu’elle soit, de nos chances si nous devons être attaqués, autant je trouve que la paix non seulement est désirable, mais est nécessaire pour le développement des idées françaises dans le domaine de la civilisation. (Très bien ! très bien !)
Le peuple allemand, en 1866 et en 1870, a remporté deux grandes victoires qui ont changé l’équilibre ou, pour appeler les choses par leur nom, le déséquilibre européen.
À travers l’épopée napoléonienne, je ne saurai dire si nous avons été des vainqueurs très accommodants ; nous avons notre manière latine, nous aimons le panache, le verbalisme de gloire, mais, au fond, nous ne sommes pas de mauvaises gens : je n’en veux pour preuve que la façon dont nos soldats ont été accueillis dans les capitales de l’Europe qu’ils ont traversées. (Très bien ! très bien !)
Il me revient à ce propos un mot de M. de Bismarck, qui n’est pas connu, qui n’a pas été publié, et que j’ai recueilli de la bouche de M. Jules Favre, au jour affreux où il revenait de traiter, à Versailles, avec M. de Bismarck, de la reddition de Paris.
Nous étions convaincus, nous avions la preuve que, si l’ennemi avait prétendu occuper Paris, la capitale de la France aurait été réduite en cendres ; et M. Jules Favre exposa la situation au vainqueur en termes excellents, j’en suis sûr. Mais M. de Bismarck lui répondit : Non ! il faut tout au moins que nos troupes franchissent une porte, parce que je ne veux pas, une fois rentré chez moi, dans mes terres, m’exposer à rencontrer un homme, amputé d’une jambe ou d’un bras, qui puisse dire à ses camarades, en me désignant : « Tu vois cet homme-là, c’est celui qui m’a empêché d’entrer à Paris. »
Comme Jules Favre répondait que l’armée allemande avait acquis assez de gloire sans cela, M. de Bismarck ripostait : « La gloire ! ce mot-là n’est pas côté chez nous. » (Mouvements divers.)
J’ai réfléchi souvent à cette parole. Il est certain que le verbalisme de gloire est différent dans les deux pays.
L’Allemand, autant que j’en ai pu juger, est surtout épris de la force, et il perd rarement une occasion de le dire : mais où il se distingue du Latin, c’est que sa première pensée est d’utiliser cette force. Comme le grand développement économique de l’Empire est une tentation perpétuelle à cet égard, il veut, – le journal la Post l’a répété il y a quelques jours, à propos du Maroc, – il veut que les Français sachent que, derrière chaque négociant allemand, il y a une armée de cinq millions d’hommes.
Voilà le fond ; mais il y a autre chose encore. L’Allemagne nous a, comment dirais-je ? pris une indemnité de guerre de cinq milliards ; elle nous a enlevé ainsi une force vive. C’est la forme moderne de l’antique esclavage. Autrefois, les guerriers s’appropriaient les hommes pour les faire travailler et jouir du fruit de leur travail. Aujourd’hui, la doctrine a changé. Les vainqueurs obligent les vaincus à leur payer une rente perpétuelle.
C’est ce qui a été fait. Nous sommes libres, nous sommes chez nous, nous travaillons, mais, chaque année, nous prélevons la rente de la somme que nous avons payée.
Le souvenir de ces cinq milliards, de la rapidité avec laquelle nous avons recouvré nos forces, reconstitué nos richesses, a vivement impressionné, me semble-t-il, l’esprit des Allemands. Je suis bien obligé de penser qu’il en est ainsi : car je vois constamment, dans leurs journaux, qu’on viendra chez nous et qu’on exigera une indemnité énorme, grâce à laquelle on reconstruira la flotte détruite par les Anglais au cours de la guerre. Et si notre temps, messieurs, n’était pas si précieux, je pourrais vous lire de nombreux articles de journaux : tous, jusqu’à ces jours derniers, ne cessent de proclamer que, c’est la France qui payera de ses milliards les frais de la construction de la nouvelle flotte allemande. Voilà l’état d’esprit de l’Allemagne, voilà la vérité qui apparaît bien dans votre traité : l’Allemagne pense d’abord à utiliser sa gloire et sa force.
Mais ce n’est pas tout. Elle a conquis l’unité par la force, par le fer, dans le sang ; elle a tant voulu cette unité – et il n’y eut certes pas de désir plus naturel – qu’elle entend s’en servir ; elle veut répandre dans le monde un surplus énorme de population. Elle se trouve donc conduite, par une fatalité à laquelle il lui est impossible de se dérober, à exercer sur ses voisins une pression telle qu’ils devront lui accorder tout au moins les facilités économiques dont elle a besoin.
Il s’est établi, au cours des siècles, à la suite des invasions venues de l’Est, un flux et un reflux de conflits sur les bords du Rhin, et il serait de l’intérêt supérieur de la civilisation que ces conflits prissent fin, qu’un bon règlement, qui devrait être salué avec bonheur par toute la civilisation, vînt mettre un terme à ces alternatives de paix toujours suivies de nouveaux massacres, à la suite des victoires des uns ou des autres.
Seulement, cela ne sera possible que lorsqu’il se rencontrera un vainqueur supérieur à sa victoire, vainqueur qui serait un héros de modération. Napoléon n’a pas été ce héros de modération ; l’Allemagne ne l’est pas davantage. C’est toujours le fameux dialogue de Pyrrhus et de Cinéas. Pyrrhus veut conquérir des terres et, parce qu’il va à Rome, Cinéas arrive à lui faire dire que de Rome il passera en Sicile, puis de Sicile en Égypte, et d’Égypte dans l’Inde. Il y a toujours de la terre devant un propriétaire qui cherche à s’arrondir. Il y a toujours des peuples devant le guerrier qui cherche à conquérir d’autres peuples. (Très bien ! très bien !)
J’ai parlé des Allemands avec discrétion, je crois, avec le respect que méritent leur culture, leurs méthodes, leur discipline, leur science, et si j’avais des défauts à décrire pour contrebalancer les traits que je viens de tracer, je ne le ferais pas. Je ne suis pas ici pour critiquer le peuple allemand, je cherche à reconstituer l’état mental dans lequel il est à notre égard. Je sais qu’il y a une social-démocratie, très différente de notre socialisme révolutionnaire, qui est pour la paix, et j’en parlerai tout à l’heure. Mais il y a en même temps, en Allemagne, un organisme de gouvernement et une opinion publique de minorités agissantes qui ne permettent pas aux pacifistes – je le dis à regret devant mon honorable ami M. d’Estournelles de Constant – de faire prévaloir leur volonté.
M. Le Bon a dit : « Le droit est une force qui dure. » Eh bien ! pour que la force puisse durer, pour que l’abus de la force n’amène pas la destruction même de la force, il faut, je le répète, que le vainqueur soit supérieur à sa victoire : ce vainqueur-là ne s’est pas encore rencontré.
Et maintenant nous, le peuple français ?
Le peuple français est un peuple d’idéalisme, de critique, d’indiscipline, de guerres et de révolutions. (Mouvements divers.)
Ses dispositions se prêtent mal à l’action continue ; certes, le peuple français a des élans magnifiques, mais, comme dit le poète, il lui arrive de mesurer à son élan la profondeur des chutes.
Nous étions au plus bas de l’un de ces intermèdes de torpeur, de somnolence, lorsque nous avons été assaillis, assommés, écrasés. Et ce qui m’a surpris le plus au moment de ces effroyables défaites, ce n’est pas que nos soldats eussent été vaincus, puisqu’ils trouvaient unies contre eux toutes les fatalités qu’avait accumulées une longue incurie dans le silence de la nation ; ce qui m’a frappé profondément, à Bordeaux en particulier, c’est cette dissociation de tous les liens politiques et sociaux, parce que le maître avait disparu ; il y avait de la poussière de Français, il n’y avait plus de France ; ou, du moins, on la cherchait : on cherchait quelque chose qui la représentât, quelque chose qui la fît vivre, qui la rendît agissante à nos yeux. On ne trouvait pas la France. Oh ! je peux dire qu’on ne la trouvait pas, puisque nous étions divisés à ce point qu’il y avait des hommes qui, se battant héroïquement contre l’ennemi, en même temps criaient, clamaient, à toute occasion, qu’il fallait faire la paix. Le peuple s’était donné les chefs qu’il avait rencontrés ; il y en a un qui siège dans cette enceinte ; j’ai le regret de ne pas le voir à son fauteuil. (Mouvements.)
La France a heureusement conservé leur souvenir ; et jusqu’au dernier moment, elle leur rendra l’hommage qu’ils ont mérité. (Applaudissements.)
… Songez, messieurs, à tous les malheurs accumulés ; que votre esprit se reporte vers ces temps-là : la guerre étrangère, l’invasion, et l’Assemblée, pour faire la paix, qui veut imposer la monarchie à la République, les révoltes de la Commune, Paris en flammes, une réaction s’organisant dans le sein de l’Assemblée directrice de la République pour détruire la République, les luttes sans fin qui s’ensuivent. Toutes les forces sociales sont anéanties ; une seule demeure debout, intacte, l’Église catholique, avec une armature qui était de tradition, je peux le dire, plus que de foi vive, et qui, dans les luttes politiques, avait perdu la meilleure partie de son prestige. Puis rien. Des hommes en désaccord, sans discipline, vivant dans l’anarchie, se demandant comment ce pays pourra sortir d’une toile crise.
Au milieu de tout cela, le parti républicain retrouvant le contact avec le pays, avec l’esprit public, reconstitué et cherchant, dès ce moment, non seulement à refaire les forces militaires de la France, mais à refaire la France elle-même tout entière, dans son esprit, dans son avenir.
Voici la différence des deux régimes : un régime centralisé, fort en apparence, qui fait taire tout le monde, qui impose le silence partout ; le chef croule : il n’y a plus, comme je le disais tout à l’heure, qu’une poussière de citoyens.
Ce n’est pas là la reconstitution française dont le parti républicain a conçu l’idée. Il a fallu reprendre la construction à la base, là où la base est inébranlable, c’est-à-dire dans le cœur de chaque citoyen : il a fallu faire des citoyens français en qui allait se développer et prospérer, dans l’intimité du cœur et de la pensée, la France de l’avenir.
Naturellement, les forces militaires et administratives, dans le cadre des institutions nouvelles, allaient se reconstituer, mais ce qu’il s’agissait d’entreprendre d’abord, ce qu’on a entrepris, c’était de corriger l’élément qui avait été la cause de notre faiblesse, mais qui sera notre grande force dans l’avenir : c’était de faire des citoyens. Il y avait des hommes, il n’y avait pas de citoyens, et il fallait en faire. Il fallait détruire cette habitude de l’esprit français, cause de tous nos malheurs, de s’emballer, comme l’on dit, de vibrer à certains moments pour retomber ensuite dans la torpeur, dans le laisser-faire. Non, il ne fallait pas que la confiance donnée au Gouvernement républicain fût la même que celle donnée à l’empire ; il ne suffisait pas de changer le Gouvernement, il fallait que ce Gouvernement fût capable de gouverner lui-même. (Applaudissements à gauche.)
Cela nous a créé une situation dure. Nous sommes aux prises avec cette grande œuvre ; nous espérons la mener à bien. Les derniers évènements dont on parlait tout à l’heure, l’intervention de l’opinion publique dans ses propres affaires, avec calme, avec tranquillité, sans un mot de fanfaronnade, c’est là un des meilleurs signes que la France ait encore donnés. (Très bien ! très bien !)
L’œuvre que nous avons accomplie, il ne faut pas la juger par ce qu’on voit, mais par les idées, le sentiment que nous avons mis au cœur de tous les citoyens français. (Applaudissements à gauche.)
La démocratie, à la suite de la Révolution française, a poursuivi sa marche par le monde ; il y a maintenant un Parlement en Chine, en Turquie ; le peuple allemand a gagné le suffrage universel et le Reichstag sur les champs de bataille de France.
Il n’en est pas moins vrai que son gouvernement est un gouvernement de la nature de celui qui nous a manqué. Il est fort, il est puissant, il a l’avantage de l’action immédiate. Et si c’était la force, la victoire, le sabre, le fer, le poing ganté de fer, comme on aime tant à le dire dans les brasseries d’outre-Rhin, qui devaient assurer l’avenir de l’humanité, il aurait toutes les chances.
Mais il n’en est pas ainsi ; notre œuvre ne brille pas, elle n’a pas le panache, elle est lente. Quand nous nous reculons après les évènements que je viens de dire, quand un recul nous est donné de quarante années, nous voyons tout de même que nous avons fait quelque chose et qu’une grande œuvre est accomplie.
Mais le plus beau ne se voit pas. Le plus beau, c’est cette jeunesse ardente à toutes les œuvres de la pensée désintéressée, cette jeunesse dans le cœur de qui germent des espoirs dont je ne verrai pas la réalisation – je mourrai cependant avec l’idée que tout de même j’y suis pour une modeste part (Approbation,) – cette jeunesse en qui nous avons mis nos espoirs, qui sera comme nous, qui se trompera… Nous avons fait des choses bonnes, utiles, grandes, nous nous sommes trompés cent fois, l’esprit public s’est trompé, et, à un moment donné, il a voulu retourner au vomissement du césarisme. Nous avons commis des fautes ; nos Gouvernements, nos Parlements ont souvent manqué de caractère, de volonté. Notre peuple, qui est bon et excellent, croit, trop souvent, que la violence pourra lui donner la victoire à laquelle il aspire.
Oui, nous nous sommes trompés, nous nous tromperons peut-être encore. Mais, malgré tout, nous avons entrepris, sur des bases nouvelles, de faire une France nouvelle qui a déjà reconstitué sa force économique. Je veux donner sa part à la politique d’expansion qui s’est répandue dans le monde avec honneur, qui a promené son drapeau aux applaudissements des populations.
Mais sur le terrain de la bataille directe, immédiate, avec le choix de l’heure laissé à l’adversaire, peut-être, au regard du gouvernement allemand, n’aurions-nous pas l’avantage.
Cette situation, il faut le reconnaître, peut inquiéter certaines gens. Pourtant, si l’esprit public s’est refait, si le sentiment de l’unité morale, qui a manqué à un tel point sous l’empire, nous a rendu la confiance en nous-mêmes, si nous avons compris que nous avons en nous, dans les traditions de notre histoire, et dans notre volonté énergique, une force, interne qui veut se développer normalement, justement, qui ne veut empiéter sur le droit de personne, qui réclame pour elle son droit, je dis que nous avons fait un grand pas et que nous avons semé le germe de l’avenir.
J’en ai eu deux preuves singulières : il y a quelques jours, le directeur d’une grande feuille anglaise m’écrivait pour me demander un article sur la France nouvelle ; je lui demandais ce que c’était que cette France nouvelle ; et mon correspondant, pour que je comprisse bien, me disait : « La France nouvelle, c’est celle qui vient de manifester cette fermeté tranquille que nous avions considérée jusqu’à ce jour comme la crème de la plus pure vertu anglo-saxonne. »
Dans sa pensée, on ne pouvait pas concevoir un plus grand éloge ; cet éloge, je l’ai accepté pour mon pays ; j’ai considéré que nous avions, certes, conservé notre audace, – nous en voyons tous les jours des exemples, donnés par ces jeunes gens qui se précipitent, lorsqu’un aviateur vient à périr dans un de ces épouvantables accidents que vous savez, et que dix, vingt se présentent, pour recommencer et retourner au plus haut du ciel faire jaillir l’éclair de l’audace française. (Applaudissements.)
Mais s’il vient à cela s’ajouter la maîtrise de soi, la domination de ses nerfs, cette vertu de composition, de volonté froide et tranquille, alors nous avons la revanche, la vraie, celle contre laquelle il n’y a pas de victoire possible, celle de l’homme reconstitué, celle de l’homme d’énergie, de volonté, qui sait son devoir, qui sait son chemin, qui sait se discipliner, qui sait se soumettre à une loi librement acceptée et qui est prêt à se sacrifier pour son pays. On peut dire du mal de la patrie : des rhétoriciens, des malheureux, qui ne comprennent pas le sens des paroles qu’ils prononcent, peuvent médire de la mère, de la vraie mère, celle pour laquelle ils ont droit au respect de tous, mais si jamais le jour vient où il faudra marcher, ces sans-patrie viendront vous demander un fusil. (Applaudissements.)
… Messieurs, ce qu’il faut noter, c’est que le peuple français n’a jamais eu moins qu’aujourd’hui de dispositions agressives. Pourquoi ? Parce qu’il comprend que, pour développer son génie, pour vivre, dans la plénitude du sens du mot, il n’a besoin que d’invoquer le droit de tous les peuples à vivre. Eh bien, ce droit de tous les peuples à la juste mesure de vie, c’est ce qui nous a été refusé par l’Allemagne au lendemain de la défaite.
Vous connaissez bien l’affaire de 1875, vous savez bien que, parce que nous nous étions permis de faire des quatrièmes bataillons, nous avons été sur le point d’être envahis à nouveau. C’est une histoire que vous trouverez tout au long dans les Mémoires de M. de Gontaut-Biron et dans la correspondance de Bismarck. Ah ! naturellement, une fois que le coup s’est trouvé manqué, par l’intervention de la reine Victoria et de l’empereur Alexandre II, on a nié. On nie toujours dans ces cas-là ! Mais il y a des preuves. Il a été acquis que le maréchal de Moltke avait parlé, et vous trouverez, dans les Mémoires de M. Gontaut-Biron, l’entretien le plus curieux et le plus décisif, entre notre ambassadeur à Berlin et M. de Radowitz, qui vient de mourir. Permettez-moi d’en extraire quelques lignes. C’est M. de Radowitz qui parle :
« Pouvez-vous assurer que la France, regagnant son ancienne prospérité, ayant réorganisé ses forces militaires, ne trouvera pas alors des alliances qui lui manquent aujourd’hui et que ses ressentiments qu’elle ne peut manquer de nourrir, qu’elle conserve pour la perte de ses deux provinces ne la pousseraient pas inévitablement à déclarer la guerre à l’Allemagne ? Et, puisque la revanche est la pensée intime de la France, et elle ne peut être autre – concluait M. de Radowitz, – nous avons intérêt, nous autres Allemands, à ne pas la laisser se relever, grandir, reprendre des forces dont elle se servirait contre nous, et à la mettre, dès maintenant, hors d’état de nous nuire plus tard. »
Il n’y a qu’un mot pour caractériser une telle politique : c’est le système qui consisterait à achever les blessés sur le champ de bataille. (Très bien ! et applaudissements.) Parce que le fer s’est brisé dans la main de l’homme, et parce que celui-ci est tombé à terre, eh bien, qu’on l’achève, car il pourrait plus tard devenir un ennemi !
Nous ne pouvons pas ignorer ces choses. Nous n’en parlons jamais, et nous faisons bien. Mais tout de même, dans le Parlement français, qui décide de la conduite politique du Gouvernement, sans injurier personne, sans se fâcher, sans provocation, n’est-il pas nécessaire que, de temps en temps, ces choses soient remémorées (Très bien) pour que l’on voie où elles nous ont conduits (Applaudissements) et qu’à la lueur de ces indications fournies par des adversaires que je voudrais ne pas appeler des ennemis, nous décidions nous-mêmes ce qu’il nous convient, à nous, d’adopter dans la liberté de notre opinion ?
Le coup a manqué, disais-je. Et M. Ribot avait bien raison, l’autre jour, d’affirmer que ce ne sont pas les diplomaties qui ont fait la Triple-Entente. Non, elle s’est faite toute seule, parce qu’elle est dans l’intérêt des trois puissances ; parce que – Bismarck n’a cessé de le répéter – parce que l’Angleterre et la Russie se sont demandé si leur neutralité n’avait pas eu l’inconvénient d’affaiblir une puissance continentale aux dépens de l’autre et de ressusciter l’hégémonie allemande. Oui ! Bismarck furieux a injurié Gortschakoff ; il n’a même pas ménagé la reine Victoria, qu’il a appelée, dans une lettre à son souverain : « Cette vieille dame exaltée. » (Rires) Mais il est constant que la reine Victoria et la Russie sont venues dire spontanément, sans appel, sans préparation diplomatique, lorsqu’il a été question d’écraser de nouveau la France : « Pardon ! il faut causer d’abord ! »
Eh bien ! messieurs, l’hégémonie de l’Allemagne s’est poursuivie ; les évènements ont rapproché les peuples, la Triple-Entente s’est opposée à la Triple-Alliance. Pourquoi ? Voilà le grand sujet de la querelle de la France et de l’Allemagne. Aujourd’hui, l’Allemagne nous dit : « Je suis en querelle avec l’Angleterre, et cette querelle peut me mener fort loin. Eh bien ! ne soyez pas de la bataille, venez de mon côté. » Nous, nous répondons : « C’est impossible. » – « Vous voyez bien que vous avez l’intention de déchaîner la guerre », répond l’Allemagne.
Mais il n’y a rien de plus contraire aux faits. La paix résulte d’un équilibre ; cet équilibre s’est fait spontanément, en dehors de toute intervention diplomatique, comme je vous le montrais tout à l’heure. Et, malgré cela, cinq menaces de guerre, depuis 1870, toutes venant de l’Allemagne et pas une provocation de notre part ; c’est l’affaire de 1875 ; c’est l’affaire Schnœbelé, où la loyauté de l’empereur Guillaume trancha d’un coup la querelle ; et puis – je reviens au Maroc, monsieur le président du conseil, en demandant pardon de m’en être éloigné si longtemps – et puis, les trois affaires marocaines de Tanger, de Casablanca et d’Agadir.