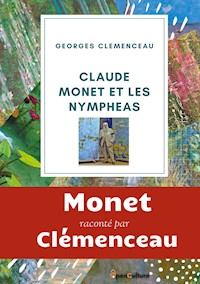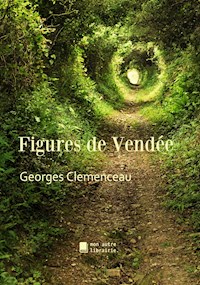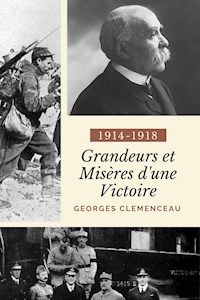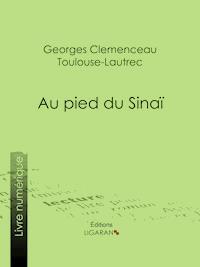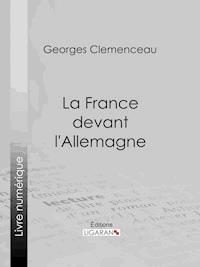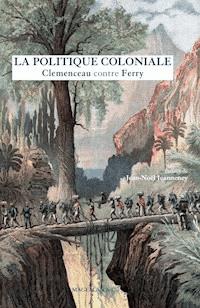Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "L'Iniquité" est une oeuvre poignante de Georges Clemenceau, qui s'inscrit dans le contexte tumultueux de l'Affaire Dreyfus, un scandale judiciaire et politique majeur de la fin du XIXe siècle en France. Ce livre, souvent considéré comme le testament de Clemenceau sur cette affaire, offre une analyse pénétrante des injustices et des erreurs judiciaires qui ont marqué cette période. Clemenceau, journaliste et homme politique influent, utilise sa plume acérée pour dénoncer les dérives de l'État et les préjugés antisémites qui ont conduit à la condamnation erronée du capitaine Alfred Dreyfus, un officier juif de l'armée française. À travers une série de réflexions et de critiques, l'auteur s'attaque aux institutions et aux figures politiques qui ont failli à leur devoir de justice. "L'Iniquité" n'est pas seulement un plaidoyer pour la réhabilitation de Dreyfus, mais aussi une réflexion plus large sur les valeurs républicaines et les dangers de l'intolérance. Clemenceau, en tant que témoin et acteur de cette époque, offre une vision unique et engagée sur l'une des affaires les plus controversées de l'histoire française. Ce livre est un témoignage intemporel de la lutte pour la vérité et la justice, et reste pertinent pour quiconque s'intéresse à l'histoire des droits de l'homme et des libertés civiles. L'AUTEUR : Georges Clemenceau, né le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Pareds et mort le 24 novembre 1929 à Paris, est une figure emblématique de la politique française. Surnommé "le Tigre" pour son tempérament fougueux, il a joué un rôle crucial dans la Troisième République. Clemenceau a commencé sa carrière en tant que médecin, mais il s'est rapidement tourné vers le journalisme et la politique, où il a laissé une empreinte indélébile. Il a été maire de Montmartre, député, sénateur, et a occupé le poste de Président du Conseil pendant la Première Guerre mondiale, où il a été un artisan majeur de la victoire des Alliés. Clemenceau est également connu pour son engagement fervent dans l'Affaire Dreyfus, où il a défendu avec ardeur la cause de Dreyfus à travers ses écrits dans le journal "L'Aurore". Sa carrière littéraire est marquée par des oeuvres incisives qui critiquent les abus de pouvoir et défendent les valeurs républicaines. En dehors de "L'Iniquité", il a écrit de nombreux articles et livres qui témoignent de son engagement pour la justice et la vérité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PRÉFACE
Chapitre I : Le Traître
Chapitre II : L’affaire Dreyfus
Chapitre III : Encore l’affaire Dreyfus
Chapitre IV : La pleine lumière
Chapitre V : Justice
Chapitre VI : La pleine lumière
Chapitre VII : Toute la Vérité
Chapitre VIII : Vers le grand jour
Chapitre IX : Toute l’enquête
Chapitre X : Les demi-vérités
Chapitre XI : Le colonel Picquart
Chapitre XII : Rue Saint-Dominique
Chapitre XIII : La parole de Vérité
Chapitre XIV : L’instruction judiciaire
Chapitre XV : La raison d’Etat
Chapitre XVI : La raison du plus fort
Chapitre XVII : Clair-obscur
Chapitre XVIII : Qui?
Chapitre XIX : De amiticia
Chapitre XX : L’Armée au grand jour
Chapitre XXI : Fausse enquête
Chapitre XXII : La question posée
Chapitre XXIII : L’instruction
Chapitre XXIV : Bafouillage
Chapitre XXV : La chambre noire
Chapitre XXVI : Les témoins
Chapitre XXVII : Au pied du mur
Chapitre XXVIII : Pas de huis clos
Chapitre XXIX : Feux croisés de procès
Chapitre XXX : Après l’attaque
Chapitre XXXI : L’Armée politique
Chapitre XXXII : Mea culpa
Chapitre XXXIII : Le doigt de Dieu
Chapitre XXXIV : Le pot au noir
Chapitre XXXV : Le voile
Chapitre XXXVI : Les supports de la machine sociale
Chapitre XXXVII : Trahisons !
Chapitre XXXVIII : Mystères
Chapitre XXXIX : A tâtons
Chapitre XL : Questions sans réponse
Chapitre XLI : La mélasse du général
Chapitre XLII : Et les lettres ?
Chapitre XLIII : Les deux points
Chapitre XLIV : L'éteignoir
Chapitre XLV : L’armée-école
Chapitre XLVI : C’est dommage
Chapitre XLVII : Ça se corse
Chapitre XLVIII : Et après ?
Chapitre XLIX : Avant le conseil de guerre
Chapitre L : Billot contre Picquart
Chapitre LI : Divagations judiciaires
Chapitre LII : Des procès ! Des procès !1
Chapitre LIII : Il faut parler
Chapitre LIV : Les experts
Chapitre LV : Les lettres du général Gonse
Chapitre LVI : Les artisans de défaites
Chapitre LVII : Le « syndicat » grandit
Chapitre LVIII : Sus aux juifs !
Chapitre LIX : Différences de points de vue
Chapitre LX : La Croisade
Chapitre LXI : A la dérive
Chapitre LXII : Au-dessus de la loi
Chapitre LXIII : Le spectacle du jour
Chapitre LXIV : Contre la preuve
Chapitre LXV : Mort aux juifs
Chapitre LXVI : Tarte à la crème
Chapitre LXVII : Le recul
Chapitre LXVIII : Il y a la France...
Chapitre LXIX : Ceux qui parlent
Chapitre LXX : 1894-1898
Chapitre LXXI : Procès de Zola et de l’AURORE
Chapitre LXXII : Vainqueurs et vaincus
Chapitre LXXIII : M. Méline a parlé
Chapitre LXXIV : La liquidation
Chapitre LXXV : Les coulisses de l’Etat-Major
Chapitre LXXVI : Eux
Chapitre LXXVII : Leur victoire
Chapitre LXXVIII : Le Bloc
Chapitre LXXIX : Les élections romaines
Chapitre LXXX : Banquo!
Chapitre LXXXI : M. Maurice Lebon
Chapitre LXXXII : Cavallotti et Zola
Chapitre LXXXIII : Souvenirs et regrets
Chapitre LXXXIV : Philosophie de violence
Chapitre LXXXV : De l’armée
Chapitre LXXXVI : Candidats ! Candidats !
Chapitre LXXXVII : Choses du jour
Chapitre LXXXVIII : Chefs en queue
Chapitre LXXXIX : Justice par ordre
Chapitre XC : Victoires et revers
Chapitre XCI : Nouveau procès
Chapitre XCII : La question sera posée
Chapitre XCIII : Plaideurs récalcitrants
Chapitre XCIV : La vérité sur l’affaire Esterhazy
Chapitre XCV : Le supplice du commandant
Chapitre XCVI : Des témoins
Chapitre XCVII : Légionnaire et légionnaire
Chapitre XCVIII : A Versailles
Chapitre XCIX : Escobards
Chapitre C : Sous la Terreur
Chapitre CI : La loi et l’armée
Chapitre CII : Esterhazy n’est pas espion français
Chapitre CIII : Qui des deux au bagne ?
Chapitre CIV : Par ordre
Chapitre CV : La poigne
Chapitre CVI : Présomptions
Chapitre CVII : Gare la bombe !
Chapitre CVIII : Un du syndicat
Chapitre CIX : Toujours la bombe
Chapitre CX : Nouvelles preuves
Chapitre CXI : Innocent ou coupable ;
Chapitre CXII : Pour la Patrie !
Chapitre CXIII : L’amnistie
Chapitre CXIV : Militairement
Chapitre CXV : L’inutile République
Chapitre CXVI : Porteurs de principes
Chapitre CXVII : Et les juifs !
Chapitre CXVIII : Preuves secrètes au grand jour
Chapitre CXIX : Genèse d’une photographie
Chapitre CXX : Politique à rebours
Chapitre CXXI : L’aimable guillotine
Chapitre CXXII : Ceux qui fuient (1)
Chapitre CXXIII : Le uhlan authentique
Chapitre CXXIV : Le photographe récalcitrant
Chapitre CXXV : Encore les juifs
Chapitre CXXVI : Sous l’uniforme
Chapitre CXXVII : Sous la croix d’honneur
Chapitre CXXVIII : Explications
Chapitre CXXIX : Menteurs ! Menteurs !
Chapitre CXXX : La fausse citation
Chapitre CXXXI : L’archimensonge
Chapitre CXXXII : L’inconséquence de certains
Chapitre CXXXIII : Le péril
Chapitre CXXXIV : L’Edit de Nantes
Chapitre CXXXIV : Le Uhlan français décoré
Chapitre CXXXV : Ils ne sont pas assez !
Chapitre CXXXVI : Nos savants experts
Chapitre CXXXVII : Tas de de juifs !
Chapitre CXXXVIII : L’ancien Etat-Major
Chapitre CXXXIX : La censure de Boisdeffre
Chapitre CXL : La question toujours posée
Chapitre CXLI : Les protecteurs du crime
Chapitre CXLII : L’histoire des aveux
Chapitre CXLIII : La chute ou le salut
Chapitre CXLIV : La Parole et l’Acte
Chapitre CXLV : L’Occasion
Chapitre CXLVI : Lui, Toujours lui
Chapitre CXLVII : Brisson, chef
Chapitre CXLVIII : Les ennemis de la vérité
Chapitre CXLIX : Ils ont la clef du mystère
Chapitre CL : La demande d’annulation
Chapitre CLI : La revision inévitable
Chapitre CLII : L’affiche du Ministère
Chapitre CLIII : Le nouveau jeu
Chapitre CLIV : Trop parlé, rien prouvé
Chapitre CLV : La marche à la revision
Chapitre CLVI : L’engrenage
Chapitre CLVII : Le cachot et le palais
Chapitre CLVIII : Un 14 Juillet
Chapitre CLIX : Sans convictions
Chapitre CLX : Documents
Chapitre CLXI : La fuite de Zola
PRÉFACE
La France, en ce moment, a l'angoisse de vivre un drame inouï d’humanité. Sans doute, l’erreur judiciaire remonte à l’âge du premier homme qui jugea. Mais vit-on jamais tout un peuple entrer, comme les Français de l’heure présente, dans l’action tragique de la justice contre l’iniquité ?
Un homme injustement condamné, combien souvent cela s’est-il vu ? Combien souvent cela se verra-t-il encore ? Les lois violées par ceux-là même, qui en ont la garde, spectacle de tous les jours ! Toute la cruauté sociale faisant rage contre la victime, ordinaire effet de la lâcheté anonyme des intérêts au pouvoir ! Mais quand, avec le condamné, avec les condamneurs, tout un ordre établi se trouve en cause, quand, derrière eux, les grandes forces sociales sont aux prises, quand le droit n’a pour lui que d’être le droit, quand toute l’administration de justice menace ruine en la succession de ses différents organes, quand la conscience individuelle voit se dresser devant elle l’appareil formidable de l’Etat soutenu par l’inconscience des foules, alors tout s’agrandit, tout prend des proportions démesurées, et le combat se hausse jusqu’à la légendaire épopée où toute l’humanité comparait.
La victime, en ce cas, quelque pitié qu’elle inspire, se fond en un vivant symbole de toutes nos défaillances d’esprit et de cœur. Ce représentant passager d’une justice humaine injuste apparait soudain comme le synthéthique témoin de toutes les iniquités du passé contre toutes les forces de domination sociale qu’une injustice réparée menace d’autres réparations plus redoutables. Il faut que l’injustice représentative demeure, pour que la ligue des puissances maîtresses ne soit pas entamée. La religion de charité brandit le fer, et dit : « Malheur au Juif ». L’esprit de caste militaire n’admet pas que la force soit sujette de la raison. Contre la liberté cherchant sa voie, se dresse l’autorité du dogme et du fer, implacable parce qu’infaillible. L’iniquité est : force immense, au regard de la justice qui veut être. L’arbitraire s’installe sur la loi, le mensonge sur la vérité, la force écrase la pensée.
Et, dans cet effroyable combat de toutes les tyrannies de la terre contre la créature désemparée, quel recours pour la débilité d’un seul aux prises avec l’énormité des puissances souveraines ? Rien que des idées, des abstractions, qui sont néant quand l’homme capable de les concevoir est inapte à les objectiver, à les faire passer de son esprit dans la réalité vivante. Des idées, des mots, mais des mots magiques tout de même, comme ces formules des contes d’orient par la vertu desquelles soudainement toute réalité s’abîme dans un éclair de foudre, pour faire place à l’enchantement des féeries.
Justice, un bien petit mot ! Le plus grand de tous, en deça de la bonté. Prenez le temps où le genre humain courbé sous le plus dur talon, accepte, oublieux de tout, le destin des bêtes passives, choisissez le moment où, désespérant de lui-même, il abdique sans regret la dignité de son corps et de son âme pour se ruer aux dégradations des servitudes volontaires, et puis, dans l’effroyable crise d’avilissement qui fait aimer ses chaînes à l’esclave, passez parmi ces hommes stupides de malheur, et faites retentir le grand cri : Justice ! Justice ! C’est assez. Tous ont frémi. Tous sont debout, debout pour la promesse sacrée, tombée miraculeusement des hauteurs, debout pour l’espérance, debout pour la volonté, pour l’effort. Le plus déchu vient de comprendre qu’une heure libératrice sonnait. Le maître a douté de lui-même, et, reconnaissant qu’il n’est rien qu’un homme, prend peur. Un grand frisson d’humanité passe dans l’air. Les cœurs battent. Les mains se cherchent. Une irrésistible impulsion précipite en avant toutes les énergies. Les résistances sont brisées. Une victoire du droit humain s’inscrit en nos annales, jusqu’aux chutes, hélas ! en des formes nouvelles, que suivront, aux heures fatales, les victoires de l’avenir.
Un beau mot, le mot qui fait ces miracles ! Un mot que l’homme ne peut entendre sans se trouver plus grand, sans se sentir meilleur. Point de sommeil qu’un tel mot ne rompe, point de mort qui ne soit par lui réveillée. Mot d’ordre des invisibles Dieux qui, par l’éternel appât de justice, entraînent l’homme en leur sillage. Mot plus fort que la force, par l’espérance.
Avec ce mot pour toute arme, nous avons engagé la bataille. Par ce mot, toutes les résistances d’oppression, une à une sont tombées. Par ce mot, demain le vaincu d’hier tiendra sa légitime revanche.
Le présent livre est la notation quotidienne de l’évolution d’un esprit de l’injustice à la réparation.
Je n’ai point le mérite d’avoir, dès le premier jour, pressenti l’iniquité. J’ai cru à la culpabilité de Dreyfus, et je l’ai dit en termes cruels. Il me paraissait impossible qu’une pareille sentence eût été prononcée légèrement par des officiers contre un de leurs pairs. Pourtant l’idée de la trahison brutale me répugnait. Je supposais quelque grave imprudence. Je trouvais le châtiment terrible, mais je l’excusais sur le culte de la patrie.
Lorsque Vaughan fonda L'Aurore, il me parla de la collaboration de Bernard Lazare. J’insistai auprès de lui pour qu’il fut stipulé que notre distingué confrère ne continuerait pas parmi nous sa vaillante campagne pour la réhabilitation de Dreyfus. D’ailleurs, je m’en expliquai, nettement avec Bernard-Lazare lui-même, et pas une fois il n’affirma l’innocence du condamné sans qu’une protestation d’incrédulité jaillit de mes lèvres.
Le premier numéro de L’Aurore parut le 19 octobre 1897. A quelques jours de là, devant la porte de l’imprimerie Dupont, je rencontrai Ranc qui venait de porter son article au Radical. Nous causâmes du nouveau journal et des rédacteurs. Il prononça le nom de Bernard Lazare.
— Ah, celui-là, m’écriai-je, tous nous aimons son talent, mais nous avons exigé de lui qu’il nous laissât tranquilles avec son affaire Dreyfus.
— Quoi ! me dit Ranc, vous ne savez donc pas que Dreyfus est innocent
— Qu’est-ce que vous me dites là ?
— La vérité. Scheurer-Kestner a des preuves. Allez le voir, il vous les montrera.
— S’il en est ainsi, m’écriai-je, c’est le plus grand crime du siècle.
— Tout simplement, conclut Ranc. Allez voir Scheurer.
Deux jours plus tard, je voyais Scheurer qui me faisait comparer le facsimilé du bordereau avec l’écriture d’Esterhazy. Je lui rendis successivement plusieurs visites, et finalement, me trouvant moi-même convaincu, non de l’innocence du condamné (c’est le procès Zola qui devait définitivement m’ouvrir les yeux là-dessus) mais de l’irrégularité du jugement, j’engageai vivement mon ami à faire campagne pour la revision du procès. Il n’avait pas besoin de mes conseils. Sa résolution était prise. Pour lui, c’était un devoir de conscience.
— Je me briserai les reins s’il le faut, me dit-il un jour. A mon âge, c’est terrible. Mais je ne reculerai pas.
L’histoire dira qu’il n’a pas reculé.
Je dois l’avouer franchement, je ne partageais pas ses craintes. Je prévoyais bien, comme lui, les résistances de l’Etat-major, soutenu des haines de l’Eglise. Mais il me semblait qu’une fois la vérité connue, un mouvement irrésistible d’opinion imposerait d’emblée la justice à tout le monde. L’événement m’a montré combien j’étais loin de compte.
De ce moment, toutefois, mes impressions, traduites en articles au jour le jour, font passer le lecteur par toutes les phases d’un esprit évoluant de l’injustice à la justice, et poursuivant, en toute indépendance, la manifestation de la vérité. C’est l’histoire d’un esprit en action : la répercussion quotidienne du drame sur un spectateur qui veut que sa pensée éclaire d’autres pensées, les échauffe, les enflamme au combat pour l’homme meilleur.
Sous ce titre : L'iniquité, un premier volume conduira le lecteur jusqu’au second procès de Zola.
Dans quelques jours, un autre volume doit suivre : Vers la réparation.
Tout l’intérêt de ces notes étant dans la sincérité, de, l’heure, j’ai pensé que rien n’y devait être changé : pas même un jugement hâtif, une appréciation erronée, pas même une négligence de style. Je n’ai donc rien relu, rien corrigé. Mes amis E. Winter et Henry Leyret ont bien voulu se charger de revoir les épreuves. Qu’ils en soient ici affectueusement remerciés.
Je voudrais que le lecteur pût suivre, au courant de ces pages, le développement parallèle de l’action et de la pensée, à chaque progrès des personnages vers le terme de justice inévitable.
Au moment où paraît ce volume, nous vivons, dans l’attente des dernières péripéties d’une tragédie sociale supérieure en intensité d’émotion à tout ce que l’invention du théâtre a jamais pu donner Depuis le jour où Zola déchaîna la Némésis, elle va : nous lui faisons cortège. Le drame individuel et le drame social se déroulent, inextricablement mêlés dans le heurt des passions privées et publiques. Tout semble en suspens, des garanties primordiales du citoyen pour sa vie, sa sécurité, son honneur : La religion, l’armée, le gouvernement, s’engagent dans la lutte, acharnés aux solutions qui ne peuvent rien résoudre, prolongeant, aggravant la crise, qui ne comporte qu’une issue : par toute la vérité connue, la justiçe égale pour tous. Et derrière des acteurs qui s’appellent, Dreyfus, Picquart, Henry, Esterhazy, Schwarzkoppen, Boisdeffre, Hanotaux, Billot, Méline et Félix Faure, avec leur cortège de choryphées, tout un peuple attend le dénouement qui doit décider de sa destinée.
La France a commis de grandes fautes. Elle demeure une nation d’idéalisme, entre toutes les nations. Dans ce long et douloureux effort de redressement, les peuples se sont montrés prompts à la blâmer. Combien d’entre eux, cependant, auraient pu nous montrer un tel concours de volontés généreuses triomphant de tous les pouvoirs et leur imposant la réparation de justice malgré la fureur des passions politiques et religieuses ? Qu’importe ! Ce n’est l’heure ni de nous glorifier, ni de nous amoindrir. La victoire des hommes de cœur a pu nous paraître longue à venir. Elle vient, elle est venue, et cela seul aujourd’hui, doit compter.
Qui de nos sévères critiques veut suivre l’exemple ? Les défaillances de tout ce qui s’attribue une autorité sur l’homme sont sans nombre. L’égoïsme féroce habite en nous. L’iniquité sociale déborde de toute puissance établie dans le monde. Qui cherche une injustice à réparer n’a qu’à tendre la main au hasard. Combien, tout aussitôt, trouvera-t-il de mains supplantes ? Combien de voix crieront secours ? Pourquoi donc tant de labeur pour aboutir à des axiomes de bonté, à des formules d’amour ? Les paroles ne sont rien, trop souvent, que des feintes de zèle. A l’action, vous tous qui sentez le mal, qui voulez le bien, et qui avez en vous quelque possibilité de faire. Profitez de l’enseignement que vous offre le spectacle de nos présentes misères. Il faut vouloir. Il faut agir. Demain nous presse. Des forces contradictoires sont en conflit dans l’homme. Au lieu de nous répandre en préceptes stériles, mettons toute chance à profit pour marquer la surprise de notre courte existence par l’acte de pitié qui nous prolonge au delà de nous-mêmes.
15 janvier 1899.
I
Le Traître
A l’unanimité, le Conseil de guerre a déclaré le capitaine Alfred Dreyfus coupable de trahison. Le crime est si épouvantable qu’on a voulu douter jusqu’au dernier moment. Un homme élevé dans la religion du drapeau, un soldat honoré de la garde des secrets de la défense nationale, trahir — mot effroyable ! — livrer à l’étranger tout ce qui peut l’aider dans les préparatifs d’une invasion nouvelle, cela paraissait impossible.
Comment se trouve-t-il un homme pour un tel acte ?
Comment un être humain peut-il se faire si déshonoré qu’il ne puisse attendre qu’un crachat de dégoût de ceux-là mêmes qu’il a servis ? Il n’a donc pas de parents, pas de femme, pas d’enfant, pas d’amour de quelque chose, pas de lien d’humanité, ou d’animalité même — car la bête en troupeau, d’instinct, défend les siens — rien qu’une âme immonde, un cœur abject. On ne voulait pas croire, et on saisissait toutes les occasions de douter. Les uns disaient : « Le ministre s’est emballé. On peut être excusable d’agir vite en pareille matière. Mais quel crime épouvantable si l’on frappait un innocent ! » Alors on a ergoté, on a supputé toutes les chances d’erreur, on a bâti des romans sur les quelques parcelles d’informations qui sont arrivées au public. On aurait voulu la complète lumière, on protestait d’avance contre le huis clos.
Dans de tels procès, il faut le reconnaître, la publicité avec les commentaires qu’elle entraîne court risque, le plus souvent, d’aggraver le mal causé par la trahison. La liberté de tout dire, sans être arrêté par aucune considération d’ordre public, peut même profiter à la défense.
Aussi, ceux qui avaient le plus vivement réclamé la publicité des débats acceptèrent sans protestation cette parole du président du Conseil de guerre : « Il y a des intérêts supérieurs à tous les intérêts de personnes. »
Le procès a duré quatre jours. L’accusé était défendu par un des premiers avocats du barreau de Paris. A l’unanimité de ses juges, Alfred Dreyfus a été condamné au maximum de la peine. Un tel arrêt ne se prononce pas sans une poignante interrogation de la conscience, et, si quelque doute avait pu subsister au profit de l’accusé, nous en aurions immanquablement trouvé trace dans la sentence. Mais le juge a dit : la mort. Sans l’article 5 de la Constitution de 1848 qui abolit la peine de mort en matière politique, Dreyfus serait fusillé demain.
Ici, une question redoutable se pose.
Le crime de Dreyfus peut-il être assimilé à un crime politique ? Je réponds hardiment : non. Que des hommes, comprenant de façon différente les intérêts de la commune patrie, combattent de tout leur effort pour la monarchie ou la république, le despotisme ou la liberté, qu’ils luttent légalement les uns contre les autres, qu’ils conspirent ou qu’ils s’entre-tuent, on n’a pas le droit de confondre dans leur rang l’ennemi public qui livre précisément ce que chacun d’eux prétend défendre. Comment les jurisconsultes sont-ils arrivés à pouvoir établir une pareille confusion entre deux actes qui sont la contradiction l’un de l’autre ? Je l’ignore, et je ne les félicite pas de leur trouvaille.
Sans doute, je suis aussi résolument que jamais l’ennemi de la peine de mort. Mais on ne fera jamais comprendre au public qu’on ait fusillé, il y a quelques semaines, un malheureux enfant de vingt ans coupable d’avoir jeté un bouton de sa tunique à la tête du président du Conseil de guerre, tandis que le traître Dreyfus, bientôt, partira pour l’île Nou, où l’attend le jardin de Candide. Hier, à Bordeaux, le soldat Brevert, du corps des disciplinaires du château d’Oloron, comparaissait devant le Conseil de guerre de la Gironde pour bris d’objets de casernement. A l’audience, il lance son képi sur le commissaire du gouvernement. La mort. Et pour l’homme qui facilite à l’ennemi l’envahissement de la patrie, qui appelle les Bavarois de Bazeilles à de nouveaux massacres, qui ouvre le chemin aux incendiaires, aux fusilleurs, aux voleurs de territoire, aux bourreaux de la patrie, une vie paisible, toute aux joies de la culture du cocotier. Il n’y a rien de si révoltant.
Je souhaite assurément que la peine de mort disparaisse de nos codes. Mais qui ne comprend que le Code militaire en sera de toute nécessité le dernier asile ? De fait, aussi longtemps qu’il subsistera des armées, il sera probablement difficile de les régir autrement que par une loi de violence. Mais si, dans l’échelle des châtiments, la peine de mort est l’ultime degré, il me semble qu’elle doit être réservée pour le plus grand crime, qui est, à n’en pas douter, la trahison. Tuer un malheureux affolé qui insulte ses juges, c’est démence, quand on fait une vie tranquille au traître.
J’estime, quant à moi, la réclusion perpétuelle une peine plus sévère que la mort. Et le bagne ? qui donc protesterait si le traître allait traîner la chaîne des forçats ?
Puisque le malheur veut qu’il y ait des êtres capables de trahison, il faut que ce crime apparaisse aux yeux de tous comme le plus exécrable forfait qui se puisse commettre, et le plus impitoyablement frappé. Malheureusement, dans l’état d’esprit où nous sommes, le sinistre incident qui a si vivement ému l’opinion n’est, pour beaucoup, qu’un prétexte à déclamation. Il est si commode d’emboucher la trompette et de prendre de belles attitudes de patriote échevelé, tout en ayant des trésors d’indulgence pour les malheureux qui ont eu les pires faiblesses, aux sombres jours de l’invasion allemande, ou pour les généraux qui tiennent ouvertement le langage antipatriotique qu’a rapporté le Figaro.
Nous n’avons même pas été capables de fusiller Bazaine. Un maréchal de France qui avait les plus hauts devoirs envers l’armée, dont il était le chef suprême, a gracié le traître et lui a fait remise de la peine de la dégradation. Après quoi, on l’a fait évader. Quelle excuse avait-il, ce chef d’armée qui avait livré son armée à l’ennemi ? Etrange patriotisme qui a permis ce scandale ! Non moins étrange la tolérance qui a récemment couvert l’abominable langage d’un autre chef d’armée à deux reporters.
Alfred Dreyfus est un traître et je ne fais à aucun soldat l’injure de le mettre en parallèle avec ce misérable. Mais que de faiblesse à l’égard des grands chefs, et que de sévérité pour une insolence au Conseil de guerre ! Frappez le traître, mais faites la discipline égale pour tous. Tolérer le désordre en haut aboutirait au même résultat que la trahison. Le privilège des uns fait la révolte des autres. Pour que l’armée soit une et forte, une seule loi pour tous. Ce fut autrefois une des promesses de la République. Nous en attendons l’effet.
25 décembre 1894.
II
L’affaire Dreyfus
Est-il donc impossible d’en finir une bonne fois avec cette histoire ? Dreyfus a été jugé par ses pairs, et déclaré coupable. Nous devons tenir le jugement pour bon jusqu’à nouvel ordre. Ce qui fait évidemment l’hésitation, de quelques consciences, c’est que certaines pièces du procès ont été soustraites au regard de tous, dans l’intérêt supérieur de la France, nous a-t-on dit. C’est aussi que l’expertise en écriture sur laquelle se fonde la condamnation a parfois été reconnue de certitude douteuse devant les tribunaux. C’est qu’enfin Dreyfus est juif, et qu’une campagne antisémitique prolongée a créé dans une partie de l’opinion française un préjugé violent contre le peuple de qui nous vint Jésus. La bonne foi des juges ne saurait être mise en question. Mais les hommes sont faillibles, ainsi que l’attestent de récentes erreurs judiciaires dans des procès conduits en pleine lumière.
Des brochures ont été publiées pour critiquer le jugement. Elles n’ont point paru avoir d’écho dans le sentiment public. Mais voici qu’on nous annonce que M. Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, possède « des preuves irrécusables de l’innocence de Dreyfus ». J’avoue que cela me paraît difficile. Mais M. Scheurer-Kestner n’est point homme à s’engager légèrement. S’il a quelque chose à dire, qu’il parle, et sans plus de délai, car il ne fait qu’énerver par l’attente l’opinion dont il a besoin pour gagner la cause de son client. Il doit s’en apercevoir aux attaques violentes dont il est l’objet. Alfred Capus annonce plaisamment qu’on se prépare à le juger à huis clos. Je n’en serais pas plus surpris que je ne le suis de voir accuser de germanisme le bon Français qui a l’honneur de représenter dans nos assemblées la dernière manifestation électorale de l’Alsace-Lorraine française. Ce seul titre devrait, à mon avis, lui assurer le crédit qu’il réclame.
Il a vu hier le ministre de la Guerre. Nous devrions déjà savoir si le ministre a été touché ou non de ses arguments, s’il a accepté d’examiner le principe d’une revision, ou s’il s’y oppose, et, dans ce cas, sous quelle forme. M. Scheurer-Kestner a l’intention d’en appeler au public. On n’a pas le droit de laisser ainsi l’opinion en suspens. Pour Dreyfus, s’il y a quelque présomption en sa faveur, pour nous, s’il est coupable, comme nous devons le croire, il faut parler très haut et très vite. S’il y a quelque chose à dire, quoi que ce soit, sachons-le. Sinon, que l’histoire se referme sur le crime.
A Venise, la place où devrait figurer le portrait de Marino Faliero ne montre rien qu’une tache noire. Même vide à la plaque de marbre, sans inscription, qui atteste à West-Point la trahison d’Arnold. Des hommes se sont rencontrés pour oser gracier Bazaine, traître authentique apparemment, traître devant l’ennemi. Je demande qu’on en finisse avec Dreyfus. Si de tout ce tapage il ne doit rien sortir, qu’on laisse retomber sur le traître la méprisante pitié du silence.
1er novembre 1897.
III
Encore l’affaire Dreyfus
J’ai pu joindre mon ami Scheurer-Kestner que je n’avais pas vu depuis plusieurs mois, et qui jamais ne m’avait parlé de Dreyfus. Il ne m’a rien dit des pièces sur lesquelles il fonde sa conviction de l’innocence du condamné, pas plus qu’il ne m’a fait connaître son plan d’action. Mais j’ai trouvé son attitude si nette, sa parole si résolue, et sa confiance si profonde dans les moyens qu’il a de faire éclater la vérité, que je n’ai pu me défendre d’en subir l’impression.,
Je connais Scheurer-Kestner depuis plus de trente ans. Ses ennemis, s’il en a, ne lui refuseront ni l’intelligence ni la loyauté. Pour qu’un tel homme, dont la vie se partage entre les travaux de science et la politique, se soit obstiné, toute une longue année, à poursuivre l’enquête la plus ingrate dans le seul intérêt de la vérité, car il ne connaît pas même un membre de la famille Dreyfus, il lui a fallu de très fortes raisons de croire et d’agir. Le hasard le mit sur la piste qu’il a suivie. Un doute surgit dans son esprit, et, pour l’éclaircir, il chercha ce qui pouvait confirmer ou détruire ses premiers soupçons. Sur des indices nouveaux, une lumière plus grande se fit. Il résolut alors d’aller jusqu’au bout de ses recherches, et s’appliqua méthodiquement à débrouiller l’écheveau. Aujourd’hui il déclare sans réticences qu’il sait la vérité, toute la vérité, et qu’il la dira. Dreyfus est, selon lui, victime d’une effroyable erreur judiciaire. Si le fait est prouvé, on ne peut s’empêcher de frémir à la pensée des tortures sans nom infligées à ce malheureux. Mais il faut prouver.
A peine avais-je dit cette parole que Scheurer-Kestner me répondit simplement :
—Je prouverai. J’en prends l’engagement.
— Mais quand ?
— Ah ! oui, répondit-il. Il y a des gens qui m’accusent d’avoir procédé avec trop de lenteur. Que diraient-ils si j’avais parlé trop tôt, avant que ma conviction fút entière ? J’ai attendu, comme c’était mon devoir, que tout fût clair, absolument clair à mes yeux. Je comprends aujourd’hui que le public ait hâte de voir les faits portés devant lui. Je ne suis pas moins pressé d’en finir. Mais, pour faire parler certaines personnes, pour obtenir des renseignements, des confidences, j’ai du prendre des engagements que je saurai tenir. Je ne suis pas libre de tout dire, avant que certaines conditions soient remplies. Bientôt, je l’espère, rien ne me retiendra plus. On devrait comprendre que mon plus vif désir est d’être soulagé de ce poids. D’ailleurs, je ne reste pas inactif. Avant de porter le débat devant le public, j’entends me conformer à ce qu’exige la loi de tous ceux qui croient pouvoir faire la démonstration d’une erreur judiciaire. Encore un peu de patience. On n’attendra pas bien longtemps. Je me suis engagé, par sentiment du devoir, dans une rude voie. Je dédaigne les insultes, et je vais droit mon chemin. On me jugera quand on saura ce que j’ai à dire.
Telles sont, brièvement résumées, les paroles que j’ai recueillies et qu’il m’a paru intéressant de faire connaître à mes lecteurs. Pour ma part, je ne demande pas même à Scheurer-Kestner la preuve éclatante qu’il nous annonce. Je dis simplement que, s’il y a des présomptions notables d’erreur, le procès doit être revisé.
2 novembre 1897.
IV
La pleine lumière
Quels que soient les scrupules — très honorables, j’en suis sûr — qui ont retenu jusqu’ici M. Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat doit comprendre qu’il lui est impossible de laisser plus longtemps le public dans l’incertitude sur la question de savoir si Dreyfus est ou non victime d’une erreur judiciaire. Tous les journaux discutent à vide là-dessus, faute d’avoir quelque chose où se prendre. M. Scheurer-Kestner annonce des révélations, mais ne les fait point. Cela devient, pour l’opinion publique, intolérable.
Pour certaines gens qu’il faut plaindre, on est bien près d’être complice de Dreyfus, dès qu’on n’admet pas, sans rien savoir, l’infaillibilité des juges. Certains ne réclament, pour toute preuve, qu’une attestation de judaïsme qui équivaut à l’aveu de tous les crimes. Un autre poursuit les protestants, cherche un second Louis XIV pour révoquer à nouveau l’édit de Nantes. Ce sont là des symptômes de dispositions mentales fort étrangères à la saine virilité d’un peuple confiant en lui-même. S’il y a des traîtres parmi nous, qu’on les cloue au poteau d’infamie, mais il n’est peut-être pas excessif de demander qu’on mette leur culpabilité d’abord en évidence.
Dreyfus, jusqu’à nouvel ordre, doit être tenu pour coupable, puisqu’il a été « régulièrement » condamné. Si un doute est demeuré dans certains esprits, c’est que cette « régularité » s’est produite en dehors des règles ordinaires. L’un des juges, interrogé par un rédacteur du Gaulois, aurait dit que sa conviction s’était faite en chambre du conseil, sur la production d’une pièce soumise au tribunal en dehors de l’accusé et de son avocat. Si le fait est exact, qu’on me dise quel innocent pourrait échapper à de tels procédés de condamnation. Robespierre lui-même se trouve dépassé, car l’infâme loi de prairial supprima la défense, mais, au moins, laissa connaître à l’accusé le témoignage d’accusation.
M. Scheurer-Kestner déclare qu’il tient en mains les preuves de l’innocence du condamné. M. Scheurer-Kestner, aussi, est faillible. Il peut être dupe d’une illusion généreuse, il peut avoir été trompé. Nous voudrions pouvoir émettre une opinion sur les faits nouveaux qu’il allègue. Mais il s’obstine à nous laisser dans l’obscurité. De là, dans le public, une irritation naturelle. L’attente ne peut pas durer plus longtemps. Il faut que nous sachions si nous sommes en face de Norton ou de Calas.
M. Scheurer-Kestner a commis la faute de s’adresser aux ministres qui, ayant promis une réponse péremptoire, restent muets. Qu’il se hâte de soumettre ses documents au public sous la forme qu’il lui plaira.
Si ses preuves sont, comme il le croit, convaincantes, l’opinion saura exiger la justice. Sinon, nous serons enfin débarrassés du cauchemar des tortures sans nom infligées à un innocent, et, la vérité reconnue, nous laisserons en toute paix de conscience le traître à sa trahison. La lumière, la pleine lumière !
8 novembre 1897.
V
Justice
Encore et toujours Dreyfus ! Je n’ai pas revu Scheurer-Kestner, et je ne sais point ce qu’il prépare. Je trouve, comme tout le monde, qu’il est bien lent à agir. Mais je suppose qu’il ne demanderait pas mieux que d’en finir — car il n’est pas agréable de s’entendre dire qu’on est complice d’un traître. C’est pourquoi j’imagine qu’il doit y avoir à ses lenteurs des explications que nous ne tarderons pas à connaître.
En tout cas, un peu de lumière se fait sur le dossier rassemblé par le vice-président du Sénat. Le Figaro nous annonce que les pièces qui seront produites mettront en cause un autre officier de l’armée, « titré, marié et très apparenté ». Une telle assertion est trop grave pour qu’il soit possible d’admettre qu’elle a été émise à la légère. Ce ne serait plus là 1’ « homme de paille » dont il a été question dans les journaux antijuifs ou partisans de l’infaillibilité des conseils de guerre. C’est d’un officier qu’il s’agit, d’un homme qui, loin d’accepter la responsabilité de la trahison, devra défendre son honneur et sa vie dans la pleine lumière. Ainsi nous aurons chance que tous les doutes soient levés, et que la vérité soit connue
On nous dit qu’il ne faut pas moins de quinze jours pour la rédaction de la requête que M. Scheurer-Kestner va remettre à M. le garde des sceaux. Il me paraît difficile qu’avant ce terme de nouvelles indiscrétions ne nous apportent pas quelques informations supplémentaires. En ce qui me concerne, le nom de l’accusé — qu’il soit innocent ou coupable — est ce, que je suis le moins pressé de savoir. Il va passer par de terribles angoisses à son tour. Il faudra que les présomptions contre lui soient bien graves pour que les autorités mêmes qui n’ont cessé jusqu’ici de croire à la culpabilité de Dreyfus se décident à la revision du procès. Mais il y a quelque chose de supérieur à l’esprit de corps, c’est la vérité, c’est la justice.
Maintenant la discussion, au lieu de se concentrer sur la question de savoir si Dreyfus fut bien ou mal jugé, aboutit tout entière aux charges nouvelles contre le nouvel accusé. Le Figaro nous en donne un aperçu. Un des experts qui a conclu contre Dreyfus aurait reconnu l’identité des écritures dans le bordereau accusateur et dans une lettre émanant de celui à qui la trahison serait imputable. Des phrases de ce document, qui ne s’appliqueraient pas à Dreyfus, trouveraient aujourd’hui leur explication dans le grade et la situation de l’officier visé. D’autres preuves seraient produites. Enfin, l’argument décisif que réservait M. le général Billot contre Scheurer-Kestner serait fondé sur un faux document fabriqué par ceux-là mêmes qui avaient intérêt à nous tromper sur la culpabilité de Dreyfus. Il n’y a qu’un examen approfondi qui puisse faire la lumière sur ces choses. Cette lumière, le gouvernement ne peut pas refuser de la rendre éclatante aux yeux de tous. Il faut que les innocents soient protégés. Il faut que les traîtres soient punis.
15 novembre 1897.
VI
La pleine lumière
Au point où en étaient les choses, un éclat était inévitable. Avant que M. Scheurer-Kestner eût pu rédiger sa requête, M. Mathieu Dreyfus adressait à M. le général Billot une lettre indiquant M. le commandant Esterhazy comme l'auteur du crime de trahison pour lequel l’ex-capitaine a été condamné. A la tribune de la Chambre, le ministre de la Guerre a déclaré qu’il allait « mettre l’auteur de la dénonciation en demeure de produire ses justifications », et qu’il serait ensuite « statué conformément à la loi ».
A la question de M. le comte d’Alsace, il n’y avait pas d’autre réponse à faire. Un homme, un officier de l’armée française, est publiquement accusé de trahison. Il faut que l’accusateur produise ses preuves. Il faut que l’accusé soit mis en situation de se justifier. Le devoir du ministre est très simple : c’est de faire la pleine lumière.
Avec de la bonne volonté, ce ne doit pas être impossible. Les experts graphologues auront sans doute encore leur mot à dire. Mais, quels que soient les détails de l’affaire, il est impossible que de nouveaux faits ne soient pas révélés par M. Mathieu Dreyfus ou par M. Esterhazy. Déjà ce dernier annonce qu’il est en possession d’une pièce qui mettrait au-dessus de toute discussion la culpabilité du prisonnier de l’île du Diable. Quoi qu’il soit dit, l’opinion ne peut que se féliciter du supplément d’informations qui lui est promis.
Une aussi redoutable question, en effet, ne se peut résoudre par des injures. Dans un sens ou dans l’autre, il faut prouver. Le reste ne signifie rien. Les Français de tous les partis n’ont, dans ce débat, qu’un même intérêt : la vérité, pour la justice. Pourquoi donc y mêler d’autres querelles ?
S’il y a vraiment une machination ténébreuse pour faire croire à l’innocence d’un traître, qu’on la révèle, qu’on la prouve, et qu’on fasse justice.
Si des juges, faillibles puisqu’ils sont hommes, ont erré, il s’agit, non de récriminer contre eux, mais de réparer l’erreur.
Si un innocent a été condamné, si un coupable a échappé au châtiment, que chacun soit remis en sa place.
Le gouvernement ne saurait avoir d’autre souci que la vérité, ni d’autre intérêt que la justice impartiale pour tous, dans la pleine lumière.
Le général Billot a promis de faire son devoir. Nous n’avons pas le droit de douter de sa parole. C’est la patrie elle-même qui commande. Il doit obéir.
17 novembre 1897.
VII
Toute la Vérité
On doit commencer maintenant à s’apercevoir que l’esprit public de notre temps ne peut plus accepter les jugements dans l’ombre. Si Dreyfus avait été jugé comme tout le monde, rien de ce qui arrive aujourd’hui n’aurait pu se produire. Pour ne pas avoir à s’expliquer sur l’origine de certains papiers dont la disparition ne peut être apparemment ignorée de ceux qui en étaient détenteurs, notre gouvernement de Gribouilles a trouvé tout simple de faire une justice obscure. C’est-à-dire qu’on a rendu dans des formes juridiques un jugement qui — par raison d’Etat — semble avoir manqué des garanties nécessaires.
La raison d’Etat — que le progrès des temps prétend éliminer des gouvernements modernes — est déjà fort inquiétante dans les actes de l’autorité souveraine. Mais prétendre la mêler aux décisions de justice, c’est supprimer du coup toutes les garanties des citoyens.
On l’a bien vu dans cette affaire Dreyfus où l’opinion publique était aussi peu disposée que possible à manifester la moindre sympathie en faveur du condamné, tandis qu’une notable partie de la presse s’acharnait contre lui, en sa qualité de juif, avec une ardeur sans pareille.
Me Demange a publiquement déclaré que nulle autre pièce n’avait été produite aux débats que le bordereau bien connu, tandis que M. Paul de Cassagnac et d’autres ont dit tenir « de source sûre » que Dreyfus avait été condamné sur un document produit en chambre du Conseil, hors la présence de l’accusé et de son défenseur. S’il en est ainsi, et aucun démenti ne s’est encore produit, où sont les garanties de justice en France ? Qui de nous serait assuré demain d’échapper à une condamnation prononcée sur des pièces dont il ignorerait même l’existence ?
Je sais qu’il y a contre Dreyfus la preuve graphologique. Mais le moins qu’on puisse dire là-dessus, c’est que les graphologues, dans le cas dont il s’agit, sont en complet désaccord. Un expert du Figaro découvrait hier dans la signature de Nicolas II qu’il était empereur de Russie, et dans celle de Félix Faure qu’il était président de la République Française. Cela n’est pas mal. Mais nous restons dans le doute sur l’auteur véritable du bordereau. D’autant que le redoutable Bertillon, qui s’est prononcé pour la culpabilité de Dreyfus, nous apprend aujourd’hui qu’il n’est pas graphologue, et que sa conviction repose simplement sur des raisonnements « d’une certitude mathématique ». Cela fait frissonner vraiment, car c’est avec des « raisonnements » de ce genre qu’on a, pendant des siècles, torturé, étranglé, brûlé tant d’innocents.
Enfin notre devoir, à tous, est bien clair à cette heure. Il ne s’agit que d’aider dans la mesure de nos forces à la production de la vérité. C’est pourquoi je sens ma curiosité s’éveiller aux romanesques dessous qu’on nous annonce. Il se peut qu’il y ait là plus d’un fil conducteur. J’imagine qu’il suffira, pour trouver la vérité, toute la vérité, de la chercher avec le ferme dessein de la dégager de sa gangue. Le voudrait-on vraiment ? Jusqu’à nouvel ordre, nous devons le croire.
18 novembre 1897.
VIII
Vers le grand jour
Il faut convenir que, pour son début, l’affaire Esterhazy-Dreyfus semble plutôt compliquée. M. Mathieu Dreyfus, par sa lettre de dénonciation, a mis en mouvement tout à coup une étrange fourmilière. On voit dans les récits du commandant une femme voilée qui promène une photographie des documents les plus secrets du ministère de la guerre, des inspecteurs de police se jetant dans la Seine pour porter à l’objectif de M. Bertillon une pièce qui va reprendre sa place dans son dossier sans que l’eau du fleuve ait laissé de traces pour dénoncer l’escapade. Tout cela n’est pas ordinaire. Mais comme tout arrive, même le roman, il suffira de la moindre enquête pour tirer ces aventures au clair. Je vois déjà par le Figaro que M. Esterhazy sait le nom de l’inconnue. La voilette soulevée, c’est un joli coin du mystère qui va tout à coup s’éclaircir.
Il est sans doute fâcheux pour M. Esterhazy qu’il soit en aussi bons termes avec M. de Schwarzkoppen, l’attaché militaire allemand qui vient justement de nous quitter, et que sa propre écriture ressemble, comme il le dit lui-même, d’une manière effrayante à l’écriture incriminée. M. Bertillon ayant édifié ses fameux raisonnements mathématiques sur une écriture qui se trouve aujourd’hui n’être plus qu’un décalque de celle de M. Esterhazy, d’après M. Esterhazy lui-même, tout l’échafaudage de l’expert reçoit ainsi de M. Esterhazy en personne une assez belle bousculade. Quant aux explications de M. Esterhazy elles peuvent être excellentes. Il suffira que l’officier chargé de l’enquête se mette en mesuré de les vérifier. S’il veut bien en même temps se donner la peine d’examiner de très près les accusations produites, contre les personnes qu’on suppose avoir fourni des renseignements à M. Scheurer-Kestner, je crois qu’il fera, dans un sens ou dans l’autre, un grand pas vers la vérité.
Voici le lieutenant-colonel Picquart, par exemple, qui se voit accuser par M. Esterhazy d’avoir reçu de l’argent (tout comme M. Scheurer-Kestner, d’ailleurs) pour innocenter un traître, et mettre à la charge d’un innocent le crime de trahison. S’il a fait cela, il faut qu’il soit puni, avec tous ses complices, de la façon la plus sévère. Il ne reste plus qu’à le prouver. M. Esterhazy, je suppose, n’a point parlé sans raisons. Qu’il se hâte d’établir ses allégations devant le magistrat enquêteur.
Le ministre, qui est, nous dit-on, au courant de ces choses — et il me paraît vraiment difficile qu’il ne le soit pas — faisait depuis quinze mois une enquête sur M. Esterhazy. Celui-ci nous annonce en effet qu’il existe au ministère de la Guerre un document qui l’accuse. Il argue la pièce de faux, bien entendu. Mais quel ami, oublieux de tous ses devoirs, lui en a révélé le contenu en dehors de toute action judiciaire ?
Est-ce donc ainsi qu’on procède en de telles affaires ? Par qui donc sommes-nous gardés ? Si on a cru M. Esterhazy innocent, pourquoi cette surveillance, et, si on l’a supposé coupable, pourquoi l’exil du colonel Picquart qu’on nous donne comme son accusateur ? On nous dit que cette dernière mesure a été prise pour éviter le scandale. En vérité, le général Billot doit commencer à reconnaître qu’il n’est pas de force à ce jeu-là.
19 novembre 1897.
IX
Toute l’enquête
Il est de toute évidence que le ministère de la Guerre tient bon pour la culpabilité de Dreyfus. Le général Billot a déclaré à la tribune qu’il avait pris connaissance des documents Scheurer-Kestner et que son opinion n’en avait pas été changée. Le chef de cabinet du général de Boisdeffre — dont les trente jours d’arrêts ne feront croire à personne qu’il ait pris l’initiative d’une démarche aujourd’hui connue — est allé dire à M. Henri Rochefort : « Nous possédons la preuve indubitable que le commandant Esterhazy est la victime d’un infâme complot ; mais en ce qui concerne Dreyfus, je suis autorisé à vous dire que nous possédons des documents absolument probants, qui, tout en dégageant complètement le commandant Esterhazy, établissent péremptoirement la culpabilité du prisonnier de l’île du Diable. Ces documents, le syndicat Dreyfus en ignore même l’existence. Lorsque le moment sera venu, on les lui servira. » Telle est la version de M. Henri Rochefort lui-même parlant à un reporter de la Patrie.
Tout ceci est très clair. Mais pourquoi faire des confidences à un journaliste et annoncer qu’on servira les pièces probantes plus tard, quand il suffirait de les produire dès à présent pour en finir avec cette triste affaire ?
Il y a huit jours, j’ignorais l’existence du commandant Esterhazy. Aujourd’hui, nous ne savons tous de lui que ce qu’il en a bien voulu dire, et chacun est d’accord pour reconnaître qu’il nous a narré des choses bien extraordinaires. Cela peut impressionner diversement. Mais si le général de Boisdeffre a la preuve que le commandant est victime d’une odieuse machination, je dis qu’il n’a pas le droit d’attendre pour nous « servir » les pièces probantes. Et quand il nous les aura « servies », quand la culpabilité de Dreyfus sera enfin, grâce à lui, publiquement démontrée, je regretterai encore — avec tout le monde, je suppose — qu’il n’ait pas commencé par là.
Seulement, comme le dit très bien l'Eclair, il y a deux affaires en ce moment devant le public :
1° La plainte Mathieu Dreyfus contre M. Esterhazy ;
2° La plainte Esterhazy. contre le colonel Picquart, accusé d’avoir reçu de l’argent pour faire innocenter un traître et condamner un innocent.
Il est impossible d’enterrer cette seconde affaire, qui ne me paraît pas beaucoup moins grave que la première. L’honneur du colonel Picquart doit bien peser, dans les balances du général Billot, autant que l’honneur du commandant Esterhazy. Comment celui-ci pourrait-il être admis à produire contre son supérieur une accusation infamante sans que ce dernier fut appelé à se défendre ? Je lis dans un journal que le colonel est si occupé en Tunisie que le général. Billot refuse de le faire venir à Paris. Il ne faut pas qu’on nous conte cette histoire. Autrement tous les soupçons seraient permis.
Ce serait trop simple, en effet, de livrer un officier en pâture à toute la presse, et de lui refuser le droit de venir présenter sa défense. Je ne sais rien du colonel Picquart, mais je ne suis certainement pas seul à penser qu’il est temps pour lui de parler, quoi qu’il ait à dire.
L’enquête à peine commencée, on nous en annonce la fin. A qui fera-t-on croire qu’elle est sérieuse, si le colonel Picquart, accusé par M. Esterhazy d’être l’âme d’un complot fomenté par un traître, ne comparaît pas en personne devant le général enquêteur ?
20 novembre 1897.
X
Les demi-vérités
Je n’ai jamais prétendu que le capitaine Dreyfus fût innocent, par la simple raison que je n’en sais rien, ni n’ai aucun moyen de le savoir. Mais je soutiens de toute mon énergie avec beaucoup d’autres — et les événements depuis quelques jours se sont étrangement chargés de nous donner raison — que la lumière n’est pas complète sur cette ténébreuse affaire, et que le Gouvernement doit à l’opinion publique la pleine vérité.
Eh bien ! la question qui se pose est précisément de savoir si, oui ou non, le ministre de la Guerre veut faire éclater la lumière dans les ténèbres où nous sommes plongés. Or, je suis bien obligé de constater que l’attitude du général Billot est fort étrange.
Il commença par nous déclarer, dans une note officieuse, qu’il n’avait reçu aucune communication de M. Scheurer-Kestner, et nous apprenions le lendemain qu’il avait eu un long entretien avec l’honorable sénateur, qui lui avait soumis tous ses documents.
Ce n’est pas tout. Le général Billot ne dit pas un mot de cette entrevue à ses collègues du Ministère, qui ne se sont pas fait faute d’en manifester leur mécontentement à leurs amis des deux Chambres. Il allègue à la tribune que l’entretien était confidentiel, mais il néglige bizarrement de dire que, loin d’être lié vis-à-vis des ministres par M. Scheurer-Kest-ner, c’est lui qui a demandé à celui-ci de se laisser couvrir d’injures pendant quinze jours sans répondre.
Hier, encore, il niait avoir reçu de M. Bazille une communication de la part de M. Esterhazy, et le député de la Vienne s’est vu dans l’obligation d’infliger à M. le ministre de la Guerre le démenti le plus courtois, sous le coup duquel celui-ci est resté bien tranquille jusqu’ici.
Est-il vrai, comme l’a dit un journal, que le ministre ait fait demander à M. Esterhazy, par M. Bazille, de ne pas poursuivre ses accusateurs au cas où il sortirait indemne de l’enquête ? Ce serait bien étrange. Pas plus, d’ailleurs, que de voir le chef d’état-major général communiquer des renseignements secrets à la presse par l’intermédiaire de son chef de cabinet, qu’il est obligé de punir pour lui avoir obéi, afin d’épargner au ministre l’obligation fâcheuse de le punir lui-même.
On se plaint que tout ce scandale ne soit pas pour accroître le prestige de l’armée. L’armée ne peut être responsable du crime d’un traître, quel qu’il soit. La seule chose qui puisse lui nuire en cette affaire, c’est l’attitude inexplicable de certains chefs, prêtant aux interprétations malveillantes.
Y a-t-il donc quelqu’un qu’on veuille couvrir quand même, voilà ce qu’on commence à se demander tout bas. La question a d’autant plus de vraisemblance qu’on nous annonce — je veux encore en douter — que le général Billot ne permet pas qu’on fasse venir le colonel Picquart à Paris.
En vérité, ce serait là le pire scandale. M. Esterhazy a lancé contre son supérieur une accusation de crime. Il ne s’agit pas d’envoyer à Tunis une commission rogatoire pour étouffer la réponse. Il faut que ces deux hommes soient confrontés, et que nous sachions qui des deux a le droit de confondre l’autre. On ne pourra le savoir qu’en les mettant face à face. Le commandant Esterhazy doit le réclamer lui-même. Autrement il nous faudra bien croire que quelqu’un redoute cette rencontre.
On nous dit que le colonel Picquart aurait été exilé pour avoir trop parlé. Ce n’est pas lui, jusqu’à présent, qui se répand dans les feuilles publiques. Il paraît qu’on arrête à la poste les lettres qu’on soupçonne d’être siennes Je n’ai rien à dire là-dessus. Il faut éclairer la justice. Non pas en laissant la moitié de la vérité dans l’ombre.
Car, alors, tout le monde croira que si on a expédié le colonel Picquart à Sousse, si on ne veut pas qu’il revienne à Paris, ce n’est pas parce qu’il a parlé, mais parce qu’on a peur qu’il parle. Que M. le général Billot réfléchisse, avant de prendre une résolution dernière.
27 novembre 1897.
XI
Le colonel Picquart
L'Echo de Paris, qui passe pour avoir de bonnes relations avec le ministère de la Guerre, a publié l’information suivante :
Nous croyons savoir que le général de Boisdeffre, chef d’état-major général, a demandé et obtenu la comparution du lieutenant-colonel Picquart devant un conseil d’enquête.
Cette note, qui parait de source officieuse, est pour moi simplement incompréhensible.
Qu’est-ce que le général de Boisdeffre vient faire encore dans cette complication de personnages, après l’incident Pauffin de Saint-Morel qui a eu l’étrange terminaison que l’on sait ?
Si le chef d’état-major général avait quelque plainte à produire contre le colonel Picquart, qu’avait-il besoin de la plainte Mathieu Dreyfus contre M. Esterhazy et de la plainte Esterhazy contre le colonel Picquart pour mettre le conseil d’enquête en mouvement ?
Enfin, comment l’idée a-t-elle pu venir au ministre de faire comparaître le colonel Picquart devant un conseil d’enquête et le commandant Esterhazy devant un autre ?
Cela me paraît si parfaitement absurde que j’attends une note Havas nous informant que le général de Boisdeffre, tout bien considéré, a fini par infliger un mois d’arrêts de rigueur à mon ami Rosati, secrétaire de la rédaction de l’Echo de Paris, pour avoir publié une nouvelle qui a cessé d’être exacte.
Ce qui achève ma surprise, c’est que le même journal donne à la note ci-dessus une conclusion encore plus bizarre.
Le lieutenant-colonel Picquart, dit-il, ne quittera pas Tunis avant son interrogatoire par le général Leclerc.
Ça, c’est le triple fond de la bouteille à l’encre. Faire interroger le colonel Picquart par le général Leclerc, à Tunis, pour lui faire continuer sa déposition devant le général de Pellieux, à Paris, est une conception si absurde qu’il faut renoncer à comprendre.
On aura beau chercher mille moyens d’éviter la confrontation du commandant Esterhazy avec le colonel Picquart, on ne réussira pas à tromper l’opinion, qui voit dans le débat contradictoire entre ces deux hommes la meilleure source des informations attendues. Beaucoup de gens sont déjà fort surpris des étranges hésitations du ministre de la guerre. Il semble qu’il veuille protéger contre les investigations du juge quelqu’un de ses subordonnés coupable, non de trahison, mais de grave négligence. C’est ce qu’on dit déjà. Que ne coupe-t-il court à toutes ces rumeurs, en mettant le général enquêteur en situation d’accomplir intégralement son devoir ?
Jamais question ne fut plus clairement posée. Le commandant Esterhazy, accusé par M. Mathieu Dreyfus, accuse d’un complot infâme le colonel Picquart. Eh bien ! il faut que le colonel Picquart soit mis en demeure de répondre — M. Esterhazy présent — aux accusations portées contre lui. Il semble que tout le nœud de l’affaire soit dans la discussion entre ces deux hommes. C’est bien ce qui fait que l’attitude imprévue du général Billot, manœuvrant, dirait-on, pour empêcher cette rencontre, a déconcerté tout le monde.
Je veux croire que le ministre est déjà en train de réparer sa faute. Tous ceux qui ne cherchent que la vérité, quelle qu’elle soit, seront unanimes à s’en féliciter.
22 novembre 1897.
XII
Rue Saint-Dominique
Tous les journaux ont reproduit une note énigmatique de l’Agence Havas ainsi conçue :
« L’enquête du général de Pellieux continue. Le lieutenant-colonel Picquart sera entendu. »
Il serait vraiment trop étrange que l’enquête du général de Pellieux ne continuât pas, et que le lieutenant-colonel Picquart ne fût pas entendu.
Les journaux au courant du style officiel nous affirment que cela veut dire en français de ministère : « Le lieutenant-colonel Picquart sera confronté, devant le général de Pellieux, avec le commandant Esterhazy. » Si cette traduction est véridique, il ne nous reste plus qu’à regretter qu’il ait fallu tant de discours pour convaincre le général Billot.
Déjà l’on aperçoit les fâcheuses conséquences de la conduite incompréhensible du ministre de la Guerre M. le colonel Picquart a été entendu à Tunis par le général Leclerc, et, bien que le colonel se soit refusé à toute interview, nous trouvons déjà dans la presse parisienne un aperçu plus ou moins exact de certaines parties de sa déposition qu’il est impossible de contrôler en l’absence de l’intéressé.
L'Echo de Paris nous informe en effet que son correspondant de Tunis lui a « télégraphié et communiqué » le renseignement suivant :
M. le colonel Picquart a formellement nié avoir communiqué à personne, soit verbalement, soit par écrit, des documents ou renseignements ayant trait au procès Dreyfus. M. Picquart aurait insisté sur cette circonstance qu’il pourrait bien se faire que des tiers ayant connu partie des pièces du dossier avant leur communication officielle au ministère de la Guerre en aient conservé des copies ou photographies ; que les indiscrétions à lui reprochées pourraient provenir de ces tiers. Enfin le colonel Picquart ignorerait à quel document probant a pu faire allusion M. le commandant Esterhazy.
Même s’il n’a pas passé par la rue Saint-Dominique, ce télégramme — émanant sans doute de quelqu’un en position de regarder par-dessus l’épaule du juge — continue de ne nous donner que des demi-vérités. Que sont ces tiers qui s’amusent à photographier des pièces secrètes intéressant la défense nationale « avant leur communication officielle au ministère de la Guerre » ? Il doit y avoir des noms et des explications. Cela vaudrait la peine d’être connu. Il serait également curieux de savoir pourquoi il faut le colonel Picquart pour dénoncer des actes si graves qui ne peuvent être ignorés de ses chefs.
L’Echo de Paris ajoute :
Bien qu’elles aient été contestées, des saisies de lettres et de télégrammes ont été opérées à Paris, Marseille, Tunis et Sousse. En ce qui concerne les télégrammes, à propos desquels une vérification rapide est facile, on posséderait la certitude, assure-t-on, que les expéditeurs auraient indiqué sur les minutes des adresses fictives, d’où la difficulté d’arriver à connaître quels sont ces expéditeurs. Pas mal de lettres saisies ne porteraient aucune signature... Cependant, de l’examen de toutes ces lettres et télégrammes, anonymes ou non, il ressortirait d’une façon certaine que les pièces constitutives du dossier Dreyfus sont connues par les auteurs de ces correspondances et que l’ensemble du dossier, y compris le dossier communiqué en chambre du Conseil de Guerre, est tombé entre les mains du syndicat.
Ceci achève d’un trait la peinture du chaos au ministère de la Guerre.
On n’a pas voulu montrer à Dreyfus, qui devait la connaître, apparemment, ni à Me Demange lui-même — dont la discrétion valait bien, cependant, celle du geôlier à qui le ministre Chautemps faisait les révélations les plus secrètes — certaine pièce mystérieuse dont la publicité devait entraîner, nous disait-on, la guerre. Le danger était tel qu’on n’a pas craint de faire le huis clos, et de juger un homme sans qu’il lui fut possible de contrôler dans son origine et dans sa teneur la pièce qui le décrétait d’infamie. Et voilà que tout ce redoutable mystère aboutit à ceci que la pièce est dans les mains de tout le monde, et qu’un de ces jours il nous en sera donné connaissance dans les. gazettes.
Même lorsque Dreyfus est à l’île du Diable, nous sommes bien mal gardés, monsieur le ministre de la Guerre !
23 novembre 1897.
XIII
La parole de Vérité
Le Figaro se pose une singulière question : Le colonel Picquart vient-il à Paris pour parler ou pour se taire ?
Je ne puis concevoir la pensée qu’on ose jouer la comédie de faire comparaître cet officier devant le général enquêteur, en lui interdisant de dire ce qu’il sait. Il est vrai que le ministre ne s’est pas montré très pressé de le faire entendre, et je comprends tout ce qu’il peut y avoir de délicat pour le colonel à mettre en cause peut-être un de ses supérieurs.