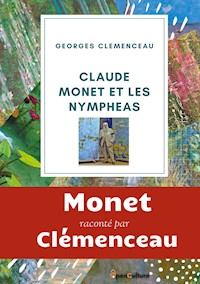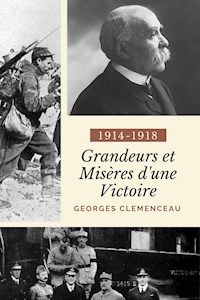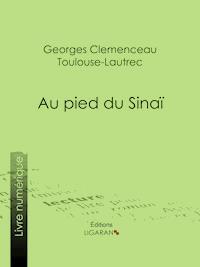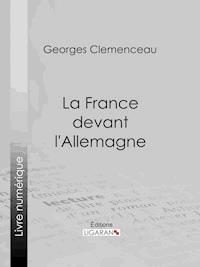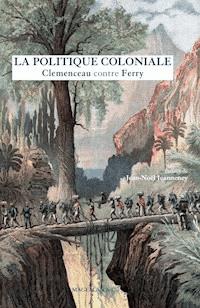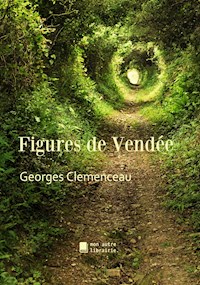
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Retour ému, quoiqu'un peu distant, d'un Vendéen devenu Parisien dans les profondeurs de la région qui l'a vu naître. Du bord de mer en passant par le marais ou le bocage, ses longues promenades à pieds, en chasseur ou en simple curieux, lui donnent l'occasion de nous présenter ceux qui ne sont jamais partis. Une émouvante collection de portraits croqués sur le vif : petites gens "dans leur jus" d'une vie immuable depuis des siècles, habiles à des métiers disparus, façonnés sur des générations par des paysages aujourd'hui nivelés.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Figures de Vendée
Georges Clemenceau
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Plon, Paris, 1930
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-008-0
Table des matières
I – La Tranche-sur-Mer
II – La « Jeune Espérance »
III – La chasse aux cailles
IV – Surprise de chasse
V – Lavabo
VI – Le buisson qui marche
VII – Au bord de l’eau
VIII – Un sauvage
IX – Chez les Anglais
X – Les deux Antoine
XI – La messe au village
XII – Six-Sous
XIII – Faustine au village
XIV – Fleur-de-Froment
XV – Bouvreuil et sabotier
XVI – Joseph Huguet
XVII – Mademoiselle Stéphanie
XVIII – Jacquille
XIX – C’est toujours mieux que de voler
XX – Le renard gris
XXI – Maître Baptiste, juge
XXII – Jacques Fagot
XXIII – La fête de Jean Piot
XXIV – La roulotte
I – La Tranche-sur-Mer
Je suis apparemment au bout du monde, puisque, marchant tout droit devant moi, la terre vient à me manquer tout à coup. En vérité, c’est l’Océan qui m’arrête, le grand flot vert, frangé de mousse blanche, que le courant chaud nous envoie des Antilles pour se pâmer tout écumant de plaisir sur le sable d’or d’une grève sans fin.
Au delà de la mer tranquille, dont la grondante caresse de bête heureuse vient jusqu’aux vignes du jardin sous ma fenêtre, une ligne bleue dentelée m’indique l’île de Ré fermant le pertuis breton. Des voiles immobiles de pêcheurs, empourprées du soleil levant, blanches sur le flot sombre, noires sur le lait bleuissant de la mer lumineuse, incertaines formes grises d’horizon embrumé, attestent l’homme sur l’immense étendue. Des vols de mouettes, de courlis, de macreuses ou de petites hirondelles de mer emportent de la vie dans la vapeur moutonneuse où transparaît la voûte bleue. La troupe des marsouins qui s’ébat dans les claires profondeurs, voyant en son plafond mouvant scintiller les milliards d’étoiles que le soleil allume aux petites vagues dansantes, s’élance en fusées d’argent dans la lumière d’or, et ne retombe en courbes joyeuses que pour s’élancer encore dans l’enivrement du ciel. Et vraiment les silencieuses vagues blanches de la voûte céleste se confondent si merveilleusement parfois, en d’étranges jeux de lumière, avec la vapeur bleue qui monte de la plaine bruissante où elles se mirent, que la voile de l’horizon paraît flotter dans l’air, et les grands goélands noirs rayer l’opale de la mer. Deux voûtes de cristal fantastiquement se confondent dans la brume, l’une de l’immobile espace illuminé de ses astres flambants du jour et de la nuit, l’autre de ce peu de planète liquide dont le mouvant miroir reçoit l’image de la profondeur infinie, et donne à notre émerveillement l’illusion de la sphère du monde. C’est l’enchantement de cette terre agitée qui a nom l’Océan, pour les êtres d’un jour naufragés de l’Océan figé qui fait les continents.
Comme elle est riante, l’aimable épave où m’a jeté le hasard d’une courte vacance. Une étendue de sable doré fleurie de pommiers blancs, de pêchers roses, et de tendre verdure, où du haut du ciel bleu l’alouette gauloise laisse tomber sa cascade joyeuse, où, sous la lune amie, le rossignol éperdu dit sa folie d’amour aux bons grondements de la mer indulgente. Du sable, toujours du sable, mais du sable en fleurs, du sable verdoyant. Sauf le blé, toutes les cultures de la plaine. Des vignes, des fusains, des grands peupliers blancs, des pins qui descendent jusqu’à la mer. Point de rochers. Des montagnes de sable aux grandes coupes molles dominant les vastes cirques de lumière ocreuse où vient mourir dans un bouillonnement de volupté la grande lame verte qu’on voit arriver du large depuis l’extrême horizon.
Des dunes, encore des dunes, vallonnantes ou montant en crêtes, comme d’une tempête furieuse qui, tout à coup, se serait figée. Et, de fait, c’est bien la tempête de l’air qui a fixé ces formes maintenant immobiles. Avant les plantations de pins qui retiennent le sol, le cinglage, sans la foi, transportait les montagnes et, sur les ailes du vent la plus haute dune faisait en une nuit d’incroyables voyages. Aujourd’hui même encore, d’imprévus déplacements se produisent, mais l’humeur errante de la fine poussière de sable ne présente plus les dangers d’autrefois. Cimes ou vallées, la forêt de pins monte ses parasols de sombre verdure sur de longs fûts violets écaillés de plaques brunes. Au travers des longues aiguilles de rouille faisant natte sur le sable clair, toute une flore a surgi, mêlant la senteur exquise du petit œillet rose, ou l’arôme pénétrant de l’immortelle, aux parfums vivifiants de la sève résineuse. Parmi les grands cônes qui jonchent le sol, sur des tapis de lichen, de mousse ou de géranium, le genêt, l’ajonc, le pourpier sont accourus. Avec la flore, la faune la perdrix rouge, les troupes de ramiers, la bécasse de passage, le lièvre, le lapin, le renard, suivis du chien et du chasseur.
Dans l’intérieur de la dune, des jardins verdoient, abrités des bastions de sable. Des cultures de vignes, de pommes de terre roses, d’oignons qui s’entassent en pyramides d’or. Et puis de grandes failles dans la montagne sablonneuse, des casses, comme on dit ici, plaines fertiles qui s’avancent vers la mer. Chacune a son nom : la Casse à la bonne femme, la Casse du navire méchant, etc. Au travers de tout cela, un dédale de sentiers où circule un peuple de bourriques grises, hirsutes, portant le varech pour la fumure ou la récolte, suivant la saison, piétinant bravement dans le sable, sous la conduite d’enfants rôtis, grillés, cuits et recuits.
La race est vigoureuse. Hommes et femmes, jambes nues dans le sable brûlant, montrent le muscle sec et dur de l’Arabe dont ils ont la patine de bronze, rehaussée de la blancheur immaculée de la coiffe ou de la chemise. Adossés aux pins des hautes dunes, les villages entassent leurs maisons blanches aux tuiles pâles dans les lilas, les tamarins et les roses. Une étroite bande de dune étalée s’étend en plaine jusqu’à la bordure du grand marais, jadis conquis sur la mer, prairie hollandaise de jeune verdure où jusqu’à l’horizon les troupeaux, parqués entre les canaux, mettent des taches fauves. Ce ruban de sable, qui marque la fin des dunes et relie les grandes casses entre elles, c’est la fortune du pays. Le varech épandu, on retourne le sol à la bêche, après quoi, hommes et femmes, à genoux, grattant le sable de leurs doigts, piquent l’ail et le haricot, double récolte, ou la petite pomme de terre d’une qualité singulière. Les Anglais, les Allemands viennent chercher ces denrées dans les petits ports de la côte. Certains de ces terrains, que vous diriez stériles, se sont vendus sur le pied de trente mille francs l’hectare. Il n’y a point de pauvres en ce pays. L’âne lui-même, broutant sa luzerne, se répand en éclats grinçants de joie, et le paysan, qui pique sa vigne, silencieusement se rit du phylloxera.
Après les moissons fécondes que le bon sable livre généreusement à qui le fouille de ses ongles, voici maintenant les récoltes de la mer. Avec son flux et son reflux, la mer, en grande coquette, ne feint de fuir que pour attirer l’homme et se donner plus complètement à lui. Le flot qui se retire laisse à nu de grandes plages vertes de varech semées de lacs pierreux où mille choses grouillantes invitent le pêcheur. Il accourt avec son filet, et la plaine luisante se peuple de silhouettes noires qui semblent autant d’échassiers. Point de port pourtant, point de barque. Une jetée à demi écroulée dit la violence du flot rageur qui déferle obliquement de l’entrée du pertuis breton. Les bateaux pêcheurs qui animent la mer viennent du petit port de l’Aiguillon, à l’embouchure du Lay, le fleuve vendéen. Les Sables, la Rochelle sont les deux grands marchés de la côte. Le poisson de notre plage n’arrive point jusque-là, et c’est tant mieux pour nous.
Sans parler des coups de seine qui jettent sur le sable toute une marée frétillante, nous avons nos écluses, enclos de murailles ouvert seulement du côté de la terre, où la mer en se retirant abandonne une dîme généreuse. Le bon pêcheur, de son pied nu dans la flaque d’eau, sent la sole ou la loubine qui se dérobent sous le sable, et triomphalement les pique de sa pointe ferrée. Parfois de grandes pièces s’attardent en l’écluse traîtresse. Quelle aventure et que de commentaires ! Aux grandes marées, quand arrive le flot poissonneux, le Tranchais, armé d’une manière de colichemarde, marche au-devant de la haute lame verte qui se dresse pour se crêter d’écume, et dans la transparence de la muraille liquide, dague le poisson comme le torero sa bête. Ainsi j’ai vu jouer du trident le pêcheur au flambeau dans le golfe de Saint-Tropez.
À d’autres jours, marqués par les saisons et les vents, la mer prévoyante apporte on ne sait d’où des flots de varech noir que toute la population s’empresse à recueillir, car c’est la fécondité de la terre. Qu’est-ce que nos gens pourraient demander de plus ? La terre et la mer sont bonnes pour eux. Le percepteur lui-même est clément, puisque le sable fertile n’est pas encore cadastré. On est heureux en ce coin oublié de civilisation presque autant qu’en pays sauvage.
Et de fait, avec sa face morose de brique pilée où deux trous ardents mettent une énergie singulière, le Tranchais semble un vestige oublié des races primitives. L’homme est doux cependant, silencieux et grave. Comme tous les riverains du flot salé, sa faculté d’observation est curieusement cultivée. Sur le sable humide, l’empreinte du talon, la disposition des orteils, l’obliquité de la trace, lui disent le nom du passant. On se connaît ici par la plante du pied comme ailleurs par le visage. « Tiens, un tel a passé là. Où allait-il ? Pourquoi avec tel autre qui aurait dû être ailleurs ? etc., etc. »
Ainsi devisaient hier soir les hommes au retour de la pêche. Les courlis invisibles au-dessus de nos têtes s’appelaient de leurs sifflets interrogateurs, et, se répondant de tous les coins de l’horizon, se dirigeaient vers les hautes dunes d’abri. La nuit tomba, une nuit sans lune et sans étoiles. Nous marchions dans l’obscurité profonde, secoués du mugissement de l’abîme noir qui s’éparpillait à nos pieds, en écume lumineuse.
– La mer est belle ainsi, fis-je sottement, sans penser.
– Oh non, monsieur, répondit le pêcheur, les vents sont mauvais, il n’y aura pas de poisson demain.
II – La « Jeune Espérance »
C’est le joli nom de la petite goélette ronde que je voyais depuis l’aube louvoyer devant ma fenêtre. Le rendez-vous était pris de l’avant-veille, et, depuis le soleil levé, j’interrogeais l’étendue pour voir d’où viendrait la Jeune Espérance. Les premières flèches de lumière, rasant en ricochets de feu la sombre mer, me montrent un peuple de voiles incertaines fêtées des mille crêtes sautillantes qui s’allument aux incendies de l’horizon. Pêcheurs, caboteurs s’éveillaient dans le pertuis breton ; toute une flotte de petites voiles penchées sur le flot, nonchalantes dans la brume assoupie du matin.
Bientôt l’une d’elles lentement se détache, grossit, et, courant de petites bordées tranquilles, s’approche de terre autant que le permet la marée basse. Enfin la voile bat le mât, l’ancre tombe ; une embarcation se détache. Qui refuserait l’invitation de la Jeune Espérance ? Ce n’est pas moi vraiment, et, dès que le canot est près d’atterrir, je suis sur le dos de Girard, qui entre bravement dans l’eau pour me déposer à bord. Il n’y a pas d’autre moyen de s’embarquer à la Tranche-sur-Mer. Nous ferons mieux quand nous aurons un port.
Je m’installe, non sans difficulté, avec mes compagnons, dans la frêle coquille vivement secouée des grandes lames qui déferlent des rochers de l’Aunis. Arc-boutés l’un contre l’autre, joyeusement douchés d’embrun, nous nous abandonnons au bercement impérieux de la vague, et nous surgissons et nous plongeons comme autant de gais marsouins. L’Aunis ne veut pas nous lâcher : sa longue vague bouillonnante s’obstine à nous garder au rivage avec la marée montante. Enfin nous franchissons la barre, et la Jeune Espérance, qui trouve maintenant plus de fond, vient à nous voiles tendues. Quel poète déçu a maudit la Fuyante Espérance ? Cela est de la terre, aède à courte vue. Comment oubliais-tu que la mer, la grande mer dansante, est féconde en surprises ? Regarde accourir vers nous la verte carène de la Jeune Espérance, au plein vol de ses grandes ailes blanches. Elle nous veut. Elle vient nous ravir à la terre pesante, pour nous emporter, sur la mobile mer où les souffles se déchaînent, à notre rêve réalisé.
Notre rêve est simplement d’aller coucher ce soir à Saint-Martin-de-Ré. Je n’ai pas plus tôt mis le pied sur le pont de la Jeune Espérance que j’oublie tout, hormis la goélette et la mer. Cinquante-cinq tonneaux, bout-dehors, misaine, artimon, cale, couchettes, treuil, barre, tout un monde enclos dans les solides nervures de chêne, où se brise l’effort du flot. Et l’équipage ? Trois Clemenceau... Des parents inconnus, peut-être. Un vieux loup de mer aux jambes torses, qui, de l’Inde à l’Australie, a fouillé tous les coins d’océan, et puis ses deux fils, deux beaux gars qui font honneur à la famille, l’un, grand gaillard bien découplé, à l’allure tranquille et résolue ; l’autre, jeune éphèbe grec de peau blanche et d’œil noir, front bas, lignes pures encore empâtées de jeunesse : deux fiers cousins que j’ai là. Dès les premiers mots, nous affirmons la parenté, et nous voilà soudainement oncle, neveu, cousins, rassemblés pour un jour sur les flots où court maintenant la goélette familiale.
Quelle joie ! Le vent saute et nous chasse de Ré. La traversée, qui devait être de trois heures, sera de six au moins. Six heures, six belles heures ensoleillées, entre le ciel et la mer, avec pas de nouvelles du monde, rien des hommes que le silence des trois Clemenceau à leurs voiles, courant d’interminables bordées, mettant le cap tour à tour sur vingt points différents, sauf celui où ils vont... comme dans la vie. C’est une belle journée, arrachée à l’absurde agitation de vivre. Rien à faire, rien à dire, s’abandonner aux éléments, regarder, rêver.
Je regarde et je ne vois rien qu’une plaine infinie de lumière d’argent, d’or, de plomb bleu, d’acier bruni, avec des myriades d’étoiles, des rayons jaillissant en bouquets d’étincelles, d’aveuglantes gerbes de flammes comme venues de fusées qui seraient lancées des profondeurs. Et, puis, parce que nous avons viré de bord et que notre éclairage est changé, voilà qu’un grand apaisement se fait, et nous voguons comme dans un ciel vert semé de clairs flocons tremblants. Ciel et mer confondus, nous passons dans une lumière mouvante, et nos yeux voient ce que nous n’eussions pas rêvé. Ainsi tout le jour, toute heure, toute minute, un changement de féerie, des hallucinations réalisées, un inextricable mélange de visions et de vérité.
Comment jouir de ces délices qui vous enlèvent à la vulgaire vie des humains quand deux assassins sont à bord, trouvant leur unique joie dans le sang ? Je vous ai vues, mouettes blanches aux ailes affilées d’aronde, battre la mer de vos ailes sanglantes. Je vous ai vus, plongeons ardoisés que ballotte la vague, disparaître en vain sous le flot vert et remonter pour mourir. Je vous ai vus, bons marsouins noirs, fuir en grands bonds rythmés sous le plomb qui rougissait l’écume, et je n’ai pas maudit les meurtriers stupides, moi coupable, au moins, d’avoir engendré l’un d’eux.
Les trois Clemenceau eux aussi regardaient sans rien dire, faisant griller une couenne de seiche, et s’en délectant après l’avoir réduite à l’état de semelle brûlée. C’est avec ces repas-là que ces gaillards se font de si beaux muscles, sans beefsteaks, ni fer, ni coca.
À quatre heures, nous donnons dans la passe, et, bientôt, nous sommes amarrés au quai. Un petit bassin carré bordé de minuscules maisons blanches et jaunes, fraîchement badigeonnées. Une belle dame en carreaux écossais nous vante son hôtel où nous nous arrêtons au hasard.
Bien curieuse, l’île, à cause du pénitencier où sont les forçats. Nous avons vu Mme Dreyfus. On a fait partir son mari sans la prévenir. Ce soir, si vous dînez à table d’hôte, vous pourrez voir le gardien-chef.
Tout cela dit avec des mines précieuses. J’éprouve une furieuse envie de reprendre la mer.
On me calme en me promettant d’éviter la table d’hôte, et je pars à la découverte. Toute la ville semble badigeonnée de frais. Maisons blanches, maisons jaunes, qu’on dirait astiquées du matin. C’est le luxe du pays. Badigeon sur badigeon. Toute la ville est propre et luisante : habitudes de marins. Silencieux logis où vivent sans bruit des êtres de calme et de paix. Une grande place bien plantée, avec un bâtiment Louis XIII, brique et pierre, d’imposante façade. Un étrange théâtre dans un reste d’église ; une grille où flambe cette inscription : Hôtel de Ville, et, derrière, rien qu’une remise de pompiers. Les grands murs d’une jésuitière. Une église en ruines aux clochetons blancs et noirs pour servir de repère aux navigateurs. Nous pénétrons dans la grande nef déserte. Une plaque tombale nous apprend qu’ici repose Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, père de Mme de Sévigné, lequel trouva la mort en 1626, défendant l’île de Ré contre les Anglais.
Nous enfilons d’humides rues moussues, pour aboutir aux ouvrages classiques de Vauban. Des blés, des vignes, une riche campagne verte, dont la végétation est remarquablement en avance sur celle du continent. De grands moulins entourés de bâtiments à respectueuse distance pour le libre jeu des ailes, le tout resplendissant de chaux blanche. La ville, où nous rentrons, s’assoupit lentement dans le soir. De petits quinquets s’allument. Des ombres passent. Les lourdes portes des vieux hôtels du siècle dernier se ferment sans bruit. Où sommes-nous ? En quels temps ? En quel pays ? Il me semble que je suis mon propre bisaïeul, et que, si j’attends assez longtemps, le roi Louis XVI finira par monter sur le trône.
Le lendemain matin, dès l’aurore, nous roulons au grand trot vers Ars et la Pointe des Baleines. Ars est un grand village blanc avec une église gothique qui paraît rentrer sous terre. On y descend par cinq ou six marches. C’est là que sont enterrés les morts des grandes batailles du protestant Soubise contre S. M. Louis XIII. Un escalier extérieur grimpe bizarrement au clocher noir, comme goudronné. De là-haut vous découvrez la grande mer intérieure dite Mer du Fief, avec ses marais salants.
Toute la côte du Grand Large est battue de la Mer Sauvage qui gronde furieusement. La Mer du Fief n’en est séparée que par une étroite langue de terre, l’isthme du Martray, que protège une longue digue servant de contrefort à la dune. La marée basse a découvert l’immense plage de sable où les débris d’une grande carène disjointe attestent un récent naufrage. Toute la plaine miroitante grouille d’un peuple noir de ramasseurs du précieux varech, engrais de la terre. Armés de longues fourches, hommes et femmes empilent dans de petites charrettes toute cette chevelure visqueuse. Près de nous deux femmes en costume de travail, sarrau bleu, pantalon bleu, horribles à voir.
Le village franchi, nous sommes aux Phares des Baleines : l’un à la pointe de l’île, au milieu d’un petit bois coquet, l’autre en pleine mer sur la pointe d’un roc où les gardiens de service font tour à tour une villégiature d’un mois. Ces bons fanaux croisent leurs feux à vingt-deux milles en mer avec le phare des Barges devant les Sables d’Olonne. La lumière ne pourrait s’éteindre sans qu’une sonnerie éveillât les dormeurs. Le terrien veille pour le hasardeux matelot. Du haut de la tour, c’est la magique vision de l’île verte battue du flot, et puis la mer infinie sillonnée de voiles qui se perdent dans la lumière.
Quelques heures plus tard, la Jeune Espérance livrait sa toile au vent et nous cinglions vers la côte vendéenne. Brise arrière. Quel dommage ! Une courte traversée. La mer, devenue forte, ne nous permettait pas d’aborder la Tranche. Nous mettons le cap sur le port de l’Aiguillon, à l’embouchure du Lay, patrie des Clemenceau, marins de la République.
Une houle joyeuse nous bouscule vivement jusqu’au large estuaire où s’apaise le flot. Des bandes de petites mouettes égayant le ciel bleu de leurs vives plumes blanches viennent saluer la Jeune Espérance qui, traîtresse, répond à cette bienvenue par une fusillade scélérate. Hélas ! la mer nous rend à la terre, et c’est par la trahison et le meurtre que nous reprenons contact avec la vie du continent.
Par nous, ton nom est devenu mensonge, Jeune Espérance des Clemenceau de la mer. Nous avons rougi ton pont du sang innocent. Ce ne sont point là de tes jeux, ô bonne barque dansante qui portes le blé dans les îles. Chasse-nous. Abandonne-nous à la terre méchante qui bientôt aura raison de nous. Nous l’avons mérité. Adieu, oncle, cousins, que je ne connaissais pas hier, que j’oublierai demain. Retournez à vos grandes lames vertes qui bercent la vie monotone dans un grondement ami. Moi, je reprends le chemin de la ville, plus tumultueuse, plus perfide, plus fertile en naufrages que votre mer en sa fureur.
Allons, ferme à la barre, citadins ou marins, et que l’aveugle providence des éléments règle, suivant ses hasards, le douloureux cours de nos destinées.
III – La chasse aux cailles
Jadis, nous avions une chasse aux cailles. Les Méridionaux et les Égyptiens nous l’ont supprimée. Aux premières floraisons du printemps, les blés verts s’emplissaient des trilles amoureux par lesquels le petit coq endiablé exprime sa naissante ardeur. Ceux qui l’ont chassé à l’appeau, comme il m’est arrivé en compagnie d’un certain Bourguignon qui fut le plus grand pipeur d’oiseaux de la chrétienté, savent que rien ne l’arrête quand il s’avance, avec un frou-frou de matou en rut, vers l’objet de ses désirs. Plus tard, un joli coup de fusil, dont l’occasion se rencontrait de vingt à trente fois le jour à l’ouverture, dans la Vendée de ma jeunesse lointaine. Surtout un bel arrêt du chien. Terrée, sous une touffe de brindilles, ramassée pour le vol, l’œil au monstre raidi dans l’attente de la proie, on découvrait la bestiole mêlant aux tons grisâtres du terrain les nuances variées de son plumage fauve. Souvent, je m’élançai pour la saisir. Au premier geste, une brusque envolée m’esbroufait de surprise, me laissait fort piteux. D’autres fois, l’oiseau se plaisait à courir, et quand le chien était capable de le suivre en tenant l’arrêt, c’était un rare amusement à travers luzerne, trèfle, chaume ou broussaille.
La caille préféra toujours la plaine et le marais au bocage. Il lui faut l’espace libre, le plein du soleil. Au temps où je suivais un mien parent qui, avec un petit fusil de calibre 24, attaquait une compagnie de perdreaux, et la poursuivait de remise en remise jusqu’à ce qu’il l’eût toute en son carnier, nous ne rencontrions que très peu de cailles dans les fourrés du bocage. Même, le grand chasseur dédaignait ce coup de fusil. En plaine, c’était une autre affaire. C’est là que je fis mon début. J’avais tiraillé tout le jour à tort et à travers, sans rien ramasser, naturellement, car mon fusil partait d’émotion à tout bruit d’ailes. Il n’était pas jusqu’à mon chien, Milord (déjà je faisais des avances à l’Angleterre), qui n’eût échappé par miracle. Bien que ce dernier résultat pût être considéré comme satisfaisant, je voyais approcher l’heure d’une triste rentrée. Soudain Milord est à l’arrêt devant un buisson. Je frappe du canon le branchage. Une caille me saute au visage. Je me défends bravement contre cette audacieuse, et mon fusil, verticalement tenu, part sous ma main crispée, comme c’était son devoir. À ce moment précis, la tête de l’oiseau se trouvait à dix centimètres au-dessus du canon. Tête et cou s’envolèrent en fumée, mais le corps tomba sur mes souliers, de quoi je ne pus m’empêcher de concevoir un orgueil, je l’avoue.
Dans la plaine de Sainte-Hermine, que j’ai tant de fois battue avec mon excellent ami Guinaudeau et ce pauvre Édouard Grimaux, que l’affaire Dreyfus a tué en l’arrachant à son cher laboratoire de l’École polytechnique, la caille demeura jusqu’à ces dernières années un gibier de prédilection pour quelques amateurs. Nous étions tous trois d’une école très différente. Dès que son chien était à l’arrêt, Grimaux, incroyablement myope, roulait une cigarette et entamait le récit d’une expérience de chimie. Une caille partait. Le fusil de Grimaux, à peine épaulé, faisait feu. Un autre coup, quelquefois deux, l’appuyaient.
– Il se peut, disait Grimaux philosophiquement, que vous l’ayez tuée. Mais je suis sûr, moi, de l’avoir touchée.
Et il montrait une extrême satisfaction.