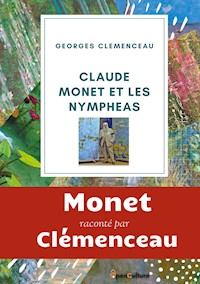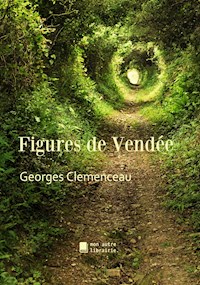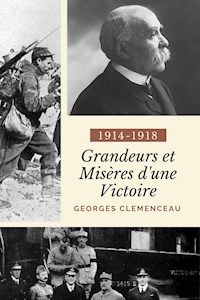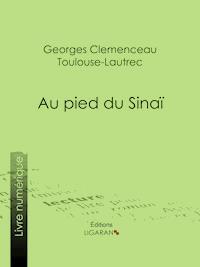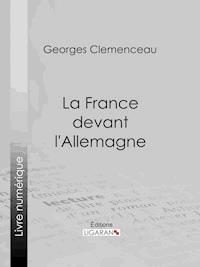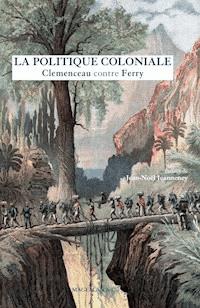
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Les Explorateurs
- Sprache: Französisch
Discours entre Clemenceau et Ferry au sujet de la décolonisation française
Avec un bel éclat, les deux discours qu’on va lire donnent à connaître, ramassé, le débat où s’affrontèrent, en un moment décisif, le camp des partisans de la colonisation et celui de ses adversaires : par les grandes voix de deux orateurs essentiels.
La résonance de l’une sur l’autre démonstration était destinée, nous le savons maintenant, à évoluer en profondeur dans la suite des temps. Un demi-siècle plus tard, vers l’époque de l’exposition coloniale de 1931, apogée d’un grand dessein, Jules Ferry aurait rallié à ses thèses la majorité des Français, les générations qui avaient assimilé, sur les bancs de l’école, en face des cartes suspendues à côté du tableau noir et portant la couleur rose de nos emprises planétaires, la fierté que leur pays pouvait en tirer. Mais cent ans après, une fois qu’aurait soufflé le grand vent de la décolonisation, Clemenceau apparaîtrait, au contraire, comme celui dont la lucidité avait porté la conscience prémonitoire de l’illégitimité d’une domination de notre peuple sur d’autres qui n’en pouvaient.
Les comptes-rendus des débats du Parlement recèlent des trésors, lorsque les tribuns les plus éloquents et les plus inspirés y confrontent leurs visions de la société et leur conception de la place de la France dans le monde. Le duel oratoire de Jules Ferry et de Georges Clemenceau sur la question coloniale, en juillet 1885, à la Chambre des députés, donne à connaître avec éclat l’opposition de deux tempéraments, de deux doctrines, de deux morales.
En se protégeant contre l’anachronisme, on découvrira dans leurs discours, reproduits ici pour la première fois en intégralité, quels échos leurs propos peuvent trouver, aujourd’hui encore, au cœur de nos interrogations contemporaines.
Un livre pour mieux comprendre l'empire colonial français
EXTRAIT
M. le président : – L’ordre du jour appelle la suite de la de la discussion du projet de loi portant ouverture au ministre de la Marine et des Colonies, au titre de l’exercice de 1885, d’un crédit extraordinaire de 12190000 francs pour les dépenses occasionnées par les événements de Madagascar. La parole est à M. Jules Ferry.
M. Jules Ferry: – Messieurs, bien que j’aie eu souvent l’occasion, pendant les deux années durant lesquelles vous m’avez maintenu votre confiance, de m’expliquer sur les origines, sur la portée, sur le caractère de la politique coloniale, et particulièrement, à propos de cette affaire de Madagascar, sur les limites que la sagesse et la prudence politiques doivent imposer à notre expansion coloniale, j’ai pensé, et la majorité de la Chambre, par un vote émis hier, et pour lequel je lui exprime ma profonde gratitude, a pensé aussi…
M. Achard: – Il n’y a pas eu d’opposition !
M. le président : – Messieurs, veuillez faire silence.
M. Jules Ferry: – S’il n’y a pas eu d’opposition, ma gratitude n’en est que plus grande…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
par Jean-Noël Jeanneney
Avec un bel éclat, les deux discours qu’on va lire donnent à connaître, ramassé, le débat où s’affrontèrent, en un moment décisif, le camp des partisans de la colonisation et celui de ses adversaires : par les grandes voix de deux orateurs essentiels.
La résonance de l’une sur l’autre démonstration était destinée, nous le savons maintenant, à évoluer en profondeur dans la suite des temps. Un demi-siècle plus tard, vers l’époque de l’exposition coloniale de 1931, apogée d’un grand dessein, Jules Ferry aurait rallié à ses thèses la majorité des Français, les générations qui avaient assimilé, sur les bancs de l’école, en face des cartes suspendues à côté du tableau noir et portant la couleur rose de nos emprises planétaires, la fierté que leur pays pouvait en tirer. Mais cent ans après, une fois qu’aurait soufflé le grand vent de la décolonisation, Clemenceau apparaîtrait, au contraire, comme celui dont la lucidité avait porté la conscience prémonitoire de l’illégitimité d’une domination de notre peuple sur d’autres qui n’en pouvaient mais.
Cette observation est nécessaire pour nous inciter tout à la fois à nous garder des anachronismes auxquels incite toujours la connaissance de la suite de l’Histoire, et à ne pas nous laisser entraîner par la restitution d’une conjoncture spécifique jusqu’à un relativisme qui occulterait la longue portée de principes universels.
En cette fin de juillet 1885, Jules Ferry n’est plus au pouvoir depuis quatre mois. Le 30 mars, le gouvernement qu’il présidait a été renversé – Clemenceau portant contre lui, avec violence, l’estocade. « Ce ne sont plus des ministres que j’ai devant moi, s’était-il écrié, ce sont des accusés de haute trahison sur lesquels, s’il existe encore en France un principe de responsabilité et de justice, la main de la loi ne tardera pas à s’abattre. »
Il s’agissait alors de la question du Tonkin1. Si Ferry avait pu renforcer notre protectorat sur la Tunisie, entamer l’instauration d’un autre à Madagascar, soutenir l’avancée de nos soldats en Afrique occidentale et équatoriale, il se heurte, en Indochine, à plus forte partie. La France est installée en Cochinchine depuis le Second Empire. Une extension souhaitée vers le Nord, en Annam et au Tonkin, se heurte à l’hostilité armée de la Chine, ardente à ménager sa suzeraineté sur cette région. Des négociations avec Pékin sont cependant en cours et sur le point d’aboutir lorsque des télégrammes annoncent un échec militaire des troupes françaises à Lang-Son, place forte proche de la frontière chinoise, au nord-ouest d’Hanoi – échec dont la gravité est exagérée sur le moment. Ferry ne peut pas évoquer devant les députés le traité, quasiment signé, qu’il a dans sa poche, car une divulgation prématurée risquerait d’en faire déchirer le texte par la Chine. Son gouvernement est culbuté, sous les huées. L’injure « Ferry-Tonkin » assaille l’homme d’État à travers Paris.
C’est seulement le 28 juillet suivant, à l’occasion d’un débat portant sur les crédits de liquidation de l’expédition de Madagascar, que Ferry se décide, après avoir choisi longtemps le silence (« Il est en moi une secrète, une profonde aversion pour cette tribune qui me fut un pilori », écrit-il à sa femme), à proposer à la Chambre une réflexion synthétique sur sa doctrine coloniale. Initiative qui provoque une longue réplique de Clemenceau, reprenant point par point ses arguments. Tel est l’échange brutal et prestigieux qu’on trouvera restitué dans ces pages.
Entre les deux protagonistes, l’hostilité est de longue main. Michel Winock, dans sa biographie du « Tigre »2, en a retracé la genèse et les conséquences politiques. Leur incompatibilité d’humeur résulte, au-delà des désaccords de fond dont on va voir l’intensité, d’une violente opposition de tempéraments. Jules Ferry, Lorrain à l’allure austère – « Mes roses poussent en dedans », a-t-il dit un jour–, est l’avocat dont les convictions républicaines impeccables et la passion intangible pour la laïcité s’accommodent de la longue durée dans le développement de ses projets. Le progrès de l’humanité, dont l’œuvre de Condorcet lui a enseigné l’ambition, ne peut, à ses yeux, s’organiser que selon les patiences du long terme, que lui paraît enseigner Auguste Comte – une autre de ses admirations. Il dissimule sous une allure qui se veut impassible, sous un comportement rigoureux et parfois rigide, la violence des émotions qui l’agitent.
Georges Clemenceau, à quarante-trois ans, est de dix ans plus jeune. Le « bleu » de Vendée, le médecin des pauvres, député de Montmartre, a installé à la gauche des républicains les exigences de son maximalisme, de son refus des compromis qu’il dénonce régulièrement comme des compromissions. Il y acquiert, admiré, craint ou haï, la réputation d’un « tombeur de ministères ». C’est le temps où Joseph Paul-Boncour le décrit, dans ses souvenirs, en réunion publique, « petit, noir, tout en muscles, étroitement serré dans une redingote courte à la mode d’alors, le col droit guillotinant le visage, la figure osseuse tendue vers la foule, tout seul, faisant face à l’orage, taureau au milieu du toril et débouchant dans l’arène… » Il met son ardeur au service d’une indépendance jalouse de n’être jamais entamée. Ses tendresses se dissimulent sous l’impétuosité du bretteur, sous une énergie qui procède parfois par foucades.
Les deux hommes se sont connus et affrontés dès le siège de Paris de 1870 et les débuts dramatiques de la Commune. Après le triomphe des républicains, lors de la crise du 16-Mai, Jules Ferry, porté par la modération de son réformisme, s’est exaspéré de l’extrémisme de Clemenceau, dénonçant dans une lettre à un ami, en mai 1879, « cet esprit de vertige (…), cette légèreté brouillonne, cette impatience démagogique, cette complète et naïve absence de moralité politique », destinés, pense-t-il déjà, à « jouer un rôle néfaste dans les destinées de la République ».
Clemenceau n’est pas moins sévère pour son adversaire, qu’il juge comme un « conservateur incapable de réaliser la République », fustigeant en lui « un esprit aventureux, obstiné, marchant les yeux au ciel, confiant dans son étoile, sans daigner regarder à terre ». Dans les confidences de son grand âge à son secrétaire Jean Martet, il dira encore avec condescendance : « [Ferry] n’était pas un malhonnête homme. Mais du point de vue de l’intelligence, il était au-dessous du médiocre, pas fichu de rien faire. » Sur la question sociale comme sur la question scolaire, il le considère trop lent, trop prudent, souvent jusqu’à la pusillanimité. Sur l’adaptation des lois constitutionnelles de 1875, il ne le trouve jamais assez hardi.
Dissemblable est le souffle de leurs éloquences, quoiqu’elles soient l’une et l’autre de bonne tradition classique, et que leur double qualité fasse parfois, depuis notre temps, regarder celui-là avec quelque nostalgie. Ferry a formé la sienne dans le prétoire, et elle trouve son efficacité dans des démonstrations construites selon la tradition d’une rhétorique classique. Clemenceau parsème ses propos, où l’indignation se mêle au dédain, de soudaines échappées, de coups de boutoir, de rebonds improvisés, auxquels il excelle, à partir des interruptions qui hachent les discours.
Sur l’ambiance passionnelle de l’hémicycle, la suite des interruptions donnera une information suffisante. Pour la petite histoire, observons que celui à qui il revient de les maîtriser, du perchoir, n’est autre que Charles Floquet, depuis peu président de la Chambre : il est l’oncle de Jules Ferry pour avoir épousé la jeune tante de sa femme, Henriette Scheurer, dont Clemenceau, jadis, a été le prétendant malheureux. Ce qui n’autorise pas à faire penser que cet ancien chagrin privé aurait pu renforcer sa hargne contre Ferry… Un petit monde, en tout cas.
On pourra s’attacher aux querelles du moment à propos des épisodes et des mésaventures indochinoises. Leur contenu est assez explicité par les deux orateurs pour qu’on ne les résume pas ici. Mais on verra surtout déployés, par-delà les escarmouches de détail, par-delà les incidents de séance propres à ce système politique où la puissance décisive du Parlement n’est mise en cause par personne, les trois grands thèmes toujours agités autour de la question coloniale.
Le premier est économique : « Pour les pays vieux et riches, la colonisation est une des meilleures affaires auxquelles il puissent se livrer. » En citant ce propos de Stuart Mill et en parlant des avantages de placement des capitaux et de débouchés pour l’industrie, Ferry est voué à se faire contrer par Clemenceau. Il faut dire que ce dernier a traduit dans sa jeunesse un petit livre de cet auteur sur Comte et le positivisme, qu’il en a été inspiré tout autant que son antagoniste et qu’il peut donc se piquer de mieux interpréter sa pensée.
Quant au fond des choses, on se doit de rappeler que l’idée du profit à attendre de la colonisation, non pas pour les firmes concernées, mais par la nation entière, a été largement remise en cause depuis lors par les historiens de l’économie. Et il est vrai que nul traité de conciliation de la France avec la Chine ne nous assure là-bas un avantage financier sur l’Angleterre. Quant aux débouchés, l’argument touche juste qui consiste à dire que les consommateurs pourraient acheter plus en France si les impôts sur la consommation, destinés à payer les expéditions lointaines, étaient moindres ; cette relance de la demande est déjà du keynésianisme avant la lettre, mais étrangère à la pensée de la plupart des contemporains. Clemenceau n’a pas tort, nous le savons aujourd’hui, quand il affirme que bien souvent « la puissance économique ne suit pas la puissance politique ».
Et voici le deuxième volet de l’argumentation, primordial. L’opposition se résume dans deux propos, qui sont au cœur de l’affrontement. Celui de Jules Ferry est sans détours : « Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles ; elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » L’année précédente, en mars 1884, il est allé jusqu’à expliquer, à la même tribune du Palais-Bourbon : « Le premier pas que la civilisation fait faire à ces races inférieures qu’elle cherche à élever jusqu’à elle, c’est de leur dicter des traités, de leur apprendre ce que c’est que la foi jurée et de l’obliger à la respecter s’ils y manquent. Il y a là, messieurs, entre ces races et nous, un véritable procédé d’éducation qui est le plus efficace, le plus pénétrant de tous. » Étrange diplomatie posée comme pédagogie du maître au grand enfant…
En face, Clemenceau jette son exclamation fameuse : « Races supérieures, races inférieures ! C’est bientôt dit… » Et d’évoquer notamment « cette grande religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec cette efflorescence d’art dont nous voyons aujourd’hui encore les magnifiques vestiges… » Rien d’autre, explique-t-il, si l’on va au fond des choses, que « la proclamation de la force sur le droit ». Et ceci encore, qui en fait un ancêtre de tous les combattants de l’anticolonialisme au XXe siècle : « N’essayez pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n’est pas le droit, c’en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la violence l’hypocrisie. »
Certes, il faut purger la réflexion de tout anachronisme devant l’utilisation du mot « race » par Jules Ferry, un terme agréé par tous à l’époque et qui n’a pas encore été chargé d’ignominie par les barbaries du siècle suivant. Certes, il ne faut pas ignorer que les progrès scientifiques, les développements de l’industrie, les améliorations sanitaires, aient été le fait, alors, du monde occidental et que les peuples soumis en ont, pour une part, bénéficié. Il demeure que le cri de Clemenceau – qui s’appuie, notons-le, sur l’Asie, non sur l’Afrique noire – rejoint pleinement nos sensibilités contemporaines.
Reste enfin la discussion, apparemment plus datée, mais en réalité de longue portée, sur la part, dans l’essor colonial de la France, du hasard, ou au moins des circonstances, ce qui n’est pas, n’en déplaise à Ferry, si différent. Clemenceau n’a pas tort d’observer que la doctrine n’a pas été définie à l’avance et qu’elle vient justifier après coup des décisions prises au jour le jour en créant « insensiblement, par degrés » la situation d’expansion coloniale.
On a parlé à juste titre de la querelle de deux patriotismes. Clemenceau, comme beaucoup d’autres, craint que la colonisation ne vienne affaiblir le pays, en termes militaires, pour le jour de la Revanche espérée contre l’Allemagne. « J’ai perdu deux enfants et vous m’offrez vingt domestiques ! » s’est écrié un jour Paul Déroulède, du côté des nationalistes. C’est contre cette doctrine du « recueillement » nécessaire que Jules Ferry inscrit sa détermination. Il est celui qui refuse cette « politique exclusivement continentale ». À quoi Clemenceau réplique qu’il faut avant tout s’assurer « que l’on a le pied solide chez soi et que le sol national ne tremble pas » et que, quant à lui, « son patriotisme est en France ». À Martet il dira, bien plus tard : « Ferry nous détournait de la seule chose à considérer et à redouter : l’Allemagne – alors que moi je savais bien que ce n’était pas au Tonkin que l’affaire se jouerait, mais là où il s’est joué : chez nous. » Ce désaccord de base était vouée à durer longtemps : énergie de l’armée stimulée dans les terres lointaines, ou bien dispersée, gaspillée loin de ses bases ?
La démonstration de Ferry cesse bientôt d’être implicite. Si nous n’y allons pas, dit-il, d’autres nations porteront leur force dans ces contrées éloignées et la France s’en trouvera, par comparaison, affaiblie pour toujours. Il ne fait pas mystère de sa conviction que notre expansion en Indochine sera à même d’effacer la politique déplorable qui, en 1882, sous l’effet de la pusillanimité parlementaire, a abandonné l’Égypte à la tutelle britannique – et permettra d’échapper au cercle vicieux qui ferait que notre marine cesse d’être aiguillonnée par cette exigence lointaine, donc d’assurer efficacement la protection du territoire national. Ainsi peut-il parler de « vastes desseins et de grandes pensées ».
Par quoi l’on vérifie ce que l’historiographie ultérieure a prouvé fortement : quelque ait pu être, par moments, la force du lobby colonial (représenté ici par Eugène Étienne, son premier inspirateur et son leader, qui essaie plusieurs fois d’interrompre Clemenceau), c’est du côté des sentiments, des passions, de la concurrence des fiertés patriotiques, qu’il faut chercher le premier ressort de l’aventure coloniale du XIXe siècle – non sans une part de noblesse incarnée par tant de soldats et de fonctionnaires dévoués à leur mission. « Un grand pays, exerçant sur les destinées de l’Europe toute l’influence qui lui appartient (…) doit répandre cette influence sur le monde et porter haut, partout où elle le peut, sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie. » Ainsi s’exprime Ferry.
Sur ce registre, Clemenceau, en face de lui, ne recule pas d’un pouce, s’acharnant à démontrer la perversité du principe qui inspire son adversaire. C’est seulement en assurant à l’intérieur d’elle-même la prospérité et le progrès social, par priorité, que la France, portant les principes des Lumières et sans les contredire à la pointe de son glaive, pourra rayonner durablement – et pacifiquement – au-dehors.
L’hostilité entre les deux duellistes est inextinguible. Clemenceau empêchera bientôt, en décembre 1887, par l’habileté de ses manœuvres, l’accession de Ferry à la présidence de la République, et lorsque ce dernier se trouvera frappé, en pleine Chambre, quelques jours plus tard, par les deux coups de revolver d’un demi-fou qu’ont excité les nationalistes, attentat qui hâtera peut-être sa mort, survenue en 1893, sa femme sera convaincue que les assauts de Clemenceau ont eu leur part indirecte dans cette agression. Rancune qui aura, trente ans plus tard, une conséquence tragique et imprévisible. Abel Ferry, neveu chéri de Jules Ferry (qui n’avait pas d’enfant) et à son tour député des Vosges à partir de 1909, se verra dissuader rigoureusement par sa tante d’accepter l’offre de Clemenceau d’entrer dans son gouvernement, en novembre 1917. Il aurait été protégé de la sorte contre la fin tragique qu’il trouvera, à trente-sept ans, en septembre 1918, dans l’Aisne, quelques semaines avant l’armistice, au cours d’une mission d’inspection parlementaire conduite, à tous risques, sur le front. Et c’est sur son lit de mort que Clemenceau viendra lui remettre, comme pour clore les cruautés d’un si long affrontement, la Croix de guerre avec palme et le ruban rouge de la Légion d’honneur.
1. Le Tonkin est la partie du nord du Vietnam actuel, où se trouve Hanoi, et sous influence historique chinoise forte. Il intégrera l’Union indochinoise créée en 1887, avec l’Annam (centre du Vietnam), la Cochinchine (sud du Vietnam) et le Cambodge, que le Laos rejoindra en 1899. (N.d.É.)
2. Clemenceau, éd. Perrin, Paris, 2007. (N.d.É.)
Chambre des Députés, 28 juillet 1885
M. le président :–L’ordre du jour appelle la suite de la de la discussion du projet de loi portant ouverture au ministre de la Marine et des Colonies, au titre de l’exercice de 1885, d’un crédit extraordinaire de 12190000 francs pour les dépenses occasionnées par les événements de Madagascar3.
La parole est à M. Jules Ferry.
M. Jules Ferry :–Messieurs, bien que j’aie eu souvent l’occasion, pendant les deux années durant lesquelles vous m’avez maintenu votre confiance, de m’expliquer sur les origines, sur la portée, sur le caractère de la politique coloniale, et particulièrement, à propos de cette affaire de Madagascar, sur les limites que la sagesse et la prudence politiques doivent imposer à notre expansion coloniale, j’ai pensé, et la majorité de la Chambre, par un vote émis hier, et pour lequel je lui exprime ma profonde gratitude, a pensé aussi…
M. Achard :–Il n’y a pas eu d’opposition !
M. le président :–Messieurs, veuillez faire silence.
M. Jules Ferry :–S’il n’y a pas eu d’opposition, ma gratitude n’en est que plus grande…
M. Andrieux :–Évidemment ! elle s’adresse à tout le monde. (Sourires.)
M. Jules Ferry :–La Chambre a pensé qu’il n’était point superflu d’échanger ici, à cette tribune, à la veille de la consultation solennelle que nous allons demander au pays, quelques explications, quelques éclaircissements sur cette politique si contestée, si combattue, et qui paraît devoir être, dans les élections prochaines, le champ de bataille de toutes les oppositions.
Messieurs, je ne viens pas ici faire d’apologie personnelle. (Oh ! oh ! à l’extrême gauche.)
M. Leydet :–C’est dommage !
M. Roque (de Fillol) :–C’est heureux ! Il ne manquerait plus que cela !
M. Jules Ferry :–Que les ennemis et les amis se rassurent : telle n’est pas mon intention. J’ai prouvé, je crois, que je sais faire passer avant le souci de ma défense personnelle d’autres soucis et d’autres devoirs (Applaudissements au centre.) et que, comme il sied à un homme qui a eu l’honneur de diriger les affaires de son pays…
M. Salis :–Malheureusement !
M. Brialou :–Pour le malheur du pays !
M. Jules Ferry :–Je suis absolument décidé à ne répondre à aucune interruption. (Très bien ! très bien ! au centre.)
M. le président :–Et moi je suis décidé à maintenir la liberté de la tribune. (Très bien ! très bien !)
M. Jules Ferry :–J’espère que, n’étant aujourd’hui qu’un membre de cette assemblée, n’ayant plus le fardeau et la responsabilité du pouvoir, je pourrai traiter ici des questions générales, des questions de politique générale, des questions d’intérêt général patriotique, je l’ose dire, et rencontrer chez tous mes collègues la courtoisie que l’on se doit de collègue à collègue. (Très bien ! très bien ! au centre.) Si je ne devais pas recevoir cet accueil et jouir de cette liberté, j’interromprais immédiatement une discussion que ni ma dignité ni l’intérêt du pays ne me permettraient de poursuivre. (Parlez ! parlez !)
Messieurs, je dis que je ne viens point faire ici une apologie personnelle, que j’avais montré que je savais me taire quand j’estimais que l’intérêt public ne permettait pas d’aborder et d’engager certaines discussions. (Mouvements divers.)
M. Loranchet :–Mais vous savez écrire !
M. le président :–Les personnes qui troublent le plus souvent l’ordre sont celles qui veulent exercer la police de la séance. Si des interruptions se produisent, je saurai les empêcher, ou du moins les réprimer. Je prie tous mes collègues d’écouter en silence, c’est le seul moyen de faire qu’il ne se produise pas de désordre dans cette discussion.
M. Jules Ferry :–Je me suis tu quand il fallait me taire et quand le devoir m’en était imposé; j’ai gardé le silence, il y a quelques jours, quand j’étais interpellé et provoqué de la manière la plus vive par un honorable membre de cette assemblée, qui avait oublié, je pense, l’excommunication majeure qu’il avait, quelques semaines auparavant, prononcée contre nous, et la manière dont il demandait de nous retrancher de la République. Je me suis tu alors, estimant que ce n’était pas le moment de s’expliquer, alors qu’il s’agissait de ratifier le traité franco-chinois, et dans un jour où venaient d’arriver des nouvelles qui, fort heureusement, ont été rectifiées, expliquées, et ne laissant plus maintenant aucun sujet d’inquiétude aux amis de la patrie. (Rumeurs à droite.) Des nouvelles arrivant de la cour de Hué à ce moment-là, certainement inquiétantes, donnaient un plus haut prix au vote rapide et immédiat du traité qui nous était soumis.
Je me suis tu pour cette raison-là. J’avais encore une autre raison : il me semblait qu’il n’était pas à propos, au moment où nous allions ratifier un traité qui doit établir entre la France et la Chine une paix solide et durable…
M. de Baudry d’Asson :–Nous en avons la preuve dans les événements de Hué !
M. le président :–N’interrompez pas !
M. Jules Ferry :–…de ranimer et de réveiller ici, dans leur plus grande amertume, nos vieux ou récents procès avec l’empire de Chine. (Très bien ! au centre.)
Aujourd’hui, messieurs, je crois qu’il faut parler sans passion, sans préoccupation personnelle, car nous parlons tous devant notre juge suprême, devant le pays.