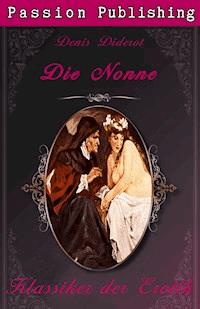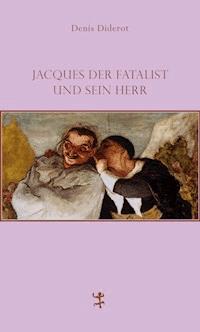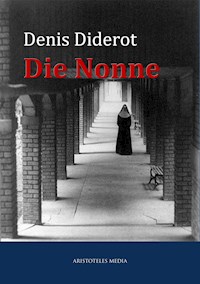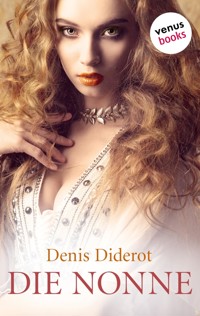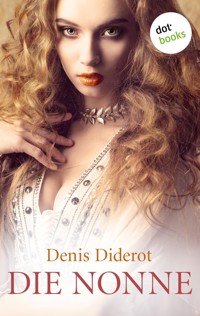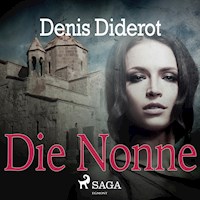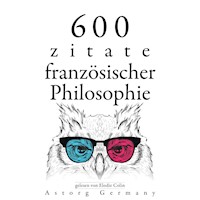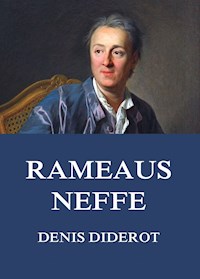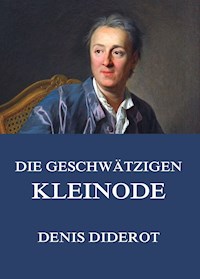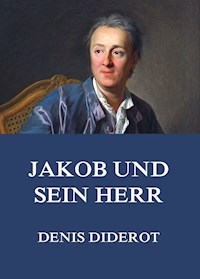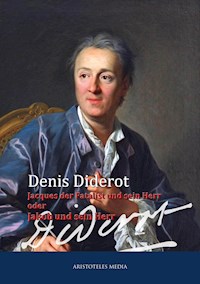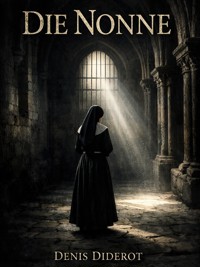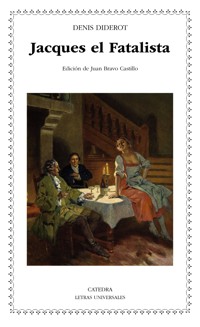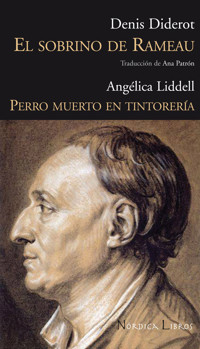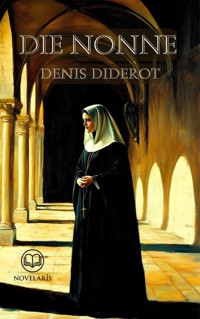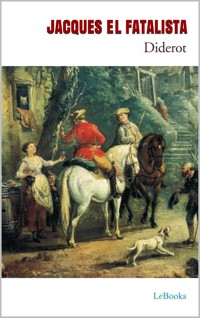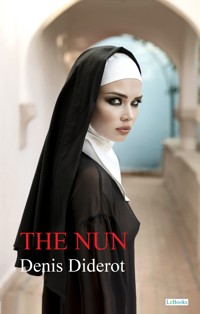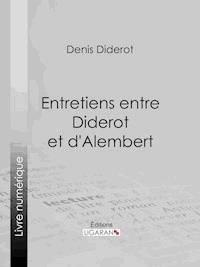
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "D'ALEMBERT : J'avoue qu'un Etre qui existe quelque part et qui ne correspond à aucun point de l'espace ; un Etre qui est inétendu et qui occupe de l'étendue ; qui est tout entier sous chaque partie de cette étendue ; qui diffère essentiellement de la matière et qui lui est uni ; qui la suit et qui la meut sans se mouvoir ; qui agit sur elle et qui en subit toutes les vicissitudes ;"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001303
©Ligaran 2015
J’avoue qu’un Être qui existe quelque part et qui ne correspond à aucun point de l’espace ; un Être qui est inétendu et qui occupe de l’étendue ; qui est tout entier sous chaque partie de cette étendue ; qui diffère essentiellement de la matière et qui lui est uni ; qui la suit et qui la meut sans se mouvoir ; qui agit sur elle et qui en subit toutes les vicissitudes ; un Être dont je n’ai pas la moindre idée ; un Être d’une nature aussi contradictoire est difficile à admettre. Mais d’autres obscurités attendent celui qui le rejette ; car enfin cette sensibilité que vous lui substituez, si c’est une qualité générale et essentielle de la matière, il faut que la pierre sente.
Pourquoi non ?
Cela est dur à croire.
Oui, pour celui qui la coupe, la taille, la broie et qui ne l’entend pas crier.
Je voudrais bien que vous me dissiez quelle différence vous mettez entre l’homme et la statue, entre le marbre et la chair.
Assez peu. On fait du marbre avec de la chair, et de la chair avec du marbre.
Mais l’un n’est pas l’autre.
Comme ce que vous appelez la force vive n’est pas la force morte.
Je ne vous entends pas.
Je m’explique. Le transport d’un corps d’un lieu dans un autre n’est pas le mouvement, ce n’en est que l’effet. Le mouvement est également et dans le corps transféré et dans le corps immobile.
Cette façon de voir est nouvelle.
Elle n’en est pas moins vraie. Ôtez l’obstacle qui s’oppose au transport local du corps immobile, et il sera transféré. Supprimez par une raréfaction subite l’air qui environne cet énorme tronc de chêne, et l’eau qu’il contient, entrant tout à coup en expansion, le dispersera en cent mille éclats. J’en dis autant de votre propre corps.
Soit. Mais quel rapport y a-t-il entre le mouvement et la sensibilité ? Serait-ce par hasard que vous reconnaîtriez une sensibilité active et une sensibilité inerte, comme il y a une force vive et une force morte ? Une force vive qui se manifeste par la translation, une force morte qui se manifeste par la pression ; une sensibilité active qui se caractérise par certaines actions remarquables dans l’animal et peut-être dans la plante ; et une sensibilité inerte dont on serait assuré par le passage à l’état de sensibilité active.
À merveille. Vous l’avez dit.
Ainsi la statue n’a qu’une sensibilité inerte ; et l’homme, l’animal, la plante même peut-être, sont doués d’une sensibilité active.
Il y a sans doute cette différence entre le bloc de marbre et le tissu de chair ; mais vous concevez bien que ce n’est pas la seule.
Assurément. Quelque ressemblance qu’il y ait entre la forme extérieure de l’homme et de la statue, il n’y a point de rapport entre leur organisation intérieure. Le ciseau du plus habile statuaire ne fait pas même un épiderme. Mais il y a un procédé fort simple pour faire passer une force morte à l’état de force vive ; c’est une expérience qui se répète sous nos yeux cent fois par jour ; au lieu que je ne vois pas trop comment on fait passer un corps de l’état de sensibilité inerte à l’état de sensibilité active.
C’est que vous ne voulez pas le voir. C’est un phénomène aussi commun.
Et ce phénomène aussi commun, quel est-il, s’il vous plaît ?
Je vais vous le dire, puisque vous voulez en avoir la honte. Cela se fait toutes les fois que vous mangez.
Toutes les fois que je mange !
Oui ; car en mangeant, que faites-vous ? Vous levez les obstacles qui s’opposaient à la sensibilité active de l’aliment. Vous l’assimilez avec vous-même ; vous en faites de la chair ; vous l’animalisez ; vous le rendez sensible ; et ce que vous exécutez sur un aliment, je l’exécuterai quand il me plaira sur le marbre.
Et comment cela ?
Comment ? je le rendrai comestible.
Rendre le marbre comestible, cela ne me paraît pas facile.
C’est mon affaire que de vous en indiquer le procédé. Je prends la statue que vous voyez, je la mets dans un mortier, et à grands coups de pilon…
Doucement, s’il vous plaît : c’est le chef-d’œuvre de Falconet. Encore si c’était un morceau d’Huez ou d’un autre…
Cela ne fait rien à Falconet ; la statue est payée, et Falconet fait peu de cas de la considération présente, aucun de la considération à venir.
Allons, pulvérisez donc.
Lorsque le bloc de marbre est réduit en poudre impalpable, je mêle cette poudre à l’humus ou terre végétale ; je les pétris bien ensemble ; j’arrose le mélange, je le laisse putréfier un an, deux ans, un siècle, le temps ne me fait rien. Lorsque le tout s’est transformé en une matière à peu près homogène, en humus, savez-vous ce que je fais ?
Je suis sûr que vous ne mangez pas de l’humus.
Non, mais il y a un moyen d’union, d’appropriation, entre l’humus et moi, un latus, comme vous dirait le chimiste.
Et ce latus, c’est la plante ?
Fort bien. J’y sème des pois, des fèves, des choux, d’autres plantes légumineuses. Les plantes se nourrissent de la terre, et je me nourris des plantes.
Vrai ou faux, j’aime ce passage du marbre à l’humus, de l’humus au règne végétal, et du règne végétal au règne animal, à la chair.
Je fais donc de la chair ou de l’âme, comme dit ma fille, une matière activement sensible ; et si je ne résous pas le problème que vous m’avez proposé, du moins j’en approche beaucoup ; car vous m’avouerez qu’il y a bien plus loin d’un morceau de marbre à un être qui sent, que d’un être qui sent à un être qui pense.
J’en conviens. Avec tout cela l’être sensible n’est pas encore l’être pensant.
Avant que de faire un pas en avant, permettez-moi de vous faire l’histoire d’un des plus grands géomètres de l’Europe. Qu’était-ce d’abord que cet être merveilleux ? Rien.
Comment rien ! On ne fait rien de rien.
Vous prenez les mots trop à la lettre. Je veux dire qu’avant que sa mère, la belle et scélérate chanoinesse Tencin, eût atteint l’âge de puberté, avant que le militaire La Touche fût adolescent, les molécules qui devaient former les premiers rudiments de mon géomètre étaient éparses dans les jeunes et frêles machines de l’un et de l’autre, se filtrèrent avec la lymphe, circulèrent avec le sang, jusqu’à ce qu’enfin elles se rendissent dans les réservoirs destinés à leur coalition, les testicules de son père et de sa mère. Voilà ce germe rare formé ; le voilà, comme c’est l’opinion commune, amené par les trompes de Fallope dans la matrice ; le voilà attaché à la matrice par un long pédicule ; le voilà, s’accroissant successivement et s’avançant à l’état de fœtus ; voilà le moment de sa sortie de l’obscure prison arrivé ; le voilà né, exposé sur les degrés de Saint-Jean-le-Rond qui lui donna son nom ; tiré des Enfants-Trouvés ; attaché à la mamelle de la bonne vitrière, madame Rousseau ; allaité, devenu grand de corps et d’esprit, littérateur, mécanicien, géomètre. Comment cela s’est-il fait ? En mangeant et par d’autres opérations purement mécaniques. Voici en quatre mots la formule générale : Mangez, digérez, distillez in vasi licito, et fiat homo secundum artem. Et celui qui exposerait à l’Académie le progrès de la formation d’un homme ou d’un animal, n’emploierait que des agents matériels dont les effets successifs seraient un être inerte, un être sentant, un être pensant, un être résolvant le problème de la précession des équinoxes, un être sublime, un être merveilleux, un être vieillissant, dépérissant, mourant, dissous et rendu à la terre végétale.
Vous ne croyez donc pas aux germes préexistants ?
Non.
Ah ! que vous me faites plaisir !
Cela est contre l’expérience et la raison : contre l’expérience qui chercherait inutilement ces germes dans l’œuf et dans la plupart des animaux avant un certain âge ; contre la raison qui nous apprend que la divisibilité de la matière a un terme dans la nature, quoiqu’elle n’en ait aucun dans l’entendement, et qui répugne à concevoir un éléphant tout formé dans un atome et dans cet atome un autre éléphant tout formé, et ainsi de suite à l’infini.
Mais sans ces germes préexistants, la génération première des animaux ne se conçoit pas.
Si la question de la priorité de l’œuf sur la poule ou de la poule sur l’œuf vous embarrasse, c’est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu’ils sont à présent. Quelle folie ! On ne sait non plus ce qu’ils ont été qu’on ne sait ce qu’ils deviendront. Le vermisseau imperceptible qui s’agite dans la fange, s’achemine peut-être à l’état de grand animal ; l’animal énorme, qui nous épouvante par sa grandeur, s’achemine peut-être à l’état de vermisseau, est peut-être une production particulière momentanée de cette planète.
Comment avez-vous dit cela ?
Je vous disais… Mais cela va nous écarter de notre première discussion.
Qu’est-ce que cela fait ? Nous y reviendrons ou nous n’y reviendrons pas.
Me permettriez-vous d’anticiper de quelques milliers d’années sur les temps ?
Pourquoi non ? Le temps n’est rien pour la nature.
Vous consentez donc que j’éteigne notre soleil ?
D’autant plus volontiers que, ce ne sera pas le premier qui se soit éteint.
Le soleil éteint, qu’en arrivera-t-il ? Les plantes périront, les animaux périront, et voilà la terre solitaire et muette. Rallumez cet astre, et à l’instant vous rétablissez la cause nécessaire d’une infinité de générations nouvelles entre lesquelles je n’oserais assurer qu’à la suite des siècles nos plantes, nos animaux d’aujourd’hui se reproduiront ou ne se reproduiront pas.
Et pourquoi les mêmes éléments épars venant à se réunir, ne rendraient-ils pas les mêmes résultats ?
C’est que tout se tient dans la nature, et que celui qui suppose un nouveau phénomène ou ramène un instant passé, recrée un nouveau monde.
C’est ce qu’un penseur profond ne saurait nier. Mais pour en revenir à l’homme, puisque l’ordre général a voulu qu’il fût ; rappelez-vous que c’est au passage de l’être sentant à l’être pensant que vous m’avez laissé.
Je m’en souviens.
Franchement vous m’obligeriez beaucoup de me tirer de là. Je suis un peu pressé de penser.
Quand je n’en viendrais pas à bout, qu’en résulterait-il contre un enchaînement de faits incontestable ?
Rien, sinon que nous serions arrêtés là tout court.
Et pour aller plus loin, nous serait-il permis d’inventer un agent contradictoire dans ses attributs, un mot vide de sens, inintelligible ?
Non.
Pourriez-vous me dire ce que c’est que l’existence d’un être sentant, par rapport à lui-même ?
C’est la conscience d’avoir été lui, depuis le premier instant de sa réflexion jusqu’au moment présent.
Et sur quoi cette conscience est-elle fondée ?
Sur la mémoire de ses actions.
Et sans cette mémoire ?
Sans cette mémoire il n’aurait point de lui, puisque, ne sentant son existence que dans le moment de l’impression, il n’aurait aucune histoire de sa vie. Sa vie serait une suite interrompue de sensations que rien ne lierait.
Fort bien. Et qu’est-ce que la mémoire ? d’où naît-elle ?
D’une certaine organisation qui s’accroît, s’affaiblit et se perd quelquefois entièrement.
Si donc un être qui sent et qui a cette organisation propre à la mémoire, lie les impressions qu’il reçoit, forme par cette liaison une histoire qui est celle de sa vie, et acquiert la conscience de lui, il nie, il affirme, il conclut, il pense.
Cela me paraît ; il ne me reste plus qu’une difficulté.
Vous vous trompez ; il vous en reste bien davantage.
Mais une principale ; c’est qu’il me semble que nous ne pouvons penser qu’à une seule chose à la fois, et que pour former, je ne dis pas ces énormes chaînes de raisonnements qui embrassent dans leur circuit des milliers d’idées, mais une simple proposition, on dirait qu’il faut avoir au moins deux choses présentes, l’objet qui semble rester sous l’œil de l’entendement, tandis qu’il s’occupe de la qualité qu’il en affirmera ou niera.
Je le pense ; ce qui m’a fait quelquefois comparer les fibres de nos organes à des cordes vibrantes sensibles. La corde vibrante sensible oscille, résonne longtemps encore après qu’on l’a pincée. C’est cette oscillation, cette espèce de résonnance nécessaire qui tient l’objet présent, tandis que l’entendement s’occupe de la qualité qui lui convient. Mais les cordes vibrantes ont encore une autre propriété, c’est d’en faire frémir d’autres ; et c’est ainsi qu’une première idée en rappelle une seconde, ces deux-là une troisième, toutes les trois une quatrième, et ainsi de suite, sans qu’on puisse fixer la limite des idées réveillées, enchaînées, du philosophe qui médite ou qui s’écoute dans le silence et l’obscurité. Cet instrument a des sauts étonnants, et une idée réveillée va faire quelquefois frémir une harmonique qui en est à un intervalle incompréhensible. Si le phénomène s’observe entre des cordes sonores, inertes et séparées, comment n’aurait-il pas lieu entre des points vivants et liés, entre des fibres continues et sensibles ?
Si cela n’est pas vrai, cela est au moins très ingénieux. Mais on serait tenté de croire que vous tombez imperceptiblement dans l’inconvénient que vous vouliez éviter.
Quel ?
Vous en voulez à la distinction des deux substances.
Je ne m’en cache pas.
Et si vous y regardez de près, vous faites de l’entendement du philosophe un être distinct de l’instrument, une espèce de musicien qui prête l’oreille aux cordes vibrantes, et qui prononce sur leur consonance ou leur dissonance.