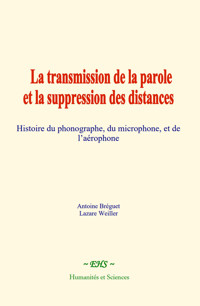
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Ce livre explore l’histoire de la transmission de la parole à partir des inventions telles que le phonographe, le microphone et l’aérophone permettant d’amplifier tellement les sons qu’il deviendra possible de les entendre à plusieurs kilomètres de distance.
Les travaux scientifiques du Nouveau Monde présentent ce caractère spécial de toujours viser un but pratique et immédiat. Semblable au touriste traditionnel des Alpes, l’homme de science aux États-Unis marche droit vers le sommet qu’il s’est promis d’atteindre. Les détails de la route ne l’intéressent pas ; il gravit la pente et ne regarde ni à droite ni à gauche. S’il arrive, il a fait une véritable conquête ; s’il ne réussit pas, comme il n’a rien vu en chemin, ses efforts ne profitent à personne. Cette tendance, qui se retrouve, quoiqu’à un moindre degré, en Angleterre, est en opposition directe avec celle des physiciens de notre vieux continent. Ceux-ci, la plupart du temps, ne fixent pas à leurs entreprises un terme bien déterminé, et la route la plus large, le chemin le plus court n’est pas toujours ce qui les séduit le plus. Ils préfèrent les sentiers les moins tracés, et ceux dont les détours sans fin leur dérobent le but à tout instant et les mettent continuellement aux prises avec des difficultés nouvelles. Ils sont d’avance, convaincus que tout travail suivi mène à coup sûr à un résultat. Ce résultat sera positif ou négatif, peu leur importe. Ils se sont imposé la tâche de collectionner des vérités, et les vérités, de quelque ordre qu’elles soient, profiteront toujours à la science. Si quelqu’un coordonne toutes ces abstractions et parvient à en tirer une application vraiment pratique, on ne l’appellera pas un savant, ce sera un inventeur…
À PROPOS DES AUTEURS
Antoine Bréguet, né à Paris le 26 janvier 18511 et mort à Paris 1er le 8 juillet 18822, est un physicien français.
Lazare Weiller est un industriel et homme politique français né à Sélestat (Bas-Rhin) le 20 juillet 1858 et mort à Territet (Suisse) le 12 août 1928.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La transmission de la parole et la suppression des distances.
La transmission de la parole et la suppression des distances
Histoire du phonographe, du microphone, et de l’aérophone
La transmission de la parole :
le phonographe, le microphone, l’aérophone{1}.
Les travaux scientifiques du Nouveau Monde présentent ce caractère spécial de toujours viser un but pratique et immédiat. Semblable au touriste traditionnel des Alpes, l’homme de science aux États-Unis marche droit vers le sommet qu’il s’est promis d’atteindre. Les détails de la route ne l’intéressent pas ; il gravit la pente et ne regarde ni à droite ni à gauche. S’il arrive, il a fait une véritable conquête ; s’il ne réussit pas, comme il n’a rien vu en chemin, ses efforts ne profitent à personne. Cette tendance, qui se retrouve, quoiqu’à un moindre degré, en Angleterre, est en opposition directe avec celle des physiciens de notre vieux continent. Ceux-ci, la plupart du temps, ne fixent pas à leurs entreprises un terme bien déterminé, et la route la plus large, le chemin le plus court n’est pas toujours ce qui les séduit le plus. Ils préfèrent les sentiers les moins tracés, et ceux dont les détours sans fin leur dérobent le but à tout instant et les mettent continuellement aux prises avec des difficultés nouvelles. Ils sont d’avance, convaincus que tout travail suivi mène à coup sûr à un résultat. Ce résultat sera positif ou négatif, peu leur importe. Ils se sont imposé la tâche de collectionner des vérités, et les vérités, de quelque ordre qu’elles soient, profiteront toujours à la science. Si quelqu’un coordonne toutes ces abstractions et parvient à en tirer une application vraiment pratique, on ne l’appellera pas un savant, ce sera un inventeur. Les savants, si l’on donne à ce mot le sens qu’on lui prête en France, n’ont pas l’idée, ni même le désir, de faire une découverte qui puisse être d’une utilité générale et immédiate. Si par hasard ils se permettaient cette dérogation à leur ordre d’idées habituel, l’examen minutieux du premier phénomène qu’ils viendraient à rencontrer les attirerait en dehors de la route, et les absorberait souvent assez pour leur faire perdre de vue leur premier objectif. Rien ne leur échappe. Ils notent, commentent, publient les moindres circonstances et s’attachent à surprendre les lois les plus cachées et les plus modestes de la nature. Ce sont là des retards, soit. Mais ici aucun effort n’est stérile. Ceux qui voudront s’engager dans la même voie trouveront le chemin préparé, et pourront partir plus vite d’une limite moins reculée.
La cause déterminante de ces tendances opposées, chez les hommes de science des diverses nations, réside en partie dans la tradition, et beaucoup aussi dans les préjugés qui s’attachent à l’exploitation commerciale d’une découverte quelconque. Chez nous, si l’inventeur témoigne le plus profond respect pour le savant, celui-ci en retour ne professe pas, dans le fond de son cœur, une estime bien sincère à l’égard de l’inventeur. Depuis qu’il était disciple, le savant, même le moins rétribué, a toujours manifesté le dégoût le plus absolu pour ce qui touche à l’argent. Il lui semble honteux de chercher un bénéfice pécuniaire, un salaire, dans l’exploitation industrielle d’un principe qu’il a eu le bonheur de mettre au jour. Il livre généreusement ses idées à la foule, et se contente des récompenses toutes platoniques qu’il en peut retirer. De l’autre côté de la Manche, les manières de voir ne sont plus les mêmes, on trouve encore des savants, mais on rencontre aussi des savants inventeurs. Là, personne ne songe à reprocher à un homme d’accroître ses revenus par ses connaissances théoriques. Chaque Anglais est marchand, et ne peut mépriser celui qui exerce un commerce, quelle que soit la nature de ce commerce. La science n’est plus une noblesse, comme en France, comme en Allemagne ; c’est un état, un métier comme un autre.
Mais, ainsi que l’idée de noblesse implique d’une façon nécessaire celle d’une distinction entre concitoyens, les aspirations de l’homme de science tendent à marquer une séparation regrettable entre deux grandes classes de travailleurs. Si le savant mésestime le commerçant, celui-ci, soit par dépit, soit par une réaction instinctive, ne se sentira pas à son aise devant celui-là. Leurs rapports seront toujours empreints d’une certaine gêne qui, si elle n’empêche pas la science de profiter sincèrement d’une donnée industrielle, pourra faire que tel chef d’usine soit naturellement porté à affecter au moins peu de déférence pour les conceptions théoriques du savant. Le rôle de l’inventeur se trouve être justement de servir de trait d’union entre la science et l’industrie. Par son penchant à rechercher le côté pratique de toutes choses, l’inventeur saisit promptement ce qu’un principe en apparence abstrait peut receler de ressourcés précieuses. Aussitôt il se met à l’œuvre, aiguillonné par l’ambition bien légitime de produire au jour une création de son esprit, et aussi par l’espoir d’arriver à une découverte dont l’exploitation puisse lui amener la fortune. En résumé, le savant prépare le terrain et pose les premiers fondements, l’inventeur conçoit l’édifice, et l’industriel l’exécute.
En Angleterre, où ces distinctions dans les classes laborieuses sont moins tranchées qu’en France, on trouve souvent alliées dans le même esprit les qualités objectives d’un administrateur et les vues subjectives de l’homme de science. Mais ces facultés ne se confondent pas ; les unes et les autres ont leurs heures. On peut voir, à Londres, quelques riches commerçants se livrer, dans les loisirs que leur laisse leur office, à des recherches de science pure. Nous pourrions citer des noms. Il n’est pas rare d’en rencontrer qui s’occupent d’astronomie avec passion, et qui possèdent de magnifiques instruments d’observation.
Aux États-Unis, tout devient franchement un commerce. Si sur le continent nous avons trouvé des savants et en Angleterre des savants-inventeurs, dans le Nouveau Monde il n’y a guère que des inventeurs. Les traditions d’un peuple si jeune ne peuvent avoir de racines bien profondes, aussi ce qu’on pourrait appeler chez nous un noble préjugé n’a pas cours au-delà de l’Océan. L’idée de s’enrichir est dans tous les esprits. Il serait malaisé d’ailleurs de modifier cette tendance, qui est la conséquence naturelle de la faiblesse de l’instruction supérieure. La science n’a pas cherché à s’ériger en aristocratie ; elle s’est épuisée dans la création d’un enseignement professionnel disproportionné. La méthode américaine est l’inverse de la nôtre.
En France, en Allemagne, les écoles élémentaires sont des dépendances des grands centres d’enseignements, elles s’échauffent aux rayons de ces derniers. Aux États-Unis, au contraire, c’est l’école qui doit arriver assez haut pour mériter le titre d’université. L’idée semble peu logique ; c’est demander à une source d’arroser un sol placé au-dessus d’elle. Il en résulte une absence complète de haute culture intellectuelle. On sait bien où il faut s’adresser pour apprendre à gagner sa vie et à là rendre plus confortable ; niais où enseigne-t-on à apprendre ? Nulle part. Les esprits les plus distingués sont fatalement conduits, et c’est un effet naturel de l’enseignement national, à considérer la vérité comme un moyen et non pas comme un but. Sauf un certain nombre de physiologistes dont les travaux présentent le caractère des recherches de science pure, on ne rencontre que des inventeurs ou des ingénieurs. Existe-t-il une loi de physique ou de mécanique dont la découverte soit due à un Américain ? C’est que, dans ce pays, les résultats spéculatifs, quelque intéressants qu’ils puissent être, ne touchent personne. On veut des machines capables de gagner du temps et par conséquent de l’argent ; mais l’on ne regarde pas aux moyens. L’invention est-elle, exploitable, on organise une compagnie, on construit une usine et on vend. Si les acheteurs affluent, l’inventeur est un grand homme ; dans le cas contraire, il n’en est plus question.
I
Thomas Edison est peut-être l’exemple le plus frappant de notre époque d’un physicien prodigieusement fécond qui n’ait jamais tenté de recherches abstraites. Doté d’un riche laboratoire d’études par la Western Union Telegraph Company, la compagnie télégraphique la plus puissante des États-Unis, il est libre d’entreprendre, sous ces généreux auspices, les expériences les plus coûteuses. Sa subvention est pour ainsi dire illimitée ; il dispose donc de moyens matériels inconnus dans nos premières universités européennes. Et c’est à son seul mérite qu’il doit cette situation exceptionnelle.
Âgé de trente et un ans à peine, Edison a déjà produit plus que ce qu’on eût été en droit d’attendre d’une réunion d’inventeurs de premier ordre. Sa découverte, le phonographe, aurait largement suffi à illustrer son nom, si ses autres créations ne s’étaient déjà chargées de ce soin. Ce qui frappera certainement ceux qui nous suivront dans la présente étude, c’est que tout ce qui sort du laboratoire de Menlo-Park est en quelque sorte accompli. Comme Pallas sortit tout armée du cerveau de Jupiter, les appareils sortent tout conçus de la tête d’Edison. Graham Bell, qui n’est Américain que d’adoption, nous a fait assister à l’enfantement progressif de son téléphone, dans une communication adressée à la Telegraph Engineers society de Londres. Des tâtonnements d’Edison, nous ne savons rien. Il n’a pas le loisir de s’attarder à faire le récit de ses labeurs.. Le temps qu’il y consacrerait serait du temps perdu. Et pouvons-nous affirmer avec certitude qu’il ait passé par de bien longues recherches ? Pour avoir parcouru tant de chemin déjà, à un âge si peu avancé, on doit posséder une jambe solide et ne pas faire souvent de faux pas. On concevrait avec peine comment il aurait pu imaginer le quadruplex telegraph, l’électro-motographe, le relais à résistance variable, la plume électrique, le téléphone à graphite, le thermoscope, le phonographe et plusieurs appareils télégraphiques imprimeurs, s’il avait dû s’arrêter longtemps à chacune de ces conceptions.
Les productions d’Edison présentent un caractère de simplicité et d’intuition prodigieux. Toutes ses données pourraient être comprises par le premier venu. Il est inventeur d’instinct ; il a en lui le don d’imaginer au moment voulu la disposition convenable et souvent définitive. Par-dessus tout, il a la foi. Combien est grand le nombre de savants qui n’auraient même pas tenté l’expérience du phonographe ou du téléphone, convaincus d’avance que le résultat en serait négatif ! Edison et Bell ont eu le rare mérite d’avoir confiance, et l’expérience leur a donné raison de la manière la plus éclatante.
Nous avions annoncé, il y a déjà plus de six mois, qu’un appareil capable d’enregistrer les sons de la voix humaine était sur le point de faire son apparition. Cette prophétie, alors presque téméraire, s’est réalisée aujourd’hui. Plusieurs esprits distingués s’occupaient à la fois de trouver une solution de ce séduisant problème. C’est à l’Amérique que revient la gloire d’avoir présenté le premier phonographe, le seul encore pour le moment. Il est difficile de concevoir un appareil plus simple que celui d’Edison.





























