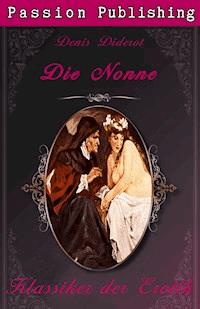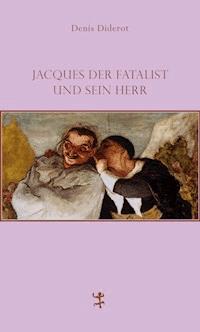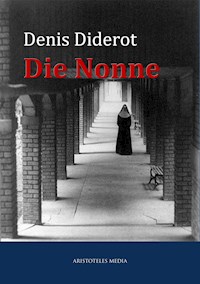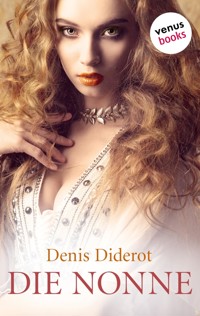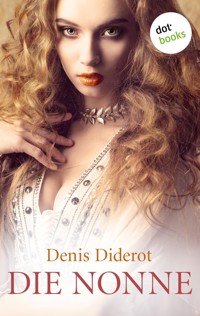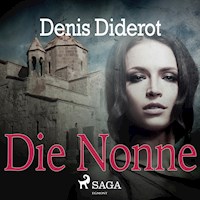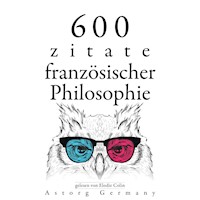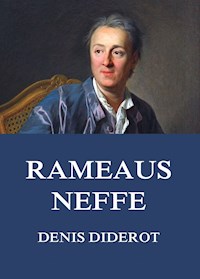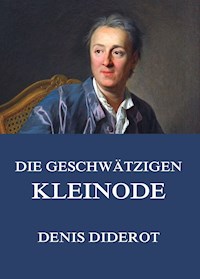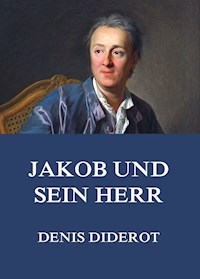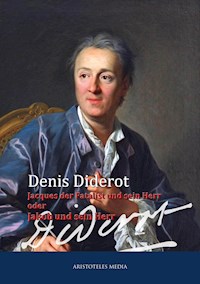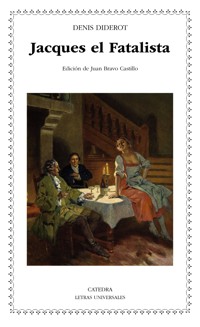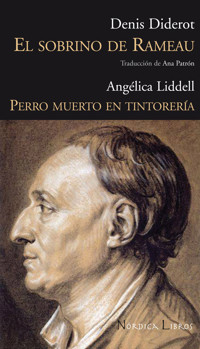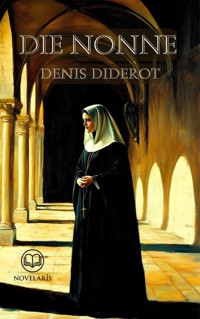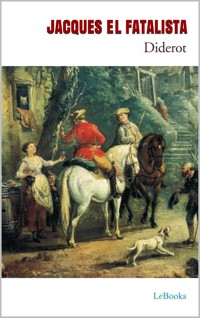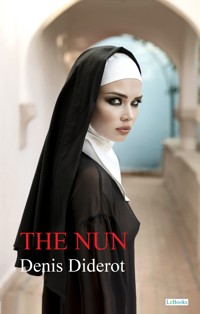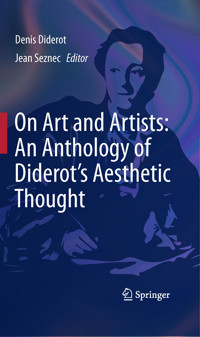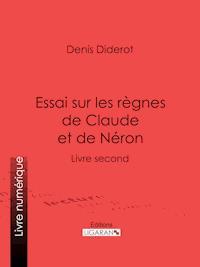
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les Lettres de Sénèque sont adressées à Lucilius, son ami, et son élève dans la philosophie stoïcienne : Lucilius, je vous réclame ; vous êtes mon ouvrage. Ils étaient âgés tous les deux ; Nous ne sommes plus jeunes. Lucilius, né dans une condition médiocre, s'était élevé par son mérite au rang de chevalier romain, et avait obtenu la place d'intendant en Sicile."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je vais parler des ouvrages de Sénèque sans prévention et sans partialité : usant avec lui d’un privilège dont il ne se départit avec aucun autre philosophe, j’oserai quelquefois le contredire. Quoique l’ordre, selon lequel le traducteur en a rangé les traités, ne soit pas celui de leur date, je m’y conformerai, parce que je ne vois aucun avantage à m’en éloigner. Cette courte analyse achèvera de dévoiler le fond de l’âme de Sénèque, le secret de sa vie privée, et les principes qui servaient de base à sa philosophie spéculative et pratique.
Je vais donc commencer par les Lettres, transportant dans l’une ce qu’il aura dit dans une autre, généralisant ses maximes, les restreignant, les commentant, les appliquant à ma manière, quelquefois les confirmant, quelquefois les réfutant ; ici, présentant au censeur le philosophe derrière lequel je me tiens caché ; là, faisant le rôle contraire, et m’offrant à des flèches qui ne blesseront que Sénèque caché derrière moi.
Les Lettres de Sénèque sont adressées à Lucilius, son ami, et son élève dans la philosophie stoïcienne : Lucilius, je vous réclame ; vous êtes mon ouvrage. Ils étaient âgés tous les deux : Nous ne sommes plus jeunes. Lucilius, né dans une condition médiocre, s’était élevé par son mérite au rang de chevalier romain, et avait obtenu la place d’intendant en Sicile.
La matière traitée dans cette correspondance, est très étendue : c’est presque un cours de morale complet ; je vais le suivre. Mais pour m’épargner à moi-même, et aux autres, la sécheresse et le dégoût d’une table, j’indiquerai, chemin faisant, quelques-uns des traits qui m’ont le plus frappé, ce que je voudrais avoir recueilli de ma lecture ; et surtout qu’on ne se persuade pas qu’il n’y ait rien ni à remarquer, ni à apprendre dans celles dont je n’annoncerai que le sujet. Lisez le reste de mon ouvrage comme vous liriez les pensées détachées de La Rochefoucauld.
La première est sur le temps : Sénèque dit, et ne dit que trop vrai, « qu’une partie de la vie se passe à mal faire, la plus grande à ne rien faire, presque entière à faire autre chose que ce qu’on devrait. »
« Où est l’homme qui sache apprécier le temps, compter les jours, et se rappeler qu’il meurt à chaque instant ? »
« Je me trouve dans le cas des gens ruinés sans qu’il y ait de leur faute ; tout le monde les excuse, personne ne les assiste. »
Il traite dans la deuxième des voyages.
« Le voyageur a beaucoup d’hôtes, et peu d’amis… » Il ressemble au possesseur d’un palais qui passerait sa vie à parcourir ses riches et vastes appartements, sans s’arrêter un instant dans celui que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses amis, ses concitoyens occupent.
Et dans la même, des lectures, autre sorte de voyages.
« Ne pouvant lire autant de livres que vous en pouvez acquérir, n’en acquérez qu’autant que vous en pourrez lire. »
« On lit pour se rendre habile : si on lisait pour se rendre meilleur, bientôt on deviendrait plus habile. »
« Si vous consultez la nature sur le travail et sur le repos, elle vous répondra qu’elle a fait le jour et la nuit. »
C’est là qu’il dit d’Épicure : « Je passe dans le camp ennemi en espion, mais non en déserteur. »
Si vous avez à faire choix d’un ami, lisez la troisième, où l’on trouve, entre autres, cette maxime de Pomponius :
« Il y a des yeux tellement accoutumés aux ténèbres, qu’ils voient trouble au grand jour. »
« Ne faites rien que votre ennemi ne puisse savoir. »
La quatrième vous affranchira des terreurs de la mort, et des sollicitudes de la vie.
« Le tyran me fera conduire, où ?… Où je vais. »
« Un mal n’est pas grand, quand il est le dernier des maux. La perte la moins à craindre est celle qui ne peut être suivie de regrets. »
« Celui qui ne veut que satisfaire à la faim, à la soif, aux besoins de la nature, ne se morfond point à la porte des grands, n’essuie ni leurs regards dédaigneux, ni leur politesse insultante. »
Frappez à cette porte pour autrui, n’y frappez jamais pour vous.
Dans la cinquième, sur la singularité, il adresse à Lucilius des conseils dont quelques-uns d’entre nous pourraient profiter.
« N’allez pas, à l’exemple de certains philosophes, moins curieux de faire des progrès que du bruit, affecter, dans votre extérieur, vos occupations, votre genre de vie, une originalité qui vous distingue : vous vous interdirez cet habillement bizarre, cette chevelure hérissée, cette barbe hétéroclite, et toutes ces voies détournées pour arriver à la considération. Eh ! le nom de philosophe n’est déjà que trop odieux, avec quelque modestie qu’on le porte ! – N’y aura-t-il donc aucune différence entre nous et le vulgaire ? – Il y en aura ; mais je veux qu’on y regarde de près pour l’apercevoir. »
« Il faut que la vie du sage soit un mélange de bonnes mœurs et de mœurs publiques… » Qu’en pense Diogène ? Celui-ci dirait à son élève : Que ta vie ne soit point un mélange bigarré de bonnes mœurs et de mœurs publiques… « Il faut qu’on l’admire, et qu’on s’y reconnaisse… » Il importe peu que des fous t’admirent ; et si le peuple se reconnaît en toi, ce sera presque toujours tant pis pour toi.
« Je n’aime à apprendre que pour enseigner. »
Je n’aime à apprendre que pour être moins ignorant… « La plus belle découverte cesserait de me plaire, si elle n’était que pour moi… » La découverte la plus simple, ne fût-elle que pour moi, me plairait encore. Ce n’est pas que je n’aime aussi à répandre le peu que je sais. Si le hasard m’offre une belle page ignorée, j’en jouis doublement, et par l’admiration qu’elle me cause, et par l’espoir de l’indiquer à mes amis.
« Philosophe, où en es-tu ?… » Heureux celui qui s’est fait cette question, et qui s’est répondu : Je commence à me réconcilier avec moi-même !
Voulez-vous savoir ce que c’est que la véritable amitié ? vous l’apprendrez dans la sixième.
« Combien d’hommes, dit-il, ont plutôt manqué d’amitié que d’amis !… » Le contraire ne serait-il pas aussi vrai ? et ne pourrait-on pas dire : Combien d’hommes ont plutôt manqué d’amis que d’amitié ?
L’amour est l’ivresse de l’homme adulte : l’amitié est la passion de la jeunesse ; c’est alors que j’étais lui, qu’il était moi. Ce n’était point un choix réfléchi ; je m’étais attaché je ne sais par quel instinct secret de la conformité. S’il eût été sage, je ne l’aurais pas aimé ; je ne l’aurais pas aimé, s’il eût été fou : il me le fallait sage ou fou de cette manière. J’éprouvais ses plaisirs, ses peines, ses goûts, ses aversions ; nous courions les mêmes hasards : s’il avait une fantaisie, j’étais surpris de ne l’avoir pas eue le premier ; dans l’attaque, dans la défense, jamais, jamais il ne nous vint en pensée d’examiner qui de nos adversaires ou de nous avait tort ou raison : nous n’avions qu’une bourse ; je n’étais indigent que quand il était pauvre. S’il eût été tenté d’un forfait, quel parti aurais-je pris ? Je l’ignore : j’aurais été déchiré de l’horreur de son projet, si j’en avais été frappé, et de la douleur de l’abandonner seul à son mauvais sort. Qu’est devenue cette manière d’exister si une, si violente et si douce ? À peine m’en souviens-je ; l’intérêt personnel l’a successivement affaiblie. Je suis vieux, et je m’avoue, non sans amertume et sans regret, qu’on a des liaisons d’habitude dans l’âge avancé ; mais qu’il ne reste en nous, à côté de nous, que le vain simulacre de l’amitié.
……. . Jam proximus ardet Ucalegon.
(Virgil. Æneid. lib. II, v 311 et 312.)
Cet Ucalégon du poète, c’est vous, c’est moi : on ne pense guère à la maison d’autrui, quand le feu est à la nôtre.
Ah ! les amis ! les amis ! il en est un ; ne compte fermement que sur celui-là : c’est celui dont tu as si longtemps et si souvent éprouvé la bienveillance et la perfidie ; qui t’a rendu tant de bons et de mauvais offices ; qui t’a donné tant de bons et de mauvais conseils ; qui t’a tenu tant de propos flatteurs, et adressé tant de vérités dures, et dont tu passes les journées à te louer et à te plaindre. Tu pourras survivre à tous les autres ; celui-ci ne t’abandonnera qu’à la mort : c’est toi ; tâche d’être ton meilleur ami.
« Le philosophe Attalus préférait un ami à faire à un ami déjà fait… » Un peintre célèbre court après un voleur, et lui offre un tableau fini pour l’ébauche que le voleur avait enlevée de dessus son chevalet. Il me déplaît qu’on en fasse autant en amitié.
J’ai vu l’amour, j’ai vu l’amitié héroïque ; le spectacle des deux amis m’a plus touché que celui des deux amants. D’un côté c’était la raison, de l’autre la passion, qui faisait de grandes choses ; l’homme et l’animal.
« Les présents de la fortune ? » Dites ses pièges.
Il conseille, Lettre VII, la fuite du monde. « Je ne rapporte jamais de la société les mœurs que j’y ai portées. »
Quel est celui d’entre nous assez sage, ou assez corrompu, qui n’en puisse dire autant ?
« Rien de plus nuisible aux bonnes mœurs que la fréquentation des spectacles… » Des spectacles de Rome, cela se peut ; des nôtres, je ne le crois pas.
À propos des spectacles de son temps, qui n’étaient que des exécutions, Sénèque dit : « Un homme a-t-il volé ? qu’on le pende. A-t-il assassiné ? qu’on le tue. Mais toi, malheureux spectateur, qu’as-tu fait pour assister à la potence ?… » Cela est beau.
« Il est dur de vivre sous la nécessité, mais il n’y a point de nécessité d’y vivre. »
« Arracher à Caton son poignard, c’est lui envier son immortalité. »
« La vertu a perdu de son prix pour celui qui se surfait celui de la vie. »
Malheur à celui que quelqu’une de ces pensées, que je jette au hasard à mesure que la lecture du philosophe me les offre, ne plongera pas dans la méditation !
« Rien de plus commun qu’un vieillard qui commence à vivre. » Rien de plus commun qu’un vieillard qui meurt avant que d’avoir vécu. La plupart des hommes meurent le hochet à la main.
« L’homme puissant craint autant de maux qu’il en peut faire… » D’où naît donc cet abus si fréquent de la puissance ? C’est que l’effet naturel de la force est d’inspirer l’audace, et que l’effet naturel du pouvoir est d’affaiblir la crainte.
« Le désespoir des esclaves immole autant d’hommes que les caprices des rois… » Je le désirerais.
« L’esclave a-t-il sur son maître le droit de vie et de mort ?… » Qui peut en douter ? Puissent tous ces malheureux enlevés, vendus, achetés, revendus, et condamnés au rôle de la bête de somme, en être un jour aussi fortement persuadés que moi !
Ici, il apostrophe les Romains ; il leur reproche d’enseigner la cruauté à leur souverain, qui ne saurait l’apprendre. Sénèque n’avait pas encore démêlé le caractère de son élève, et son commerce épistolaire avec Lucilius commença apparemment pendant les cinq premières années du règne de Néron.
« La route du précepte est longue, celle de l’exemple est courte. Les disciples de Socrate et d’Épicure profitèrent plus de leurs mœurs que de leurs discours… » (Lettre VI.) Il résulte de cette maxime, applicable surtout à l’éducation des enfants, qu’il faut leur adresser rarement de ces préceptes dont la vérité ne peut être constatée que par une longue expérience ; mais parlez sensément, agissez toujours bien devant eux. C’est ainsi que les Romains préparaient à la république des magistrats, des guerriers et des orateurs. Vous serez difficile sur la compagnie dans laquelle vous pourrez les admettre, si vous pensez qu’il y a tel mot, telle action, capable de détruire le fruit de plusieurs années.
Heureux les enfants nés de parents élevés aux grandes places ! ils entendent, dès le berceau, parler des grandes choses.
L’activité du sage est le sujet de la huitième.
Dans la neuvième, où il en caractérise l’amitié, il prétend qu’on refait aussi aisément un ami perdu, que Phidias une statue brisée. Je n’en crois rien. Quoi ! l’homme à qui je confierai mes pensées les plus secrètes, qui me soutiendra dans les pas glissants de la vie, qui me fortifiera par la sagesse de ses conseils et la continuité de son exemple ; qui sera le dépositaire de ma fortune, de ma liberté, de ma vie, de mon honneur ; sur les mœurs duquel les hommes seront autorisés à juger des miennes ; je dis plus, l’homme que je pourrai interroger sans crainte, dont je ne redouterai point la confidence ; dont, pour me servir de l’expression de génie du chancelier Bacon, j’oserai éclairer le fond de la caverne, sans sentir vaciller le flambeau dans ma main ; cet homme se refait en un jour, en un mois, en un an ! Eh ! malheureusement la durée de la vie y suffit à peine ; et c’est un fait bien connu des vieillards, qui aiment mieux rester seuls, que de s’occuper à retrouver un ami.
Lorsque notre philosophe se demande à lui-même ce qu’il s’est promis en prenant un ami ; et qu’il se répond : « D’avoir quelqu’un pour qui mourir, qui accompagner en exil, qui sauver aux dépens de mes jours… » il est grand, il est sublime ; mais il a changé d’avis.
Lorsque, comparant l’amour et l’amitié, il ajoute que l’amour est presque la folie de l’amitié, il est délicat. Lorsqu’il répond à la question : quelle sera la vie du sage sur une plage déserte, dans le fond d’un cachot ? celle de Jupiter dans la dissolution des mondes, il montre une âme forte. De pareilles idées ne viennent qu’à des hommes d’une trempe rare.
Il traite, dans la dixième, de la solitude.
« Cratès disait à un jeune homme : Que fais-tu là seul ? Le jeune homme lui répondit : Je m’entretiens avec moi-même. Prends garde, lui répliqua le philosophe, de t’entretenir avec un flatteur… » Le sot cesse d’être un sot pour le moment où il nous flatte, et nous dirions volontiers de lui : Mais cet homme n’est pourtant pas-trop bête.
« Vivez avec les hommes comme si les dieux vous voyaient ; parlez aux dieux comme si les hommes vous entendaient. »
Dans la onzième, des avantages de la vieillesse, de la mort, et du suicide.
La manière dont les habitants de sa campagne, son fermier, son jardinier, ses arbres, ses charmilles lui rappellent son grand âge, est charmante… « Qu’est-ce que cet homme qu’on a posté là, et qu’on ne tardera pas d’y exposer ? Où a-t-on trouvé ce squelette ? Le beau passe-temps de m’apporter ici les morts du voisinage ! – Quoi ! vous ne reconnaissez pas Félicion, le fils de votre métayer, à qui vous avez donné tant de jouets quand il était enfant ? »
Dans la douzième, des effets de la philosophie sur les défauts et sur les vices.
Dans la treizième, du courage que donne la vertu, et du dessouci de l’avenir.
« Le sage qui craint l’opinion, ressemble à un général qui s’ébranle à la vue d’un nuage de poussière élevé par un troupeau. »
« Espérer au lieu de craindre, c’est remplacer un mal par un autre. »
Dans la quatorzième, des soins du corps.
« Donnons-lui des soins, mais prêts à le précipiter dans les flammes, au moindre signal de la raison, de l’honneur, du devoir. »
« L’administration d’une république livrée à des brigands, n’est pas digne du sage… » Hommes publics, consolez-vous, si votre disgrâce est arrivée, ou si le mauvais génie de l’État veut qu’elle arrive.
« Le sage ne provoquera point le courroux des grands… » Maxime pusillanime : c’est le condamner à taire la vérité.
On dit : Vivre d’abord, ensuite philosopher… C’est le peuple qui parle ainsi. Mais le sage dit : Philosopher d’abord, et vivre ensuite, si l’on peut, ou aimer la vertu avant la vie.
Si le philosophe ne croyait pas que la périlleuse vérité qu’il va dire fructifiera dans l’avenir, il se tairait. Il parle en attendant un grand prince, un grand ministre qui exécute ; il aime la vertu, il la pratique : il fait peu de cas de la vie, il méprise la mort. Un d’entre eux disait : « La nature qui a fait le tyran terrible, m’a fait sans peur. » S’il peut conserver la vie en attaquant le vice, il le fera ; mais s’il est impossible de vivre, et de dire la vérité, il fera son métier. Quoi ! l’apôtre de la vérité n’aurait pas le même courage que l’apôtre du mensonge !
On ne fait point une tragédie de la mort de celui qui craint l’échafaud, et qui va lâchement apostasier au pied d’un tribunal. Il ignore que sa mort sera plus instructive que tous ses écrits.
« Le sage dans la prospérité me montre l’apôtre de la vertu ; dans l’adversité, son martyr. »
Pourquoi le sang du philosophe ne serait-il pas aussi fécond que celui des martyrs ? C’est qu’il est plus facile de croire que de bien faire.
« Il y a trois passions qu’il ne faut point exciter : la haine, l’envie, le mépris. »
Cela est plus digne du moine de Rabelais, que du disciple de Zénon. C’est vous, Sénèque, qui m’avez appris à vous répondre. Il y a des hommes dont il est glorieux d’être haï ; le tourment de l’envie est toujours un éloge ; le mépris n’est souvent qu’une affectation… « Craignons l’admiration… » Et pourquoi ? Faisons tout ce qui peut en mériter.
Il s’entretient avec son ami, Lettres XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, des exercices du corps, de l’utilité de la philosophie, de la richesse, de la pauvreté, des persécutions, de la calomnie ; qu’il faut embrasser la philosophie sans délai ; des amusements du sage, de la colère, des passions, des vices, des vertus, des avantages du repos, de la société, des fonctions publiques, du bonheur, du malheur.
« Le même mot peut sortir de la bouche d’un sage et d’un fou. »
« La sagesse, comme l’or, est l’équivalent de toute richesse. »
« La richesse est souvent la fin d’une misère, et le commencement d’une autre. »
« Le philosophe a son ennemi et sa discipline comme le militaire : pour vaincre, la bravoure seule ne suffit pas. »
On dit : Ce fait, de qui le tenez-vous ? « Ce témoin est suspect ; c’est son père, c’est son ami, c’est son collègue, c’est son protecteur, c’est son client… » Qui est-ce qui vous contredit ainsi ? C’est l’envie, l’envie que vous affligez par le récit d’une belle action.
Les préceptes de Sénèque sont austères ; mais l’expérience journalière et l’usage du monde en confirment la vérité : on ne les conteste que par la vanité ou par la faiblesse.
C’est dans sa Lettre XX qu’il dit aux grands, aux gens en place, un mot simple, mais qu’ils devraient avoir sans cesse à la bouche, s’ils sentaient vivement les inconvénients de leur élévation : « Quand viendra le jour heureux où l’on ne me mentira plus ? »
Je ne relis point les ouvrages de Sénèque sans m’apercevoir que je ne les ai point encore assez lus.
Quel est l’objet de la philosophie ? c’est de lier les hommes par un commerce d’idées, et par l’exercice d’une bienfaisance mutuelle.
La philosophie nous ordonne-t-elle de nous tourmenter ? Non.
Dans la Lettre vin, sur l’activité du sage, il parle des drames mixtes, dont le ton est grave, et le genre moyen entre la tragédie et la comédie. Ce genre eut-il aussi des détracteurs chez les Anciens ? Il ne le dit pas.
Selon lui, Lettre XIV, « la philosophie est une espèce de sacerdoce révéré des gens de bien, respecté même de ceux qui ne sont méchants qu’à demi ; et celui qui jette de la boue au philosophe, est une espèce d’impie. » Non, non, Suilius, Aristophanes modernes, jamais la dépravation ne sera assez générale, assez durable, assez puissante, ou la ligue de l’ignorance et du vice contre la science et la vertu assez forte, pour empêcher la philosophie d’être vénérable et sacrée.
Ne nous engageons point dans les querelles. Méprisons les propos de l’impudent ; soyons convaincus qu’il n’y a que des hommes abjects qui osent nous insulter. Ne soyons pas plus offensés de leurs injures, que nous ne serions flattés de leur éloge ; abandonnons le pervers à sa honte secrète.
– Est-ce qu’il en éprouve ?
– Je le crois, depuis qu’un de ces infâmes salariés des grands pour déchirer les gens de bien, a dit d’une satire de commande, qu’il n’était pas bien sûr d’être content de l’avoir faite. Un des châtiments de la folie est de se déplaire à elle-même.
L’ouvrage de Sénèque est un champ où l’on trouve toujours à glaner. Je vois que dans l’opulence il s’exerçait à la pauvreté ; au milieu des richesses, il se rit de la peine inutile que la fortune s’est donnée.
« Dieux, accordez-moi la sagesse, et je vous tiens quittes du reste… » Mais, Sénèque, dans votre système, est-ce que les dieux accordent la sagesse ? La sagesse n’est-elle pas l’ouvrage du sage ? Et n’est-ce pas la raison pour laquelle, dans votre enthousiasme, vous avez élevé quelquefois le sage au-dessus des dieux, sages par leur nature, sans efforts et sans mérite ?
Dans les pensées de Sénèque les plus subtiles, dans ses opinions les plus paradoxales, il y a presque toujours un côté juste.
Comme il n’y a presque aucune proposition sur les mœurs qui soit vraie sans exception, il arrive souvent au moraliste d’assurer le pour et le contre ; selon qu’il se renferme dans la loi générale, ou qu’il ne considère qu’un cas particulier, l’homme lui paraîtra grand ou petit.
Il dit, Lettre XXI, à propos de la vraie gloire du sage : « En vain Atticus aurait eu pour gendre Agrippa, pour descendants Tibère et Drusus ; parmi ces noms illustres le sien serait ignoré, si le prince des orateurs ne lui eût adressé quelques lettres. Lucilius, si la gloire vous touche, les miennes vous feront plus connaître que toutes vos dignités : qui saurait qu’il exista un Idoménée sans celles d’Épicure ? »
Il ajoute : « J’ai aussi quelques droits sur les races futures ; je puis sauver un nom de l’oubli, et partager mon immortalité avec un ami… » Qu’on doit être heureux par cette pensée ! En effet, quoi de plus doux que de croire qu’on enrichira sa nation d’un grand nom de plus ? Ne se félicite-t-on pas d’avoir pris naissance dans une contrée célèbre par les hommes rares qu’elle a produits ? Est-il de plus flatteuse espérance que de laisser à ses parents, à ses amis, à ses descendants, aux étrangers, aux siens, à l’univers, un sujet d’admiration, d’entretien et de regrets ? Qui est-ce qui a fait cet ouvrage, ce poème, ce tableau, cette statue, cette colonnade ? C’est un Français, c’est Bouchardon, c’est Pigalle ; c’était l’ami de mon grand-père, voilà son buste. Avec quel plaisir mon père, qui l’avait vu dans sa jeunesse, nous entretenait de son maintien, de son caractère et de ses opinions ! Voilà la maison qu’il habitait, on la visite encore. La république a doté une de ses arrière-nièces ; un citoyen bienfaisant tira de l’indigence un de ses descendants, qui n’avait d’autre mérite que de porter son nom. Malheur à l’homme personnel qui lira cette page avec dédain ! Si par hasard c’est un artiste distingué, croyez qu’il n’est sincère ni avec vous ni avec lui-même.
Une sorte de reconnaissance délicate s’unit à une curiosité digne d’éloge, pour nous intéresser à l’histoire privée de ceux dont nous admirons les ouvrages. Le lieu de leur naissance, leur éducation, leur caractère, la date de leurs productions, l’accueil qu’elles reçurent dans le temps, leurs penchants, leurs goûts honnêtes ou malhonnêtes, leurs amitiés, leurs fantaisies, leurs travers, leur forme extérieure, les traits de leur visage, tout ce qui les concerne, arrête l’attention de la postérité. Nous aimons à visiter leurs demeures, nous éprouverions une douce émotion à l’ombre d’un arbre sous lequel ils se seraient reposés ; nous voudrions voir et converser avec les sages dont les travaux ont augmenté le pouvoir de la vertu et les trésors de la vérité. Sans ce tribut, la sagesse accumulée des siècles serait un don gratuitement accordé à des ingrats.
« Mes concitoyens ne m’ont point élevé aux honneurs ; Idoménée, ils ont mieux fait, ils m’en ont ôté le désir… » Ce mot est d’Épicure.
Notre stoïcien, conduit à la porte des jardins de ce philosophe, y grave une inscription qui atteste l’austérité de l’un, et l’impartialité de l’autre. La voici :
« Passant, tu peux t’arrêter ici ; la volupté y donne la loi.
Quoi ! c’est de la farine détrempée que tu me présentes, c’est d’eau que tu remplis ma coupe !
– Assurément ; à ma table, les mets apaisent la faim, la boisson n’irrite pas la soif : voilà ma volupté. »
« Agissez toujours, Lucilius, comme si Épicure vous regardait. »
C’est ainsi que Sénèque pensait de ce philosophe, si mal connu, et tant calomnié. On ne s’est pas acharné avec moins de fureur sur la doctrine d’Épicure, que sur les mœurs de Sénèque.
Je lis dans un auteur moderne : « On oppose Sénèque comme un bouclier impénétrable à tous les traits qu’on peut lancer sur Épicure. Il est vrai que l’apologie que Sénèque a faite d’Épicure est formelle ; mais il est à craindre que, loin de justifier l’un, elle ne donne des soupçons contre l’autre. Si, à l’honneur d’Épicure, leurs doctrines avaient des apparences communes, ce serait à la honte de Zénon. »
Lorsque Sénèque fait l’éloge d’Épicure, il ne décrie point Zénon, non plus qu’il ne préconise celui-ci, lorsqu’il attaque le premier. C’est un juge impartial qui pèse ce que chaque secte enseigne de contraire ou de conforme à la vérité, et qui s’en explique avec franchise. Si les talents sublimes et les vertus transcendantes de l’académicien des Inscriptions, qui a enrichi l’histoire critique de la philosophie de son examen de la vie et de la doctrine d’Épicure, ne m’étaient parfaitement connus, je penserais qu’un auteur qui se sert de l’éloge de l’une des écoles pour les rendre toutes deux suspectes, est un mauvais logicien, s’il pense ce qu’il écrit, ou un dangereux hypocrite, s’il écrit ce qu’il ne pense pas.
Un littérateur du jour aurait-il la vanité de se croire mieux instruit des sentiments d’Épicure, dont les ouvrages nous manquent, qu’un ancien philosophe, qu’un Sénèque, qui les avait sous les yeux ?
Qu’Épicure et Zénon se soient accordés l’un et l’autre à regarder la vertu comme le plus essentiel de tous les biens, et qu’ils en aient eu les mêmes idées, que s’ensuit-il ? que l’épicurien n’en était pas moins corrompu, et que le stoïcien en était peut-être moins sage ? Voilà une étrange conclusion.
Eh ! c’est bien assez de condamner Épicure, sans lui associer aussi lestement le philosophe Sénèque, son apologiste ; Sénèque, que saint Jérôme, qui n’était pas le plus tolérant des Pères de l’Église, loue pour la pureté de sa morale, la sainteté de sa vie, et qu’il a inscrit dans le catalogue des auteurs sacrés.
« Ô Dieu, je vois à tes côtés un Sénèque à qui tu rends le prix du sang qu’il eût versé pour toi ; un Épictète qui te chérit dans les fers ; un Antonin qui ne te méconnut pas sur le trône : j’y vois un Tite qui regrettait les instants où il avait négligé de faire du bien aux hommes ; un Aristide qui honora la pauvreté, et qui préféra le nom de juste aux honneurs et aux richesses ; un Régulus qui sourit aux bourreaux ; et je vois loin de toi des barbares qui, la croix à la main, assouvissent leurs fureurs, et réussiraient à te faire haïr, si l’homme vertueux pouvait t’imputer leurs atrocités… » Ces lignes énergiques ne sont pas de moi ; mais je les envie à l’auteur anonyme d’un Éloge de Socrate.
Sénèque ne ferme presque pas une de ses Lettres sans la sceller de quelques maximes d’Épicure ; et ces maximes sont toujours d’un grand sens, et d’une sagesse merveilleuse : quelle honte pour le zénonisme !
C’est dans la Lettre XXII sur les conseils et sur les affaires, que Sénèque dit des goûts passagers de l’ambition : « C’est un amant qui querelle avec sa maîtresse ; n’allez pas prendre un moment d’humeur pour une rupture. » Croit-on que cette pensée déparât celles de La Rochefoucauld ? Il ajoute : « Nous mourons plus mauvais que nous ne naissons. Je t’avais engendré, nous dit la nature, sans désirs, sans crainte, sans superstition, sans perfidie, sans vice… Cela est-il bien vrai ?… Retourne comme tu es venu. La vie nous corrompt. »
« Vicieux, je te condamne à quitter ou le vice ou la vie. Choisis. »
En parcourant les Lettres XXIII et XXIV sur la philosophie, source des vrais plaisirs, sur le passé, le présent, le futur, les craintes de l’avenir, les terreurs de la mort, je me suis rappelé l’endroit où Horace recommande au poète la lecture des feuillets de Socrate : on pourrait lui dire avec plus de raison encore :
Rem tibi Senecæ poterunt ostendere chartæ.
(Horat. de Arte poet., v 354.)
Si tu crains d’être un poète exsangue, un diseur de puérilités sonores ; si tu veux connaître les vices, les vertus, les passions, les devoirs de l’homme dans toutes les conditions et les circonstances, lis Sénèque.
Homme pusillanime, si les deux grands fantômes, la douleur et la mort, t’effrayent, lis Sénèque.
« Que veulent dire ces fouets armés de pointes aiguës, ces chevalets, cet attirail de supplices ? Quoi ! ce n’est que de la douleur ! Ce n’est rien, ou elle finira promptement. À quoi bon ces glaives, ces feux, ces bourreaux qui frémissent autour de moi ? Quoi ! ce n’est que la mort ! Mon esclave la bravait hier. »
Il s’occupe, Lettre XXV, des dangers de la solitude : si l’homme se retire dans la forêt par vanité ou par misanthropie, s’il y porte une âme pleine de fiel, il ne tardera pas à y devenir une bête féroce ; celui dont il y prendra conseil, est un méchant qui achèvera de le pervertir.
Tel homme se croit sage, tandis que sa folie sommeille.
C’est dans une des Lettres qui suivent qu’il dit au philosophe : « Que fais-tu là ?… » et que le philosophe lui répond : « Hélas ! couché dans une même vaste infirmerie, je m’entretiens avec les autres malades… » On est vraiment touché de cette modestie.
Il écrit, Lettres XXVI, XXVII, XXVIII et XXIX, des avantages de la vieillesse, de la vertu, du vrai bonheur, des voyages, des conseils indiscrets. On voit, dans cette dernière, qu’il y avait aussi à Rome des hommes pervers qu’on se plaisait à associer aux philosophes en général, dans le dessein cruel de souiller la pureté des uns par la turpitude des autres. Ce fait me rappelle l’auteur de l’Anti-Sénèque, et la constante affectation des ennemis de la philosophie à le citer parmi les hommes sages et éclairés, dont la vie se passe à chercher la vérité, et à pratiquer la vertu. Si ces calomniateurs des gens de bien n’étaient pas étrangers à tout sentiment honnête, ils rougiraient de placer ce nom justement décrié, à côté des noms les plus respectables et les plus respectés.
La Mettrie est un auteur sans jugement, qui a parlé de la doctrine de Sénèque sans la connaître ; qui lui a supposé toute l’âpreté du stoïcisme, ce qui est faux ; qui n’a pas écrit une seule bonne ligne dans son Traité du Bonheur, qu’il ne l’ait ou prise dans notre philosophe, ou rencontrée par hasard, ce qui n’est et ne pouvait malheureusement être que très rare ; qui confond partout les peines du sage avec les tourments du méchant, les inconvénients légers de la science avec les suites funestes de l’ignorance : dont on reconnaît la frivolité de l’esprit dans ce qu’il dit, et la corruption du cœur dans ce qu’il n’ose dire ; qui prononce ici que l’homme est pervers par sa nature, et qui fait, ailleurs, de la nature des êtres, la règle de leurs devoirs, et la source de leur félicité ; qui semble s’occuper à tranquilliser le scélérat dans le crime, le corrompu dans ses vices ; dont les sophismes grossiers, mais dangereux par la gaîté dont il les assaisonne, décèlent un écrivain qui n’a pas les premières idées des vrais fondements de la morale, de cet arbre immense dont la tête touche aux cieux et les racines pénètrent jusqu’aux enfers, où tout est lié, où la pudeur, la décence, la politesse, les vertus les plus légères, s’il en est de telles, sont attachées comme la feuille au rameau, qu’on déshonore en l’en dépouillant ; dont le chaos de raison et d’extravagance ne peut être regardé sans dégoût que par ces lecteurs futiles qui confondent la plaisanterie avec l’évidence, et à qui l’on a tout prouvé, quand on les a fait rire ; dont les principes, poussés jusqu’à leurs dernières conséquences, renverseraient la législation, dispenseraient les parents de l’éducation de leurs enfants, renfermeraient aux Petites-Maisons l’homme courageux qui lutte sottement contre ses penchants déréglés, assureraient l’immortalité au méchant qui s’abandonnerait sans remords aux siens ; et dont la tête est si troublée, et les idées sont à tel point décousues, que, dans la même page, une assertion sensée est heurtée par une assertion folle, et une assertion folle par une assertion sensée ; en sorte qu’il est aussi facile de le défendre que de l’attaquer. La Mettrie, dissolu, impudent, bouffon, flatteur, était fait pour la vie des cours et la faveur des grands. Il est mort comme il devait mourir, victime de son intempérance et de sa folie ; il s’est tué par ignorance de l’art qu’il professait.
Je n’accorde le titre de philosophe qu’à celui qui s’exerce constamment à la recherche de la vérité et à la pratique de la vertu ; et lorsque je rayerai de ce nombre un homme corrompu dans ses mœurs et ses opinions, puis-je me promettre que les ennemis de la philosophie se tairont ? Non.
Voltaire, diront-ils, en a fait l’éloge. Il s’agit bien de ce que Voltaire en aura dit dans une ode anacréontique ! mais de ce qu’un homme de bien en doit penser d’après ses écrits qui sont entre nos mains et d’après les mœurs qu’il professait.
J’admire Voltaire comme un des hommes les plus étonnants qui aient encore paru, et c’est de très bonne foi que je le publie ; mais je ne suis pas toujours de son avis, et ce ne sera pas dans une pièce de poésie fugitive que j’irai chercher le sentiment de Voltaire, et moins encore puiser le mien sur la philosophie et la morale d’un écrivain.
Dans la même Lettre, Sénèque cite un beau mot d’Épicure sur les jugements populaires. « Jamais je n’ai voulu plaire au peuple : ce que je sais n’est pas de son goût ; et ce qui serait de son goût, je ne le sais pas. »
La contrainte des gouvernements despotiques rétrécit l’esprit sans qu’on s’en aperçoive : machinalement on s’interdit une certaine classe d’idées fortes, comme on s’éloigne d’un obstacle qui nous blesserait ; et lorsqu’on s’est accoutumé à cette marche pusillanime et circonspecte, on revient difficilement à une marche audacieuse et franche. On ne pense, on ne parle avec force que du fond de son tombeau ; c’est là qu’il faut se placer, c’est de là qu’il faut s’adresser aux hommes. Celui qui conseilla au philosophe de laisser un testament de mort, eut une idée utile et grande. Je souhaite pour le progrès des sciences, pour l’honneur des académies, pour le bonheur de ses amis et pour l’intérêt du malheureux, qu’il nous fasse attendre le sien longtemps.
« À Paris, diriez-vous cela ?
– Non. Je me suis trouvé l’âme d’un homme libre dans la contrée qu’on appelle des esclaves, et l’âme d’un esclave dans la contrée qu’on appelle des hommes libres.
– Jusqu’à présent je n’ai rien entendu de vous qui m’ait fait autant de plaisir. »
C’est la fin d’une conversation dans le cabinet d’une grande souveraine.
Lisez la Lettre XXX, de la mort et de la nécessité de l’attendre de pied ferme ; et vous me direz ensuite ce qu’il y a de nouveau sur ce sujet dans nos écrivains modernes. Quoi de plus délicat que ce mot : « L’âme s’échappe du vieillard sans effort ; elle est sur le bord de sa lèvre… ? » Quoi de plus sensé que ce qui suit : « Qu’est-ce que ces noms d’empereur, de sénateur, de questeur, de chevalier, d’affranchi, d’esclave… ? » ou en style moderne, de rois, de grands, de nobles, de roturiers, de paysans ? « Ce que c’est ? répond-il, Lettre XXXI, des titres inventés pour enorgueillir les uns et dégrader les autres. N’avons-nous pas tous le ciel au-dessus de nos têtes ! »
Il vous exhortera à la philosophie, Lettre XXXII ; il vous dira, Lettre XXXIII, que, dans un ouvrage de l’art, il faut que la beauté de l’ensemble fixant le premier coup d’œil, on n’aperçoive pas les détails ; et que, dans un ouvrage de philosophie ou de littérature, les beaux vers, les sentences sont les dernières choses à louer.
Il encourage Lucilius à l’étude de la philosophie, Lettre XXXIV, et le félicite sur ses progrès. Il prouve, Lettre XXXV, qu’il ne peut y avoir d’amitié qu’entre les gens de bien. La mort d’un ami ravit à l’homme vertueux un témoin de ses vertus ; au méchant, un complice, peut-être indiscret, de ses crimes. Les avantages du repos, les vœux du vulgaire, le mépris de la mort, texte auquel il ne se lasse point de revenir ; le courage que donne la philosophie, les dangers de la prospérité, l’éloquence qui convient au sage, la voix de la divinité qui est en nous, ou la conscience, la rareté des gens de bien l’occupent depuis la Lettre XXXVI jusqu’à la Lettre LI.
Voici un paragraphe de la Lettre XLI : je le trouve si beau, que je ne puis m’empêcher de le transcrire. « S’il s’offre à vos regards une vaste forêt, peuplée d’arbres antiques, dont les cimes montent jusqu’aux nues et dont les rameaux entrelacés vous dérobent l’aspect du ciel, cette hauteur démesurée, ce silence profond, ces masses d’ombres que la distance épaissit et rend continues, tant de signes ne vous intiment-ils pas la présence d’un Dieu ? Sur un antre creusé dans un énorme rocher, s’il s’élève une montagne, cette profonde, immense, obscure cavité ne vous frappera-t-elle pas d’une terreur religieuse ? L’éruption d’un fleuve souterrain a fait dresser des autels ; les fontaines d’eaux thermales ont un culte ; l’opacité de certains lacs les a rendus sacrés. Et lorsque vous rencontrerez un homme tranquille dans le péril, serein dans l’adversité, intrépide au sein des orages, qui, placé sur la ligne des dieux, voit les faibles mortels sous ses pieds, le respect n’inclinera pas votre front ?… Pour être descendu du ciel, le sage ne s’est pas expatrié. Les rayons du soleil qui se répandent sur la terre tiennent au globe lumineux d’où ils sont élancés ; ainsi l’âme du grand homme, de l’homme vertueux, envoyée d’en haut pour nous montrer la divinité de plus près, séjourne à nos côtés sans oublier le lieu de son origine. Elle le regarde, elle y aspire, elle y reste comme attachée… » Telles sont les pointes de Sénèque, lorsqu’il parle de Dieu, de la vertu et de l’homme vertueux.
Il dit à Lucilius, Lettre XXXVI : « On blâme votre ami d’avoir embrassé le repos, abandonné ses places et préféré l’obscurité de la retraite aux nouveaux honneurs qui l’attendaient. Exhortez-le à se mettre au-dessus de l’opinion : chaque jour il fera sentir à ses censeurs qu’il a choisi le parti le plus avantageux… » Pour lui, peut-être ; mais pour la société ? Il y a dans le stoïcisme un esprit monacal qui me déplaît ; c’est cependant une philosophie à porter à la cour, près des grands, dans l’exercice des fonctions publiques, ou c’est une voix perdue qui crie dans le désert. J’aime le sage en évidence, comme l’athlète sur l’arène : l’homme fort ne se reconnaît que dans les occasions où il y a de la force à montrer. Ce célèbre danseur qui déployait ses membres sur la scène avec tant de légèreté, de noblesse et de grâces, n’était dans la rue qu’un homme dont vous n’eussiez jamais deviné le rare talent.